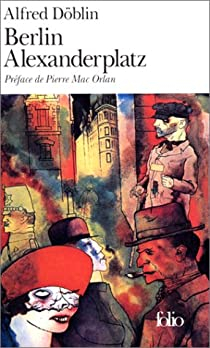>
Critique de bobbysands
Mon propos, peut-être assez long mais le but est d'essayer de vous inciter à lire ce livre alors je me lance :
Et nous voici plongé dans le Berlin de l'entre-deux guerres en pleine république de Weimar, un Berlin sombre et sans espoir, le Berlin des bas-fonds. J'ai essayé une première fois d'entamer la bête de 612 pages et au bout de 50 pages, ne comprenant absolument rien à ce que je lisais, j'abandonnais mollement, et replaçait l'ouvrage dans la bibliothèque de mon salon, au rayon des mystérieux objets (entre Knut Hamsun et le Jan Potocki). A ce moment, lire ce genre de livre pour moi, revenait à regarder Canal + en crypté. Je laissais donc le livre de côté, persuadé que la traduction ne me permettait pas de rentrer dans le délire de son auteur.
Pourtant, l'objet littéraire reste séduisant et crâneur du haut de son étagère. Structure énigmatique, titres des chapitres loufoques, contexte urbain oppressant, à mi-chemin entre le suffocant Saint-Pétersbourg Dostoïevskien et le Paris glauque de Céline et surtout, et surtout, le style … particulier !
La comparaison avec Céline se fait naturellement. Roman Urbain, noir, anti-héros pathétiques, style elliptique. Berlin Alexanderplatz serait clairement le Voyage allemand si ce dernier n'avait pas été écrit 4 ans avant. Ultime comparaison : les auteurs sont tous deux médecins.
Pour comprendre POURQUOI, il faut lire Berlin Alexanderplatz, il faut en fait comprendre comment lire.
Alors comment lire Berlin Alexanderplatz ?
Tout d'abord, et toujours d'ailleurs, recontextualiser l'oeuvre dans l'histoire de la littérature. Döblin est un contemporain de Céline. James Joyce et Marcel Proust ont déjà frappé fort en termes d'innovations stylistiques et une guerre mondiale est venu choc-post-traumatiser bon nombre de petit génie de notre élite littéraire (Céline et Döblin). Les 30 premières années de notre siècle, d'un point de vue littéraire, mettent à disposition une ressource illimitée de sujet d'étude : appauvrissement, déshumanisation, désillusion de l'industrialisation mais aussi de possibilité infinie d'innovation stylistiques. Les deux maîtres Stylistes que furent Proust et Joyce font voler en éclat le classicisme du 19ème et réinvente la littérature faisant du « style » leur terrain de jeu illimité. Ils ouvrent une parenthèse que refermeront Céline … et Döblin. Je dirai, la parenthèse des « stylistes » ou celle de la littérature impressionniste. Il ne s'agit pas comme Zola, Balzac, Hugo et bien d'autres de recréer un cadre historique ou de décrire méticuleusement l'ambiance, comme on ferait une peinture réaliste d'un objet. Il s'agit maintenant, d'implémenter dans l'esprit et la moëlle épinière du lecteur, une mémoire sensorielle, une nostalgie, de quelque chose qu'il n'a pas connu : Les repas interminables de l'aristocratie pour Proust, l'allégorique et absurde Dublin de Joyce, le traumatisme post-apocalyptique de la Grande Guerre de Céline et enfin les bas-fonds et le banditisme de Döblin. L'outil de cette implémentation est le style. Et les écrivains dont je parle sont des stylistes. Ils vont, par leur style, faire naître en nous une impression. On retrouve ici le procédé utilisé par Dostoïevski, auteur vénéré par les auteurs cités, quand il implémente à l'aide d'une écriture instantanée et brouillonne, l'idée de folie dans l'esprit de son lecteur. A bien y réfléchir, on pourrait même parler d'un courant littéraire : les stylistes. (D'ailleurs, petites digressions qui justifiera mon appellation, ils termineront tous emportés par leur obsession pour le style : Proust écrivant la plus longue phrase dans le plus long roman du monde qui s'achèvera d'ailleurs après sa mort, Joyce passant dans un monde parallèle avec son dément Fannigan's bar (900 pages) qu'il mit 17 ans à écrire et affirmant modestement qu'il faut 17 ans pour le déchiffrer (à mon avis, plus), Céline qui avec son alambiqué et franchement bizarre Guignol's Band (700 pages), nous offre une des tranches les plus apocalyptiques de la littérature. BREF : le style n'est plus un moyen, c'est une fin en soi ! le fond n'est qu'un prétexte pour la forme)
Je n'ai pas encore répondu à la question ! Comment lire Berlin Alexanderplatz ? Eh bien tout d'abord - entrainement difficile guerre facile - il peut être bon de s'être frotter aux plus durs. Je veux dire par là d'être aller faire ses armes face à un tome de la Recherche de Proust ou un chapitre de l'Ulysse de Joyce (à peu près intelligible). On se rendra compte que Céline et Döblin ne sont pas si inabordables qu'on ne se l'imagine. Ensuite, nos crocs acérés, on peut s'attaquer à la pièce dont on parle aujourd'hui : Berlin Alexanderplatz. Certes, le style, phrase par phrase n'est pas franchement ragoutant mais on distingue la forme d'une narration. On distingue la polyphonie, on comprend qui parle, qui pense, quand intervient l'auteur etc. On peut donc décrypter, globalement l'action qui se déroule et ainsi, avancer, ou plutôt creuser, à travers les différentes couches que sont les niveaux de lecture. Ne vous inquiétez surtout pas si vous avez l'impression de ne pas saisir tel morceau de phrase, tel paragraphe complètement hors sujet. L'auteur se fout un peu de vous, alors ne vous laisser pas intimider et suivez le dans sa folie, comme Alice suivit le lapin. C'est bien pour ça que vous avez ouvert ce livre non ? Alors en avant.
Après plusieurs pages, on discerne mieux le projet. L'auteur force notre adhésion : Soit nous abandonnons et refermons le livre (ce que je fis la première fois), soit nous y allons « à fond » et nous descendons dans les bas-fonds. Nous ne les regardons pas de notre fenêtre, depuis notre appartement embourgeoisé, nous descendons, mouchoir sur le nez, à travers l'odeur putride des bars infâmes (surement les équivalents de nos PMU), à travers les ruelles sordides d'une ville au bord du précipice. C'est un choix, donc, au service duquel le style va se mettre : nous rendre au mieux l'impression de bassesse, sans distinguer la narration du narré. Un peu lourd, dirons les plus réticents, ceux qui ont quand même réussi à passer outre l'obstacle de ce style ardu. Mais aucune inquiétude, l'auteur est talentueux. Il maîtrise l'emploi de son argot et l'utilise judicieusement pour décrire son objet et lui donner toute sa dégoutante splendeur. Des qualités évidemment toute céliniennes. Donc voilà comment lire, du moins aborder la lecture de Berlin Alexanderplatz en bravant l'épreuve du style (qui n'est que le premier des 12 travaux que vous aurez accomplis !). Pour en finir et pour conclure sur cette partie, je vous demande de voir le style comme un outils, qui s'apparente à une paire de lunettes 3D, grâce auxquelles vous verrez ce que l'auteur veux vous montrer : Berlin la sordide.
L'étude de ce sujet, Berlin, vu avec nos lunettes 3D nous est faites sous forme de visite guidée avec en guise de guide, Franz Biberkopf, une sorte de gros sac à, une sorte de personnage un peu pathétique, qu'on aime appeler antihéros.
Venons-en à l'analyse des niveaux de lecture qui vous permettra d'apercevoir une once de finalité dans cet objet littéraire non identifié. A la première lecture, nous en distinguons trois.
Le premier niveau de lecture des péripéties de Franz, est celui, classique, de la lecture d'une fresque urbaine, tout à fait romanesque. Une intrigue pleine de rebondissement, narrée avec entrain, une multitude de personnages, fort de leur caractère, un tourbillon de mésaventures toute plus dramatiques les unes que les autres. Pour ce niveau de lecture, vous serez servis : Prisons, viol, maltraitance des femmes, amitié, braquage, trahison, amputation, re-viol, meurtre, re-trahison, dépression, hôpital psychiatrique et fin à la 1984 d'Orwell, lobotomisation et vie minable. le Drame urbain par excellence, digne des plus grands des contemporains de Döblin. (Mais pourquoi les romans urbains sont-ils si déprimants ? L'homme n'est donc pas fait pour une vie urbaine ? Merde !)
Le deuxième niveau de lecture est évidemment la (fameuse) critique sociale. L'auteur, je le rappelle, est un médecin des quartiers populaire. Question misère sociale, il en connaît un rayon. Je dirais que sa période gauchiste se justifie pleinement (et pourtant, alléluia, il s'en émancipera). le roman est un hommage à tous ces petits, ces truands, ces putes, ces repentis éternellement jetés dans la spirale de la violence et de la perdition. Ceux qui essaient, mais n'y arrivent pas.
(Aux riches et instruits lecteurs … :) « Regardez ! Vous-autres qui savez lire de grands romans, et imaginez ce que vivent ces petits qui peuplent les quartiers mal famés. Regardez en face, Berlinois ! la face de votre ville minable. »
Mais plus malin encore, et moins populiste qu'on ne se l'imagine, Döblin tourne aussi son discours contre le peuple. Son héros, certes, n'est pas épargné par la malchance. du moins, c'est ce que nous affirme avec une fausse naïveté, la narration. En fait, avec un simple esprit critique, et fort de notre connaissance du bien et du mal, aucun évènement ne forcent notre héros à faire le mal, à violer sa belle-soeur pour retrouver sa libido, ni à s'acoquiné avec une bande de braqueurs ou d'admirer un assassin en puissance, manifestement violent.
(Aux petits … :) « et vous Arrêtez de vous lamenter ! arrêtez de promettre que vous ne retomberait pas dans le banditisme quand vous faites tout…, ou du moins quand vous ne faites rien pour empêcher que ça arrive ! »
Nous avons donc ce double discours de l'auteur qui pointe du doigt la responsabilité de chacun, y compris des plus petits, dans la misère de la capitale teutonne.
Enfin, dernier niveau de lecture, qui nous pousse à penser, une fois le livre refermé, qu'il faudra le relire plus attentivement ce chef d'oeuvre : religieux. Pour ne citer qu'une référence, je dirai celle du livre de Job, pleinement appropriée pour décrire la triste vie de notre universel Franz. L'oeuvre contient énormément de références, profanes et religieuses et nous rappellent en fait que Berlin Alexanderplatz est construit comme une parabole, ou du moins en apparence. Et c'est peut-être l'analyse la plus intéressante de l'oeuvre de Döblin, juif qui aura la riche idée de se convertir au catholicisme. Si Franz est un anti-héros, son histoire est une anti-parabole. Les paraboles, vous savez ? Ces petits textes d'une simplicité affligeante conclus par une petite morale que le Christ utilisait pour faire rentrer de grandes vérités dans les petits cerveaux de ses apôtre. « Un homme avait deux fils », « Un semeur sortit pour semer », « le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champs » … etc.
Döblin fait de même avec nos petits cerveaux. L'« histoire d'un bandit repentis, qui veut arrêter de faire le mal ». Il va « tout » faire pour y arriver, mais le monde étant trop dur, il butera à chaque nouvelle tentative et retombera dans le banditisme. Nous avons une sorte de contre-évangile, qui nous dit avec simplicité que tout n'est pas si simple. Et nous, apôtre d'un instant du maître Döblin, nous sommes partagés entre l'idée qu'effectivement, on ne peut juger un homme sans connaitre la dureté de sa vie et, en même temps, l'idée qu'on se moque un peu de nous dans cette affaire - tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise - Franz a eu ce qu'il méritait. Plusieurs personnes lui ont tendu la main et ce blaireau n'a jamais su écouter et n'en a fait qu'à sa tête pour finalement retomber dans le crime.
Double morale donc : soit on voit le texte comme une parabole et la morale est donc que la vie finit toujours par l'emporter sur les volontés de fer. Il donc faut se soumettre à sa destinée (même si celle-ci est noire) sans lutter contre ses passions, être cohérent. Soit on voit le texte comme une anti-parabole dont la morale est donc qu'il faut vraiment et sincèrement lutter, sans se cacher derrière de fausses résolutions, contre le mal qu'il y a en nous et ce dans chacune de nos actions, actions qui constituent le torrent de notre destinée. Si ces deux morales sont banales et sont complètement opposées, l'auteur adresse la première à notre conscience via la forme : (la narration naïve) et la seconde à notre subconscient via le fond (le contenu du récit). La première nous dit qu'il ne sert à rien de lutter dans un Berlin comme celui qui nous est présenté la seconde attend de nous que nous refusions cette démission, ce lâche abandon.
La fin est assez intéressante, notamment la dernière page ou notre héros est lobotomisé, vaincu. Son âme est morte. Il est comme emporté dans l'allégorie d'une marche guerrière et nationaliste qui se nourrit de ce genre de profil pour grossir et gagner en puissance. Cette marche guerrière résonne tout particulièrement quand on connaît la suite (et la fin ?) de l'Histoire Allemande.
Terminer Berlin Alexanderplatz procure avant tout le sentiment de fierté légitime d'avoir terrasser un monstre littéraire et d'en avoir extrait la substantifique moelle, aliment nécessaire aux muscles de notre cerveau, fatigués de l'inconsistance de la littérature contemporaine. Berlin Alexanderplatz est bien un challenge littéraire et comme toute épreuve, on en ressort plus clairvoyant, on en tire une conclusion qui perdurera tout au long de notre chemin sur cette terre. le pacte de lecture est respecté, Alfred Döblin réussit pleinement son effraction dans nos boites crânienne, pour y déposer un germe : sa vision de Berlin de 1928. Et ce germe grandira quand nous regarderons notre ville (Marseille, Paris, Bordeaux…), ses mouvements, ses bruits, ses odeurs, ses trognes à travers les yeux Döblinesques, et que nous sentirons dès lors cette nostalgie intense d'un Berlin que nous n'avons jamais connu, révolu à jamais.
Et nous voici plongé dans le Berlin de l'entre-deux guerres en pleine république de Weimar, un Berlin sombre et sans espoir, le Berlin des bas-fonds. J'ai essayé une première fois d'entamer la bête de 612 pages et au bout de 50 pages, ne comprenant absolument rien à ce que je lisais, j'abandonnais mollement, et replaçait l'ouvrage dans la bibliothèque de mon salon, au rayon des mystérieux objets (entre Knut Hamsun et le Jan Potocki). A ce moment, lire ce genre de livre pour moi, revenait à regarder Canal + en crypté. Je laissais donc le livre de côté, persuadé que la traduction ne me permettait pas de rentrer dans le délire de son auteur.
Pourtant, l'objet littéraire reste séduisant et crâneur du haut de son étagère. Structure énigmatique, titres des chapitres loufoques, contexte urbain oppressant, à mi-chemin entre le suffocant Saint-Pétersbourg Dostoïevskien et le Paris glauque de Céline et surtout, et surtout, le style … particulier !
La comparaison avec Céline se fait naturellement. Roman Urbain, noir, anti-héros pathétiques, style elliptique. Berlin Alexanderplatz serait clairement le Voyage allemand si ce dernier n'avait pas été écrit 4 ans avant. Ultime comparaison : les auteurs sont tous deux médecins.
Pour comprendre POURQUOI, il faut lire Berlin Alexanderplatz, il faut en fait comprendre comment lire.
Alors comment lire Berlin Alexanderplatz ?
Tout d'abord, et toujours d'ailleurs, recontextualiser l'oeuvre dans l'histoire de la littérature. Döblin est un contemporain de Céline. James Joyce et Marcel Proust ont déjà frappé fort en termes d'innovations stylistiques et une guerre mondiale est venu choc-post-traumatiser bon nombre de petit génie de notre élite littéraire (Céline et Döblin). Les 30 premières années de notre siècle, d'un point de vue littéraire, mettent à disposition une ressource illimitée de sujet d'étude : appauvrissement, déshumanisation, désillusion de l'industrialisation mais aussi de possibilité infinie d'innovation stylistiques. Les deux maîtres Stylistes que furent Proust et Joyce font voler en éclat le classicisme du 19ème et réinvente la littérature faisant du « style » leur terrain de jeu illimité. Ils ouvrent une parenthèse que refermeront Céline … et Döblin. Je dirai, la parenthèse des « stylistes » ou celle de la littérature impressionniste. Il ne s'agit pas comme Zola, Balzac, Hugo et bien d'autres de recréer un cadre historique ou de décrire méticuleusement l'ambiance, comme on ferait une peinture réaliste d'un objet. Il s'agit maintenant, d'implémenter dans l'esprit et la moëlle épinière du lecteur, une mémoire sensorielle, une nostalgie, de quelque chose qu'il n'a pas connu : Les repas interminables de l'aristocratie pour Proust, l'allégorique et absurde Dublin de Joyce, le traumatisme post-apocalyptique de la Grande Guerre de Céline et enfin les bas-fonds et le banditisme de Döblin. L'outil de cette implémentation est le style. Et les écrivains dont je parle sont des stylistes. Ils vont, par leur style, faire naître en nous une impression. On retrouve ici le procédé utilisé par Dostoïevski, auteur vénéré par les auteurs cités, quand il implémente à l'aide d'une écriture instantanée et brouillonne, l'idée de folie dans l'esprit de son lecteur. A bien y réfléchir, on pourrait même parler d'un courant littéraire : les stylistes. (D'ailleurs, petites digressions qui justifiera mon appellation, ils termineront tous emportés par leur obsession pour le style : Proust écrivant la plus longue phrase dans le plus long roman du monde qui s'achèvera d'ailleurs après sa mort, Joyce passant dans un monde parallèle avec son dément Fannigan's bar (900 pages) qu'il mit 17 ans à écrire et affirmant modestement qu'il faut 17 ans pour le déchiffrer (à mon avis, plus), Céline qui avec son alambiqué et franchement bizarre Guignol's Band (700 pages), nous offre une des tranches les plus apocalyptiques de la littérature. BREF : le style n'est plus un moyen, c'est une fin en soi ! le fond n'est qu'un prétexte pour la forme)
Je n'ai pas encore répondu à la question ! Comment lire Berlin Alexanderplatz ? Eh bien tout d'abord - entrainement difficile guerre facile - il peut être bon de s'être frotter aux plus durs. Je veux dire par là d'être aller faire ses armes face à un tome de la Recherche de Proust ou un chapitre de l'Ulysse de Joyce (à peu près intelligible). On se rendra compte que Céline et Döblin ne sont pas si inabordables qu'on ne se l'imagine. Ensuite, nos crocs acérés, on peut s'attaquer à la pièce dont on parle aujourd'hui : Berlin Alexanderplatz. Certes, le style, phrase par phrase n'est pas franchement ragoutant mais on distingue la forme d'une narration. On distingue la polyphonie, on comprend qui parle, qui pense, quand intervient l'auteur etc. On peut donc décrypter, globalement l'action qui se déroule et ainsi, avancer, ou plutôt creuser, à travers les différentes couches que sont les niveaux de lecture. Ne vous inquiétez surtout pas si vous avez l'impression de ne pas saisir tel morceau de phrase, tel paragraphe complètement hors sujet. L'auteur se fout un peu de vous, alors ne vous laisser pas intimider et suivez le dans sa folie, comme Alice suivit le lapin. C'est bien pour ça que vous avez ouvert ce livre non ? Alors en avant.
Après plusieurs pages, on discerne mieux le projet. L'auteur force notre adhésion : Soit nous abandonnons et refermons le livre (ce que je fis la première fois), soit nous y allons « à fond » et nous descendons dans les bas-fonds. Nous ne les regardons pas de notre fenêtre, depuis notre appartement embourgeoisé, nous descendons, mouchoir sur le nez, à travers l'odeur putride des bars infâmes (surement les équivalents de nos PMU), à travers les ruelles sordides d'une ville au bord du précipice. C'est un choix, donc, au service duquel le style va se mettre : nous rendre au mieux l'impression de bassesse, sans distinguer la narration du narré. Un peu lourd, dirons les plus réticents, ceux qui ont quand même réussi à passer outre l'obstacle de ce style ardu. Mais aucune inquiétude, l'auteur est talentueux. Il maîtrise l'emploi de son argot et l'utilise judicieusement pour décrire son objet et lui donner toute sa dégoutante splendeur. Des qualités évidemment toute céliniennes. Donc voilà comment lire, du moins aborder la lecture de Berlin Alexanderplatz en bravant l'épreuve du style (qui n'est que le premier des 12 travaux que vous aurez accomplis !). Pour en finir et pour conclure sur cette partie, je vous demande de voir le style comme un outils, qui s'apparente à une paire de lunettes 3D, grâce auxquelles vous verrez ce que l'auteur veux vous montrer : Berlin la sordide.
L'étude de ce sujet, Berlin, vu avec nos lunettes 3D nous est faites sous forme de visite guidée avec en guise de guide, Franz Biberkopf, une sorte de gros sac à, une sorte de personnage un peu pathétique, qu'on aime appeler antihéros.
Venons-en à l'analyse des niveaux de lecture qui vous permettra d'apercevoir une once de finalité dans cet objet littéraire non identifié. A la première lecture, nous en distinguons trois.
Le premier niveau de lecture des péripéties de Franz, est celui, classique, de la lecture d'une fresque urbaine, tout à fait romanesque. Une intrigue pleine de rebondissement, narrée avec entrain, une multitude de personnages, fort de leur caractère, un tourbillon de mésaventures toute plus dramatiques les unes que les autres. Pour ce niveau de lecture, vous serez servis : Prisons, viol, maltraitance des femmes, amitié, braquage, trahison, amputation, re-viol, meurtre, re-trahison, dépression, hôpital psychiatrique et fin à la 1984 d'Orwell, lobotomisation et vie minable. le Drame urbain par excellence, digne des plus grands des contemporains de Döblin. (Mais pourquoi les romans urbains sont-ils si déprimants ? L'homme n'est donc pas fait pour une vie urbaine ? Merde !)
Le deuxième niveau de lecture est évidemment la (fameuse) critique sociale. L'auteur, je le rappelle, est un médecin des quartiers populaire. Question misère sociale, il en connaît un rayon. Je dirais que sa période gauchiste se justifie pleinement (et pourtant, alléluia, il s'en émancipera). le roman est un hommage à tous ces petits, ces truands, ces putes, ces repentis éternellement jetés dans la spirale de la violence et de la perdition. Ceux qui essaient, mais n'y arrivent pas.
(Aux riches et instruits lecteurs … :) « Regardez ! Vous-autres qui savez lire de grands romans, et imaginez ce que vivent ces petits qui peuplent les quartiers mal famés. Regardez en face, Berlinois ! la face de votre ville minable. »
Mais plus malin encore, et moins populiste qu'on ne se l'imagine, Döblin tourne aussi son discours contre le peuple. Son héros, certes, n'est pas épargné par la malchance. du moins, c'est ce que nous affirme avec une fausse naïveté, la narration. En fait, avec un simple esprit critique, et fort de notre connaissance du bien et du mal, aucun évènement ne forcent notre héros à faire le mal, à violer sa belle-soeur pour retrouver sa libido, ni à s'acoquiné avec une bande de braqueurs ou d'admirer un assassin en puissance, manifestement violent.
(Aux petits … :) « et vous Arrêtez de vous lamenter ! arrêtez de promettre que vous ne retomberait pas dans le banditisme quand vous faites tout…, ou du moins quand vous ne faites rien pour empêcher que ça arrive ! »
Nous avons donc ce double discours de l'auteur qui pointe du doigt la responsabilité de chacun, y compris des plus petits, dans la misère de la capitale teutonne.
Enfin, dernier niveau de lecture, qui nous pousse à penser, une fois le livre refermé, qu'il faudra le relire plus attentivement ce chef d'oeuvre : religieux. Pour ne citer qu'une référence, je dirai celle du livre de Job, pleinement appropriée pour décrire la triste vie de notre universel Franz. L'oeuvre contient énormément de références, profanes et religieuses et nous rappellent en fait que Berlin Alexanderplatz est construit comme une parabole, ou du moins en apparence. Et c'est peut-être l'analyse la plus intéressante de l'oeuvre de Döblin, juif qui aura la riche idée de se convertir au catholicisme. Si Franz est un anti-héros, son histoire est une anti-parabole. Les paraboles, vous savez ? Ces petits textes d'une simplicité affligeante conclus par une petite morale que le Christ utilisait pour faire rentrer de grandes vérités dans les petits cerveaux de ses apôtre. « Un homme avait deux fils », « Un semeur sortit pour semer », « le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champs » … etc.
Döblin fait de même avec nos petits cerveaux. L'« histoire d'un bandit repentis, qui veut arrêter de faire le mal ». Il va « tout » faire pour y arriver, mais le monde étant trop dur, il butera à chaque nouvelle tentative et retombera dans le banditisme. Nous avons une sorte de contre-évangile, qui nous dit avec simplicité que tout n'est pas si simple. Et nous, apôtre d'un instant du maître Döblin, nous sommes partagés entre l'idée qu'effectivement, on ne peut juger un homme sans connaitre la dureté de sa vie et, en même temps, l'idée qu'on se moque un peu de nous dans cette affaire - tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise - Franz a eu ce qu'il méritait. Plusieurs personnes lui ont tendu la main et ce blaireau n'a jamais su écouter et n'en a fait qu'à sa tête pour finalement retomber dans le crime.
Double morale donc : soit on voit le texte comme une parabole et la morale est donc que la vie finit toujours par l'emporter sur les volontés de fer. Il donc faut se soumettre à sa destinée (même si celle-ci est noire) sans lutter contre ses passions, être cohérent. Soit on voit le texte comme une anti-parabole dont la morale est donc qu'il faut vraiment et sincèrement lutter, sans se cacher derrière de fausses résolutions, contre le mal qu'il y a en nous et ce dans chacune de nos actions, actions qui constituent le torrent de notre destinée. Si ces deux morales sont banales et sont complètement opposées, l'auteur adresse la première à notre conscience via la forme : (la narration naïve) et la seconde à notre subconscient via le fond (le contenu du récit). La première nous dit qu'il ne sert à rien de lutter dans un Berlin comme celui qui nous est présenté la seconde attend de nous que nous refusions cette démission, ce lâche abandon.
La fin est assez intéressante, notamment la dernière page ou notre héros est lobotomisé, vaincu. Son âme est morte. Il est comme emporté dans l'allégorie d'une marche guerrière et nationaliste qui se nourrit de ce genre de profil pour grossir et gagner en puissance. Cette marche guerrière résonne tout particulièrement quand on connaît la suite (et la fin ?) de l'Histoire Allemande.
Terminer Berlin Alexanderplatz procure avant tout le sentiment de fierté légitime d'avoir terrasser un monstre littéraire et d'en avoir extrait la substantifique moelle, aliment nécessaire aux muscles de notre cerveau, fatigués de l'inconsistance de la littérature contemporaine. Berlin Alexanderplatz est bien un challenge littéraire et comme toute épreuve, on en ressort plus clairvoyant, on en tire une conclusion qui perdurera tout au long de notre chemin sur cette terre. le pacte de lecture est respecté, Alfred Döblin réussit pleinement son effraction dans nos boites crânienne, pour y déposer un germe : sa vision de Berlin de 1928. Et ce germe grandira quand nous regarderons notre ville (Marseille, Paris, Bordeaux…), ses mouvements, ses bruits, ses odeurs, ses trognes à travers les yeux Döblinesques, et que nous sentirons dès lors cette nostalgie intense d'un Berlin que nous n'avons jamais connu, révolu à jamais.