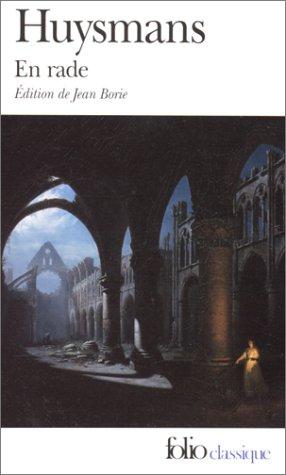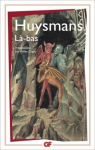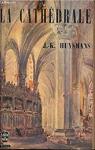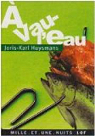Huysmans poursuit avec En rade le travail de fuite de son époque qu'il avait entamé avec À rebours, dans une version plus narrative, et sur un mode souvent comique.
Jacques et Louise sont deux jeunes parisiens, mariés sans fortune et sans dot, qui se retrouvent bien vite criblés de dettes. Devant l'urgence de leur situation, Louise suggère une retraite à la campagne chez un oncle paysan qui leur a promis un hébergement provisoire, le temps pour le couple d'échapper aux créanciers. Comme bien souvent l'idée est bonne sur le papier, mais une fois arrivés à Lourps (bonjour l'ambiance), les deux amants découvrent en guise de gîte un château à l'abandon rongé par l'humidité, et pour tout accueil la langue boueuse et les manières rustres du père Antoine et de sa femme Norine. Aux problèmes financiers s'ajoutent donc, dans cette campagne laide, des conditions de vie hostiles et des codes sociaux repoussants, tirés à grands traits par Huysmans qui s'amuse sans trop se cacher des dialogues gras et des épisodes scabreux qu'il insère dans son récit. A Lourps, point de salut, donc : si là-bas Jacques et Louise parviennent au moins à échapper à Paris, c'est pour ressentir bien vite le désir de s'échapper de Lourps tout autant.
De manière fascinante, En rade fait se côtoyer les contingences au ras du sol et l'imaginaire le plus merveilleux, entre lesquels Jacques, personnage passif et inadapté au monde, est partout déboussolé. Mauvais au travail manuel, pas assez brillant, il incarne la victime d'un environnement en perpétuel mouvement où Dieu est déjà trop mort, même si, çà et là, sont semés les signes que c'est vers Lui qu'il faudra retourner pour succéder à la petite satisfaction de s'être « débarrassé de l'écorce temporaire d'un corps. » En attendant, c'est dans le rêve que se retrouve, sous des formes folles et élastiques, le substitut féérique aux textes fondateurs, qui s'offre au lecteur dans des passages étranges et hallucinés, semblant eux-mêmes vouloir lacérer l'entreprise naturaliste dans son ensemble par leurs retours réguliers tout au long du roman.
L'ouvrage alterne donc de très belles descriptions topographiques qui affirment par métonymie la mort d'une époque, et des délires oniriques qui cherchent ailleurs une évasion encore embryonnaire et indéfinie. A défaut de solution, Jacques et Louise au terme du livre s'en retournent tout bêtement à Paris, tout aussi pauvres et un peu plus dégoûtés du monde et d'eux-mêmes : au-delà de l'apparent échec de leur petite aventure, En rade marque les tâtonnements spirituels de Huysmans, encore loin d'avoir repéré un chemin, mais tout de même un peu sorti de la stase totale d'À rebours, avant que tout cela ne se précise dans le cycle de Durtal à venir. Un roman court et original, qui trouve ses meilleures pages là où s'expriment les hilarants penchants macabres de son auteur.
Jacques et Louise sont deux jeunes parisiens, mariés sans fortune et sans dot, qui se retrouvent bien vite criblés de dettes. Devant l'urgence de leur situation, Louise suggère une retraite à la campagne chez un oncle paysan qui leur a promis un hébergement provisoire, le temps pour le couple d'échapper aux créanciers. Comme bien souvent l'idée est bonne sur le papier, mais une fois arrivés à Lourps (bonjour l'ambiance), les deux amants découvrent en guise de gîte un château à l'abandon rongé par l'humidité, et pour tout accueil la langue boueuse et les manières rustres du père Antoine et de sa femme Norine. Aux problèmes financiers s'ajoutent donc, dans cette campagne laide, des conditions de vie hostiles et des codes sociaux repoussants, tirés à grands traits par Huysmans qui s'amuse sans trop se cacher des dialogues gras et des épisodes scabreux qu'il insère dans son récit. A Lourps, point de salut, donc : si là-bas Jacques et Louise parviennent au moins à échapper à Paris, c'est pour ressentir bien vite le désir de s'échapper de Lourps tout autant.
De manière fascinante, En rade fait se côtoyer les contingences au ras du sol et l'imaginaire le plus merveilleux, entre lesquels Jacques, personnage passif et inadapté au monde, est partout déboussolé. Mauvais au travail manuel, pas assez brillant, il incarne la victime d'un environnement en perpétuel mouvement où Dieu est déjà trop mort, même si, çà et là, sont semés les signes que c'est vers Lui qu'il faudra retourner pour succéder à la petite satisfaction de s'être « débarrassé de l'écorce temporaire d'un corps. » En attendant, c'est dans le rêve que se retrouve, sous des formes folles et élastiques, le substitut féérique aux textes fondateurs, qui s'offre au lecteur dans des passages étranges et hallucinés, semblant eux-mêmes vouloir lacérer l'entreprise naturaliste dans son ensemble par leurs retours réguliers tout au long du roman.
L'ouvrage alterne donc de très belles descriptions topographiques qui affirment par métonymie la mort d'une époque, et des délires oniriques qui cherchent ailleurs une évasion encore embryonnaire et indéfinie. A défaut de solution, Jacques et Louise au terme du livre s'en retournent tout bêtement à Paris, tout aussi pauvres et un peu plus dégoûtés du monde et d'eux-mêmes : au-delà de l'apparent échec de leur petite aventure, En rade marque les tâtonnements spirituels de Huysmans, encore loin d'avoir repéré un chemin, mais tout de même un peu sorti de la stase totale d'À rebours, avant que tout cela ne se précise dans le cycle de Durtal à venir. Un roman court et original, qui trouve ses meilleures pages là où s'expriment les hilarants penchants macabres de son auteur.
Huysmans un écrivain trop méconnu à découvrir absolument!
oui, bien sur........ mais si loin de la puissance de" A REBOURS"
ou de Lorrain........
ou de Lorrain........
cauchemardesque et fin; une perle
Déjà, je suis attiré par le titre "En rade". J'adore.
Bon, c'est un livre assez étrange, mais fortement bien pensé et exprimé. Quelle belle écriture, intelligente. Peut-être un peu trop, c'est toujours la faiblesse dans un point très-trop fort.
De très puissantes descriptions de la réalité, nature, et des délires ou rêveries, où la folie frôle. de puissants contrastes agitent ce roman, comme les marées.
Le truc étonnant est qu'il passe d'un registre à l'autre sans trop crier gare, mais ça se tient, la cohérence est.
Extrait de la notice, sise après le texte proprement dit :
Comment mieux dire : Huysmans n'a pas le sens de l'absolu, il ne sépare pas la cuisine de la théologie, avoir mal au ventre d'avoir mal à l'âme, une prière d'un médicament. Il serait absurde de le lui reprocher, comme de l'en féliciter. Il ne le fait pas exprès, et c'est cela qui donne une saveur à son oeuvre.
J'ajoute que la préface de Jean Borie dans l'édition Folio Classique est remarquable !
Bon, c'est un livre assez étrange, mais fortement bien pensé et exprimé. Quelle belle écriture, intelligente. Peut-être un peu trop, c'est toujours la faiblesse dans un point très-trop fort.
De très puissantes descriptions de la réalité, nature, et des délires ou rêveries, où la folie frôle. de puissants contrastes agitent ce roman, comme les marées.
Le truc étonnant est qu'il passe d'un registre à l'autre sans trop crier gare, mais ça se tient, la cohérence est.
Extrait de la notice, sise après le texte proprement dit :
Comment mieux dire : Huysmans n'a pas le sens de l'absolu, il ne sépare pas la cuisine de la théologie, avoir mal au ventre d'avoir mal à l'âme, une prière d'un médicament. Il serait absurde de le lui reprocher, comme de l'en féliciter. Il ne le fait pas exprès, et c'est cela qui donne une saveur à son oeuvre.
J'ajoute que la préface de Jean Borie dans l'édition Folio Classique est remarquable !
Deux ans après « A rebours », en 1886, Joris Karl Huysmans – de son vrai nom Charles Marie Georges Huysmans – publie en feuilleton « En rade ». Depuis 1876, l'année de son premier roman, il est l'ami d'Emile Zola qu'il considère comme son maître à penser en littérature ; et qui l'invite fréquemment à Médan, avec d'autres écrivains comme Guy de Maupassant...
Amateurs de Zola, rien que ce petit rappel chronologique impose la lecture de Huysmans ; même si « A rebours » constituait en quelque sorte une rupture avec le courant « naturaliste » cher à Zola… Une rupture assumée avec « En rade »…
Jacques Marles, un riche parisien s'est réfugié au château de Lourps avec sa femme, Louise, ruiné à cause de la « faillite d'un trop ingénieux banquier ». Un retour à la terre, en quelque sorte. Sauf que la campagne quand on est citadin comporte énormément d'inconvénients… Quant aux hôtes du couple, ils s'avéreront de fieffés coquins…
On ne rompt pas aussi facilement avec le naturalisme : j'en veux pour preuve quelques scènes de la vie quotidienne au château que Zola n'aurait pas reniées. Mais l'interêt de « En rade » réside surtout en une ouverture sur le rêve et son analyse, bien avant les théories de Freud : on passe du naturalisme au « surnaturalisme » …
Trois rêves ponctuent le récit, le rêve d'Assuérus au chapitre III, le rêve de la Lune au chapitre V et celui des tours de Saint-Sulpice au chapitre X ; des rêves comme des résurgences de l'inconscient dans la vie réelle. Précurseur, Huysmans ? Peut-être… inconsciemment…
Il n'en reste pas moins que Huysmans est un écrivain majeur du XIXème siècle, contemporain de Zola, et pratiquement oublié de nos jours. Dommage.
Amateurs de Zola, rien que ce petit rappel chronologique impose la lecture de Huysmans ; même si « A rebours » constituait en quelque sorte une rupture avec le courant « naturaliste » cher à Zola… Une rupture assumée avec « En rade »…
Jacques Marles, un riche parisien s'est réfugié au château de Lourps avec sa femme, Louise, ruiné à cause de la « faillite d'un trop ingénieux banquier ». Un retour à la terre, en quelque sorte. Sauf que la campagne quand on est citadin comporte énormément d'inconvénients… Quant aux hôtes du couple, ils s'avéreront de fieffés coquins…
On ne rompt pas aussi facilement avec le naturalisme : j'en veux pour preuve quelques scènes de la vie quotidienne au château que Zola n'aurait pas reniées. Mais l'interêt de « En rade » réside surtout en une ouverture sur le rêve et son analyse, bien avant les théories de Freud : on passe du naturalisme au « surnaturalisme » …
Trois rêves ponctuent le récit, le rêve d'Assuérus au chapitre III, le rêve de la Lune au chapitre V et celui des tours de Saint-Sulpice au chapitre X ; des rêves comme des résurgences de l'inconscient dans la vie réelle. Précurseur, Huysmans ? Peut-être… inconsciemment…
Il n'en reste pas moins que Huysmans est un écrivain majeur du XIXème siècle, contemporain de Zola, et pratiquement oublié de nos jours. Dommage.
Jacques et Louise Marles sont ruinés. Pour fuir leurs créanciers, ils partent en Brie, dans un château dont Antoine, l'oncle de Louise, a la garde. Arrivés sur place, ils constatent que le château de Lourps est une ruine battue par les vents et hantée par les chats-huants. La promesse du repos et du réconfort s'éloigne rapidement. Aux tracas parisiens se substituent les misères provinciales.
Antoine et Norine, sa femme, sont des paysans filous, âpres au gain, avares et malhonnêtes. Ils ne voient en Louise et Jacques que des Parisiens à rançonner. Ressassant leur pauvreté et égrenant la liste de leurs prétendus malheurs paysans, ils incarnent l'image populaire des provinciaux rustres et malappris. Leur langage à lui seul, entre patois et jurons, se veut l'illustration de leur caractère grossier. Étymologiquement, Jacques est l'un d'eux par son prénom, mais tout son être se révolte et se rebiffe : pour lui, il est impensable de s'assimiler à cette population frustre. Et pourtant, dans sa solitude exacerbée, il croit trouver un plaisir à la compagnie des navrants paysans.
Dès le début du séjour, Jacques est traversé de rêves et d'hallucinations qui le laissent épuisé. « Il tenta de s'analyser, s'avoua qu'il se trouvait dans un état désorbité d'âme, soumis contre toute volonté à des impressions externes, travaillé par des nerfs écorchés en révolte contre sa raison, dont les misérables défaillances s'étaient, quand même, dissipées depuis la venue du jour. » (p.76) Des heures entières, Jacques revit les songes qui ont occupé son esprit : « l'insondable énigme du Rêve le hantait. » (p.78) C'est ainsi qu'il occupe de mornes journées. Jacques s'ennuie maladivement : plus sa mélancolie s'aggrave, plus l'ennui se fait prégnant et cet ennui entraîne une mélancolie toujours plus profonde. Mais, à l'inverse de l'illustre Des Esseintes, héros du précédent héros de Huysmans, Jacques n'a pas de fortune pour tenter de tromper l'ennui. Sa misère lui est une douleur supplémentaire, une barrière à un hypothétique bonheur.
Le château en ruines est propre aux fantasmagories les plus hideuses et aux suppositions les plus baroques. Son immensité délabrée et ses mystères insondés ont quelque chose de gothique qui cède finalement au pathétique le plus profond. Nul secret et nulle merveille en ces murs poussiéreux, le château n'est qu'une bâtisse aussi vide que l'âme de Jacques, une incarnation architecturale du taedium vitae. À l'instar de Jacques qui se laisse glisser dans une mélancolie néfaste, le château de Lourps rend les armes devant le temps et les hommes. Les ténébreux songes de Jacques ne sont finalement que l'écho de ses promenades vaines dans les couloirs du triste manoir. « Les cauchemars de Jacques étaient patibulaires et désolants, laissaient dès le réveil, un funèbre impression qui stimulait la mélancolie des pensées déjà lasses de se ressasser, à l'état de veille, dans le milieu de ce château vide. » (p. 199)
Dans la solitude et l'indigence campagnarde, la maladie de nerfs de Louise s'aggrave. Et le couple se délire inexorablement. L'épouse refuse sa couche à l'époux et l'homme s'exaspère de cette chasteté forcée autant qu'il s'énerve de ne plus désirer sa femme. « Ce séjour à Lourps aura vraiment eu de bien heureuses conséquences ; il nous aura mutuellement initiés à l'abomination de nos âmes et de nos corps. » (p. 211) À cela s'ajoutent les terreurs causées par le manque d'argent et les angoisses des comptes qui laissent la bourse de plus en plus vide. Pour Jacques et son épouse, ce séjour en province n'aura rien résolu. le retour à Paris, espéré et idéalisé, porte à peine la promesse de lendemains meilleurs. « Ce départ ferait-il taire la psalmodie de ses pensées tristes et décanterait-il cette détresse d'âme dont il accusait la défection de sa femme d'être la cause ? Il sentait bien qu'il ne pardonnerait pas aisément à Louise de s'être éloignée de lui au moment où il aurait voulu se serrer contre elle. » (p. 211)
Dans ce roman, Huysmans s'essaie au symbolisme et à la transcription du rêve. Une nouvelle fois, il fait montre d'une remarquable puissance d'évocation dans ses descriptions : entre hypotyposes et ekphrasis, elles ne laissent rien au hasard et le lecteur n'est privé d'aucun détail. Dans Là-bas, Huysmans faisait s'élever les murs sur des ruines, ici il fait tomber les murs et révèlent les ruines à venir.
L'opposition Paris/province est savoureuse, mais ce roman m'a assez rapidement lassée et je l'ai achevé sans plaisir. Si j'ai retrouvé la belle plume de Huysmans, j'ai le sentiment qu'il s'est écouté écrire : bien que l'auteur propose des phrases sublimes, il aurait pu faire l'économie de quelques formulations, voire de quelques pages.
Antoine et Norine, sa femme, sont des paysans filous, âpres au gain, avares et malhonnêtes. Ils ne voient en Louise et Jacques que des Parisiens à rançonner. Ressassant leur pauvreté et égrenant la liste de leurs prétendus malheurs paysans, ils incarnent l'image populaire des provinciaux rustres et malappris. Leur langage à lui seul, entre patois et jurons, se veut l'illustration de leur caractère grossier. Étymologiquement, Jacques est l'un d'eux par son prénom, mais tout son être se révolte et se rebiffe : pour lui, il est impensable de s'assimiler à cette population frustre. Et pourtant, dans sa solitude exacerbée, il croit trouver un plaisir à la compagnie des navrants paysans.
Dès le début du séjour, Jacques est traversé de rêves et d'hallucinations qui le laissent épuisé. « Il tenta de s'analyser, s'avoua qu'il se trouvait dans un état désorbité d'âme, soumis contre toute volonté à des impressions externes, travaillé par des nerfs écorchés en révolte contre sa raison, dont les misérables défaillances s'étaient, quand même, dissipées depuis la venue du jour. » (p.76) Des heures entières, Jacques revit les songes qui ont occupé son esprit : « l'insondable énigme du Rêve le hantait. » (p.78) C'est ainsi qu'il occupe de mornes journées. Jacques s'ennuie maladivement : plus sa mélancolie s'aggrave, plus l'ennui se fait prégnant et cet ennui entraîne une mélancolie toujours plus profonde. Mais, à l'inverse de l'illustre Des Esseintes, héros du précédent héros de Huysmans, Jacques n'a pas de fortune pour tenter de tromper l'ennui. Sa misère lui est une douleur supplémentaire, une barrière à un hypothétique bonheur.
Le château en ruines est propre aux fantasmagories les plus hideuses et aux suppositions les plus baroques. Son immensité délabrée et ses mystères insondés ont quelque chose de gothique qui cède finalement au pathétique le plus profond. Nul secret et nulle merveille en ces murs poussiéreux, le château n'est qu'une bâtisse aussi vide que l'âme de Jacques, une incarnation architecturale du taedium vitae. À l'instar de Jacques qui se laisse glisser dans une mélancolie néfaste, le château de Lourps rend les armes devant le temps et les hommes. Les ténébreux songes de Jacques ne sont finalement que l'écho de ses promenades vaines dans les couloirs du triste manoir. « Les cauchemars de Jacques étaient patibulaires et désolants, laissaient dès le réveil, un funèbre impression qui stimulait la mélancolie des pensées déjà lasses de se ressasser, à l'état de veille, dans le milieu de ce château vide. » (p. 199)
Dans la solitude et l'indigence campagnarde, la maladie de nerfs de Louise s'aggrave. Et le couple se délire inexorablement. L'épouse refuse sa couche à l'époux et l'homme s'exaspère de cette chasteté forcée autant qu'il s'énerve de ne plus désirer sa femme. « Ce séjour à Lourps aura vraiment eu de bien heureuses conséquences ; il nous aura mutuellement initiés à l'abomination de nos âmes et de nos corps. » (p. 211) À cela s'ajoutent les terreurs causées par le manque d'argent et les angoisses des comptes qui laissent la bourse de plus en plus vide. Pour Jacques et son épouse, ce séjour en province n'aura rien résolu. le retour à Paris, espéré et idéalisé, porte à peine la promesse de lendemains meilleurs. « Ce départ ferait-il taire la psalmodie de ses pensées tristes et décanterait-il cette détresse d'âme dont il accusait la défection de sa femme d'être la cause ? Il sentait bien qu'il ne pardonnerait pas aisément à Louise de s'être éloignée de lui au moment où il aurait voulu se serrer contre elle. » (p. 211)
Dans ce roman, Huysmans s'essaie au symbolisme et à la transcription du rêve. Une nouvelle fois, il fait montre d'une remarquable puissance d'évocation dans ses descriptions : entre hypotyposes et ekphrasis, elles ne laissent rien au hasard et le lecteur n'est privé d'aucun détail. Dans Là-bas, Huysmans faisait s'élever les murs sur des ruines, ici il fait tomber les murs et révèlent les ruines à venir.
L'opposition Paris/province est savoureuse, mais ce roman m'a assez rapidement lassée et je l'ai achevé sans plaisir. Si j'ai retrouvé la belle plume de Huysmans, j'ai le sentiment qu'il s'est écouté écrire : bien que l'auteur propose des phrases sublimes, il aurait pu faire l'économie de quelques formulations, voire de quelques pages.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Joris-Karl Huysmans (86)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Joris-Karl Huysmans
Quel est le véritable prénom de Joris-Karl Huysmans
François-Louis
Edmund
Charles Marie Georges
Anatole
10 questions
57 lecteurs ont répondu
Thème :
Joris-Karl HuysmansCréer un quiz sur ce livre57 lecteurs ont répondu