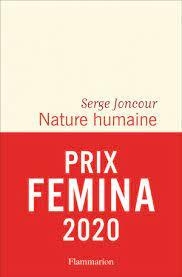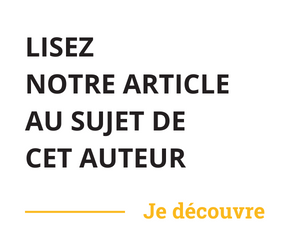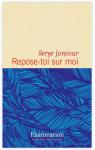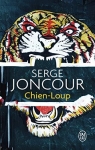Les Bertranges, une ferme paumée au milieu des coteaux, les Fabrier y ont vécu pendant quatre générations, aujourd'hui Alexandre est le seul à y vivre au sommet des prairies. Alexandre est le fils sacrificiel qui doit endosser le fardeau de la pérennisation de la ferme, est-ce qu'un jour il trouvera une fille qui acceptera de vivre ici ? Alexandre va faire la connaissance d'un groupe d'activistes, des étudiants, des militants antinucléaires, d'autres très à jour sur l'utilisation des explosifs. Il va mettre la main dans un foutu engrenage. C'est là qu'il croise Constanze, elle vient d'un pays coupé en deux, elle a la manie de voyager, de courir le monde, elle parle de s'installer en Inde. Alexandre, il ne quittera jamais cette terre qui a besoin de lui. Ils sont originaires de deux planètes inconciliables.
Serge Joncour nous délivre un grand roman social, de 1976 jusqu'aux derniers jours de 1999. A travers le portrait d'Alexandre il nous entraîne à la croisée de deux époques, de deux mondes. Avec sa plume toujours aussi belle et précise, il nous décrit les conséquences sociales, politiques, culturelles, écologiques et humaines de cette fuite en avant, de cette course à la consommation et au profit qui détruit tout sur son passage : la nature et les hommes.
Le père Crayssac, un vieil agriculteur, un rouge, un précurseur, est le symbole de ces luttes perdues d'avance : le camp militaire du Larzac, l'installation des poteaux du téléphone, les centrales nucléaires et l'accident de Tchernobyl ; les autoroutes qui défigurent les paysages, les meilleures terres agricoles qu'on bétonne pour y faire pousser des centres commerciaux.
Un roman ancré dans son époque : les veaux aux hormones, la mode des hippies paysans, les maïs transgéniques ; la campagne présidentielle de 1981 et l'élection de Mitterrand porteur de tant d'espoir, la montée des nationalismes, le sida, la marée noire provoquée par un pétrolier échoué au large de la Bretagne, le bug de l'an 2000 et la fin du monde annoncé.
Un roman d'une grande richesse par toutes les questions que Serge Joncour aborde, toutes ces questions qui nous interrogent sur le vrai sens de la vie.
Serge Joncour nous délivre un grand roman social, de 1976 jusqu'aux derniers jours de 1999. A travers le portrait d'Alexandre il nous entraîne à la croisée de deux époques, de deux mondes. Avec sa plume toujours aussi belle et précise, il nous décrit les conséquences sociales, politiques, culturelles, écologiques et humaines de cette fuite en avant, de cette course à la consommation et au profit qui détruit tout sur son passage : la nature et les hommes.
Le père Crayssac, un vieil agriculteur, un rouge, un précurseur, est le symbole de ces luttes perdues d'avance : le camp militaire du Larzac, l'installation des poteaux du téléphone, les centrales nucléaires et l'accident de Tchernobyl ; les autoroutes qui défigurent les paysages, les meilleures terres agricoles qu'on bétonne pour y faire pousser des centres commerciaux.
Un roman ancré dans son époque : les veaux aux hormones, la mode des hippies paysans, les maïs transgéniques ; la campagne présidentielle de 1981 et l'élection de Mitterrand porteur de tant d'espoir, la montée des nationalismes, le sida, la marée noire provoquée par un pétrolier échoué au large de la Bretagne, le bug de l'an 2000 et la fin du monde annoncé.
Un roman d'une grande richesse par toutes les questions que Serge Joncour aborde, toutes ces questions qui nous interrogent sur le vrai sens de la vie.
En quelques mots, le prologue brosse le décor d'une ferme familiale dont la vie semble s'être échappée en ce mois de décembre 1999 et place d'emblée le récit sous tension : pourquoi Alexandre craint-il l'intervention des gendarmes ? Patience, il s'agit d'une longue histoire : celle d'une ferme lotoise et d'une famille de paysans dont chaque génération fait face à ses propres défis ; celle d'une histoire d'amour ; et, en même temps, l'histoire d'une société en pleine mutation, d'un monde où tout se dérègle.
« le téléphone, c'est comme le Larzac, Golfech et Creys-Malville, c'est comme toutes ces mines et ces aciéries qu'ils ferment, tu vois pas que le peuple se lève, de partout les gens se dressent contre ce monde-là. »
Ce sont les clivages abyssaux entre rural et urbain, centre et périphérie, nature et productivisme, savoir-faire traditionnels et « progrès » qui se cristallisent dans la destinée de la famille Fabrier. Leur histoire fait écho à mille autres vies de paysans aux prises avec la sécheresse et les intempéries, la concurrence internationale, les négociations avec l'hypermarché, les injonctions à voir les choses en grand… Elle entre, plus largement, en résonance avec d'autres luttes politiques qui traversent la France en cette fin de XXe siècle, du plateau du Larzac au réacteur Superphénix en passant par la centrale de Golfech. Serge Joncour inscrit habilement son intrigue dans cette époque-charnière dont il restitue les lignes de force avec beaucoup de justesse.
« Chaque vie se tient à l'écart de ce qu'elle aurait pu être. »
Si ce livre est de nature à ravir les amateurs d'histoire politique, il reste avant tout un très bon roman. de ce point de vue-là, j'ai été touchée par cette famille dont les liens se distendent progressivement, mais aussi par la responsabilité endossée par Alexandre pour la pérennisation de la ferme, permettant à ses soeurs de construire leur vie ailleurs. Fasciné par l'effervescence politique et sociale qu'il observe de loin, il voit chaque embryon de rêve tourner court face aux réalités brutes de la météo, des vêlages et de la croissance des herbages à surveiller.
« Angèle s'était toujours dit que les vaches méprisaient les chiens, elles les trouvaient serviles, alors qu'elles-mêmes s'étaient affranchies depuis belle lurette, elles ne tiraient plus de carrioles ni de charrues. »
Si l'espoir ne se fonde plus dans la religion, le progrès ou « le ventre fabuleux » du Mammouth, j'ai été réconfortée, à la lecture de ces pages, par ces vaches tranquilles et majestueuses qui semblent trôner sur leurs prés, allégorie d'un trésor qu'il s'agit plus que jamais de préserver.
« le téléphone, c'est comme le Larzac, Golfech et Creys-Malville, c'est comme toutes ces mines et ces aciéries qu'ils ferment, tu vois pas que le peuple se lève, de partout les gens se dressent contre ce monde-là. »
Ce sont les clivages abyssaux entre rural et urbain, centre et périphérie, nature et productivisme, savoir-faire traditionnels et « progrès » qui se cristallisent dans la destinée de la famille Fabrier. Leur histoire fait écho à mille autres vies de paysans aux prises avec la sécheresse et les intempéries, la concurrence internationale, les négociations avec l'hypermarché, les injonctions à voir les choses en grand… Elle entre, plus largement, en résonance avec d'autres luttes politiques qui traversent la France en cette fin de XXe siècle, du plateau du Larzac au réacteur Superphénix en passant par la centrale de Golfech. Serge Joncour inscrit habilement son intrigue dans cette époque-charnière dont il restitue les lignes de force avec beaucoup de justesse.
« Chaque vie se tient à l'écart de ce qu'elle aurait pu être. »
Si ce livre est de nature à ravir les amateurs d'histoire politique, il reste avant tout un très bon roman. de ce point de vue-là, j'ai été touchée par cette famille dont les liens se distendent progressivement, mais aussi par la responsabilité endossée par Alexandre pour la pérennisation de la ferme, permettant à ses soeurs de construire leur vie ailleurs. Fasciné par l'effervescence politique et sociale qu'il observe de loin, il voit chaque embryon de rêve tourner court face aux réalités brutes de la météo, des vêlages et de la croissance des herbages à surveiller.
« Angèle s'était toujours dit que les vaches méprisaient les chiens, elles les trouvaient serviles, alors qu'elles-mêmes s'étaient affranchies depuis belle lurette, elles ne tiraient plus de carrioles ni de charrues. »
Si l'espoir ne se fonde plus dans la religion, le progrès ou « le ventre fabuleux » du Mammouth, j'ai été réconfortée, à la lecture de ces pages, par ces vaches tranquilles et majestueuses qui semblent trôner sur leurs prés, allégorie d'un trésor qu'il s'agit plus que jamais de préserver.
"Moi aussi, si je pouvais, j'irais bien jusqu'au Mexique boire de la tequila avec le commandant Marcos, mais j'ai encore au moins cinq hectares à labourer, je remonte sur mon tracteur et je chante pour me donner du coeur..." Ca c'était Didier Wampas ("Manu Chao"), mais Alexandre sur son John Deere rêve plutôt de Berlin et de la belle Constanze.
Et l'on suit, de la sècheresse de l'été 1976 à la grande tempête de Décembre 1999, le parcours de ce solide gaillard amené à reprendre la ferme de ses parents et grands-parents, quelque part dans le Lot. Ses soeurs sont attirées par la ville, mais lui préfère les vaches, l'odeur de la menthe, le bruissement des arbres et les couchers de soleil sur la plaine. Toutefois, pendant ce dernier quart du XXe siècle, le paysage change : supermarchés et autoroutes se développent, tandis que les catastrophes environnementales s'enchainent et que l'occupation du Larzac voisin invite à une résistance plus ou moins explosive...
J'ai été charmée par cette chronique française qui s'étend sur deux décennies et fleure bon le patrimoine sans tomber dans la caricature façon publicité H3rta. A travers les trois générations de la famille Fabrier, on découvre l'évolution du monde agricole qui mue les paysans en exploitants, et on ne peut que déplorer les ravages de la PAC et de la mondialisation sur un savoir-être et un savoir-faire respectueux de la Nature. Mais même si un léger parfum de nostalgie flotte sur le récit, celui-ci reste combatif, à l'image d'Alexandre. En cela, Serge Joncour salue cette paysannerie qui résiste à l'appel du profit et des subventions, et il dresse le portrait de personnages attachants (sacré père Crayssac !).
Mais en émaillant sa chronique de repères populaires (chansons, élections, émissions TV), il nous fait également entrer dans l'album de famille des Fabrier, et c'est plutôt tendre et émouvant. Retrouver autant de souvenirs collectifs est toujours une expérience troublante, et j'aime les auteurs capables de raconter des pages d'Histoire en veillant aux petits détails qui y intègrent leurs lecteurs.
J'ai donc beaucoup apprécié ce roman, qui m'a permis de découvrir un monde que je ne connaissais que de loin, et de replonger dans un passé qui n'est plus si près. J'ai aimé sa simplicité et sa poésie terriennes, son humour discret, sa célébration du bon sens paysan, et la saveur de certains de ses personnages.
Une bon gros roman plaisant, comme une grosse tranche de pain de campagne ; à déguster sans faire de manières !
Et l'on suit, de la sècheresse de l'été 1976 à la grande tempête de Décembre 1999, le parcours de ce solide gaillard amené à reprendre la ferme de ses parents et grands-parents, quelque part dans le Lot. Ses soeurs sont attirées par la ville, mais lui préfère les vaches, l'odeur de la menthe, le bruissement des arbres et les couchers de soleil sur la plaine. Toutefois, pendant ce dernier quart du XXe siècle, le paysage change : supermarchés et autoroutes se développent, tandis que les catastrophes environnementales s'enchainent et que l'occupation du Larzac voisin invite à une résistance plus ou moins explosive...
J'ai été charmée par cette chronique française qui s'étend sur deux décennies et fleure bon le patrimoine sans tomber dans la caricature façon publicité H3rta. A travers les trois générations de la famille Fabrier, on découvre l'évolution du monde agricole qui mue les paysans en exploitants, et on ne peut que déplorer les ravages de la PAC et de la mondialisation sur un savoir-être et un savoir-faire respectueux de la Nature. Mais même si un léger parfum de nostalgie flotte sur le récit, celui-ci reste combatif, à l'image d'Alexandre. En cela, Serge Joncour salue cette paysannerie qui résiste à l'appel du profit et des subventions, et il dresse le portrait de personnages attachants (sacré père Crayssac !).
Mais en émaillant sa chronique de repères populaires (chansons, élections, émissions TV), il nous fait également entrer dans l'album de famille des Fabrier, et c'est plutôt tendre et émouvant. Retrouver autant de souvenirs collectifs est toujours une expérience troublante, et j'aime les auteurs capables de raconter des pages d'Histoire en veillant aux petits détails qui y intègrent leurs lecteurs.
J'ai donc beaucoup apprécié ce roman, qui m'a permis de découvrir un monde que je ne connaissais que de loin, et de replonger dans un passé qui n'est plus si près. J'ai aimé sa simplicité et sa poésie terriennes, son humour discret, sa célébration du bon sens paysan, et la saveur de certains de ses personnages.
Une bon gros roman plaisant, comme une grosse tranche de pain de campagne ; à déguster sans faire de manières !
Je pense que Serge Joncour tient là son meilleur livre ( ayant adoré déjà ses anciens opus, je me réjouis toujours de la sortie d'un nouvel ouvrage....)
Avec précision, l'auteur nous relate l'histoire d'une famille d'agriculteurs, et l'inexorable transformation de la société. Nous traversons ainsi toute une époque, de 1976 et la grande sécheresse à décembre 1999.
Ce livre nous montre que les changements sociétaux et de consommation nous ont fait oublier les vraies valeurs et les enseignements de nos aïeux. le progrès est-il vraiment bon ? On pourrait simplement se dire « Tout ça pour ça ? »
Alors revenons à l'essentiel et retrouvons les gestes simples et bons pour nous.
Avec précision, l'auteur nous relate l'histoire d'une famille d'agriculteurs, et l'inexorable transformation de la société. Nous traversons ainsi toute une époque, de 1976 et la grande sécheresse à décembre 1999.
Ce livre nous montre que les changements sociétaux et de consommation nous ont fait oublier les vraies valeurs et les enseignements de nos aïeux. le progrès est-il vraiment bon ? On pourrait simplement se dire « Tout ça pour ça ? »
Alors revenons à l'essentiel et retrouvons les gestes simples et bons pour nous.
S . Joncour a beau avoir un nom breton , être né à Paris, son arrivée à la présentation de son livre comme vendredi dernier au Forum du Livre de Rennes ne laisse aucun doute sur la solidité du bonhomme:ce n'est pas un gandin.
Ceci dit, nous revoilà dans le Lot , sur une période de 20ans , chez les Fabrier, fermiers de père en fils et justement dans ces années 80 , c'est Alexandre le fils qui va devoir reprendre l'exploitation. Les filles partent à la ville, les parents vieillissent , et seuls les grands espaces verdoyants et le travail d'éleveur sont l'horizon du jeune homme.
Il va rencontrer fortuitement une jeune allemande à Toulouse, elle fréquente des activistes qui manient l'explosif. Alexandre n'y sera pas insensible mais sans aucune idéologie.
Puis le temps passe, le jeune homme voit Constanze tous les 3 ans environ, c'est elle qui vient voir son père en même temps et ses anciens amis.
Puis vient la construction d'une autoroute qui va traverser champs et villages...
De l'été caniculaire de 1976 à la tempête de la fin décembre 1999 S.Joncour décrit ces territoires "enclavés" qui entrent dans la modernité pour le meilleur mais surtout pour le pire, mais sans ressentiment ni nostalgie. Une bien belle lecture qui devrait se prolonger bientôt sur les années 2000 à 2020, mais la covid en a bousculé l'écriture ,cette maladie n'était pas prévue dans le scénario envisagé. A suivre donc...
Ceci dit, nous revoilà dans le Lot , sur une période de 20ans , chez les Fabrier, fermiers de père en fils et justement dans ces années 80 , c'est Alexandre le fils qui va devoir reprendre l'exploitation. Les filles partent à la ville, les parents vieillissent , et seuls les grands espaces verdoyants et le travail d'éleveur sont l'horizon du jeune homme.
Il va rencontrer fortuitement une jeune allemande à Toulouse, elle fréquente des activistes qui manient l'explosif. Alexandre n'y sera pas insensible mais sans aucune idéologie.
Puis le temps passe, le jeune homme voit Constanze tous les 3 ans environ, c'est elle qui vient voir son père en même temps et ses anciens amis.
Puis vient la construction d'une autoroute qui va traverser champs et villages...
De l'été caniculaire de 1976 à la tempête de la fin décembre 1999 S.Joncour décrit ces territoires "enclavés" qui entrent dans la modernité pour le meilleur mais surtout pour le pire, mais sans ressentiment ni nostalgie. Une bien belle lecture qui devrait se prolonger bientôt sur les années 2000 à 2020, mais la covid en a bousculé l'écriture ,cette maladie n'était pas prévue dans le scénario envisagé. A suivre donc...
C'est l'histoire d'un paysan... Terminologie obsolète et légèrement péjorative à laquelle on préfère dorénavant exploitant agricole ou agriculteur.
Pour autant, le paysan est celui qui vit à la campagne, de travaux de la terre. Et Alexandre n'a jamais quitté la ferme du Lot qu'il exploite seul, métier fait par choix familial et loyauté. C'est donc un paysan.
Sur plusieurs années se racontent sa vie personnelle, son travail d'éleveur de bovins, ses compétences dans un univers qu'il connait parfaitement, les changements imposés par la mondialisation, la solitude d'un métier qui n'attire plus les femmes. Alexandre est à la croisée de deux mondes, l'ancien où on produisait pour se nourrir et le contemporain qui impose de la rentabilité.
Si votre âge vous fait souvenir des années Giscard/Mitterrand, des échauffourées sur le plateau de Larzac, du militantisme antinucléaire et anarchiste, des évolutions fulgurantes des techniques et de la société de consommation, ce livre va évoquer des images: les nouveaux supermarchés, le téléphone pour tous, la désertification programmée des campagnes, les normes de production agricole, l'engrenage diabolique de l'investissement.
En dépit d'une conscience écologique grandissante, au tournant du nouveau siècle, la société a produit un métier de terroir en voie de disparition.
Serge Joncour a fait encore une fois mon bonheur de lectrice, par sa parfaite restitution d'un univers naturel idyllique et menacé, et sa justesse de ton jusqu'à l'évocation de beaux sentiments amoureux dénués de toute sucrerie. le récit est vivant, à rebondissements, et ne perd jamais l'espoir d'un futur meilleur.
Un prix Fémina 2020 bien mérité.
Pour autant, le paysan est celui qui vit à la campagne, de travaux de la terre. Et Alexandre n'a jamais quitté la ferme du Lot qu'il exploite seul, métier fait par choix familial et loyauté. C'est donc un paysan.
Sur plusieurs années se racontent sa vie personnelle, son travail d'éleveur de bovins, ses compétences dans un univers qu'il connait parfaitement, les changements imposés par la mondialisation, la solitude d'un métier qui n'attire plus les femmes. Alexandre est à la croisée de deux mondes, l'ancien où on produisait pour se nourrir et le contemporain qui impose de la rentabilité.
Si votre âge vous fait souvenir des années Giscard/Mitterrand, des échauffourées sur le plateau de Larzac, du militantisme antinucléaire et anarchiste, des évolutions fulgurantes des techniques et de la société de consommation, ce livre va évoquer des images: les nouveaux supermarchés, le téléphone pour tous, la désertification programmée des campagnes, les normes de production agricole, l'engrenage diabolique de l'investissement.
En dépit d'une conscience écologique grandissante, au tournant du nouveau siècle, la société a produit un métier de terroir en voie de disparition.
Serge Joncour a fait encore une fois mon bonheur de lectrice, par sa parfaite restitution d'un univers naturel idyllique et menacé, et sa justesse de ton jusqu'à l'évocation de beaux sentiments amoureux dénués de toute sucrerie. le récit est vivant, à rebondissements, et ne perd jamais l'espoir d'un futur meilleur.
Un prix Fémina 2020 bien mérité.
Quelle drôle d'impression de se retrouver plonger en 1976 dans les années Giscard . Une période que j'ai vécue à la campagne avec peu de décalage d'âge par rapport au jeune Alexandre , le personnage principal de ce roman . Il vit avec ses parents et ses trois soeurs dans une ferme plutôt opulente dans le Lot, se pose des questions sur son avenir tout en sachant que c'est lui qui reprendra la ferme sans que cela le perturbe vraiment .
Très imbriquée avec les événements principaux qui ont marqué la France , l'histoire d'Alexandre est le reflet de l'époque , les nouveautés matérielles, l'évolution de la mentalité des jeunes, Mai 68 était passé par là.
Cela appuie douloureusement sur tout ce qu'on a pu considérer comme le progrès avec l'enthousiasme qui va avec et une petite bande de détracteurs dont les combats changent suivant les époques mais dont les méthodes restent les mêmes .
Tout y est, la construction des centrales nucléaires, l'arrivée de Mitterand comme Président, Tchernobyl , le naufrage de l'Erica etc ... pour se conclure par la tempête de Décembre 1999 .
Comme on oublie vite ce qui a fait notre passé , nos jeunes années , nos certitudes et nos rêves puis nos désillusions . Pour des lecteurs de ma génération c'est percutant avec en plus un personnage que l'on prend en sympathie et une campagne qui restera magnifique si on sait lui redonner vie !
Félicitations à Serge Joncour pour le prix Femina 2020 amplement mérité
Très imbriquée avec les événements principaux qui ont marqué la France , l'histoire d'Alexandre est le reflet de l'époque , les nouveautés matérielles, l'évolution de la mentalité des jeunes, Mai 68 était passé par là.
Cela appuie douloureusement sur tout ce qu'on a pu considérer comme le progrès avec l'enthousiasme qui va avec et une petite bande de détracteurs dont les combats changent suivant les époques mais dont les méthodes restent les mêmes .
Tout y est, la construction des centrales nucléaires, l'arrivée de Mitterand comme Président, Tchernobyl , le naufrage de l'Erica etc ... pour se conclure par la tempête de Décembre 1999 .
Comme on oublie vite ce qui a fait notre passé , nos jeunes années , nos certitudes et nos rêves puis nos désillusions . Pour des lecteurs de ma génération c'est percutant avec en plus un personnage que l'on prend en sympathie et une campagne qui restera magnifique si on sait lui redonner vie !
Félicitations à Serge Joncour pour le prix Femina 2020 amplement mérité
Retour de lecture sur “Nature humaine” un roman de Serge Joncour publié en 2020. Ce livre a obtenu le prix Femina, dans un contexte controversé, lié au fait que ce prix a été maintenu malgré le deuxième confinement Covid-19. Il nous raconte, à travers une saga familiale qui dure de 1976 à 1999, l'histoire d'Alexandre Fabrier, un fils d'agriculteur dans le Lot, qui se destine sans vraiment avoir le choix, ni pour autant être contre, à la reprise de l'exploitation familiale. Ses trois soeurs peu intéressées par la ferme rêvent d'un avenir ailleurs, en ville, et c'est donc tout naturellement que les parents préparent la transition avec leur fils, et lui cèdent l'ensemble de leur exploitation. A travers sa soeur aînée, Alexandre fera la connaissance d'une étudiante allemande Constanze, militante anti-nucléaire dont il tombera amoureux et de ses amis, qui sont des activistes bien plus virulents qu'elle. Ces relations, ainsi que la fréquentation d'un vieux voisin rebelle et taiseux, l'amèneront à un questionnement sur son métier, sa situation, son attitude par rapport à l'évolution de son environnement. On a à travers ce livre une fresque des bouleversements du monde agricole sur pratiquement un quart de siècle, avec notamment la désertification des campagnes, le nucléaire qui se généralise et s'impose, les rendements demandés qui explosent et entraînent l'utilisation intensive de la chimie, la surexploitation du monde animal, tout cela imposé par une mondialisation effrénée et une société de consommation intéressée uniquement par la quantité à petit prix. Joncour à réussi à intégrer tout cela dans un récit très juste, à aborder pratiquement toutes ces problématiques tout en nous racontant avec beaucoup d'empathie, une histoire très belle et touchante. Étant moi-même professionnellement très lié à ce monde agricole, je ne peux que confirmer la justesse de cette peinture, très ancrée dans la réalité. le pire étant que, malgré les catastrophes qui se succèdent, la sécheresse de 76, Tchernobyl, la tempête de 99, ce récit reste fortement empreint de nostalgie, les choses s'étant encore fortement dégradées sur bien des points depuis. Joncour a vu juste, ce sont ces années-là qui représentent le basculement irréversible du monde agricole vers un système basé sur les rendements, donc de la chimie, au détriment de la nature et c'est bien de la fin d'un monde dont on nous parle dans ce livre. Joncour remet néanmoins l'humain au milieu de tout ça, à travers une plongée dans l'histoire politique de ces années, et sans porter particulièrement de jugement, il nous décrit comment tous ces bouleversements se sont imposés peu à peu aux protagonistes, à ceux qui travaillent cette terre. Il nous explique que la responsabilité de l'agriculteur dans ce désastre écologique est bien limitée, il ne fait que s'adapter en essayant de faire face, tant bien que mal, aux contraintes économiques et sanitaires toujours plus fortes qu'on lui impose, et qui n'ont pour but que d'aller vers encore plus de mondialisation. On finit donc cette lecture un peu désabusé, l'homme ne pèse pas grand-chose face à cette machine qui écrase tout, mais la fin qui se passe en 1999 rappelle que la nature, elle, n'a pas forcément dit son dernier mot. Cela est raconté avec une écriture très simple, douce et fluide comme peut être la vie à la campagne, parfaitement adaptée à cette ambiance bucolique et à la simplicité de ces gens. C'est pour conclure, malgré un contenu un peu déprimant d'un point de vue écologique, une très belle fresque rurale et sociale, avec des personnages très attachants. Ce livre fut pour moi un très beau moment de lecture.
____________________________________
"À la télé comme partout, chacun y allait de ses superstitions, et la seule réponse concrète qui s'offrait face à cette canicule, c'étaient les montagnes de ventilateurs Calor à l'entrée du Mammouth, avec en prime le Tang et les glaces Kim Pouss, signe que ce monde était tout de même porteur d'espoir."
____________________________________
"À la télé comme partout, chacun y allait de ses superstitions, et la seule réponse concrète qui s'offrait face à cette canicule, c'étaient les montagnes de ventilateurs Calor à l'entrée du Mammouth, avec en prime le Tang et les glaces Kim Pouss, signe que ce monde était tout de même porteur d'espoir."
Décidément, mes lectures se suivent et se ressemblent. Me voilà confrontée à l'élevage intensif des bovins.
Je me trouve sur une autoroute qui me conduit de 1976 à 1999. C'est en lisant ce livre que vous comprendrez pourquoi je parle d'autoroute. Sur chaque aire, je retrouve un évènement que j'ai vécu : dans le désordre ( car je ne me rappelle plus la chronologie, j'aurais du noter ) ; la canicule de 1976 ; le scandale du veau aux hormones ; l'élection de François Mitterrand ; la chute du mur de Berlin ; la vache folle ; le sida ; Tchernobyl dont, miracle, le nuage radioactif s'est arrêté à nos frontières ; l'Erika ; les tempêtes de 1999 etc.
Un cours d'histoire de France me rappelant des choses que j'avais oubliées.
C'est à travers l'histoire d'Alexandre et de Constanze que la grande Histoire est contée. Et deux façons de vivre s'opposent : la vie rurale avec l'élevage des bêtes en liberté totale et les fermes, pas encore à mille vaches, où celle-ci passent leur existence en stabulation ; la vie à la campagne et la vie en ville.
C'est avec talent et humanité que Serge Joncour parcourt cette époque.
Je me trouve sur une autoroute qui me conduit de 1976 à 1999. C'est en lisant ce livre que vous comprendrez pourquoi je parle d'autoroute. Sur chaque aire, je retrouve un évènement que j'ai vécu : dans le désordre ( car je ne me rappelle plus la chronologie, j'aurais du noter ) ; la canicule de 1976 ; le scandale du veau aux hormones ; l'élection de François Mitterrand ; la chute du mur de Berlin ; la vache folle ; le sida ; Tchernobyl dont, miracle, le nuage radioactif s'est arrêté à nos frontières ; l'Erika ; les tempêtes de 1999 etc.
Un cours d'histoire de France me rappelant des choses que j'avais oubliées.
C'est à travers l'histoire d'Alexandre et de Constanze que la grande Histoire est contée. Et deux façons de vivre s'opposent : la vie rurale avec l'élevage des bêtes en liberté totale et les fermes, pas encore à mille vaches, où celle-ci passent leur existence en stabulation ; la vie à la campagne et la vie en ville.
C'est avec talent et humanité que Serge Joncour parcourt cette époque.
une saga paysanne qui commence en juillet 76 alors que, déjà, comme aujourd'hui, la canicule fait rage.
On est près de Cahors, à la ferme des Fabrier tenue par les parents et la fratrie composée de trois filles et d'un garçon. Les grands grands-parents ont quitté l'exploitation, retirés dans un pavillon neuf à portée de fusil pour donner la main (et les conseils) quand c'est nécessaire. On imagine déjà que, plus tard, les filles gagneront la ville alors qu'Alexandre, le garçon, honorera l'héritage familial isolé.
Un voisin, un seul, militant sur le Larzac et réfractaire à ce fichu progrès qui ne peut semer que la discorde.
Le décor est planté, comme les crocus qu'on vient de mettre en terre pour cinq années de récolte de safran, le dernier français.
On est bien là, au coeur des insouciantes années 70 (de Giscard et de Sardou) qui voient s'installer la profusion et le miroir aux alouettes de la grande distribution et de son historique Mammouth qui n'écrase pas que les prix !
Viendront les années 80, 90 puis 2000, Supertramp, Madness et Police, les antinucléaires, les activistes, le terrorisme international, l'arrivée de la gauche au pouvoir, le fameux 10 mai 81, le SIDA, Chernobyl, l'Erika, la chute du mur à Berlin, le Roundup et…la productivité !
Au milieu de cette ‘grande histoire' contemporaine, celle, plus intime d'Alexandre, né pour reprendre le domaine familial, pour grandir, vivre, vieillir et mourir, ici, à la ferme ancestrale, dans ce paysage immaculé que l'état voudrait fracturer pour tracer une autoroute.
Ses espoirs de jeune homme, ses engagements de citoyen, ses amours compliquées, ses dérapages violents aussi font le lit des méandres de ce roman majestueux. Une histoire tricotée finement, plus du point qu'un chemin de croix, une destinée brodée habilement dont on a, en permanence, envie de dérouler l'écheveau tant belle est l'écriture. Une leçon d'histoire également ou un rappel pour ceux qui on gardé en fil rouge les moments charnières de ces dernières décennies.
J'avais aimé ‘chien loup', j'ai adoré cette ‘nature humaine' qui porte si bien son titre, emporté ai-je été par ce personnage attachant, viscéralement attaché à son lopin de terre natal, un homme qui se bâtit en faisant corps avec cette nature qui fait battre son coeur, les yeux grand ouverts pour embrasser la chance qu'il a d'être de là. Une nature qui, peut-être, le lui rendra bien.
En un mot : Une vie.
On est près de Cahors, à la ferme des Fabrier tenue par les parents et la fratrie composée de trois filles et d'un garçon. Les grands grands-parents ont quitté l'exploitation, retirés dans un pavillon neuf à portée de fusil pour donner la main (et les conseils) quand c'est nécessaire. On imagine déjà que, plus tard, les filles gagneront la ville alors qu'Alexandre, le garçon, honorera l'héritage familial isolé.
Un voisin, un seul, militant sur le Larzac et réfractaire à ce fichu progrès qui ne peut semer que la discorde.
Le décor est planté, comme les crocus qu'on vient de mettre en terre pour cinq années de récolte de safran, le dernier français.
On est bien là, au coeur des insouciantes années 70 (de Giscard et de Sardou) qui voient s'installer la profusion et le miroir aux alouettes de la grande distribution et de son historique Mammouth qui n'écrase pas que les prix !
Viendront les années 80, 90 puis 2000, Supertramp, Madness et Police, les antinucléaires, les activistes, le terrorisme international, l'arrivée de la gauche au pouvoir, le fameux 10 mai 81, le SIDA, Chernobyl, l'Erika, la chute du mur à Berlin, le Roundup et…la productivité !
Au milieu de cette ‘grande histoire' contemporaine, celle, plus intime d'Alexandre, né pour reprendre le domaine familial, pour grandir, vivre, vieillir et mourir, ici, à la ferme ancestrale, dans ce paysage immaculé que l'état voudrait fracturer pour tracer une autoroute.
Ses espoirs de jeune homme, ses engagements de citoyen, ses amours compliquées, ses dérapages violents aussi font le lit des méandres de ce roman majestueux. Une histoire tricotée finement, plus du point qu'un chemin de croix, une destinée brodée habilement dont on a, en permanence, envie de dérouler l'écheveau tant belle est l'écriture. Une leçon d'histoire également ou un rappel pour ceux qui on gardé en fil rouge les moments charnières de ces dernières décennies.
J'avais aimé ‘chien loup', j'ai adoré cette ‘nature humaine' qui porte si bien son titre, emporté ai-je été par ce personnage attachant, viscéralement attaché à son lopin de terre natal, un homme qui se bâtit en faisant corps avec cette nature qui fait battre son coeur, les yeux grand ouverts pour embrasser la chance qu'il a d'être de là. Une nature qui, peut-être, le lui rendra bien.
En un mot : Une vie.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Serge Joncour (17)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Nature humaine : Serge Joncour
Les événements du roman se déroulent entre 1976 et 1999
VRAI
FAUX
10 questions
29 lecteurs ont répondu
Thème : Nature humaine de
Serge JoncourCréer un quiz sur ce livre29 lecteurs ont répondu