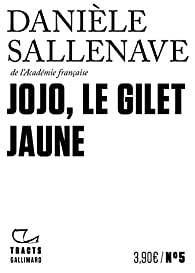Danièle Sallenave, Académicienne, prend fait et cause pour le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi un immortel viendrait-il s'épancher sur les gens de peu ? On peut lire dans son ouvrage au moins trois raisons.
Tout d'abord, l'auteure se reconnaît dans l'origine sociale des manifestants. Ses parents étaient aussi d'humbles et invisibles travailleurs. Ensuite, Danièle Sallenave croit toujours à l'idée d'égalité et l'espoir d'un dénivellement social. Enfin, l'auteur croit tout autant au pouvoir de l'éducation populaire, de l'instruction et de la culture pour sortir de sa condition et s'élever intellectuellement sans même chercher une quelconque promotion sociale. A ce propos, elle évoque cette histoire lu dans dans le roman « Démons » de « l'écrivain autrichien Heimito von Dorerer, qui a surpris par son appétit de livres. Sa vie lui convient. Avec des livres. On lui propose de devenir responsable culturel à la mairie ? "Mais non, répond-il. Je veux être un menuisier qui lit."»
Avec ce soutien indéfectible aux Gilets jaunes, aux opprimés en général, on se demande bien ce que Danièle Sallenave trouve comme plaisir à siéger dans une institution aussi conservatrice que l'Académie française ; peut-être est-ce le plaisir d'enrager les plus réactionnaires. Et ce plaisir est partagé.
Tout d'abord, l'auteure se reconnaît dans l'origine sociale des manifestants. Ses parents étaient aussi d'humbles et invisibles travailleurs. Ensuite, Danièle Sallenave croit toujours à l'idée d'égalité et l'espoir d'un dénivellement social. Enfin, l'auteur croit tout autant au pouvoir de l'éducation populaire, de l'instruction et de la culture pour sortir de sa condition et s'élever intellectuellement sans même chercher une quelconque promotion sociale. A ce propos, elle évoque cette histoire lu dans dans le roman « Démons » de « l'écrivain autrichien Heimito von Dorerer, qui a surpris par son appétit de livres. Sa vie lui convient. Avec des livres. On lui propose de devenir responsable culturel à la mairie ? "Mais non, répond-il. Je veux être un menuisier qui lit."»
Avec ce soutien indéfectible aux Gilets jaunes, aux opprimés en général, on se demande bien ce que Danièle Sallenave trouve comme plaisir à siéger dans une institution aussi conservatrice que l'Académie française ; peut-être est-ce le plaisir d'enrager les plus réactionnaires. Et ce plaisir est partagé.
Analyse du mouvement des gilets jaunes. L'auteur se décide à écrire ce opus après avoir entendu les propos condescendants du président évoquant "Jojo le gilet jaune".
Elle ne nie pas les débordements, les violences mais évoque en face la violence des puissants, le mépris de classe y compris au sein de la gauche institutionnelle ou chez les intellectuels, enseignants, artistes. le peuple est oublié et avec l'uniformisation des modes de vie, la culture populaire qu'elle soit ouvrière ou paysanne a été détruite.
Les gilets jaunes sont ainsi exclus de la culture qui se stérilise, se développe en vase clos, ignorant une grande partie de la population.
La fracture économique, sociale, culturelle entre "élite" et "France d'en bas" s'accroît de plus en plus. C'est ce que montre ce mouvement qui refuse les élites et ne se reconnaît pas dans le système représentatif qui parle en son nom.
Elle ne nie pas les débordements, les violences mais évoque en face la violence des puissants, le mépris de classe y compris au sein de la gauche institutionnelle ou chez les intellectuels, enseignants, artistes. le peuple est oublié et avec l'uniformisation des modes de vie, la culture populaire qu'elle soit ouvrière ou paysanne a été détruite.
Les gilets jaunes sont ainsi exclus de la culture qui se stérilise, se développe en vase clos, ignorant une grande partie de la population.
La fracture économique, sociale, culturelle entre "élite" et "France d'en bas" s'accroît de plus en plus. C'est ce que montre ce mouvement qui refuse les élites et ne se reconnaît pas dans le système représentatif qui parle en son nom.
Le mouvement des Gilets jaunes a été longuement commenté et analysé. Les émissions spéciales télévisés, radiodiffusés, se comptent en centaine d'heures. Les hors-séries des journaux et magasines ont longtemps occupés les devantures des kiosques. Les sociologues, journalistes et essayistes ont alimenté une production éditoriale impressionnante. Il faut dire que la France n'avait pas connu un tel mouvement social depuis des décennies. Par sa durée, sa radicalité, son imprévisibilité, les Gilets Jaunes ont surpris, sidérés, de la gauche à la droite française.
Danielle Sallenave s'est penchée essentiellement sur la dichotomie mise à nue entre les Gilets Jaunes et les élites. Cette élite d'ailleurs qui ne cache plus son mépris de classe vis-à-vis des « sans dents », de « ceux qui ne sont rien », de ces « réfractaires » au changement. Fait marquant pour l'auteure, les intellectuels et les artistes de gauche ont eu aussi fait sécession : ils étaient rares à soutenir ouvertement ces révoltés.
"Mauvais républicains, ces Gilets jaunes, qui refusent la représentativité, clé du fonctionnement démocratique, et s'abstiennent aux grands scrutins. Mauvais démocrates, qui veulent s'appuyer sur la pression de la rue. Mauvais révoltés puisqu'ils ne sont même pas fichus de faire un bon service d'ordre comme la CGT." [p.13]
Le 6 décembre 2019, la CGT appelle d'ailleurs, avec une large intersyndicale, le gouvernement au « dialogue« , en condamnant « toute forme de violence dans l'expression des revendications » du mouvement. le communiqué fera bondir la base syndicale, obligeant la centrale à désavouer sa propre signature. Bernard Lavilliers, soutient historique aux luttes sociales, accuse lui le mouvement de « virer au poujadisme ». Ils sont bien seuls, les révoltés en chasubles …
Les Gilets jaunes sont peut-être difficile à comprendre quand on habite en ville : aucune difficulté à retrouver ses connaissances dans un troquet, à rejoindre un collectif, à participer à des débats lorsque l'on vit dans une grande agglomération. Choses impossibles à faire, quand on habite le périurbain, l'enfer pavillonnaire, « une ville franchisée, ni rurale, ni urbaine » [p.17], où rien n'existe – et on ne parlera même pas des services publics … Tisser du lien, se retrouver, partager, sont sans aucun doute ce qui a pu arriver de mieux à ces hommes et ces femmes qui se sont retrouvés samedi après samedi sur les ronds-points.
Alors qu'en ville, « nous nous sommes habitués à l'invisibilité des opprimés, de leurs lieux de vie, à l'effacement de la mémoire des pauvres dans les quartiers restaurés des grandes villes » [p.26], les gilets jaunes ont (re)projeté le social sur le devant de la scène politique. Ils et elles ont repris la parole et l'espace public, que plus personnes ne prenaient pour eux.
Avec le renfort de Brecht, de Michelet et de multiples intellectuels, l'auteure nous donne à voir dans ce petit texte les tensions perpétuelles qu'il existe entre les élites et le peuple.
Lien : https://delivronsnous.home.b..
Danielle Sallenave s'est penchée essentiellement sur la dichotomie mise à nue entre les Gilets Jaunes et les élites. Cette élite d'ailleurs qui ne cache plus son mépris de classe vis-à-vis des « sans dents », de « ceux qui ne sont rien », de ces « réfractaires » au changement. Fait marquant pour l'auteure, les intellectuels et les artistes de gauche ont eu aussi fait sécession : ils étaient rares à soutenir ouvertement ces révoltés.
"Mauvais républicains, ces Gilets jaunes, qui refusent la représentativité, clé du fonctionnement démocratique, et s'abstiennent aux grands scrutins. Mauvais démocrates, qui veulent s'appuyer sur la pression de la rue. Mauvais révoltés puisqu'ils ne sont même pas fichus de faire un bon service d'ordre comme la CGT." [p.13]
Le 6 décembre 2019, la CGT appelle d'ailleurs, avec une large intersyndicale, le gouvernement au « dialogue« , en condamnant « toute forme de violence dans l'expression des revendications » du mouvement. le communiqué fera bondir la base syndicale, obligeant la centrale à désavouer sa propre signature. Bernard Lavilliers, soutient historique aux luttes sociales, accuse lui le mouvement de « virer au poujadisme ». Ils sont bien seuls, les révoltés en chasubles …
Les Gilets jaunes sont peut-être difficile à comprendre quand on habite en ville : aucune difficulté à retrouver ses connaissances dans un troquet, à rejoindre un collectif, à participer à des débats lorsque l'on vit dans une grande agglomération. Choses impossibles à faire, quand on habite le périurbain, l'enfer pavillonnaire, « une ville franchisée, ni rurale, ni urbaine » [p.17], où rien n'existe – et on ne parlera même pas des services publics … Tisser du lien, se retrouver, partager, sont sans aucun doute ce qui a pu arriver de mieux à ces hommes et ces femmes qui se sont retrouvés samedi après samedi sur les ronds-points.
Alors qu'en ville, « nous nous sommes habitués à l'invisibilité des opprimés, de leurs lieux de vie, à l'effacement de la mémoire des pauvres dans les quartiers restaurés des grandes villes » [p.26], les gilets jaunes ont (re)projeté le social sur le devant de la scène politique. Ils et elles ont repris la parole et l'espace public, que plus personnes ne prenaient pour eux.
Avec le renfort de Brecht, de Michelet et de multiples intellectuels, l'auteure nous donne à voir dans ce petit texte les tensions perpétuelles qu'il existe entre les élites et le peuple.
Lien : https://delivronsnous.home.b..
S'accaparant comme tout un chacun la figure du gilet jaune, Danièle Sallenave en décrit une image correspondant à sa propre culture modeste. Au travers de cette image pleine d'humanisme et empreinte de finesse, elle propose une réflexion sur l'incompréhension collective de notre propre société et l'aveuglement des uns envers les autres. le métier du romancier apprend sans doute à transmettre par ses textes des sentiments plutôt que des seuls faits, et c'est bien là l'intérêt majeur que j'ai vu dans cette proposition d'analyse.
Le recul et la culture politique aussi de Danièle Sallenave font de cette réflexion, sans devenir pamphlet ou manifeste, un éclairage bienvenu.
Le recul et la culture politique aussi de Danièle Sallenave font de cette réflexion, sans devenir pamphlet ou manifeste, un éclairage bienvenu.
Ce livre est aussi court (42 pages) qu'il est intéressant.
On pourrait croire que, par sa condition d'Académicienne et de femme de lettres, Danièle Sallenave pourrait regarder les Gilets jaunes de haut, comme beaucoup de ces "gens d'en haut", mais il n'en est rien : a contrario, elle prend, avec un certain brio verbal, la défense des Gilets Jaunes, comprend et légitime leurs revendications de justices fiscale et sociale et mène une charge contre les politiques et certains médias qui ont tendance à dénigrer le mouvement, ce qui est contraire à l'attitude qui devrait être la leur.
Elle pose également la question et trouve des explications relativement justes au fait que certains sujets soient absents de leurs revendications comme la culture (qui, selon elle, ne s'intéresse pas assez aux personnes qui ont peu de moyens) ou l'éducation.
Cependant, il ne faut pas croire qu'elle légitime tout ce qui vient des Gilets jaunes. Elle remet l'église au milieu du village en disant que les violences qu'elles soient verbales ou physiques ont eu tendance à nuancer sa sympathie, qui, au début, était totale, envers les Gilets jaunes.
Donc, une position modérée et richement argumentée de la part de cette grande dame de lettres : soutien aux Gilets jaunes, qui ne légitime pas pour autant la violence qui émane par moment du mouvement.
On pourrait croire que, par sa condition d'Académicienne et de femme de lettres, Danièle Sallenave pourrait regarder les Gilets jaunes de haut, comme beaucoup de ces "gens d'en haut", mais il n'en est rien : a contrario, elle prend, avec un certain brio verbal, la défense des Gilets Jaunes, comprend et légitime leurs revendications de justices fiscale et sociale et mène une charge contre les politiques et certains médias qui ont tendance à dénigrer le mouvement, ce qui est contraire à l'attitude qui devrait être la leur.
Elle pose également la question et trouve des explications relativement justes au fait que certains sujets soient absents de leurs revendications comme la culture (qui, selon elle, ne s'intéresse pas assez aux personnes qui ont peu de moyens) ou l'éducation.
Cependant, il ne faut pas croire qu'elle légitime tout ce qui vient des Gilets jaunes. Elle remet l'église au milieu du village en disant que les violences qu'elles soient verbales ou physiques ont eu tendance à nuancer sa sympathie, qui, au début, était totale, envers les Gilets jaunes.
Donc, une position modérée et richement argumentée de la part de cette grande dame de lettres : soutien aux Gilets jaunes, qui ne légitime pas pour autant la violence qui émane par moment du mouvement.
Petit essai de réflexions qui a le mérite de remettre en perspective une partie du conflit des gilets jaunes. J'avais une vision très parcellaire de ce conflit qui a commencé par une taxe sur le gas-oil. L'auteur a un peu réussi à me faire voir une autre réalité, en plaçant ce mouvement dans une perspective historique au moins jusqu'à la révolution française.
« Jojo, le gilet jaune » Danièle Sallenave (42 pages, Tracts Gallimard)
Un texte qui fait du bien, signé d'une académicienne assez classique dans son écriture.
Danièle Sallenave prend ici un parti résolu pour le mouvement des gilets jaunes, sans pour autant occulter certains dérapages physiques ou verbaux. Mais elle pose la question pertinente : d'où vient la première violence ? de “ceux d'en haut”. Quelle est cette surdité des puissants, des gouvernants, à l'égard de revendications plus que légitimes de la part de celles et ceux qui sont en souffrance, relégués dans des zones vidées de toute politique publique de développement ? Et quel est ce mépris profond de la part de cette soi-disant élite intellectuelle et culturelle à l'égard de ceux qu'on prive systématiquement de parole et qui exigent d'être entendus ? Elle n'est pas très jolie jolie, cette intelligentsia, de droite ou de gauche (cf ces soi-disant progressistes laïcs qui ont tôt fait d'user de toutes les stratégies pour mettre leur progéniture dans les écoles privées), et qui se plaignent que la culture ne soit pas un sujet de préoccupation de gilets jaunes. Ils sont bien méprisants, ces gouvernants qui, tel Macron, ne comprennent pas que certains médias accordent autant de temps de parole à un « Jojo le gilet jaune » qu'à un ministre !
C'est aussi cela qui est un grand bol d'air frais dans ce « tract » d'une immortelle, cette claque à la petite bourgeoisie pseudo intellectuelle très hautaine à l'égard d'un mouvement social profond, ce rappel que les classes sociales existent, et que celle d'en bas exige fort légitimement plus de justice sociale.
Un texte qui fait du bien, signé d'une académicienne assez classique dans son écriture.
Danièle Sallenave prend ici un parti résolu pour le mouvement des gilets jaunes, sans pour autant occulter certains dérapages physiques ou verbaux. Mais elle pose la question pertinente : d'où vient la première violence ? de “ceux d'en haut”. Quelle est cette surdité des puissants, des gouvernants, à l'égard de revendications plus que légitimes de la part de celles et ceux qui sont en souffrance, relégués dans des zones vidées de toute politique publique de développement ? Et quel est ce mépris profond de la part de cette soi-disant élite intellectuelle et culturelle à l'égard de ceux qu'on prive systématiquement de parole et qui exigent d'être entendus ? Elle n'est pas très jolie jolie, cette intelligentsia, de droite ou de gauche (cf ces soi-disant progressistes laïcs qui ont tôt fait d'user de toutes les stratégies pour mettre leur progéniture dans les écoles privées), et qui se plaignent que la culture ne soit pas un sujet de préoccupation de gilets jaunes. Ils sont bien méprisants, ces gouvernants qui, tel Macron, ne comprennent pas que certains médias accordent autant de temps de parole à un « Jojo le gilet jaune » qu'à un ministre !
C'est aussi cela qui est un grand bol d'air frais dans ce « tract » d'une immortelle, cette claque à la petite bourgeoisie pseudo intellectuelle très hautaine à l'égard d'un mouvement social profond, ce rappel que les classes sociales existent, et que celle d'en bas exige fort légitimement plus de justice sociale.
Je découvre cette collection. Titre intéressant, malgré une digression.
Lien : http://aufildesimages.canalb..
Lien : http://aufildesimages.canalb..
Oeuvre salutaire, relativement "à chaud" mais écrite avec le recul qui sied à une grande dame, académicienne et - cependant - fille de l'Ecole de la République (ses parents étaient d'ailleurs instituteurs).
Une sympathie affirmée pour le mouvement des Gilets jaunes, ce que l'on peut ou non partager, mais surtout des analyses qui valent par leur acuité quant à la crise de notre société : crise de la représentation démocratique, crise de l'économie, crise de l'éducation, crise de la culture. Un dénominateur commun à tout cela, l'inégalité croissante entre ceux "d'en-haut" et ceux "d'en-bas", entre ceux qui possèdent (le statut social, l'argent, le pouvoir) et ceux qui n'ont rien ou pas grand-chose, ou qui même, pour certain Président, "ne sont rien". Les excès du mouvement sont à mesurer aussi à l'aune de cette inégalité-là.
Une quarantaine de pages ne sauraient bien sûr pallier une analyse approfondie des événements. Celle-ci viendra en son temps, mais en cette période post-Grand débat, où l'explosion soudaine de fin 2018 semble retombée, il fait bon se souvenir que tout ce qui a causé le mouvement est encore loin d'être résolu, tant la transformation attendue, si elle vient un jour, devra être nécessairement conquise de haute lutte, démocratique s'entend.
Petit livre très sain et à consulter, de même que cette nouvelle collection Gallimard qui semble promettre de bonnes choses.
Une sympathie affirmée pour le mouvement des Gilets jaunes, ce que l'on peut ou non partager, mais surtout des analyses qui valent par leur acuité quant à la crise de notre société : crise de la représentation démocratique, crise de l'économie, crise de l'éducation, crise de la culture. Un dénominateur commun à tout cela, l'inégalité croissante entre ceux "d'en-haut" et ceux "d'en-bas", entre ceux qui possèdent (le statut social, l'argent, le pouvoir) et ceux qui n'ont rien ou pas grand-chose, ou qui même, pour certain Président, "ne sont rien". Les excès du mouvement sont à mesurer aussi à l'aune de cette inégalité-là.
Une quarantaine de pages ne sauraient bien sûr pallier une analyse approfondie des événements. Celle-ci viendra en son temps, mais en cette période post-Grand débat, où l'explosion soudaine de fin 2018 semble retombée, il fait bon se souvenir que tout ce qui a causé le mouvement est encore loin d'être résolu, tant la transformation attendue, si elle vient un jour, devra être nécessairement conquise de haute lutte, démocratique s'entend.
Petit livre très sain et à consulter, de même que cette nouvelle collection Gallimard qui semble promettre de bonnes choses.
Suite au mouvement des gilets jaunes elle se pose de bonnes questions : c'est rare et remarquable pour un membre de l'intelligentsia, immortelle de surcroit. Il en faudra plus pour faire avancer le schmilblick !
Les Dernières Actualités
Voir plus

Célébration du jaune
steka
18 livres

Tracts Gallimard
jaiuneheurealire
64 livres
Autres livres de Danièle Sallenave (31)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quel froid !
Que signifie l'expression "jeter un froid" ?
Provoquer une situation désagréable de gêne où les personnes présentes ne savent pas comment réagir
Etre en désaccord ou avoir un conflit avec quelqu'un
Lancer des boules de neige sur quelqu'un
12 questions
773 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, écrivain
, roman
, politiqueCréer un quiz sur ce livre773 lecteurs ont répondu