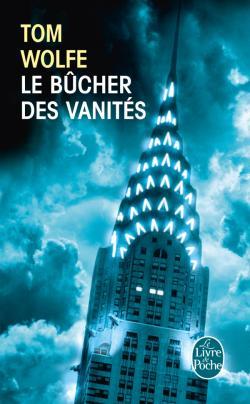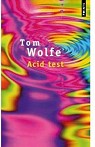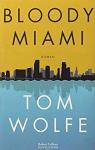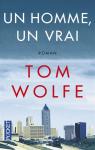Critiques filtrées sur 5 étoiles
Somptueux ! Coup de maître ! Un tableau cynique de la société où dominent les tensions raciales, la cupidité et la loi du plus fort. Foisonnant fresque avec un soin particulier pour le détail qui tue ; et qui renvoie une image déplorable de la justice. Une intrigue qui fonctionne, quelques scènes coup de poing. Au fil des pages, le lecteur construit le film dans sa tête, avec des accélérations, des montées en puissance, avec des cabotinages et dérapages tragi-comiques.
Le narrateur n'oublie jamais de préciser l'origine de chaque personnage. Voici "la pyramide sociale" : tout en haut les Wasp ; loin derrière, les irlandais et les italiens. Suivent les juifs et les noirs (cependant il y a des exceptions, comme le juge Kovitzky, qui se révèle un vrai guerrier). Sans
oublier deux intrus, un britannique et une roturière venue du sud. Aucun ne trouve grâce à ses yeux.
Un roman emblématique fin de siècle, contemporain avec American Psycho et possédant la même force de frappe.
Plutôt que des extraits, j'ai choisi deux scènes.
-->Larry Kramer, le substitut de procureur, se rend au travail dans le Bronx. Il porte un costume
gris et des Nikes et il porte ses chaussures en cuir dans un sac en plastique. Ces chaussures, il
les met une fois arrivé au travail. Cela lui attire les ricanements de ses collègues. Pourquoi chausse-t-il des tennis ? Pour pouvoir se sauver s'il se fait agresser, même s'il est un type costaud. Cela arrive touts les jours dans le Bronx, de se faire agresser. D'ailleurs dans le métro tout le monde en porte, ces tennis sont comme un panneau annonçant BAS-FONDS (page 52).
--> Lopwitz, le patron de Sherman, s'est fait construire une vraie cheminée dans son bureau, ça fait lord anglais. Ce n'était pas une mince affaire, il a dû batailler avec le gérant de l'immeuble, les pompiers et le Département d'Urbanisme, car son bureau se trouvait au 50eme étage d'une tour dépourvue de conduits de cheminée. Finalement, suite à un investissement de 350 000 $, il se réjouit de sa cheminée avec un vrai manteau de bois sculpté. Mais son bonheur fut de courte durée et il dut arrêter de l'utiliser à cause de punaises. Des morsures des punaises aux fesses ! Les bêtes sont arrivées avec le bois de feu (page 584).
Le narrateur n'oublie jamais de préciser l'origine de chaque personnage. Voici "la pyramide sociale" : tout en haut les Wasp ; loin derrière, les irlandais et les italiens. Suivent les juifs et les noirs (cependant il y a des exceptions, comme le juge Kovitzky, qui se révèle un vrai guerrier). Sans
oublier deux intrus, un britannique et une roturière venue du sud. Aucun ne trouve grâce à ses yeux.
Un roman emblématique fin de siècle, contemporain avec American Psycho et possédant la même force de frappe.
Plutôt que des extraits, j'ai choisi deux scènes.
-->Larry Kramer, le substitut de procureur, se rend au travail dans le Bronx. Il porte un costume
gris et des Nikes et il porte ses chaussures en cuir dans un sac en plastique. Ces chaussures, il
les met une fois arrivé au travail. Cela lui attire les ricanements de ses collègues. Pourquoi chausse-t-il des tennis ? Pour pouvoir se sauver s'il se fait agresser, même s'il est un type costaud. Cela arrive touts les jours dans le Bronx, de se faire agresser. D'ailleurs dans le métro tout le monde en porte, ces tennis sont comme un panneau annonçant BAS-FONDS (page 52).
--> Lopwitz, le patron de Sherman, s'est fait construire une vraie cheminée dans son bureau, ça fait lord anglais. Ce n'était pas une mince affaire, il a dû batailler avec le gérant de l'immeuble, les pompiers et le Département d'Urbanisme, car son bureau se trouvait au 50eme étage d'une tour dépourvue de conduits de cheminée. Finalement, suite à un investissement de 350 000 $, il se réjouit de sa cheminée avec un vrai manteau de bois sculpté. Mais son bonheur fut de courte durée et il dut arrêter de l'utiliser à cause de punaises. Des morsures des punaises aux fesses ! Les bêtes sont arrivées avec le bois de feu (page 584).
Très beau roman grâce à la rencontre avec SHerman héro pour quelques pages de ce roman qui voit sa vie basculer. Un maître de l'univers qui travaille à Wall street qu'on rencontre à quatre pattes en train d'essayer de passer une laisse à son chien pour le promener. C'est la seule chose qu'il a trouvé pour aller passer un coup de fil à sa maîtresse.
Un soir, alors qu'il est en voiture avec cette maîtresse, perdus dans le Bronx, ils heurtent quelque chose. C'est en lisant les journaux qu'il apprend qu'ils ont heurté un jeune homme noir qui est dans le coma.
C'est alors une lente déchéance pour Sherman victime de sa propre cupidité (voir stupidité) orchestrée par un révérend un peu magouilleur, un journaliste alcoolique, des enquêteurs pas très motivés mais poussés par un procureur qui veut se faire réélire et un substitut du procureur moyen qui fantasme sur beaucoup de femmes à part la sienne qui vient d'accoucher. On assiste à un acharnement de la presse et du procureur pour satisfaire le peuple qui gronde et pour qui Sherman représente la classe privilégiée le blanc riche qui habite la Vème avenue et qu'il faut abattre pour rendre justice.
Les soutiens de Sherman sont réduits, sa femme apprenant la tromperie n'est pas très coopérative, ceux qui se présentent à sa porte sont en fait des opportunistes. Son seul atout se révèle être un avocat que j'ai eu du mal à cerner au début impuissant, désintéressé, profiteur ...
C'est un tableau un peu ragoutant de la justice qui est dépeinte, une justice manipulée selon les procureurs en place où enquêteurs et avocats se doivent des services, passent des contrats. Un tableau de New York où chacun se positionne selon sa communauté.
Il y a des tirades sublimes des personnages qui analysent le monde dans lequel ils vivent, des scènes habilement orchestrées avec le pauvre Sherman qu'on prend en pitié tant il est malmené, humilié avant d'être déterminé à se défendre.
Lien : https://www.babelio.com/monp..
Un soir, alors qu'il est en voiture avec cette maîtresse, perdus dans le Bronx, ils heurtent quelque chose. C'est en lisant les journaux qu'il apprend qu'ils ont heurté un jeune homme noir qui est dans le coma.
C'est alors une lente déchéance pour Sherman victime de sa propre cupidité (voir stupidité) orchestrée par un révérend un peu magouilleur, un journaliste alcoolique, des enquêteurs pas très motivés mais poussés par un procureur qui veut se faire réélire et un substitut du procureur moyen qui fantasme sur beaucoup de femmes à part la sienne qui vient d'accoucher. On assiste à un acharnement de la presse et du procureur pour satisfaire le peuple qui gronde et pour qui Sherman représente la classe privilégiée le blanc riche qui habite la Vème avenue et qu'il faut abattre pour rendre justice.
Les soutiens de Sherman sont réduits, sa femme apprenant la tromperie n'est pas très coopérative, ceux qui se présentent à sa porte sont en fait des opportunistes. Son seul atout se révèle être un avocat que j'ai eu du mal à cerner au début impuissant, désintéressé, profiteur ...
C'est un tableau un peu ragoutant de la justice qui est dépeinte, une justice manipulée selon les procureurs en place où enquêteurs et avocats se doivent des services, passent des contrats. Un tableau de New York où chacun se positionne selon sa communauté.
Il y a des tirades sublimes des personnages qui analysent le monde dans lequel ils vivent, des scènes habilement orchestrées avec le pauvre Sherman qu'on prend en pitié tant il est malmené, humilié avant d'être déterminé à se défendre.
Lien : https://www.babelio.com/monp..
Lorsque le bûcher des vanités est sorti, il y a tout jute trente ans, le monde littéraire s'est arrêté de tourner un moment, sidéré par l'impact incroyable de ce roman qui ne ressemblait à rien d'autre; à rien !
Trois décennies plus tard, ce chef-c'oeuvre n'a pas perdu une miette de sa force, de sa puissance et doit être considéré comme un des grands romans américains du XX° siècle.
Que vous découvriez ce monstre en format broché (700 pages, un bon kilo et demi) ou en édition poche (plus de 900 pages), vous serez d'abord impressionné par sa dimension physique.
Mais cette impression sera vite effacé par le choc que vous recevrez en pleine tronche dès que vous aurez lu la première page et que vous aurez été confronté au style de Tom Wolfe.
Des phrases parlées pleines de points de suspension, d'exclamation , des dialogues bourrées d'onomatopées, un rythme syncopé qui colle au plus prêt de la réalité audible, comme si l'auteur cherchait à vous faire voir l'histoire qu'il vient décrire.
Wolfe venait du journalisme. Avec ce livre, il a inventé un style inimitable immédiatement reconnaissable, comme s'il transcrivait tout simplement sur le papier les sons et les ambiances enregistrés préalablement sur une bande magnéto.
Tiens, je vous en mettrais bien un bout, pour le plaisir, mais c'est un peu contre mes principes, à vous d'aller découvrir ! Je vous l'assure : vous ne risquez pas d'être déçu !
Lire la suite de ma critique sur le site le Tourne Page
Lien : http://www.letournepage.com/..
Trois décennies plus tard, ce chef-c'oeuvre n'a pas perdu une miette de sa force, de sa puissance et doit être considéré comme un des grands romans américains du XX° siècle.
Que vous découvriez ce monstre en format broché (700 pages, un bon kilo et demi) ou en édition poche (plus de 900 pages), vous serez d'abord impressionné par sa dimension physique.
Mais cette impression sera vite effacé par le choc que vous recevrez en pleine tronche dès que vous aurez lu la première page et que vous aurez été confronté au style de Tom Wolfe.
Des phrases parlées pleines de points de suspension, d'exclamation , des dialogues bourrées d'onomatopées, un rythme syncopé qui colle au plus prêt de la réalité audible, comme si l'auteur cherchait à vous faire voir l'histoire qu'il vient décrire.
Wolfe venait du journalisme. Avec ce livre, il a inventé un style inimitable immédiatement reconnaissable, comme s'il transcrivait tout simplement sur le papier les sons et les ambiances enregistrés préalablement sur une bande magnéto.
Tiens, je vous en mettrais bien un bout, pour le plaisir, mais c'est un peu contre mes principes, à vous d'aller découvrir ! Je vous l'assure : vous ne risquez pas d'être déçu !
Lire la suite de ma critique sur le site le Tourne Page
Lien : http://www.letournepage.com/..
Ouf, après deux mois de lecture, je viens de terminer mon premier roman de Tom Wolfe !
Comment résumer ? Je dirai que c'est un roman bourdieusien sur la vie New-Yorkaise des années 80-90 où s'affrontent différents champs sociaux en quête d'un peu de pouvoir... à n'importe quel prix !
On s'imagine tout le travail d'investigation qu'a dû abattre Tom Wolfe pour peindre avec réalisme les différents aspects de la société new-yorkaise.
J'espère retrouver ce style, ce travail de description de la société américaine dans les autres romans de Tom Wolfe, en tout cas c'est une belle découverte depuis le temps que je l'avais dans ma bibliothèque !
Comment résumer ? Je dirai que c'est un roman bourdieusien sur la vie New-Yorkaise des années 80-90 où s'affrontent différents champs sociaux en quête d'un peu de pouvoir... à n'importe quel prix !
On s'imagine tout le travail d'investigation qu'a dû abattre Tom Wolfe pour peindre avec réalisme les différents aspects de la société new-yorkaise.
J'espère retrouver ce style, ce travail de description de la société américaine dans les autres romans de Tom Wolfe, en tout cas c'est une belle découverte depuis le temps que je l'avais dans ma bibliothèque !
Shermann McCoy est un "maitre de l'univers" : richissime, marié à une femme magnifique, père d'une fille qu'il aime par dessus tout, le plus grand vendeur d'obligation de NY, il est à l'apogée de sa vie.
Mais ce cher Shermann a un soir un accident : sa voiture renverse un jeune noir.
Et en ces temps d'élections municipales à NY, il fait bon pour les sondages épingler pour homicide un riche blanc de parc avenue pour la mort d'un jeune homme noir brillant promis à bel avenir...
Voilà donc Shermann McCoy en pleine descente aux enfers...
Quel pavet! Je suis ravie d'en être enfin venue à bout. Et pourtant, j'ai adoré la lecture de ce livre. Mais il faut bien avouer que ce Tom Wolfe est tout de même très bavard... Cela est probablement lié au fait que l'histoire a initialement été écrite pour être publiée par épisodes dans un magasine américain.
Le bûcher des vanités, c'est la critique de tous ces journalistes, politiques, people, qui s'engouffrent dans ce scandale pour en tirer profit. Ils se targuent d'amener sur le bûcher notre héros au nom d'une justice sociale au détriment de la vérité.
Ce livre est triste, je n'ai d'ailleurs pas compris la fin, je suis ouverte à une discussion pour avoir vos avis! Mais qu'est-ce qu'il est passionnant! Et plus on avance, plus ça s'accélère.
C'est une merveille à n'en pas douter.
Lien : http://piccolanay.blogspot.f..
Mais ce cher Shermann a un soir un accident : sa voiture renverse un jeune noir.
Et en ces temps d'élections municipales à NY, il fait bon pour les sondages épingler pour homicide un riche blanc de parc avenue pour la mort d'un jeune homme noir brillant promis à bel avenir...
Voilà donc Shermann McCoy en pleine descente aux enfers...
Quel pavet! Je suis ravie d'en être enfin venue à bout. Et pourtant, j'ai adoré la lecture de ce livre. Mais il faut bien avouer que ce Tom Wolfe est tout de même très bavard... Cela est probablement lié au fait que l'histoire a initialement été écrite pour être publiée par épisodes dans un magasine américain.
Le bûcher des vanités, c'est la critique de tous ces journalistes, politiques, people, qui s'engouffrent dans ce scandale pour en tirer profit. Ils se targuent d'amener sur le bûcher notre héros au nom d'une justice sociale au détriment de la vérité.
Ce livre est triste, je n'ai d'ailleurs pas compris la fin, je suis ouverte à une discussion pour avoir vos avis! Mais qu'est-ce qu'il est passionnant! Et plus on avance, plus ça s'accélère.
C'est une merveille à n'en pas douter.
Lien : http://piccolanay.blogspot.f..
Ce long roman (702 pages) de l'écrivain états-unien Tom Wolfe (1930-2018) nous raconte la triste aventure de Sherman McCoy, le meilleur vendeur d'obligations de Pierce & Pierce.
Sherman est donc un habitant fortuné de Manhattan, l'île au sud de New-York, qui semble rouler droit dans la vie, sur la file de gauche et plus vite que nous (en tout cas plus vite que moi). Un soir, ce qui devait arriver arrive : Sherman rate la sortie sur l'autoroute, et se perd dans "la jungle", c'est-à-dire dans le quartier du Bronx, situé plus au nord, où il ne va jamais.
La suite est une extraordinaire histoire new-yorkaise, ville dont toutes les couches sociales sont dépeintes avec précision et avec une ironie très plaisante, car elle reste au service de l'histoire. le roman est vertigineux et effrayant, montrant ce que peut rapidement devenir la vie d'un homme dans une ville où les écarts de revenus sont gigantesques et où le communautarisme crée des ghettos. La Justice peut-elle rester aveugle et maintenir l'égalité des citoyens devant la Loi quand des forces puissantes, telles que la presse et la politique, s'emparent d'un triste fait divers ?
Techniquement, le roman est excellent (rythme, découpage, profondeur), il n'y a guère que l'excès de description des vêtements portés par les personnes qui m'a un peu fatigué, car c'est vraiment systématique. Les personnages semblent plus vrais que nature, leurs ambitions et leurs vanités s'entrechoquent et une chose est sûre : certains s'y brûleront.
Sherman est donc un habitant fortuné de Manhattan, l'île au sud de New-York, qui semble rouler droit dans la vie, sur la file de gauche et plus vite que nous (en tout cas plus vite que moi). Un soir, ce qui devait arriver arrive : Sherman rate la sortie sur l'autoroute, et se perd dans "la jungle", c'est-à-dire dans le quartier du Bronx, situé plus au nord, où il ne va jamais.
La suite est une extraordinaire histoire new-yorkaise, ville dont toutes les couches sociales sont dépeintes avec précision et avec une ironie très plaisante, car elle reste au service de l'histoire. le roman est vertigineux et effrayant, montrant ce que peut rapidement devenir la vie d'un homme dans une ville où les écarts de revenus sont gigantesques et où le communautarisme crée des ghettos. La Justice peut-elle rester aveugle et maintenir l'égalité des citoyens devant la Loi quand des forces puissantes, telles que la presse et la politique, s'emparent d'un triste fait divers ?
Techniquement, le roman est excellent (rythme, découpage, profondeur), il n'y a guère que l'excès de description des vêtements portés par les personnes qui m'a un peu fatigué, car c'est vraiment systématique. Les personnages semblent plus vrais que nature, leurs ambitions et leurs vanités s'entrechoquent et une chose est sûre : certains s'y brûleront.
Oh que j'ai ri! Et croyez-moi, non seulement cela fait du bien mais quant à faire rire leur public, peu d'auteurs s'y entendent aussi bien. Jonathan Coe fait pâle figure à côté de Tom Wolfe! En effet si la lecture des romans de J.Coe fait sourire, celle du Bûcher des Vanités nous fait souvent éclater de rire.
Le roman est truffé de "rayons x" (femmes décharnées au point que si on leur mettait un niveau dans le dos, rien ne ressortirait, de "tartes jaunes", équivalent de nos "blondes oxygénées" mais combien plus imagées, de tennis Reebok qui doivent être "blanches-toutes-neuves-sorties-de-la-boîte". le malfrat en a "deux paires de neuves par semaine", ("lui demander de sortir de Rikers sans ses Reebok blanches, c'était comme de demander à une diva de se raser le crâne"), le tout le plus souvent en italiques, ce qui est encore plus drôle, doublement drôle.
C'est un grand délire de A à Z. le monde des affaires, les soirées mondaines ("HOHOHOHO, HEHEHEHE, HAHAHAHA), la justice, le racisme, tout est passé à la moulinette de l'humour. Oh le Juge Kovitsky! " un homme mince et chauve au nez en bec d'aigle et en robe noire". Il abaisse la tête et on lui voit le blanc des yeux..."Il s'attendait à ce qu'il explose encore, mais à la place il fit quelque chose de bien plus déconcertant. Il sourit. Sa tête était baissée, son bec était sorti, ses iris faisaient de l'hydroglisseur sur l'océan".
Ainsi l'on progresse jusqu'au climax, sans pause.
Je ne sais pas si Tom Wolfe a emprunté son titre à La Foire aux Vanités de Thackeray, je ne l'ai pas lu (en revanche je vous conseille Les Tours de Barchester, très très drôle), un roman moraliste inspiré par le Voyage du Pèlerin de John Bunyan : une foire perpétuelle se tenant dans une ville nommée « Vanité », qui est censée représenter le péché d'attachement des hommes aux choses de ce monde.
Sauf si l'on considère la 2° partie du titre : "La Foire aux Vanités, un roman sans héros".
Le roman est truffé de "rayons x" (femmes décharnées au point que si on leur mettait un niveau dans le dos, rien ne ressortirait, de "tartes jaunes", équivalent de nos "blondes oxygénées" mais combien plus imagées, de tennis Reebok qui doivent être "blanches-toutes-neuves-sorties-de-la-boîte". le malfrat en a "deux paires de neuves par semaine", ("lui demander de sortir de Rikers sans ses Reebok blanches, c'était comme de demander à une diva de se raser le crâne"), le tout le plus souvent en italiques, ce qui est encore plus drôle, doublement drôle.
C'est un grand délire de A à Z. le monde des affaires, les soirées mondaines ("HOHOHOHO, HEHEHEHE, HAHAHAHA), la justice, le racisme, tout est passé à la moulinette de l'humour. Oh le Juge Kovitsky! " un homme mince et chauve au nez en bec d'aigle et en robe noire". Il abaisse la tête et on lui voit le blanc des yeux..."Il s'attendait à ce qu'il explose encore, mais à la place il fit quelque chose de bien plus déconcertant. Il sourit. Sa tête était baissée, son bec était sorti, ses iris faisaient de l'hydroglisseur sur l'océan".
Ainsi l'on progresse jusqu'au climax, sans pause.
Je ne sais pas si Tom Wolfe a emprunté son titre à La Foire aux Vanités de Thackeray, je ne l'ai pas lu (en revanche je vous conseille Les Tours de Barchester, très très drôle), un roman moraliste inspiré par le Voyage du Pèlerin de John Bunyan : une foire perpétuelle se tenant dans une ville nommée « Vanité », qui est censée représenter le péché d'attachement des hommes aux choses de ce monde.
Sauf si l'on considère la 2° partie du titre : "La Foire aux Vanités, un roman sans héros".
Un roman majeur, pour ingrédient des personnages vrais et percutants : le maître de l'univers avec vie de rêve (femme enfant appart sur Park Avenue) l'adjoint au procureur qui cherche à s'affirmer, toute sa carrière (avec le salaire) dans le Bronx un journaliste un peu débraillé limite looser à l'affut du gros scoop le révérend noir qui manifeste pour leur cause dans un climat d'injustice sociale. Tom Wolfe, cinquantaine, journaliste de profession, signe ce premier roman, mélange tous ces ingrédients ajoute le mauvais accident de la route et tout explose. Car aucun de ses personnages dans cette confrontation des mondes ne va lâcher _ comme dit le titre. 900 pages où je n'ai rien lâché jusqu'à la dernière page. Et d'ailleurs où est le bien où est le mal ?
Une jungle ou une fosse d'aisance. Pleine d'animaux sauvages ou de merde. Où l'on discute de la loi, où l'on vit de l'outrage. Approchons-nous de la ville, de New York, de sa skyline aux allures de mythe mondial, de cette représentation tout en reflets et en verticalité du capitalisme dont elle est la preuve la plus formidable de son triomphe. Laissons derrière nous les quartiers de Tribeca, de Chelsea, puis Central Park et l'Upper East Side. La question "est-ce toujours New York ?" trouve une étonnante réponse positive, suivie d'une précision qui a son importance : c'est le Bronx. L'ancien borough italien et juif est peuplé très majoritairement de populations hispaniques et afro-américaines, et pauvres. C'est dans ces ruelles qu'un soir, en rentrant de l'aéroport où il a été chercher sa maîtresse, Maria Ruskin, Sherman McCoy se perd au volant de sa Mercedes. Sans que les circonstances ni que les intentions des protagonistes ne soient très claires, Maria, au volant, heurte un jeune homme Noir, Henry Lamb. L'affaire, révélée par le journal City Light, devient alors le diagnostic d'une ville en réalité malade. Malade des écarts de richesse, malade de la question raciale, malade d'une fausseté qui éclabousse tout, de la promesse du rêve américain à la réalité de celui-ci. Sur le bûcher des vanités, l'accusé n'est pas tant McCoy que le système dont il est le fruit.
Sherman McCoy et Henry Lamb sont les deux visages d'un même personnage nommé New York. McCoy est l'archétype du golden boy des années 1980, dont les revenus dépassent de loin tout ce que la génération précédente - représentée par le père de McCoy, un avocat surnommé le Lion - pouvait imaginer. McCoy habite Park Avenue, dans l'Upper East Side, dans un appartement gigantesque à la valeur faramineuse, avec son épouse Judy et leur fille, Campbell. Judy est décoratrice d'intérieur. Elle expose leur appartement dans les plus chics magazines dédiés. McCoy, lui, est l'un de ces financiers de Wall Street dont les émoluments approchent le million de dollars annuel. Réactif et perspicace, il donne des ordres d'achat et de vente à plusieurs zéros, parle à Tokyo et à Paris, joue avec la dette des États. Selon ses propres mots, telles ces figurines horriblement musculeuses, il est un Maître de l'Univers. A bien des égards, sa victime, Henry Lamb peut aussi apparaître comme méritant. Orphelin de père, le jeune homme vit dans une cité difficile du Bronx. Ses faits de gloire sont simples : écouter en cours et ne pas avoir de casier judiciaire. Lamb et McCoy sont New York. Comme le sont les autres personnages. Ce que dessine Wolfe dans ce roman, c'est d'abord le portrait vivant d'une ville. Pour le vivant, Wolfe s'attache à décrire plusieurs personnages, chacun représentatif d'un corps de métier, d'une identité, d'une raison d'être. Défilent et reviennent les inspecteurs Martin et Goldberg, le procureur Abe Weiss, le juge Kovitsky, l'avocat Thomas Killian, le révérend et leader politique Bacon, le journaliste britannique Fallow, le substitut du procureur Larry Kramer : la faune new-yorkaise est irlandaise, juive, afro-américaine ; elle est revendicative, combative, rude, opportuniste, hypocrite, suffisante, populeuse, rupine. Pour le portrait, Tom Wolfe dessine des tableaux. Ce sont des saynètes de cette vie new-yorkaise, qui donnent à voir cette prodigalité qui fait que la ville est la plus enviée et la plus scrutée au monde. Wolfe nous entraîne dans la salle des obligations de Pierce & Pierce, royaume de la furie financière et de la derby brillante, puis au dîner mondain des si bien nommés Bavardage, où les Tartes (de jeunes femmes dont le principal intérêt ne réside pas dans la conversation) croisent les Rayons X (les épouses aux corps amaigris, mis en valeur par des vêtements hors de prix) et leurs époux, gloires masculines, réussites financières ou intellectuelles que l'âge affadit ; sous les masques et les faux rires se devine l'hypocrisie d'une mondanité exagérée. On assiste aussi au défilé des avocats à la recherche d'un client dans le hall du tribunal, puis on file à une manifestation organisée par les sbires de Bacon, qui n'est qu'une mise en scène organisée pour les besoins des chaînes de télévision. New York est un monstre, un labyrinthe, dont l'affaire McCoy serait un plan pour le découvrir, ou tenter de s'y retrouver.
New York est un monstre, mais un monstre malade. La ville est un paradoxe tout entier, reflété par sa géographie. Au sud est le Manhattan blanc et riche, celui de Wall Street, celui des cabinets d'avocats, des soirées mondaines, des écoles privées hors de prix, des pied-à-terre sur Long Island, des copropriétés aux prestations de haute gamme, aux halls de marbre et aux chemins de fleurs, sur les tables, à plusieurs milliers de dollars. Au nord, par-delà Harlem, c'est le Bronx noir et hispanique, celui des rois du crack, celui de la langue espagnole, celui des écoles publiques sans vrais objectifs pédagogiques, celui des salaires annuels à cinq chiffres à peine. Dans ce Bronx noir existe pourtant un îlot blanc, une forteresse comme aime le dire Larry Kramer : le tribunal. La rencontre entre Henry Lamb et la Mercedes de Sherman McCoy, si elle est improbable, montre à quel point cette ville dysfonctionne. La question sociale s'y dédouble d'une question raciale, et c'est c'est bien sur ce double argument que se base la revendication de justice du révérend Bacon et, à sa suite, Abe Weiss et Larry Kramer. Ce n'est pas tant le délit de fuite de McCoy que ces derniers veulent juger, mais bien l'impunité supposée d'un riche Blanc qui écrase un Noir pauvre. New York est malade, même si elle resplendit. Toutes les laideurs s'effacent sur le champ de course où chacun tente sa chance pour atteindre les honneurs. Tous les moyens sont bons, y compris ceux qui peuvent mener au déshonneur, du moment que les apparences sont avantageuses. On voit un substitut du procureur se servir de ses plaidoiries pour impressionner une jeune femme qu'il veut conquérir. On voit un procureur prêt à bâcler une enquête pour garantir sa réélection. On voit un journaliste, fat et dédaigneux des Américains dont il profite pourtant, Britannique supposément homme de goût mais fondamentalement alcoolique, qui se jette sur la viande avariée d'une affaire pourrie comme une mouche se repaît d'un mets dégoûtant. Tout ici démontre que la vie new-yorkaise est un jeu, où chacun joue selon ses propres atouts. Pour l'un, le terrain de jeu sera les marchés financiers, où sentir les bons coups et les gros gains vous fait devenir le numéro un des vendeurs. Pour un autre, ce sera les arcanes de la loi, la connaissance des juges, et les dépôts qu'il aura faits à la Banque des Faveurs pour, au jour J, pouvoir bénéficier en retour d'un coup de pouce. Pour une autre, ce sera les hommes, et l'irrésistible attrait qu'elle exerce sur eux. New York est un pari, où beaucoup perdent, mais qu'importe, quand la ville, elle, gagne ? Au-delà du monstre, la ville est un gouffre. Elle est le lieu du cannibalisme social, car elle se nourrit de ceux qui tombent de son sommet. Ceux qui, comme McCoy, connaissent la chute, sont promis à une mort professionnelle, économique et sociale. La mise à mort est assurée par les autres membres de ce corps difforme et monstrueux, chacun agissant selon ses intérêts qu'il maquille, au choix, sous le fard de la morale, de la justice, de l'intelligence, et jamais sous celui de l'orgueil (Fallow), du désir sexuel (Kramer) ou de la survie professionnelle (Weiss).
Il est toutefois des questions profondes posées par ce roman. Car le drame de Henry Lamb, premièrement, brise la surface lisse des apparences pour montrer la fausseté non seulement des personnages, mais aussi du système. D'ailleurs, si les personnages agissent si lâchement, c'est que le système, non seulement les y autorise, mais les encourage. McCoy, le premier d'entre eux, est pris au piège de sa tromperie vis-à-vis de son épouse, mais aussi pris au piège de son racisme ordinaire, vis-à-vis de la société et de la justice. Ce qu'il ne peut pas dire, c'est qu'il a pris peur parce que les deux jeunes gens devant sa voiture étaient Noirs, et uniquement pour ça. Bûcher des vanités, bal des hypocrites, où tout le monde a une bonne raison pour faire ce qu'il fait, et pour le sublimer. Ainsi ,pour McCoy, sa rencontre nocturne fut un combat dans la jungle. Larry Kramer, lui, vit dans la frustration de ses 36000 dollars annuels. Lui-même opprimé par un système de justice déshumanisant, il se réjouit des sandwichs gratuits les jours de procès, et des débouchés sexuels que peut lui offrir sa position par rapport aux jolies membres des jurys. le révérend Bacon, lui, détourne l'argent du diocèse, et c'est un redoutable politique. le culte du lisse, vu sous l'angle des dollars, de l'agencement des intérieurs et de l'élégance - ou non - des vêtements se fissure avec cette affaire McCoy. Une question surgit : si tout cela est faux, où est le vrai ? Fallow lèverait alors la main, son journal dans l'autre : une vérité crue, sordide selon les détails, cruelle pour ceux qu'elle pousse sur la place publique. Mais les médias - presse et télévision - n'offrent qu'une vision étriquée de la réalité, qui doit correspondre à leurs intérêts, en premier lieu économique. Où est la vérité, où est la justice, puisque les deux sont liés, et où ces deux concepts peuvent-ils bien se trouver si on ne les croise même plus au tribunal du Bronx, où le procureur Weiss et le substitut Kramer mènent en réalité une campagne politique ? Pour peu qu'ils existent encore, ces deux concepts semblent avoir été travestis par New York. Manipulés par les groupes sociaux en fonction de leurs intérêts, ils sont des valeurs phares au nom desquelles toute conduite individuelle et collective trouve une justification. Vérité et justice deviennent alors des prises de guerre dans ce qui apparaît fondamentalement comme une lutte politique. Vérité et justice définissent, en réalité, des rapports de pouvoir. Justice blanche, clament les soutiens du révérend Bacon ; justice universelle, répond Abe Weiss qui y voit un moyen de sa réélection. La vérité et la justice appartiennent à ceux qui détiennent le pouvoir : ainsi Kramer croit-il se servir du sien pour faire triompher, au-delà de la justice due à une communauté, sa propre carrière. Dans l'océan de mensonge, toutefois, apparaissent quelques bouées de vérité. le juge Kovitsky, est l'une d'elles.
Ne demeure alors que la morale, dont McCoy a des réminiscences, d'abord liées à son milieu social - il convient d'avoir une prononciation et une grammaire parfaites, il convient de ne pas demeurer seul à un dîner mondain, il convient que le petit personnel reste à sa place - puis aux actes qu'il commet. Il pense d'abord - mais Maria Ruskin l'en dissuade - à se dénoncer auprès de la police pour avoir renversé Henry Lamb puis, au moment de se défendre, la honte l'assaille souvent. D'abord parce que lui, le Maître de l'Univers, connaît l'intimité des cages sombres et violentes du tribunal, où ses chemises bien coupées le désignent comme inférieur (en force physique ou mentale) aux autres ; ensuite parce que, pour prouver son innocence, McCoy doit utiliser la ruse et la trahison, armes dont d'autres, avant, se sont servis contre lui (le financier français pour le Giscard d'or, Maria qui part en Italie). Enfin parce que sa dégringolade n'est pas seulement personnelle : c'est aussi en tant que mari, et surtout en tant que père, que McCoy perd sa position. de façon paradoxale mais assez logique d'un point de vue chrétien, c'est au fond du gouffre, sans ses revenus, sans sa fonction de père, que la vraie dimension morale de McCoy apparaît. Pris dans l'engrenage d'une justice aveugle pour de mauvaises raisons - sa cécité est liée à des intérêts politiques -, McCoy éprouve dans sa chair l'hypocrisie de son milieu - le président du syndic qui lui demande de quitter les lieux, l'ancienne amie qui se propose de vendre leur superbe appartement, l'appétit voyeur de la bonne société pour le récit glauque de Sherman sur sa courte expérience carcérale - et la violence du système. A ce titre, l'épisode de l'emprisonnement très temporaire de McCoy est d'une brutalité effrayante, et l'humiliation infligée est la plus totale. L'humiliation, ici, doit d'ailleurs être comprise à son sens littéral : ce qui rend humble. C'est aussi ce qui fait retrouver à McCoy sa dignité noyée autrefois dans les dollars et la suffisance. C'est cela qui lui fait affronter, à la fin du roman, une foule prête pourtant à le lyncher. C'est cela qui le fait redevenir humain. Car Sherman McCoy l'a compris : il n'y a pas que le Bronx qui est une jungle ; c'est New York toute entière qui l'est. Et dans la jungle n'existe qu'une seule loi : celle du plus fort.
Sherman McCoy et Henry Lamb sont les deux visages d'un même personnage nommé New York. McCoy est l'archétype du golden boy des années 1980, dont les revenus dépassent de loin tout ce que la génération précédente - représentée par le père de McCoy, un avocat surnommé le Lion - pouvait imaginer. McCoy habite Park Avenue, dans l'Upper East Side, dans un appartement gigantesque à la valeur faramineuse, avec son épouse Judy et leur fille, Campbell. Judy est décoratrice d'intérieur. Elle expose leur appartement dans les plus chics magazines dédiés. McCoy, lui, est l'un de ces financiers de Wall Street dont les émoluments approchent le million de dollars annuel. Réactif et perspicace, il donne des ordres d'achat et de vente à plusieurs zéros, parle à Tokyo et à Paris, joue avec la dette des États. Selon ses propres mots, telles ces figurines horriblement musculeuses, il est un Maître de l'Univers. A bien des égards, sa victime, Henry Lamb peut aussi apparaître comme méritant. Orphelin de père, le jeune homme vit dans une cité difficile du Bronx. Ses faits de gloire sont simples : écouter en cours et ne pas avoir de casier judiciaire. Lamb et McCoy sont New York. Comme le sont les autres personnages. Ce que dessine Wolfe dans ce roman, c'est d'abord le portrait vivant d'une ville. Pour le vivant, Wolfe s'attache à décrire plusieurs personnages, chacun représentatif d'un corps de métier, d'une identité, d'une raison d'être. Défilent et reviennent les inspecteurs Martin et Goldberg, le procureur Abe Weiss, le juge Kovitsky, l'avocat Thomas Killian, le révérend et leader politique Bacon, le journaliste britannique Fallow, le substitut du procureur Larry Kramer : la faune new-yorkaise est irlandaise, juive, afro-américaine ; elle est revendicative, combative, rude, opportuniste, hypocrite, suffisante, populeuse, rupine. Pour le portrait, Tom Wolfe dessine des tableaux. Ce sont des saynètes de cette vie new-yorkaise, qui donnent à voir cette prodigalité qui fait que la ville est la plus enviée et la plus scrutée au monde. Wolfe nous entraîne dans la salle des obligations de Pierce & Pierce, royaume de la furie financière et de la derby brillante, puis au dîner mondain des si bien nommés Bavardage, où les Tartes (de jeunes femmes dont le principal intérêt ne réside pas dans la conversation) croisent les Rayons X (les épouses aux corps amaigris, mis en valeur par des vêtements hors de prix) et leurs époux, gloires masculines, réussites financières ou intellectuelles que l'âge affadit ; sous les masques et les faux rires se devine l'hypocrisie d'une mondanité exagérée. On assiste aussi au défilé des avocats à la recherche d'un client dans le hall du tribunal, puis on file à une manifestation organisée par les sbires de Bacon, qui n'est qu'une mise en scène organisée pour les besoins des chaînes de télévision. New York est un monstre, un labyrinthe, dont l'affaire McCoy serait un plan pour le découvrir, ou tenter de s'y retrouver.
New York est un monstre, mais un monstre malade. La ville est un paradoxe tout entier, reflété par sa géographie. Au sud est le Manhattan blanc et riche, celui de Wall Street, celui des cabinets d'avocats, des soirées mondaines, des écoles privées hors de prix, des pied-à-terre sur Long Island, des copropriétés aux prestations de haute gamme, aux halls de marbre et aux chemins de fleurs, sur les tables, à plusieurs milliers de dollars. Au nord, par-delà Harlem, c'est le Bronx noir et hispanique, celui des rois du crack, celui de la langue espagnole, celui des écoles publiques sans vrais objectifs pédagogiques, celui des salaires annuels à cinq chiffres à peine. Dans ce Bronx noir existe pourtant un îlot blanc, une forteresse comme aime le dire Larry Kramer : le tribunal. La rencontre entre Henry Lamb et la Mercedes de Sherman McCoy, si elle est improbable, montre à quel point cette ville dysfonctionne. La question sociale s'y dédouble d'une question raciale, et c'est c'est bien sur ce double argument que se base la revendication de justice du révérend Bacon et, à sa suite, Abe Weiss et Larry Kramer. Ce n'est pas tant le délit de fuite de McCoy que ces derniers veulent juger, mais bien l'impunité supposée d'un riche Blanc qui écrase un Noir pauvre. New York est malade, même si elle resplendit. Toutes les laideurs s'effacent sur le champ de course où chacun tente sa chance pour atteindre les honneurs. Tous les moyens sont bons, y compris ceux qui peuvent mener au déshonneur, du moment que les apparences sont avantageuses. On voit un substitut du procureur se servir de ses plaidoiries pour impressionner une jeune femme qu'il veut conquérir. On voit un procureur prêt à bâcler une enquête pour garantir sa réélection. On voit un journaliste, fat et dédaigneux des Américains dont il profite pourtant, Britannique supposément homme de goût mais fondamentalement alcoolique, qui se jette sur la viande avariée d'une affaire pourrie comme une mouche se repaît d'un mets dégoûtant. Tout ici démontre que la vie new-yorkaise est un jeu, où chacun joue selon ses propres atouts. Pour l'un, le terrain de jeu sera les marchés financiers, où sentir les bons coups et les gros gains vous fait devenir le numéro un des vendeurs. Pour un autre, ce sera les arcanes de la loi, la connaissance des juges, et les dépôts qu'il aura faits à la Banque des Faveurs pour, au jour J, pouvoir bénéficier en retour d'un coup de pouce. Pour une autre, ce sera les hommes, et l'irrésistible attrait qu'elle exerce sur eux. New York est un pari, où beaucoup perdent, mais qu'importe, quand la ville, elle, gagne ? Au-delà du monstre, la ville est un gouffre. Elle est le lieu du cannibalisme social, car elle se nourrit de ceux qui tombent de son sommet. Ceux qui, comme McCoy, connaissent la chute, sont promis à une mort professionnelle, économique et sociale. La mise à mort est assurée par les autres membres de ce corps difforme et monstrueux, chacun agissant selon ses intérêts qu'il maquille, au choix, sous le fard de la morale, de la justice, de l'intelligence, et jamais sous celui de l'orgueil (Fallow), du désir sexuel (Kramer) ou de la survie professionnelle (Weiss).
Il est toutefois des questions profondes posées par ce roman. Car le drame de Henry Lamb, premièrement, brise la surface lisse des apparences pour montrer la fausseté non seulement des personnages, mais aussi du système. D'ailleurs, si les personnages agissent si lâchement, c'est que le système, non seulement les y autorise, mais les encourage. McCoy, le premier d'entre eux, est pris au piège de sa tromperie vis-à-vis de son épouse, mais aussi pris au piège de son racisme ordinaire, vis-à-vis de la société et de la justice. Ce qu'il ne peut pas dire, c'est qu'il a pris peur parce que les deux jeunes gens devant sa voiture étaient Noirs, et uniquement pour ça. Bûcher des vanités, bal des hypocrites, où tout le monde a une bonne raison pour faire ce qu'il fait, et pour le sublimer. Ainsi ,pour McCoy, sa rencontre nocturne fut un combat dans la jungle. Larry Kramer, lui, vit dans la frustration de ses 36000 dollars annuels. Lui-même opprimé par un système de justice déshumanisant, il se réjouit des sandwichs gratuits les jours de procès, et des débouchés sexuels que peut lui offrir sa position par rapport aux jolies membres des jurys. le révérend Bacon, lui, détourne l'argent du diocèse, et c'est un redoutable politique. le culte du lisse, vu sous l'angle des dollars, de l'agencement des intérieurs et de l'élégance - ou non - des vêtements se fissure avec cette affaire McCoy. Une question surgit : si tout cela est faux, où est le vrai ? Fallow lèverait alors la main, son journal dans l'autre : une vérité crue, sordide selon les détails, cruelle pour ceux qu'elle pousse sur la place publique. Mais les médias - presse et télévision - n'offrent qu'une vision étriquée de la réalité, qui doit correspondre à leurs intérêts, en premier lieu économique. Où est la vérité, où est la justice, puisque les deux sont liés, et où ces deux concepts peuvent-ils bien se trouver si on ne les croise même plus au tribunal du Bronx, où le procureur Weiss et le substitut Kramer mènent en réalité une campagne politique ? Pour peu qu'ils existent encore, ces deux concepts semblent avoir été travestis par New York. Manipulés par les groupes sociaux en fonction de leurs intérêts, ils sont des valeurs phares au nom desquelles toute conduite individuelle et collective trouve une justification. Vérité et justice deviennent alors des prises de guerre dans ce qui apparaît fondamentalement comme une lutte politique. Vérité et justice définissent, en réalité, des rapports de pouvoir. Justice blanche, clament les soutiens du révérend Bacon ; justice universelle, répond Abe Weiss qui y voit un moyen de sa réélection. La vérité et la justice appartiennent à ceux qui détiennent le pouvoir : ainsi Kramer croit-il se servir du sien pour faire triompher, au-delà de la justice due à une communauté, sa propre carrière. Dans l'océan de mensonge, toutefois, apparaissent quelques bouées de vérité. le juge Kovitsky, est l'une d'elles.
Ne demeure alors que la morale, dont McCoy a des réminiscences, d'abord liées à son milieu social - il convient d'avoir une prononciation et une grammaire parfaites, il convient de ne pas demeurer seul à un dîner mondain, il convient que le petit personnel reste à sa place - puis aux actes qu'il commet. Il pense d'abord - mais Maria Ruskin l'en dissuade - à se dénoncer auprès de la police pour avoir renversé Henry Lamb puis, au moment de se défendre, la honte l'assaille souvent. D'abord parce que lui, le Maître de l'Univers, connaît l'intimité des cages sombres et violentes du tribunal, où ses chemises bien coupées le désignent comme inférieur (en force physique ou mentale) aux autres ; ensuite parce que, pour prouver son innocence, McCoy doit utiliser la ruse et la trahison, armes dont d'autres, avant, se sont servis contre lui (le financier français pour le Giscard d'or, Maria qui part en Italie). Enfin parce que sa dégringolade n'est pas seulement personnelle : c'est aussi en tant que mari, et surtout en tant que père, que McCoy perd sa position. de façon paradoxale mais assez logique d'un point de vue chrétien, c'est au fond du gouffre, sans ses revenus, sans sa fonction de père, que la vraie dimension morale de McCoy apparaît. Pris dans l'engrenage d'une justice aveugle pour de mauvaises raisons - sa cécité est liée à des intérêts politiques -, McCoy éprouve dans sa chair l'hypocrisie de son milieu - le président du syndic qui lui demande de quitter les lieux, l'ancienne amie qui se propose de vendre leur superbe appartement, l'appétit voyeur de la bonne société pour le récit glauque de Sherman sur sa courte expérience carcérale - et la violence du système. A ce titre, l'épisode de l'emprisonnement très temporaire de McCoy est d'une brutalité effrayante, et l'humiliation infligée est la plus totale. L'humiliation, ici, doit d'ailleurs être comprise à son sens littéral : ce qui rend humble. C'est aussi ce qui fait retrouver à McCoy sa dignité noyée autrefois dans les dollars et la suffisance. C'est cela qui lui fait affronter, à la fin du roman, une foule prête pourtant à le lyncher. C'est cela qui le fait redevenir humain. Car Sherman McCoy l'a compris : il n'y a pas que le Bronx qui est une jungle ; c'est New York toute entière qui l'est. Et dans la jungle n'existe qu'une seule loi : celle du plus fort.
Sherman McCoy mène une vie luxueuse entre Wall Street, dont il est l'un des jeunes lions, et Park Avenue. Un soir, revenant de l'aéroport avec sa maîtresse, il rate la sortie de l'autoroute, et se perd dans le Bronx. Là, commence sa descente aux enfers…
Tom Wolfe met en place intelligemment les rouages de son récit. On pénètre progressivement dans l'univers hors sol des familles Wasp et huppées de la cinquième avenue avec le Shermann le golden boy, pour plonger dans celui du monde policier et judiciaire avec l'ambitieux procureur Kramer et enfin le monde du journalisme avec l'arriviste chic et dépravé Fallow. A chaque fois, la description de ces mondes est fine, précise et sans concession.
Leurs points communs sont le cynisme, l'opportunisme, l'individualisme et l'hypocrisie.
La façon dont Tom Wolfe nous plonge dans le récit et ses différentes atmosphères est absolument remarquable. On commence par détester le Shermann le golden boy mais au fil du récit la tendance s'inverse. On s'attache aux personnages tous aussi égoïstes et hypocrites les uns que les autres. Notre sympathie oscille au gré des moments intenses que l'auteur nous fait vivre.
C'est un roman fort et dense, que je n'ai que très rarement lâché. Remarquable fresque sur les mondes new-yorkais imprégnés de racisme et de jugements de classe.
Tom Wolfe met en place intelligemment les rouages de son récit. On pénètre progressivement dans l'univers hors sol des familles Wasp et huppées de la cinquième avenue avec le Shermann le golden boy, pour plonger dans celui du monde policier et judiciaire avec l'ambitieux procureur Kramer et enfin le monde du journalisme avec l'arriviste chic et dépravé Fallow. A chaque fois, la description de ces mondes est fine, précise et sans concession.
Leurs points communs sont le cynisme, l'opportunisme, l'individualisme et l'hypocrisie.
La façon dont Tom Wolfe nous plonge dans le récit et ses différentes atmosphères est absolument remarquable. On commence par détester le Shermann le golden boy mais au fil du récit la tendance s'inverse. On s'attache aux personnages tous aussi égoïstes et hypocrites les uns que les autres. Notre sympathie oscille au gré des moments intenses que l'auteur nous fait vivre.
C'est un roman fort et dense, que je n'ai que très rarement lâché. Remarquable fresque sur les mondes new-yorkais imprégnés de racisme et de jugements de classe.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Tom Wolfe (16)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Le Bûcher des vanités
Tout au début du roman, la scène d'ouverture :
Maria fait du shopping
Sherman sort promener son chien
Sherman et Maria rentrent de l'aéroport en voiture
15 questions
30 lecteurs ont répondu
Thème :
Tom WolfeCréer un quiz sur ce livre30 lecteurs ont répondu