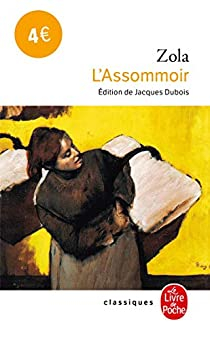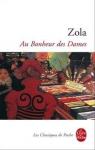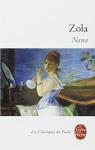Le cycle des Rougon-Macquart – 07/20
Le monde ouvrier nous est dépeint ici pour la première fois dans ce tome 7 des Rougon-Macquart.
Zola y aborde les sujets de la société ouvrière assommée par le travail et la misère.
Les dialogues retranscrit nous plongent dans cette vie parsemée d'obstacles ; obstacles à la fois financiers, sociétaux, et où les jalousies et les rancoeurs sont légions et viennent s'ajouter à un mode de vie difficile où chaque pièce est durement gagnée.
Alors face à toutes ces difficultés, on comprend aisément que certains esprits viennent chercher à s'évader de leurs malheurs par tous les moyens possibles. Et lorsque ce n'est pas possible physiquement, cette fuite en avant se caractérise alors par une fuite de l'esprit, une fuite qui prend dangereusement racine dans les assommoirs. Ces lieux où les alcools (souvent mauvais) coulent à flot et où les économies peuvent être entièrement dilapidées ; d'abord par plaisir après une journée de dur travail puis souvent par addiction ensuite.
Gervaise n'aura jamais lâché, et Zola rend hommage à travers son symbole, à cette société ouvrière qui aura tenté tout au long de son existence de survivre. Sa fin n'en est que plus bouleversante et marquante.
Depuis le début de la lecture des Rougon-Macquart, c'est le personnage dont la fin m'aura le plus marqué tant Zola parvient à nous rendre Gervaise attachante, en qui on peut presque parfois se reconnaitre.
Un chef d'oeuvre.
Le monde ouvrier nous est dépeint ici pour la première fois dans ce tome 7 des Rougon-Macquart.
Zola y aborde les sujets de la société ouvrière assommée par le travail et la misère.
Les dialogues retranscrit nous plongent dans cette vie parsemée d'obstacles ; obstacles à la fois financiers, sociétaux, et où les jalousies et les rancoeurs sont légions et viennent s'ajouter à un mode de vie difficile où chaque pièce est durement gagnée.
Alors face à toutes ces difficultés, on comprend aisément que certains esprits viennent chercher à s'évader de leurs malheurs par tous les moyens possibles. Et lorsque ce n'est pas possible physiquement, cette fuite en avant se caractérise alors par une fuite de l'esprit, une fuite qui prend dangereusement racine dans les assommoirs. Ces lieux où les alcools (souvent mauvais) coulent à flot et où les économies peuvent être entièrement dilapidées ; d'abord par plaisir après une journée de dur travail puis souvent par addiction ensuite.
Gervaise n'aura jamais lâché, et Zola rend hommage à travers son symbole, à cette société ouvrière qui aura tenté tout au long de son existence de survivre. Sa fin n'en est que plus bouleversante et marquante.
Depuis le début de la lecture des Rougon-Macquart, c'est le personnage dont la fin m'aura le plus marqué tant Zola parvient à nous rendre Gervaise attachante, en qui on peut presque parfois se reconnaitre.
Un chef d'oeuvre.
Mon premier Zola ! J'avais beaucoup aimé la lecture cette oeuvre, je devais être au collège.
Mais je me souviens bien de ce roman. Gervaise m'avait beaucoup marquée. Quelles galères elle doit surmonter chaque jour cette femme. Bien brave, bien gentille, elle retrousse ses manches pour deux, c'est pas son imbécile d'amant flemmard qui va l'aider. Pov' Gervaise, abandonnée par celui-ci. Ca commençait mal, tout ça. Je l'aimais bien, moi, c'te brav' Gervaise. Flanquée si jeune d'un crétin d'amant et de deux mouflets.
Et puis le roman commence une lente montée vers de beaux jours.
On est dans le petit peuple, et Zola nous y emmène sans détours. Il ne fait pas semblant. On n'est pas chez les bourgeois ici. Pour sûr, l'assommoir a l'odeur du peuple. Un peuple qui travaille, le dos courbé, qui s'affaire, et qui petit à petit, à la sueur de son front, parvient à s'extirper de sa misère. Tout y est, jusqu'au langage.
Ah, que j'étais contente de voir cette blanchisserie marcher du tonnerre. Et la rouste flanquée à cette garce de Virginie. Et ce repas pendant lequel tout le monde s'éclate la panse. Un morceau d'anthologie ! La lumière arrivée ! Les galères finies et passées ! L'acmé du roman.
Mais après, une lente et irrémédiable apodose s'amorce. Tandis que l'un se met à picoler et devient fou, l'autre s'engraisse, et picole aussi. Hop, une petite anisette. Les gosses se tirent, l'argent aussi. S'il n'y avait que la misère matérielle ! Mais non, Gervaise dépasse toutes les limites, de la morale, de son éducation, de ses principes, jusqu'à se détruire elle-même.
Il n'y a pas d'embellissement artificiel chez Zola, pas de volonté de voiler le réel; il n'y a pas de petit procédé romanesque qui va tirer ses héros de là et faire triompher la bonne morale ou les héros à bon coeur. Zola piétine tout ça. Ce n'est pas tant le dur monde ouvrier de l'époque qui est difficile, c'est cette fatalité noire qui colle à la peau de Gervaise.
Finalement, ce roman qui est très musical, marqué par de grandes phases montantes et descendantes, finit malgré tout ceci à nous ramener au point de départ. Zola boucle la boucle, en remettant au premier plan des personnages du début, venus prendre leur revanche. Tout ça pour ça : on voit ici la réalité de ce lourd fardeau de fatalité qui pèse sur les épaules de chacun des membres de cette famille. Dans l'Assommoir, c'est un rouleau compresseur auquel il n'est pas possible d'échapper.
Pas possible pour moi d'enchaîner la lecture de plusieurs tomes des RM; si tous n'ont pas cette noirceur, je sais qu'un tome plus léger ne sera qu'une parenthèse planante dans la saga, et que la redescente sera violente.
A posteriori je me dis que je n'avais pas commencé par le plus gai, le plus léger ni le plus facile, mais j'avais trouvé ce roman tellement vivant, tellement vrai, haut en couleurs, en voix, en sonorités. Comme si j'étais sortie de la Caverne et que j'avais retrouvé la vision. Avec l'Assommoir j'ai découvert Zola, et la saga dont j'ai lu ensuite plusieurs tomes, et que je n'ai d'ailleurs pas encore finie.
Mais je me souviens bien de ce roman. Gervaise m'avait beaucoup marquée. Quelles galères elle doit surmonter chaque jour cette femme. Bien brave, bien gentille, elle retrousse ses manches pour deux, c'est pas son imbécile d'amant flemmard qui va l'aider. Pov' Gervaise, abandonnée par celui-ci. Ca commençait mal, tout ça. Je l'aimais bien, moi, c'te brav' Gervaise. Flanquée si jeune d'un crétin d'amant et de deux mouflets.
Et puis le roman commence une lente montée vers de beaux jours.
On est dans le petit peuple, et Zola nous y emmène sans détours. Il ne fait pas semblant. On n'est pas chez les bourgeois ici. Pour sûr, l'assommoir a l'odeur du peuple. Un peuple qui travaille, le dos courbé, qui s'affaire, et qui petit à petit, à la sueur de son front, parvient à s'extirper de sa misère. Tout y est, jusqu'au langage.
Ah, que j'étais contente de voir cette blanchisserie marcher du tonnerre. Et la rouste flanquée à cette garce de Virginie. Et ce repas pendant lequel tout le monde s'éclate la panse. Un morceau d'anthologie ! La lumière arrivée ! Les galères finies et passées ! L'acmé du roman.
Mais après, une lente et irrémédiable apodose s'amorce. Tandis que l'un se met à picoler et devient fou, l'autre s'engraisse, et picole aussi. Hop, une petite anisette. Les gosses se tirent, l'argent aussi. S'il n'y avait que la misère matérielle ! Mais non, Gervaise dépasse toutes les limites, de la morale, de son éducation, de ses principes, jusqu'à se détruire elle-même.
Il n'y a pas d'embellissement artificiel chez Zola, pas de volonté de voiler le réel; il n'y a pas de petit procédé romanesque qui va tirer ses héros de là et faire triompher la bonne morale ou les héros à bon coeur. Zola piétine tout ça. Ce n'est pas tant le dur monde ouvrier de l'époque qui est difficile, c'est cette fatalité noire qui colle à la peau de Gervaise.
Finalement, ce roman qui est très musical, marqué par de grandes phases montantes et descendantes, finit malgré tout ceci à nous ramener au point de départ. Zola boucle la boucle, en remettant au premier plan des personnages du début, venus prendre leur revanche. Tout ça pour ça : on voit ici la réalité de ce lourd fardeau de fatalité qui pèse sur les épaules de chacun des membres de cette famille. Dans l'Assommoir, c'est un rouleau compresseur auquel il n'est pas possible d'échapper.
Pas possible pour moi d'enchaîner la lecture de plusieurs tomes des RM; si tous n'ont pas cette noirceur, je sais qu'un tome plus léger ne sera qu'une parenthèse planante dans la saga, et que la redescente sera violente.
A posteriori je me dis que je n'avais pas commencé par le plus gai, le plus léger ni le plus facile, mais j'avais trouvé ce roman tellement vivant, tellement vrai, haut en couleurs, en voix, en sonorités. Comme si j'étais sortie de la Caverne et que j'avais retrouvé la vision. Avec l'Assommoir j'ai découvert Zola, et la saga dont j'ai lu ensuite plusieurs tomes, et que je n'ai d'ailleurs pas encore finie.
Et voilà que l'on revient à la populace, les petits métiers manuels peu payés et précaires, l'habitat insalubre et les ravages d'un soutien recherché dans l'alcool. A faire pleurer si ce n'était du passé. Je ne peux cependant m'empêcher de me demander comment Zola a pu s'immerger dans ce monde, tant les descriptions sont ponctuées d'accents réalistes. A t-il vécu quelques mois dans une chambre de l'un de ces taudis? Je n'ai pas la réponse. Il semble que ce qui est décrit était la réalité, mais je la suppose mise en scène par l'auteur pour les besoins de son roman . Une réalité qui met mal à l'aise, vu le peu place laissée à la dignité des personnes décrites. Pauvreté et vice ne sont pas des synonymes. Et pourtant, la plupart des personnages abandonnent leur dignité quand ils sombrent dans la précarité. Il faut dire que l'auteur s'est fait une spécialité de la noirceur de l'âme humaine. « C'est du Zola », l'expression est passée dans le langage courant. Un roman à la fois superbe et déprimant.
Après avoir, dans les volumes précédents de l'histoire des Rougon-Macquart, décrit des personnages qui prennent ou incarnent une forme de pouvoir (Félicité, Aristide Saccard, l'abbé Faujas, Eugène Rougon,…), Zola explore dans ce septième tome la faiblesse. Elle est principalement incarnée par Gervaise et Coupeau.
Après une première mésaventure avec le chapelier Lantier, Gervaise pense refaire sa vie avec Coupeau, un ouvrier zingueur sérieux et sobre. Malheureusement, à la suite d'un accident, Coupeau devient oisif, et, entraîné par de mauvaises fréquentations, tombe dans l'alcoolisme. Gervaise, qui a monté une petite blanchisserie prospère, ne réussit pas à rétablir l'équilibre de son ménage, bien qu'elle voie clairement ce qui risque de se produire. Mais elle fataliste, et refuse de voir la réalité en face. Les dettes s'accumulent, mais on continue à faire la fête, sans souci de l'avenir. Et peu à peu arrive la déchéance, la perte de la blanchisserie, les crises de delirium tremens de Coupeau, qui finit par entraîner Gervaise dans le tourbillon de l'alcool.
Il y a un peu de tragédie grecque dans ce livre : dès le chapitre 2, nous savons ce qui va arriver : Gervaise a une vision, dans le café du Père Colombe : « L'alambic, sourdement, sans une flamme, sans une gaieté dans les reflets éteints de ses cuivres, continuait, laissait couler sa sueur d'alcool, pareil à une source lente et entêtée, qui à la longue devait envahir la salle, se répandre sur les boulevards extérieurs, inonder le trou immense de Paris. Alors Gervaise, prise d'un frisson, recula. »
Au fil des chapitres, présentés comme les tableaux d'un opéra, racontant, par des scènes précisément situées dans le temps, les moments de bonheur, puis la déchéance et la chute, on voit une Gervaise qui s'enfonce dans le déni : Coupeau sombre dans l'alcoolisme, mais elle prend cela en riant, comme si ce n'était pas grave, ça ira mieux demain… Elle ne tient pas compte des avertissements qu'elle reçoit, elle a déjà renoncé à réagir. Les conseils donnés par Madame Goujet, sa voisine prise un moment comme modèle, ainsi que l'amour du fils de cette dernière, restent vains.
La puissance et l'art de Zola sont superbement mis en oeuvre, dans la peinture de la misère qui règne dans les faubourgs de Paris, dans le discours de Coupeau qui justifie ses escapades au cabaret en proclamant sa « liberté » et le mépris du « qu'en dira t'on ». le réalisme est terrible dans la description des violences faites aux femmes et aux enfants sous l'empire de l'alcool, dans l'évocation des femmes qui attendent leurs maris à la sortie du travail pour les empêcher de dépenser leur paie au cabaret. Les crises de delirium de Coupeau sont évoquées avec des détails qui font penser que Zola s'est beaucoup documenté sur le sujet.
Comme toujours dans les Rougon-Macquart, des figures innocentes viennent par contraste renforcer la noirceur du tableau. Ce sont d'une part Goujet, dont on devine que sa vie sera dévastée, et Lallie, petite fille de huit ans qui, après sa mère, succombe sous les coups et les mauvais traitements de son père.
Voilà donc un roman très dur, une peinture sociale noire, où, en plus de la dénonciation de la condition sociale des classes défavorisées, commence à poindre le combat contre les violences faites aux femmes. Un livre toujours d'actualité !
Après une première mésaventure avec le chapelier Lantier, Gervaise pense refaire sa vie avec Coupeau, un ouvrier zingueur sérieux et sobre. Malheureusement, à la suite d'un accident, Coupeau devient oisif, et, entraîné par de mauvaises fréquentations, tombe dans l'alcoolisme. Gervaise, qui a monté une petite blanchisserie prospère, ne réussit pas à rétablir l'équilibre de son ménage, bien qu'elle voie clairement ce qui risque de se produire. Mais elle fataliste, et refuse de voir la réalité en face. Les dettes s'accumulent, mais on continue à faire la fête, sans souci de l'avenir. Et peu à peu arrive la déchéance, la perte de la blanchisserie, les crises de delirium tremens de Coupeau, qui finit par entraîner Gervaise dans le tourbillon de l'alcool.
Il y a un peu de tragédie grecque dans ce livre : dès le chapitre 2, nous savons ce qui va arriver : Gervaise a une vision, dans le café du Père Colombe : « L'alambic, sourdement, sans une flamme, sans une gaieté dans les reflets éteints de ses cuivres, continuait, laissait couler sa sueur d'alcool, pareil à une source lente et entêtée, qui à la longue devait envahir la salle, se répandre sur les boulevards extérieurs, inonder le trou immense de Paris. Alors Gervaise, prise d'un frisson, recula. »
Au fil des chapitres, présentés comme les tableaux d'un opéra, racontant, par des scènes précisément situées dans le temps, les moments de bonheur, puis la déchéance et la chute, on voit une Gervaise qui s'enfonce dans le déni : Coupeau sombre dans l'alcoolisme, mais elle prend cela en riant, comme si ce n'était pas grave, ça ira mieux demain… Elle ne tient pas compte des avertissements qu'elle reçoit, elle a déjà renoncé à réagir. Les conseils donnés par Madame Goujet, sa voisine prise un moment comme modèle, ainsi que l'amour du fils de cette dernière, restent vains.
La puissance et l'art de Zola sont superbement mis en oeuvre, dans la peinture de la misère qui règne dans les faubourgs de Paris, dans le discours de Coupeau qui justifie ses escapades au cabaret en proclamant sa « liberté » et le mépris du « qu'en dira t'on ». le réalisme est terrible dans la description des violences faites aux femmes et aux enfants sous l'empire de l'alcool, dans l'évocation des femmes qui attendent leurs maris à la sortie du travail pour les empêcher de dépenser leur paie au cabaret. Les crises de delirium de Coupeau sont évoquées avec des détails qui font penser que Zola s'est beaucoup documenté sur le sujet.
Comme toujours dans les Rougon-Macquart, des figures innocentes viennent par contraste renforcer la noirceur du tableau. Ce sont d'une part Goujet, dont on devine que sa vie sera dévastée, et Lallie, petite fille de huit ans qui, après sa mère, succombe sous les coups et les mauvais traitements de son père.
Voilà donc un roman très dur, une peinture sociale noire, où, en plus de la dénonciation de la condition sociale des classes défavorisées, commence à poindre le combat contre les violences faites aux femmes. Un livre toujours d'actualité !
L'Assommoir est le septième volume de la saga Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. le grand romancier y poursuit son portrait de la société française sous le Second Empire. Après les coulisses du pouvoir dans le roman précédent, place cette fois au petit peuple ouvrier de Paris.
Nous suivons la lente et fragile ascension sociale de Gervaise, la jeune fille boiteuse élevée à l'anisette par sa mère Joséphine Macquart. Au début du roman, abandonnée par son amant Lantier qui lui a donné deux fils, elle se marie avec le bon chapelier Coupeau et se met à compte comme blanchisseuse.
Les débuts du ménage sont prometteurs, mais on pressent que l'édifice est fragile, qu'une simple bourrasque peut faire chuter le château de cartes. On guette les signes avant-coureurs de la déchéance que l'on devine inévitable. C'est la triste fatalité des gens mal nés.
Le roman décrit également les rapports de voisinage dans ce quartier populaire de Paris. Les amitiés se font et se défont, au gré des jalousies provoquées par la réussite des uns et des autres. Les rumeurs circulent vite, qu'elles soient avérées ou non.
J'ai lu que ce roman avait suscité des polémiques lors de sa sortie, certains le trouvant trop cru. En effet, Emile Zola dresse un portrait dur et acerbe de la condition ouvrière dans cette seconde partie du XIXe siècle, mais je la crois volontiers réaliste. L'auteur n'est pas toujours tendre avec ses personnages, il ne nous épargne pas leurs faiblesses et leurs vices, mais il le fait pour éclairer leur condition vécue comme une fatalité.
L'Assommoir est un roman dur mais nécessaire, l'un de mes préférés de la saga des Rougon-Macquart pour le moment.
Nous suivons la lente et fragile ascension sociale de Gervaise, la jeune fille boiteuse élevée à l'anisette par sa mère Joséphine Macquart. Au début du roman, abandonnée par son amant Lantier qui lui a donné deux fils, elle se marie avec le bon chapelier Coupeau et se met à compte comme blanchisseuse.
Les débuts du ménage sont prometteurs, mais on pressent que l'édifice est fragile, qu'une simple bourrasque peut faire chuter le château de cartes. On guette les signes avant-coureurs de la déchéance que l'on devine inévitable. C'est la triste fatalité des gens mal nés.
Le roman décrit également les rapports de voisinage dans ce quartier populaire de Paris. Les amitiés se font et se défont, au gré des jalousies provoquées par la réussite des uns et des autres. Les rumeurs circulent vite, qu'elles soient avérées ou non.
J'ai lu que ce roman avait suscité des polémiques lors de sa sortie, certains le trouvant trop cru. En effet, Emile Zola dresse un portrait dur et acerbe de la condition ouvrière dans cette seconde partie du XIXe siècle, mais je la crois volontiers réaliste. L'auteur n'est pas toujours tendre avec ses personnages, il ne nous épargne pas leurs faiblesses et leurs vices, mais il le fait pour éclairer leur condition vécue comme une fatalité.
L'Assommoir est un roman dur mais nécessaire, l'un de mes préférés de la saga des Rougon-Macquart pour le moment.
C'est le coeur lourd et angoissé que je referme l'Assommoir, que j'aurais envie de nommer "Gervaise", tant ce personnage habite le livre. Chère et tendre Gervaise, pure et aimante, dont la bonté naturelle la rend faible et la mène au gouffre des assommoirs ; ces funestes débits de boisson où s'alcoolise toute une population qui cherche l'oubli de ses souffrances.
Jusqu'au 18ème siècle, le vin, considéré comme la boisson des dieux, rare et cher, n'a jamais provoqué de troubles sociétaux majeurs. C'est d'ailleurs ainsi que Coupeau, époux de Gervaise, se défend de boire : le vin ne fait pas de mal, il donne du coeur à l'ouvrage !
Mais au 19ème siècle, toutes sortes d'alcool frelatés font leur apparition et le Prolétariat (ces populations rurales déracinées, devenues main-d'oeuvre à bon marché à l'usine et vivant dans la précarité totale), va faire les frais de cette consommation excessive et bon marché. Durant cette période, la France est un grand producteur d'alcool à bas prix et la consommation sera d'ailleurs confortée en 1914, par la distribution automatique de vin et d'alcool aux soldats. L'alcool, la drogue, l'opium du peuple.
Le mot "alcoolisme" date des années 1800 et ces effets en sont alors étudiés dans les asiles psychiatriques. La corrélation entre internement et alcoolisme suit une courbe statistique parfaite. Zola fait une description très documentée de la crise finale de delirium tremens qui emporte Coupeau sous les yeux de Gervaise.
Ce qui est frappant également dans ce roman-étude de Zola, c'est l'éclatement des familles par la misère, la dureté du travail, l'absence de secours. C'est chacun pour soi. Les enfants vont chercher ailleurs un meilleur sort, l'entraide est affaiblie. Gervaise reçoit quelques subsides de son fils aîné Etienne, mais elle ne reverra jamais celui-ci : trop loin, peu de moyens de communication, chacun vit sa vie. Sa fille Nana, devenue fille de joie, gueuletonne sans plus s'occuper de sa mère. Lisa, soeur de Gervaise, la belle charcutière du "Ventre de Paris", ne lui viendra jamais en aide, elle a honte de cette soeur mariée à un ouvrier...
Zola écrit là un de ses meilleurs romans "le premier roman sur le peuple qui ne mente pas" répond-il à Victor Hugo, qui estime le roman trop cru. Zola s'est documenté et lui-même a connu la pauvreté ; il connaît les moeurs populaires "de l'intérieur" ; il sait de quoi il parle. Et dans ce livre, il parle comme parle le peuple. Si le fait littéraire est évident au 19ème siècle (Gavroche), Zola lui a le "coup de gosier" populeux et il ose le style littéraire indirect libre à la troisième personne, qui confond les voix : "Enfin, si Coupeau rapportait sa paie, on mangerait quelque chose de chaud". Qui parle, Zola, Gervaise ?
La compassion de Zola pour ses personnages - et notamment les figures féminines dont l'existence est vouée au désastre - Lalie, la petite fille martyrisée par son père, Gervaise et les autres, toutes soumises à l'ordre patriarcal - est évident et digne d'attention.
Jusqu'au 18ème siècle, le vin, considéré comme la boisson des dieux, rare et cher, n'a jamais provoqué de troubles sociétaux majeurs. C'est d'ailleurs ainsi que Coupeau, époux de Gervaise, se défend de boire : le vin ne fait pas de mal, il donne du coeur à l'ouvrage !
Mais au 19ème siècle, toutes sortes d'alcool frelatés font leur apparition et le Prolétariat (ces populations rurales déracinées, devenues main-d'oeuvre à bon marché à l'usine et vivant dans la précarité totale), va faire les frais de cette consommation excessive et bon marché. Durant cette période, la France est un grand producteur d'alcool à bas prix et la consommation sera d'ailleurs confortée en 1914, par la distribution automatique de vin et d'alcool aux soldats. L'alcool, la drogue, l'opium du peuple.
Le mot "alcoolisme" date des années 1800 et ces effets en sont alors étudiés dans les asiles psychiatriques. La corrélation entre internement et alcoolisme suit une courbe statistique parfaite. Zola fait une description très documentée de la crise finale de delirium tremens qui emporte Coupeau sous les yeux de Gervaise.
Ce qui est frappant également dans ce roman-étude de Zola, c'est l'éclatement des familles par la misère, la dureté du travail, l'absence de secours. C'est chacun pour soi. Les enfants vont chercher ailleurs un meilleur sort, l'entraide est affaiblie. Gervaise reçoit quelques subsides de son fils aîné Etienne, mais elle ne reverra jamais celui-ci : trop loin, peu de moyens de communication, chacun vit sa vie. Sa fille Nana, devenue fille de joie, gueuletonne sans plus s'occuper de sa mère. Lisa, soeur de Gervaise, la belle charcutière du "Ventre de Paris", ne lui viendra jamais en aide, elle a honte de cette soeur mariée à un ouvrier...
Zola écrit là un de ses meilleurs romans "le premier roman sur le peuple qui ne mente pas" répond-il à Victor Hugo, qui estime le roman trop cru. Zola s'est documenté et lui-même a connu la pauvreté ; il connaît les moeurs populaires "de l'intérieur" ; il sait de quoi il parle. Et dans ce livre, il parle comme parle le peuple. Si le fait littéraire est évident au 19ème siècle (Gavroche), Zola lui a le "coup de gosier" populeux et il ose le style littéraire indirect libre à la troisième personne, qui confond les voix : "Enfin, si Coupeau rapportait sa paie, on mangerait quelque chose de chaud". Qui parle, Zola, Gervaise ?
La compassion de Zola pour ses personnages - et notamment les figures féminines dont l'existence est vouée au désastre - Lalie, la petite fille martyrisée par son père, Gervaise et les autres, toutes soumises à l'ordre patriarcal - est évident et digne d'attention.
Un des meilleurs livres depuis que j'ai entamé la lecture de cette série de 20 volumes. La scène du repas dans la blanchisserie est un moment d'anthologie et la déchéance de Gervaise et de son mari, qui sombrent peu à peu dans un aloccolisme démesuré, est littéralement désespérante.
Quel tragique destin que celui de Gervaise. On la suit depuis son arrivée sur Paris, quand elle se fait abandonner de son amant, se retrouvant ainsi seule avec ses deux fils.
A partir de là, elle va améliorer sa vie par le travail acharné, puis tomber petit à petit dans la déchéance ... Son histoire nous fascine, et pourtant elle est très simple, c'est celle d'une femme qui voulait à tout prix être heureuse, mais qui a voulu trop profiter et qui s'est faite avoir par les vautours qui tournaient autour de la blanchisseuse.
Et puis, c'est dans ce roman que l'on découvre Nana, l'une des héroïne d'un prochain roman, ainsi qu'Etienne, héros de Germinal! Tous deux étant les enfants de Gervaise.
C'était une très bonne lecture, cependant pas mon préféré dans la série des Rougon-Macquarts, à cause de certaines longueurs, notamment dans la deuxième partie du livre.
A partir de là, elle va améliorer sa vie par le travail acharné, puis tomber petit à petit dans la déchéance ... Son histoire nous fascine, et pourtant elle est très simple, c'est celle d'une femme qui voulait à tout prix être heureuse, mais qui a voulu trop profiter et qui s'est faite avoir par les vautours qui tournaient autour de la blanchisseuse.
Et puis, c'est dans ce roman que l'on découvre Nana, l'une des héroïne d'un prochain roman, ainsi qu'Etienne, héros de Germinal! Tous deux étant les enfants de Gervaise.
C'était une très bonne lecture, cependant pas mon préféré dans la série des Rougon-Macquarts, à cause de certaines longueurs, notamment dans la deuxième partie du livre.
Lorsqu'on commence le livre, on est pris dans un engrenage qui fait qu'on ne le lâche pas pendant plusieurs jours. Et pourtant, il ne se passe pas grand chose, mais l'intrigue, les rapports entre les personnages et les descriptions sont captivants et envoutants. Un des meilleurs romans de Zola.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Émile Zola (294)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les personnages des Rougon Macquart
Dans l'assommoir, quelle est l'infirmité qui touche Gervaise dès la naissance
Elle est alcoolique
Elle boîte
Elle est myope
Elle est dépensière
7 questions
593 lecteurs ont répondu
Thème :
Émile ZolaCréer un quiz sur ce livre593 lecteurs ont répondu