
La Suisse : l'autre pays de l'amour et de l'invasion fiscale
Interview : Joseph Incardona à propos de La Soustraction des possibles
Article publié le 11/05/2020 par Nicolas Hecht
Comment parler d'amour en littérature aujourd'hui, en passant après des centaines de milliers d'auteurs sur le sujet ? Sûrement en laissant sa propre voix d'écrivain résonner dans les pages, en y injectant pas mal de passion pour son histoire et une belle brassée d'amour, justement, envers ses personnages.
C'est ce que fait Joseph Incardona dans La Soustraction des possibles, son dernier roman en date paru chez Finitude. On y suit Aldo et Svetlana, deux Suisses ambitieux bien décidés à empocher un pactole et se la couler douce, au début des années 1990. Evidemment, la nage en eaux profondes ne va pas sans croiser quelques requins (mafieux, patrons véreux), surtout dans un pays qui a fait de sa politique fiscale et de sa "tolérance bancaire" son atout principal. Un pays avec lequel l'auteur, suisse également, n'est pas tendre, et dont il brosse un portrait culturel et historique dans son roman. Voilà un livre dense donc, aux faux airs de thriller (ou plutôt, de tragédie), dont on a voulu savoir plus sur la genèse et les enjeux à travers quelques questions.

Joseph Incardona © Sandrine Cellard
Comme vous le précisez en introduction, ce livre est avant tout une histoire d’amour, celle de l’évidence de la rencontre entre Aldo, prof de tennis-gigolo terriblement ambitieux, et Svetlana, banquière qui essaie de se frayer une place parmi les puissants. Tous deux vont être broyés par le monde de l’argent, ce que vous annoncez dès le début et mettez en place dans une narration implacable. Vous ne croyez pas au hasard de l’existence ? Ou bien est-ce que le déterminisme sert avant tout les ressorts tragiques de la construction du récit ?
Il est vrai que le déterminisme est le ressort de la tragédie, souvent une tragédie annoncée. En même temps, mes deux personnages principaux ont une vision existentialiste de l’existence, liée au « faire ». C’est l’idée du self-made man, on est ce que l’on fait, mais surtout ici, on obtient ce que l’on fait. Au fond, cette histoire est à la confluence du déterminisme et de l’existentialisme. Mais vu que le destin de mes personnages, c’est moi qui le décide, je les place dans une position précaire. Car, en réalité, je ne décide pas grand-chose non plus, ça se passe à un niveau presque inconscient. Jusqu’au bout, j’ai souhaité qu’ils s’en sortent… C’est ce que je mets en miroir dans le roman avec mes interventions dans l’histoire, de ses rouages, de sa mécanique.
Quant au hasard de l’existence… Ah, d’un point de vue personnel, c’est assez complexe. Je suis troublé par la théorie de la Synchronicité de Jung : parfois, certaines choses adviennent défiant toute loi statistique, c’est-à-dire que l’on est au-delà de la statistique. Avons-nous une influence sur ces manifestations ? Les appelle-t-on ? Les crée-t-on ? Nos dimensions de l’espace et du temps sont-elles incluses non seulement dans la troisième découverte par Einstein ou plus ? La théorie des Cordes envisage sept dimensions… Qu’en est-il de la simultanéité des événements, de leur diffusion, de leur incarnation…? Qu’est-ce que la chance ou la malchance ? Je pense qu’il y a ce que nous faisons mêler à une part d’inconnu, ce que j’appelle le mystère. Ce que l’on peut faire, c’est d’essayer d’agir et ouvrir notre sensibilité à ce mystère…
Vous situez l’action de La Soustraction des possibles à une époque charnière, entre octobre 1989 et février 1990, soit juste avant l’effondrement de l’URSS et ses conséquences. Pourtant, malgré les références à cette époque, on a souvent l’impression de lire un récit très contemporain. Sommes-nous encore aujourd’hui les héritiers de la Chute du Mur de Berlin, selon vous ?
Personnellement, si je devais déterminer une date charnière du passage d’une époque à l’autre, celle de l’époque postmoderne à… quoi ? – celle de l’Anthropocène, peut-être, pour reprendre un terme de classification géologique ? –, eh bien, ce serait celle-ci. Pour une raison simple : 1990 marque un tournant dans l’Histoire de l’humanité. L’Anglais Tim Berners-Lee et son équipe, notamment le Belge Robert Cailliau, mettent au point le world wide web. Dès 1991, l’hyperréalité est donnée gratuitement à l’humanité. À partir de là, le monde change radicalement, nous entrons dans une dimension nouvelle de notre histoire, une méta-révolution de l’économie, de la finance, de la culture, bref, nous entrons dans une nouvelle ère où le monde est dédoublé par une réalité virtuelle. Au fond, l’effondrement du mur de Berlin est la manifestation physique d’un bouleversement, le prologue à une révolution silencieuse et majeure de l’humanité (le feu, la roue, le web). L’année 1990 marque donc le passage symbolique à un nouveau monde.
Ce roman est aussi le portrait de l’autre pays de l’invasion/évasion fiscale : la Suisse, avec laquelle vous n’êtes pas tendre. Votre amour des paysages semble proportionnel à votre haine des malversations bancaires et d’une certaine étroitesse d’esprit calviniste...
Où a été mise au point cette invention du web qui va révolutionner le monde ? Au CERN de Genève. Il ne m’en fallait pas plus pour que mon histoire se déroule principalement dans cette ville, et je réponds ainsi à votre question du lieu. Pour moi, c’était l’occasion de parler à la fois d’une époque et d’un lieu connus, de me plonger dans le passé avec une perception particulière des événements, de faire appel à la fois aux souvenirs, aux sensations, aux témoignages. Genève est une ville qui, du point de vue de l’âme, ressemblerait un peu à un non-lieu, c’est-à-dire une ville qui se débarrasse régulièrement de son passé, ne gardant de l’histoire que sa façade. C’est une ville sans cesse remise à neuf. Il y a toujours de grands chantiers publics, une façon de faire tourner l’économie locale. Quant aux privés, ils ne se gênent pas non plus, restaurants, boutiques, commerces sans cesse refaits, pour certains, une manière sans doute de blanchir ou de recycler de l’argent, aussi. La mémoire individuelle et collective perd régulièrement son assise.
Quand je me promène dans cette ville, je suis tout le temps en train de me souvenir, « là, il y avait ci ou ça à la place de… ». Du coup, pour moi, les lieux que je raconte ont été recouverts par de nouvelles strates, je me superpose à moi-même, en quelque sorte, ce que je mets en scène par moments en affirmant un dédoublement narrateur/auteur. D’une certaine manière, c’est comme si j’écrivais un roman se déroulant dans une autre ville, dans un ailleurs que je connaîtrais parfaitement. C’est troublant. Et puis, Genève est l’antre du Calvinisme et de sa philosophie de la thésaurisation. Tout ça fait aussi partie de mon roman, tout ça apparaît d’une façon ou l’autre. J’ai l’habitude de dire que je vis à Genève comme je vivrais dans un hôtel : vous êtes dans une petite ville absolument internationale où l’anonymat est une réalité fortement voulue par ses habitants, la plupart de passage.

Joseph Incardona © Sandrine Cellard
Le ton général du livre est assez cynique - mais souvent poétique, aussi. Est-ce que l’idée derrière ce choix était de combattre les excès du néolibéralisme (notamment sa voracité et sa collusion avec les milieux mafieux) avec ses propres armes ?
Sans doute que le ton du roman est en symbiose avec son sujet. Cela dit, il n’y a pas de combat, j’essaie de relater, de raconter, et puis chacun se fait son opinion. Bien sûr, j’oriente mon propos, et mon angle d’attaque est personnel.
Dans La Soustraction des possibles, vous parvenez à créer un univers foisonnant et réaliste, mais ne manquez pas d’invectiver le lecteur, de vous adresser en tant qu’auteur/narrateur directement aux personnages, et donc de revendiquer l’aspect purement fictionnel. Est-ce que vous envisagez le roman à la fois comme un miroir et un jeu de dupes ?
Mais oui, ça aussi, ce recul un peu brechtien qui vous rappelle que vous lisez un roman, que c’est un roman, que ce n’est pas la réalité tout en s’appuyant fortement sur celle-ci… Je parlais tout à l’heure du web, de sa réalité augmentée d’un monde parallèle et virtuel. L’art en général, et la littérature en particulier, n’a fait que de proposer des mondes possibles, parallèles et virtuels nous proposant des points de vue sur ce qu’on nomme la « réalité ». Même si pour moi ce qui est imaginé, ce qui est vécu dans notre intériorité, notre imaginaire, nos sensations et nos sentiments, est aussi réel que le « réel ».
Alors, oui, je prends ces deux dimensions, je les malaxe, je les détache, je les multiplie, je jongle avec. Ce qui donne des entrées multiples, des clés de lectures différentes. Si on peut lire le même roman plusieurs fois et y trouver chaque fois de nouvelles pistes, une sorte d’étonnement, de renouveau, alors oui… C’est peut-être pour cette raison, d’ailleurs, qu’un livre devient, au bout d’un certain temps, un « classique ». Vous le gardez dans votre bibliothèque parce que vous vous dites que vous pourrez le relire un jour…
Vous mentionnez dans ce texte de nombreux artistes, personnalités et auteurs. Est-ce une forme d’hommage à vos influences de faire intervenir Rousseau, Pasolini, Ramuz ou encore Bashung ? Et un contrepoint de citer à chaque début de partie des Al Capone, Jacques Mesrine, Henry Ford ou Bill Gates ?
Charles-Ferdinand Ramuz. Cet immense écrivain dont j’avais lu Derborence au lycée. Et qui, déjà, du haut de mon ignorance, ne m’avait pas laissé indifférent. Que j’ai (re)découvert il y a deux ans et dont j’ai lu la moitié de l’œuvre, depuis. C’est quelque chose, c’est immense, de la tragédie pure, mais surtout avant son aspect dramaturgique toujours surprenant, une écriture, une langue. Je répète sans cesse que c’est tout ce que peut espérer un écrivain, c’est tout ce qu’il peut souhaiter de meilleur : une écriture qui le caractérise et qui nous donne à voir sa vision du monde. C’est une sorte de dialogue secret qui s’installe entre l’écrivain et le lecteur, quelque chose de très personnel, parfois sensuel, et qui vous bouscule aux tréfonds, parle à votre âme, circule des écrivains morts aux lecteurs vivants, au-delà des années, voire des siècles. C’est un secret transmis en silence, c’est une joie, une révélation.
Quant à Ferdinand Hodler, c’est aussi un peintre que je découvre aujourd’hui. Les deux hommes se connaissaient, se fréquentaient. Ils ont en commun ce territoire autour du lac Léman, des montagnes l’entourant. Ils sont partis d’un lieu concret pour en faire des lieux universels grâce à leur art, leur façon de s’exprimer, leur travail assidu. D’un point de vue géographique, La Soustraction des possibles part lui aussi d’un noyau dur s’ouvrant au monde l’entourant ; il n’est pas seulement polyphonique d’un point de vue des personnages, mais il s’ouvre également à toute une série de lieux, allant du lac Léman au Mexique.
Pour ce qui est de l’hommage, oui et non. Si l’on fait intervenir des figures tutélaires dans ce jeu de mise en abîme, elles doivent avoir une nécessité, s’inscrire dans l’âme du roman. En revanche, les citations sont là de façon à donner la couleur de la partie traitée, parfois aussi, elles révèlent cette part de superficialité à les sortir de leur contexte. Elles sont pour moi l’équivalent des proverbes : ils disent une certaine vérité et ne disent rien du tout, car ils écartent toute complexité. Comme disait Henry-Louis Mencken : « Il existe pour chaque problème complexe, une réponse simple, claire et fausse…»

Vous avez déjà écrit une vingtaine de livres depuis la toute fin des années 1990. Y avait-il un enjeu particulier avec ce roman-ci ? Un public plus large semble vous découvrir...
D’après moi, la réalité d’un écrivain est qu’il creuse son sillon livre après livre. Les premiers romans mettant immédiatement l’auteur sous les feux de la rampe sont l’exception. Je me souviens qu’Éric Holder m’avait dit que le chemin d’un écrivain est comme une ligne de vie : elle est unique. Sans doute qu’avec le temps, les réflexions, bref, l’expérience de vie, donne davantage de poids à ce que l’on écrit, ouvre des dimensions plus larges et plus profondes. Chaque livre est un enjeu particulier, car pour moi il demande à me renouveler, à me recréer dans la forme et dans le sujet traité. Chaque sujet est traité avec une forme particulière, on ne peut pas raconter des mondes différents avec une forme identique. C’est mon opinion en lien avec le « style ».
Joseph Incardona à propos de ses lectures
Quel est le livre qui vous a donné envie d’écrire ?
L’écriture, le désir et la nécessité d’écriture viennent de très loin, sans doute de l’enfance déjà. J’étais un enfant solitaire parce que mes parents travaillaient dans les hôtels, faisaient les saisons et on déménageait très souvent. J’avais de la peine à m’intégrer chaque année dans une nouvelle classe. Donc, je jouais beaucoup tout seul, et forcément, je me créais des mondes… Je crois que l’écriture pour moi vient de là. Maintenant, vers 20 ans, je lis Sexus d’Henry Miller sur lequel je tombe par hasard. Et là, c’est la prise de conscience de ce que je veux faire, ce que je veux être : écrivain.
Quel est le livre que vous auriez rêvé d’écrire ?
On rêve toujours d’écrire le livre qu’on est en train d’écrire. Il faut placer le rêve, le lancer loin devant soi et puis essayer de le rejoindre… Dans l’absolu, je ne sais pas, il y a un certain nombre de livres qui vous laissent pantois, sans souffle, admiratif… Peut-être Voyage au bout de la nuit ? Demande à la poussière ? 2666 ? La Malédiction du gitan ? La Grande Peur dans la montagne ? Il y en a tant et chacun pour une raison différente.
Quelle est votre première grande découverte littéraire ?
Blaise Cendrars. C’est un hymne aux éléments, à la vie… Toute son œuvre est tournée vers la lumière et a l’élan vital.
Quel est le livre que vous avez relu le plus souvent ?
Les livres de Bukowski. Il est un ami. Quand je ne trouve rien à lire, je retrouve cet ami et de le relire me requinque, c’est comme si on buvait des coups ensemble. S’il y avait un écrivain que j’aurais voulu rencontrer, c’est lui.
Quel est le livre que vous avez honte de ne pas avoir lu ?
Je n’arrive pas à lire Ulysse, de Joyce. Je n’y arrive pas, mais j’essaie régulièrement, qui sait ?
Quelle est la perle méconnue que vous souhaiteriez faire découvrir à nos lecteurs ?
Lisez Car, Body, La Malédiction du gitan, La Foire aux serpents de Harry Crews. Et puis Ramuz, n’importe lequel, car cet écrivain reste malheureusement méconnu bien qu’il soit dans La Pléiade. Sinon, je viens de lire un très beau roman Bajass de Flavio Steimann, publié chez Agone.
Quel est le classique de la littérature dont vous trouvez la réputation surfaite ?
À partir de quand un livre devient un « classique » ? C’est difficile à dire. Disons que certains auteurs des années 1960/70 me semblent avoir été surévalués, en effet. Ceux du XIXe, de ceux que j’ai lus en tout cas, je les garde tous !
Avez-vous une citation fétiche issue de la littérature ?
Aucune ne me vient. Mais je sais qu’il y en a. Mais c’est surtout l’éclat d’une phrase, une tournure particulière qui me saisissent…
Et en ce moment que lisez-vous ?
Je relis 2666 de Roberto Bolano (quel immense auteur !) et je lis la Dame aux Camélias, de Dumas. Après avoir lu le père, je m’attaque au fils.
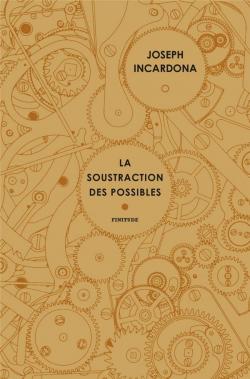
Découvrez La Soustraction des possibles de Joseph Incardona publié aux éditions Finitude.







