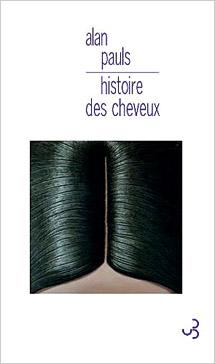Critiques de Alan Pauls (29)
J'arrête là, à presque la moitié. Pourtant je cherche encore la moitié qui m'intéressait dans l'idée : un homme qui a du mal avec la modernité et qui continue, par exemple, de payer en espèce, de vouloir rencontrer les gens en vrai, d'acheter dans les magasins, etc. Mais le style est lourd, les phrases à rallonge. Et surtout, combien de fois, en finissant un paragraphe je me suis demandé : "qu'est-ce que je viens de lire là" ?! Ca ne rentre pas, j'ai survolé des mots. Il y a ceux qui passent les idées simplement, et les autres. Comme d'habitude, je tenterai (plus tard) un autre de ses romans..
Il s'est écoulé treize ans entre "Wasabi" et "Histoire des larmes", première parution de cette trilogie remarquée dont je vous ai entretenus ici et là avec un réel engouement. En 1994, Alan Pauls semblait ne pas avoir encore entièrement acquis son phrasé proustien, pourtant en germe, ni acquis la volonté de raconter des histoires sérieuses. C'est en tout cas ce qui ressort de ce récit extravaguant et néanmoins plaisant où il met en scène un écrivain argentin hypocondriaque en voyage en Europe avec sa femme, séjournant dans une résidence pour jeunes auteurs à Saint-Nazaire. Des aventures pitoyables arrivent à ce pauvre personnage qui se met en tête de tuer Pierre Klossowski en personne, qu'il déteste pour des raisons obscures. En outre un kyste inquiétant à la base du cou se transforme en une protubérance qui finira même, en fin de récit, par acquérir des vertus phalliques. Selon son épouse, la pommade qu'il applique sur l'excroissance a le goût du wasabi.
Je pourrais vous dire encore qu'en postface, on découvre un bref entretien avec Bernard Bretonnière où le sud-américain affirme que "la littérature est une pratique minoritaire, résiduelle, dys-chronique, qui trouve dans la solitude non pas son destin funèbre mais la force et l'intensité de la résistance". Et quand on lui parle d'élégance en littérature, il affirme que "c'est la question du style. Une certaine façon de porter, de malporter, rapporter (comme on disait à l'école : rapporteur) la langue."
Sur ce point, deux extraits parleront mieux que de longs palabres : découvrez-les sur mon blog "Marque-pages".
Lien : http://christianwery.blogspo..
Je pourrais vous dire encore qu'en postface, on découvre un bref entretien avec Bernard Bretonnière où le sud-américain affirme que "la littérature est une pratique minoritaire, résiduelle, dys-chronique, qui trouve dans la solitude non pas son destin funèbre mais la force et l'intensité de la résistance". Et quand on lui parle d'élégance en littérature, il affirme que "c'est la question du style. Une certaine façon de porter, de malporter, rapporter (comme on disait à l'école : rapporteur) la langue."
Sur ce point, deux extraits parleront mieux que de longs palabres : découvrez-les sur mon blog "Marque-pages".
Lien : http://christianwery.blogspo..
Le salon du livre de Paris qui mettait à l'honneur la littérature argentine m'a conduit vers les rayons sud-américains de la bibliothèque provinciale de Liège. J'espérais peut-être, malgré moi, trouver un nouveau Borges : deux noms d'Argentine tombèrent dans ma gibecière (il y a en moi du chasseur dans ces lieux dévolus aux livres), Juan José Saer et Alan Pauls. Le premier, aux descriptions longues et méticuleuses, très visuelles, m'a d'abord séduit (avec le roman Le Tour Complet) mais trop vite lassé, avec des interminables descriptions sans que l'objet du récit ne prenne consistance. J'ai pensé à Hemingway : tout est apparence extérieure, l'intime se devine (ou pas).
Alan Pauls (non présent à Paris) est autrement dense, maître de l'intrication, de l'intime à l'histoire du pays, du secret à l'universel. L'incipit saillant "Il n'a pas encore quinze ans lorsqu'il voit son premier mort en personne" vous enlève jusqu'au bout, sans temps mort.
La première marque de Pauls est son style qui rappelle celui de Proust. Élégante et tortueuse à la fois, sa phrase est virtuose, serpente, morcelée entre tirets et parenthèses, pour choir entière aux pieds du lecteur ravi, quelquefois irrité d'avoir dû la relire. Irritation rapidement voilée par l'éblouissement que procure la maîtrise de l'écrivain pour traduire le sens d'une idée aux multiples facettes, comme des yeux d'insectes, pour reprendre l'excellente métaphore de Guillaume Contré[1] : "La phrase de Pauls fragmente la temporalité telle les mille facettes d’un œil de mouche, prétendant ainsi embrasser plusieurs moments d’un seul coup, afin de mieux en souligner les lignes de force communes ; elle retranscrit la complexité d’une perception, la sinuosité d’une pensée ; elle prétend à la totalité, cherchant à unir des éléments à priori disparates et à en démontrer coûte que coûte la cohérence cachée. Elle est ludique, d’une certaine façon, mais elle n’est pas qu’un jeu. Précise et détaillée, elle est aussi une perpétuelle prise de distance, une manière de survoler son objet non pas pour en diminuer la valeur mais pour mieux en présenter le plan d’ensemble depuis le détail, comme une image légèrement biscornue sur laquelle on opérait des zoom successifs et interpénétrés." Quand je disais «dense», c'est à cette simultanéité de la pensée que je pensais : il vous est dans doute arrivé, pour un sujet précis, d'avoir soudain en tête une foule d'idées qui surviennent quasi simultanément, l'envie de tout dire à la fois, car tout est d'égale importance et ne se comprend qu'ensemble et au même moment. Voilà le style paulsien. Proust me semble toutefois plus harmonieux car je n'entends pas (je peux me tromper) les textes de l'argentin franchir le seuil de la lecture à voix haute.
Il s'agit de littérature traduite mais Alan Pauls parle[2] un excellent français : je ne sais si ceci l'explique ou si la brillante traduction de Serge Maistre est parfaite mais on a constamment l'impression de lire un texte rédigé en français original. L'origine latine de la langue y aide certainement.
Histoire de l'argent fait partie d'une trilogie (Histoire des larmes, Histoire des cheveux) qui a pour thème l'histoire récente de l'Argentine. Si ce ne sont les nombreuses allusions aux problèmes économiques graves (dévaluations, changements de monnaie, inflation) qu'a connus le pays à la fin du 20ème siècle, l'histoire nationale passe ici à l'arrière-plan : l'axe en est l'argent, le rapport que les êtres entretiennent avec, la façon de le dépenser, de le manipuler. Rapport pathologique surtout avec trois personnages, fils, père et mère suivis plusieurs décennies en héritages et faillites, magouilles et caprices ruineux, où les sentiments semblent valorisés comme de la monnaie. Ruine financière et relationnelle relatée sur une ton parfois parodique, parfois glaçant, remuant, car Pauls est davantage qu'un essayiste : il conduit le lecteur précisément là où des larmes seraient peut-être de mise, là où le désespoir repose douloureusement. Mon avis diverge là de celui de Guillaume Condé qui ne les voit que comme des représentations au service des idées de l'auteur. Pour moi, Alan Pauls est un grand intellectuel mais son roman est autant une étude qu'un récit très humain de vies soumises à l'argent. Il est vrai que Pauls ne cherche pas de réelles incarnations, utilisation de la troisième personne, peu de descriptions personnelles, ni même de prénoms. Néanmoins certains moments m'ont paru si forts que leurs acteurs se sont incarnés automatiquement. Et grandement.
Multiple facette de la phrase, digressions nombreuses à tel point que le roman lui-même en paraît une grande. L'essentiel est que l'intérêt demeure et la curiosité en éveil quand l'auteur s'éloigne sur les entiers digressifs pour revenir sereinement, avec l'assurance d'un guide éprouvé, au propos de départ : la maladie de l'argent, universelle, plus que jamais actuelle, révélatrice de désordres affectifs. Très bonne découverte que ce roman âpre, la plus belle étant d'avoir envie de connaître mieux ce pays culturellement très riche où la littérature connaît de si belles pages. Mil gracias señor Pauls !
[1] L'escalier des aveugles : quel blog tourné vers à la littérature sud-américaine !
Lien : http://www.christianwery.be/..
WASABI d’ALAN PAULS
Un écrivain argentin vient à Buenos Aires avec sa femme, Tellas, pour une résidence d’écriture. Dès son arrivée il est gêné par un kyste apparu dans son cou. Il va voir un homéopathe qui lui propose une petite chirurgie qu’il ne souhaite pas et donc lui propose une pommade à étaler sur son kyste. Le soir en l’embrassant, Tellas trouve que son kyste enduit de crème a un goût de wasabi! Il n’a aucune inspiration pour écrire, Tellas s’ennuie, son kyste prend de l’ampleur, ressemble à un porte manteau au point qu’il marche courbé. Il projette de quitter St Nazaire pour Paris. Sur place, Tellas, qui utilise la pommade pour se frotter les tempes contre ses migraines, décide de partir pour Londres. De son côté, il s’enfonce dans une douleur semblable à l’enfer et sombre dans une profonde déprime.
Un récit court sur un homme perdu qui tombe régulièrement en catalepsie pendant laquelle il rêve, qui veut tuer de façon obsessionnelle un collectionneur parisien ou qui passe ses soirées avec un drôle d’éditeur qui l’entraîne dans des beuveries sans fin pendant que son kyste grossit, grossit…
Un écrivain argentin vient à Buenos Aires avec sa femme, Tellas, pour une résidence d’écriture. Dès son arrivée il est gêné par un kyste apparu dans son cou. Il va voir un homéopathe qui lui propose une petite chirurgie qu’il ne souhaite pas et donc lui propose une pommade à étaler sur son kyste. Le soir en l’embrassant, Tellas trouve que son kyste enduit de crème a un goût de wasabi! Il n’a aucune inspiration pour écrire, Tellas s’ennuie, son kyste prend de l’ampleur, ressemble à un porte manteau au point qu’il marche courbé. Il projette de quitter St Nazaire pour Paris. Sur place, Tellas, qui utilise la pommade pour se frotter les tempes contre ses migraines, décide de partir pour Londres. De son côté, il s’enfonce dans une douleur semblable à l’enfer et sombre dans une profonde déprime.
Un récit court sur un homme perdu qui tombe régulièrement en catalepsie pendant laquelle il rêve, qui veut tuer de façon obsessionnelle un collectionneur parisien ou qui passe ses soirées avec un drôle d’éditeur qui l’entraîne dans des beuveries sans fin pendant que son kyste grossit, grossit…
Assurément un très grand auteur, cet écrivain argentin Alan Pauls. Dans la même veine que des Espagnols comme Vila-Matas ou de Javier Marías. Pour seule preuve, Alan Pauls (lisez Paouls) n'utilise que d'immenses phrases qui se déroulent les unes après les autres comme d'immenses vagues. Et c'est bien révélateur du thème du livre, cet argent qui vient et qui s'enfuit, comme le flux et le reflux continuel du ressac.
Alan Pauls nous conte ici l'histoire d'une famille bourgeoise aux alentours des années 1970 et l'argent est omniprésent. Il remplissait une mallette pleine et était destiné à corrompre on ne sait qui, lorsqu'on a retrouvé uniquement le cadavre de son propriétaire privé de sa mallette après le crash de l'hélicoptère le transportant. C'était un parent du jeune protagoniste dont les parents séparés ne vivent que pour l'argent, son père qui ne le veut qu'en espèces et le compte et le recompte pour le jouer au casino et sa mère qui semble ne pas savoir s'arrêter de le dépenser.
C'est très bien écrit, mais la lecture est lente car il faut s'accrocher à ce style assez particulier.
J'ai bien aimé ce livre, même si j'ai trouvé sa lecture ardue, bien davantage que celle des ouvrages de Vila-Matas ou de Marías auxquelles Pauls me fait penser justement. En tout cas, un auteur à découvrir et dans l'oeuvre duquel je n'hésiterai pas à me replonger.
Alan Pauls nous conte ici l'histoire d'une famille bourgeoise aux alentours des années 1970 et l'argent est omniprésent. Il remplissait une mallette pleine et était destiné à corrompre on ne sait qui, lorsqu'on a retrouvé uniquement le cadavre de son propriétaire privé de sa mallette après le crash de l'hélicoptère le transportant. C'était un parent du jeune protagoniste dont les parents séparés ne vivent que pour l'argent, son père qui ne le veut qu'en espèces et le compte et le recompte pour le jouer au casino et sa mère qui semble ne pas savoir s'arrêter de le dépenser.
C'est très bien écrit, mais la lecture est lente car il faut s'accrocher à ce style assez particulier.
J'ai bien aimé ce livre, même si j'ai trouvé sa lecture ardue, bien davantage que celle des ouvrages de Vila-Matas ou de Marías auxquelles Pauls me fait penser justement. En tout cas, un auteur à découvrir et dans l'oeuvre duquel je n'hésiterai pas à me replonger.
HISTOIRE DES LARMES d’ALAN PAULS
Quand son père a quitté la maison pour ne plus y apparaître que les samedis matin, Il était parti avec ses chemises à monogrammes et sa montre à gousset. Lui avait quatre ans, c’était une oreille absolue, un confident, on se précipitait vers lui pour raconter, il écoutait, son père en était fier et en parlait à tous ses amis dans les réunions. Pendant qu’il jouait avec ses petites voitures sa mère venait s’asseoir près de lui et lui racontait ses malheurs, son mari parti, la pression de ses parents, sa grand mère qui avait été obligée de jeter au feu l’argent volé au grand père dans le but de s’acheter un rasoir pour éliminer son duvet…il aimait son père qui l’utilisait comme espion dans la maison et surtout c’était la seule personne au monde avec laquelle il pleurait, c’était si bon de verser des larmes.
C’est à tout cela qu’il pense lorsqu’il regarde la télévision ce 11 septembre 1973 qui voit le bâtiment de la Moneda où vivait Salvador Allende en feu. Aucune larme ne sortira de ses yeux désespérément secs bien qu’il fût un lecteur acharné du Manifeste du Parti Communiste et de la Cause Péroniste depuis l’âge de 14 ans.
Comme souvent avec Alan Pauls, un récit très intimiste ancré profondément dans l’histoire argentine.
Quand son père a quitté la maison pour ne plus y apparaître que les samedis matin, Il était parti avec ses chemises à monogrammes et sa montre à gousset. Lui avait quatre ans, c’était une oreille absolue, un confident, on se précipitait vers lui pour raconter, il écoutait, son père en était fier et en parlait à tous ses amis dans les réunions. Pendant qu’il jouait avec ses petites voitures sa mère venait s’asseoir près de lui et lui racontait ses malheurs, son mari parti, la pression de ses parents, sa grand mère qui avait été obligée de jeter au feu l’argent volé au grand père dans le but de s’acheter un rasoir pour éliminer son duvet…il aimait son père qui l’utilisait comme espion dans la maison et surtout c’était la seule personne au monde avec laquelle il pleurait, c’était si bon de verser des larmes.
C’est à tout cela qu’il pense lorsqu’il regarde la télévision ce 11 septembre 1973 qui voit le bâtiment de la Moneda où vivait Salvador Allende en feu. Aucune larme ne sortira de ses yeux désespérément secs bien qu’il fût un lecteur acharné du Manifeste du Parti Communiste et de la Cause Péroniste depuis l’âge de 14 ans.
Comme souvent avec Alan Pauls, un récit très intimiste ancré profondément dans l’histoire argentine.
HISTOIRE DE L’ARGENT d’ALAN PAULS
Il a 15 ans quand il assiste à ses funérailles, il le connaissait depuis huit ans qu’il venait avec sa mère dans sa belle-famille au milieu d’une ribambelle de petits cousins et petites cousines. Il ne l’avait jamais aimé quoiqu’il fasse ou dise mais surtout sa présence était liée invariablement au bruit de ses mâchoires quand il mangeait ses »crostini» dont il répandait les miettes un peu partout et en se penchant sur le cercueil il craignait justement d’en voir à la commissure de ses lèvres. Il était mort dans son hélicoptère retrouvé dans la rivière avec ses papiers mais pas l’argent(sale)qu’il transportait. Il n’a qu’une envie, quitter cet endroit, Mar de la Plata, son père vient le chercher et quand il doit payer le taxi(il avait raté le train) il sort un énorme rouleau de billets, il en avait toujours dans ses poches, de même qu’il ne cesse de répéter qu’on lui doit de l’argent et qu’il l’abandonne souvent le soir pour ses rendez-vous qui ne sont jamais là, pourtant il rentre au petit matin. Il ne lui parlera de rien de son vivant. Sa mère de son côté (ainsi que lui) va toucher de l’argent suite au décès de l’homme aux »crostini» il ne comprend pas. C’est aussi le moment des enlèvements dans le pays des banquiers des industriels des héritiers auxquels on réclame des rançons.
Alan Pauls parle de son pays, l’Argentine, indirectement à travers les questionnements de ce jeune garçon pour lequel l’argent est bien mystérieux. Son père qui parle de »faire de l’argent » sa mère, elle, doit «hériter de l’argent »les kidnappeurs parlent de montant de la rançon, lui se demande comment on fixe le montant à payer. Dans le Buenos Aires des années 70, dans sa famille où l’argent se dissout par le jeu ou les dépenses inconsidérées, le jeune homme découvrira à la mort de ses parents la vérité sur l’argent. Très bon livre et découverte de cet auteur.
Il a 15 ans quand il assiste à ses funérailles, il le connaissait depuis huit ans qu’il venait avec sa mère dans sa belle-famille au milieu d’une ribambelle de petits cousins et petites cousines. Il ne l’avait jamais aimé quoiqu’il fasse ou dise mais surtout sa présence était liée invariablement au bruit de ses mâchoires quand il mangeait ses »crostini» dont il répandait les miettes un peu partout et en se penchant sur le cercueil il craignait justement d’en voir à la commissure de ses lèvres. Il était mort dans son hélicoptère retrouvé dans la rivière avec ses papiers mais pas l’argent(sale)qu’il transportait. Il n’a qu’une envie, quitter cet endroit, Mar de la Plata, son père vient le chercher et quand il doit payer le taxi(il avait raté le train) il sort un énorme rouleau de billets, il en avait toujours dans ses poches, de même qu’il ne cesse de répéter qu’on lui doit de l’argent et qu’il l’abandonne souvent le soir pour ses rendez-vous qui ne sont jamais là, pourtant il rentre au petit matin. Il ne lui parlera de rien de son vivant. Sa mère de son côté (ainsi que lui) va toucher de l’argent suite au décès de l’homme aux »crostini» il ne comprend pas. C’est aussi le moment des enlèvements dans le pays des banquiers des industriels des héritiers auxquels on réclame des rançons.
Alan Pauls parle de son pays, l’Argentine, indirectement à travers les questionnements de ce jeune garçon pour lequel l’argent est bien mystérieux. Son père qui parle de »faire de l’argent » sa mère, elle, doit «hériter de l’argent »les kidnappeurs parlent de montant de la rançon, lui se demande comment on fixe le montant à payer. Dans le Buenos Aires des années 70, dans sa famille où l’argent se dissout par le jeu ou les dépenses inconsidérées, le jeune homme découvrira à la mort de ses parents la vérité sur l’argent. Très bon livre et découverte de cet auteur.
Une écriture lente, ennuyeuse, avec beaucoup de détails superflus qui alourdissent la narration. Il y a aussi pas mal de descriptions qui n'ajoutent pas au récit de dimension complémentaire.
Les personnages? Rimini est un traducteur simultané, mais sa carrière n'intéresse guère l'auteur qui préfère décrire sa vie amoureuse, comment Rimini passe d'une femme à l'autre. Sa première épouse, Sofia, l'aime toujours malgré ses propres liaisons avec des hommes divers. Elle échoue cependant à chaque fois parce que son seul amour est Rimini.
Ce dernier est un personnage étrange. Il se conduit comme s'il n'avait aucune volonté propre. Il est guidé par ses instincts et par des gens et des événements extérieurs. Ce sont toujours d'autres personnes qui décident pour lui. Il devient éducateur sportif, parce qu'il a été tiré d'une la dépression profonde par un entraîneur de son père. À la fin, il revient à son premier amour, mais il ne l'a pas choisie. La passivité de Rimini m'a bien fatiguée.
On raconte également une histoire de Riltse, un peintre qui travaille sur le sujet de la physiologie. L'un de ses tableaux est tellement excitant que n'importe quel homme a envie de se masturber ou de faire l'amour avec une femme dès qu'il voit la toile. Le texte est imprégné de descriptions de scènes de sexe, mais il est écrit de manière peu originale et plutôt rebutante.
C'est un roman très prétentieux qui ne tient cependant pas ses promesses de devenir un événement pour un public de lecteurs. Et donc un roman très décevant.
La nausée de la modernité !
Les personnages? Rimini est un traducteur simultané, mais sa carrière n'intéresse guère l'auteur qui préfère décrire sa vie amoureuse, comment Rimini passe d'une femme à l'autre. Sa première épouse, Sofia, l'aime toujours malgré ses propres liaisons avec des hommes divers. Elle échoue cependant à chaque fois parce que son seul amour est Rimini.
Ce dernier est un personnage étrange. Il se conduit comme s'il n'avait aucune volonté propre. Il est guidé par ses instincts et par des gens et des événements extérieurs. Ce sont toujours d'autres personnes qui décident pour lui. Il devient éducateur sportif, parce qu'il a été tiré d'une la dépression profonde par un entraîneur de son père. À la fin, il revient à son premier amour, mais il ne l'a pas choisie. La passivité de Rimini m'a bien fatiguée.
On raconte également une histoire de Riltse, un peintre qui travaille sur le sujet de la physiologie. L'un de ses tableaux est tellement excitant que n'importe quel homme a envie de se masturber ou de faire l'amour avec une femme dès qu'il voit la toile. Le texte est imprégné de descriptions de scènes de sexe, mais il est écrit de manière peu originale et plutôt rebutante.
C'est un roman très prétentieux qui ne tient cependant pas ses promesses de devenir un événement pour un public de lecteurs. Et donc un roman très décevant.
La nausée de la modernité !
Alan Pauls est un écrivain argentin , fils d'un émigré allemand qui a fui le nazisme en 1936.
Le titre de ce livre est donc Histoire des larmes- Un témoignage, il n'est nulle part précisé , ce que le mot "témoignage" signifie ici. Et, bien sûr, le mot " roman" n'apparait nulle part, mais c'est de plus en plus fréquent.
Il appartient à une trilogie qui se complètera peut-être qui comprend successivement, du moins dans leur traduction française , cette Histoire des larmes, suivie de Histoire des cheveux et d'Histoire de l'argent. A suivre, donc..
C'est l'histoire d'un enfant très.. empathique, qui attire les confidences et devient, de ce fait , un parfait réceptacle des souffrances des autres. Ce n'est qu'en compagnie de son père qu'il pleure , jamais avec quelqu'un d'autre.
"Il considère les larmes comme un moyen, une monnaie d'échange avec laquelle acheter ou payer. Ou peut-être est-ce la forme que le Proche adopte chez lui quand il est avec son père. Quelque chose dans l'acte de pleurer lui rappelle le bout de ses doigts poli par le frottement contre le fond de la piscine. Si ses doigts pouvaient saigner, s'ils saignaient sans blessure, seulement parce que leur peau est devenue extrêmement fine, alors ce serait parfait."
Difficile de ne pas penser au Moi-Peau de Didier Anzieu..
Mais ce Proche?
" Il ne croit pas au bonheur, pas plus qu'à qu'à toute autre émotion telle que celui qui l'éprouve n'a besoin de rien d'autre. Pour quelque raison, il se sent proche de la douleur ou, très tôt, il a perçu la relation profonde qui existe entre la proximité , quelle qu'elle soit, et la douleur: ce qu'il y a de crucial dans le fait que la distance se réduise soudain, que l'air disparaisse et que les intervalles entre deux choses soient comblés. C'est là qu'il brille, lui, qu'il brille comme personne c'est là qu'il trouve sa place. S'il le pouvait, à l'Heureux et au Bon, il opposerait ceci: le Proche."
Ce n'est que plus tard, le 11 septembre 1973, en regardant à la télévision la mort d'Allende en direct , qu'il va s'apercevoir qu'il ne peut plus pleurer. Du tout. Par contre, il va agir et rompre immédiatement avec sa petite amie dont la famille appartient à la droite chilienne. Sans doute plus sain, finalement, comme réaction?
C'est un beau et surprenant texte , écrit en de très longues phrases pleines de digressions multiples qui s'entrecroisent.
Quant à la dimension métaphorique, qui existe sans doute, elle m'a beaucoup échappé...
Je préfère, à ce niveau , donner ce lien , trouvé en cherchant d'autres visions de ce livre, qui en dit plus:
Lien : http://table-rase.blogspot.c..
Le titre de ce livre est donc Histoire des larmes- Un témoignage, il n'est nulle part précisé , ce que le mot "témoignage" signifie ici. Et, bien sûr, le mot " roman" n'apparait nulle part, mais c'est de plus en plus fréquent.
Il appartient à une trilogie qui se complètera peut-être qui comprend successivement, du moins dans leur traduction française , cette Histoire des larmes, suivie de Histoire des cheveux et d'Histoire de l'argent. A suivre, donc..
C'est l'histoire d'un enfant très.. empathique, qui attire les confidences et devient, de ce fait , un parfait réceptacle des souffrances des autres. Ce n'est qu'en compagnie de son père qu'il pleure , jamais avec quelqu'un d'autre.
"Il considère les larmes comme un moyen, une monnaie d'échange avec laquelle acheter ou payer. Ou peut-être est-ce la forme que le Proche adopte chez lui quand il est avec son père. Quelque chose dans l'acte de pleurer lui rappelle le bout de ses doigts poli par le frottement contre le fond de la piscine. Si ses doigts pouvaient saigner, s'ils saignaient sans blessure, seulement parce que leur peau est devenue extrêmement fine, alors ce serait parfait."
Difficile de ne pas penser au Moi-Peau de Didier Anzieu..
Mais ce Proche?
" Il ne croit pas au bonheur, pas plus qu'à qu'à toute autre émotion telle que celui qui l'éprouve n'a besoin de rien d'autre. Pour quelque raison, il se sent proche de la douleur ou, très tôt, il a perçu la relation profonde qui existe entre la proximité , quelle qu'elle soit, et la douleur: ce qu'il y a de crucial dans le fait que la distance se réduise soudain, que l'air disparaisse et que les intervalles entre deux choses soient comblés. C'est là qu'il brille, lui, qu'il brille comme personne c'est là qu'il trouve sa place. S'il le pouvait, à l'Heureux et au Bon, il opposerait ceci: le Proche."
Ce n'est que plus tard, le 11 septembre 1973, en regardant à la télévision la mort d'Allende en direct , qu'il va s'apercevoir qu'il ne peut plus pleurer. Du tout. Par contre, il va agir et rompre immédiatement avec sa petite amie dont la famille appartient à la droite chilienne. Sans doute plus sain, finalement, comme réaction?
C'est un beau et surprenant texte , écrit en de très longues phrases pleines de digressions multiples qui s'entrecroisent.
Quant à la dimension métaphorique, qui existe sans doute, elle m'a beaucoup échappé...
Je préfère, à ce niveau , donner ce lien , trouvé en cherchant d'autres visions de ce livre, qui en dit plus:
Lien : http://table-rase.blogspot.c..
Savoy n’est pas en phase avec le monde dans lequel il vit. Trop de modernisme le bouscule, l’angoisse, le dérange. Il n’aime pas l’univers virtuel de plus en plus présent dans le quotidien. Lui, quand il paie son loyer, il y va en personne et avec de la monnaie. Et pourtant, de temps à autre, il achète en ligne, mais on ne peut pas l’assimiler à un acheteur compulsif. Il va sur des sites, observe, décortique, analyse, puis il se rend sur place pour finaliser la transaction. Le contact est essentiel et quand il est en face de la personne, il peut également « voir d’autres choses, d’autres gens…. »
Ce qui l’intéresse, c’est la vraie vie. Il veut être là., ressentir une atmosphère retranscrivant ce qui se passe. Humer les odeurs de cuisine, écouter les bruits de lessive, voir quelqu’un sortir de la chambre ou de la salle de bain. Être au plus près de chacun. Remplir sa vie de ces petites rencontres, presque fortuites, qui le captivent. Non, ce n’est pas un voyeur, il ne revient pas forcément chaque jour au même endroit, bien que de temps à autre, il retourne en visite dans un appartement déjà connu (lieu qu’il explore pour des connaissances qui cherchent un logement). Il tient à ce que ce soit éphémère. La nostalgie l’habite….
Alors incontestablement, il est incompris. S’il explique ce besoin ses amis s’interrogent… Il n’éprouve pas le besoin de justifier quoi que ce soit. C’est ainsi, point.
Et un beau jour, Savoy fait connaissance avec Carla sur un site de rencontres. Un début de relation se noue. Mais la jeune femme parcourt le monde en allant de maison en maison et elle le laisse avec de quoi aller nager (lui qui déteste la piscine) et le mode d’emploi pour communiquer via ordinateur, à distance, avec elle. Savoy est perdu, ça ne l’intéresse pas, ni de barboter, ni de « Skyper »….
Mais comment pallier ce manque de « vrai », comment vivre avec cette moitié fantôme, celle qu’on ne peut pas toucher car elle est virtuelle ou/ et à distance ? Savoy est un original, mais il est comme beaucoup d’entre nous (sauf que c’est plus « visible »). Il cherche sans cesse l’amour le plus abouti, l’objet parfait … sans doute parce qu’ainsi il existe.
C’est avec une écriture singulière, presque philosophique, des phrases parfois longues et des dialogues indirects que l’auteur nous emmène dans l’univers de cet homme atypique mais attachant. Quelques fois, une pointe d’humour tourne en dérision une situation somme toute banale « Savoy confia la mission à ses pieds-aussi apeurés que lui- d’évaluer la température de l’eau. »
Dans ce récit surprenant, Alan Pauls démontre l’absurdité du virtuel, tel que certains l’utilisent. On peut jouer sur le lieu, tricher « Allo t’es où ? Je ne t’entends pas… » L’emprise et la place dans et sur nos vies de ce mode de communication est énorme. Il est peut-être tellement superficiel que tout risque de se déliter d’un instant à l’autre, non ?
Le ton est assez souvent désuet, un peu à l’image du personnage principal, décalé, perdu dans un monde qui peut lui échapper avant qu’il ne le rattrape à sa manière. Le fond et la forme ont un petit quelque chose de délicieux comme une parenthèse enchantée.
Lien : https://wcassiopee.blogspot...
Ce qui l’intéresse, c’est la vraie vie. Il veut être là., ressentir une atmosphère retranscrivant ce qui se passe. Humer les odeurs de cuisine, écouter les bruits de lessive, voir quelqu’un sortir de la chambre ou de la salle de bain. Être au plus près de chacun. Remplir sa vie de ces petites rencontres, presque fortuites, qui le captivent. Non, ce n’est pas un voyeur, il ne revient pas forcément chaque jour au même endroit, bien que de temps à autre, il retourne en visite dans un appartement déjà connu (lieu qu’il explore pour des connaissances qui cherchent un logement). Il tient à ce que ce soit éphémère. La nostalgie l’habite….
Alors incontestablement, il est incompris. S’il explique ce besoin ses amis s’interrogent… Il n’éprouve pas le besoin de justifier quoi que ce soit. C’est ainsi, point.
Et un beau jour, Savoy fait connaissance avec Carla sur un site de rencontres. Un début de relation se noue. Mais la jeune femme parcourt le monde en allant de maison en maison et elle le laisse avec de quoi aller nager (lui qui déteste la piscine) et le mode d’emploi pour communiquer via ordinateur, à distance, avec elle. Savoy est perdu, ça ne l’intéresse pas, ni de barboter, ni de « Skyper »….
Mais comment pallier ce manque de « vrai », comment vivre avec cette moitié fantôme, celle qu’on ne peut pas toucher car elle est virtuelle ou/ et à distance ? Savoy est un original, mais il est comme beaucoup d’entre nous (sauf que c’est plus « visible »). Il cherche sans cesse l’amour le plus abouti, l’objet parfait … sans doute parce qu’ainsi il existe.
C’est avec une écriture singulière, presque philosophique, des phrases parfois longues et des dialogues indirects que l’auteur nous emmène dans l’univers de cet homme atypique mais attachant. Quelques fois, une pointe d’humour tourne en dérision une situation somme toute banale « Savoy confia la mission à ses pieds-aussi apeurés que lui- d’évaluer la température de l’eau. »
Dans ce récit surprenant, Alan Pauls démontre l’absurdité du virtuel, tel que certains l’utilisent. On peut jouer sur le lieu, tricher « Allo t’es où ? Je ne t’entends pas… » L’emprise et la place dans et sur nos vies de ce mode de communication est énorme. Il est peut-être tellement superficiel que tout risque de se déliter d’un instant à l’autre, non ?
Le ton est assez souvent désuet, un peu à l’image du personnage principal, décalé, perdu dans un monde qui peut lui échapper avant qu’il ne le rattrape à sa manière. Le fond et la forme ont un petit quelque chose de délicieux comme une parenthèse enchantée.
Lien : https://wcassiopee.blogspot...
Drôle et émouvant.
Au départ, le personnage central d' "Histoire des larmes", un petit garçon, déjà fanatique de lecture avant de savoir lire, tente à quatre ans d’imiter Superman, en se jetant, costumé dans l’habit de son super-héros, au travers d’une porte vitrée.
Premier volume de la trilogie d’Alan Pauls (précédant "Histoire des cheveux" et "Histoire de l’argent"), "Histoire des larmes" est, comme les deux autres, une exploration de la première moitié des années 1970 en Argentine, cette période d’espoir et de rêves de révolution, ensuite déçus avec le retour de la dictature militaire en 1976. Sous-titré "Un témoignage", cette histoire est vue, de côté, à travers le parcours familial, et politique, d’un enfant et d’un adolescent.
Dans ce récit néanmoins, le cœur de la douleur et des larmes n’est pas en Argentine, mais en septembre 1973, au Chili, alors que le narrateur, maintenant adolescent, est devenu un lecteur assidu de la littérature marxiste et de la presse révolutionnaire.
«À quatorze ans il donne déjà libre cours à une rapacité marxiste qui dévore tout sur son passage : Fanon, Michael Löwy, Marta Harnecker, Armand Mattelart, le couple Dorfman-Jofré, qui lui enseigne à quel point Superman, l’homme d’acier qu’il a toujours idolâtré et idolâtre encore, dans cette sorte de seconde vie légèrement déphasée qui court parallèlement à celle dans laquelle il s’use les yeux pour se former à la pensée révolutionnaire latino-américaine, est en réalité incompatible avec cette vie, en est l’un des principaux ennemis, un ennemi déguisé et donc mille fois plus dangereux que ceux qui laissent leur uniforme les trahir comme tels – tels ces tortionnaires, sans chercher plus loin, qui, à Santiago, mettent le feu au palais de la Moneda, passé de siège du gouvernement à tombe du socialisme à la chilienne, car la catastrophe a eu lieu il y a seulement un an, elle est encore toute fraîche.»
Lui, si proche de la douleur, pleurant au moindre prétexte en présence de son père lorsqu’il était enfant, est devenu précocement un être trop lucide, pas un super-héros mais un homme incapable de pleurer, même en ce 11 septembre 1973 devant les images du palais de la Moneda en feu.
Virtuoses, les phrases d’Alan Pauls ont la force des grandes vagues, entremêlant la fiction familiale, les sentiments intimes et l’histoire argentine. Une lecture nécessaire.
Au départ, le personnage central d' "Histoire des larmes", un petit garçon, déjà fanatique de lecture avant de savoir lire, tente à quatre ans d’imiter Superman, en se jetant, costumé dans l’habit de son super-héros, au travers d’une porte vitrée.
Premier volume de la trilogie d’Alan Pauls (précédant "Histoire des cheveux" et "Histoire de l’argent"), "Histoire des larmes" est, comme les deux autres, une exploration de la première moitié des années 1970 en Argentine, cette période d’espoir et de rêves de révolution, ensuite déçus avec le retour de la dictature militaire en 1976. Sous-titré "Un témoignage", cette histoire est vue, de côté, à travers le parcours familial, et politique, d’un enfant et d’un adolescent.
Dans ce récit néanmoins, le cœur de la douleur et des larmes n’est pas en Argentine, mais en septembre 1973, au Chili, alors que le narrateur, maintenant adolescent, est devenu un lecteur assidu de la littérature marxiste et de la presse révolutionnaire.
«À quatorze ans il donne déjà libre cours à une rapacité marxiste qui dévore tout sur son passage : Fanon, Michael Löwy, Marta Harnecker, Armand Mattelart, le couple Dorfman-Jofré, qui lui enseigne à quel point Superman, l’homme d’acier qu’il a toujours idolâtré et idolâtre encore, dans cette sorte de seconde vie légèrement déphasée qui court parallèlement à celle dans laquelle il s’use les yeux pour se former à la pensée révolutionnaire latino-américaine, est en réalité incompatible avec cette vie, en est l’un des principaux ennemis, un ennemi déguisé et donc mille fois plus dangereux que ceux qui laissent leur uniforme les trahir comme tels – tels ces tortionnaires, sans chercher plus loin, qui, à Santiago, mettent le feu au palais de la Moneda, passé de siège du gouvernement à tombe du socialisme à la chilienne, car la catastrophe a eu lieu il y a seulement un an, elle est encore toute fraîche.»
Lui, si proche de la douleur, pleurant au moindre prétexte en présence de son père lorsqu’il était enfant, est devenu précocement un être trop lucide, pas un super-héros mais un homme incapable de pleurer, même en ce 11 septembre 1973 devant les images du palais de la Moneda en feu.
Virtuoses, les phrases d’Alan Pauls ont la force des grandes vagues, entremêlant la fiction familiale, les sentiments intimes et l’histoire argentine. Une lecture nécessaire.
Deuxième volume d’une trilogie après Histoire des larmes, paru en 2010, c’est le parcours étrange d’un homme hanté par ses cheveux, par leur présence physique, leur allure, leur coupe. Ce récit est l’histoire de la perte, et chaque coupe de cheveux semble être une petite mort : aller chez le coiffeur, quand on franchit la porte d’un salon inconnu, s’apparente à un acte suicidaire. Pourtant le narrateur continue de le faire, habité par l’espoir, ou l’esprit d’aventure.
Comme Alan Pauls, cet homme a grandi à Buenos Aires dans les années 1970. Dans une Argentine alors agitée de pulsions révolutionnaires, qui rejette la dictature, la violence et l’exploitation, l’adolescent de douze ans aux cheveux blonds et raides adopte une coupe afro comme acte de rébellion. Son camarade Monti, son meilleur ami, a opté pour la même jungle de bouclettes mais, quelques mois plus tard, arrêté pour un vol de voiture, il passe au tribunal et son crâne est rasé.
« Se raser le crâne. Et pourquoi pas ? Il a souvent pensé que rien d’autre ne se rapproche plus de la solution finale. Se raser le crâne et faire d’une pierre deux coups : en finir une bonne fois pour toutes avec les hésitations, le désir insatisfait, l’espoir de toucher du doigt le style, le genre de coupe spéciale qu’il suppose lui être destinés, enterrer pour toujours – pour la modeste éternité que mettent les cheveux à revivre, à pousser, à revenir à la charge avec leur lot de complications – le rêve de l’unique dans cette espèce d’étendue désertique, anonyme, indifférente, à laquelle se réduit la tête une fois balayée par la tondeuse, et accéder du même coup à ce trésor que représente le cuir chevelu, si dissimulé et superficiel à la fois, ou une série de raies et d’entailles semblent décrire un dessin secret, ainsi qu’il le découvre lorsque Monti passe menotté devant lui et qu’il en profite pour examiner la surface comme moquettée de son crâne. »
Bien des années plus tard, toujours incertain et obsédé par l’allure de ses cheveux, le narrateur tombe dans un salon sur Celso, le coiffeur absolu. La coupe semble durer un temps infini, à tel point qu’il imagine ses cheveux blanchir tandis qu’on les lui coupe. Mais à la fin pas de doute, Celso est un génie.
Dans ce récit comique, par ses personnages excentriques tous un peu déjantés, la mort est toujours là, tapie derrière chaque mèche, au détour de chaque phrase, comme attendant son heure. À travers cette rencontre avec un coiffeur génial et avec Monti, qu’il continue de croiser par hasard au fil des années, c’est l’histoire de l’Argentine qui affleure tout au long du récit, ses épisodes noirs et de destruction, mais aussi la décadence du corps avec les années et la maladie.
Moins riche et moins profond que l’Histoire de l’argent, ce roman d’une légèreté funèbre prend par ses personnages incertains des accents de Bolaño. Alan Pauls est un vrai magicien des sentiments ténus, dans lesquels la grande Histoire vient se refléter.
Comme Alan Pauls, cet homme a grandi à Buenos Aires dans les années 1970. Dans une Argentine alors agitée de pulsions révolutionnaires, qui rejette la dictature, la violence et l’exploitation, l’adolescent de douze ans aux cheveux blonds et raides adopte une coupe afro comme acte de rébellion. Son camarade Monti, son meilleur ami, a opté pour la même jungle de bouclettes mais, quelques mois plus tard, arrêté pour un vol de voiture, il passe au tribunal et son crâne est rasé.
« Se raser le crâne. Et pourquoi pas ? Il a souvent pensé que rien d’autre ne se rapproche plus de la solution finale. Se raser le crâne et faire d’une pierre deux coups : en finir une bonne fois pour toutes avec les hésitations, le désir insatisfait, l’espoir de toucher du doigt le style, le genre de coupe spéciale qu’il suppose lui être destinés, enterrer pour toujours – pour la modeste éternité que mettent les cheveux à revivre, à pousser, à revenir à la charge avec leur lot de complications – le rêve de l’unique dans cette espèce d’étendue désertique, anonyme, indifférente, à laquelle se réduit la tête une fois balayée par la tondeuse, et accéder du même coup à ce trésor que représente le cuir chevelu, si dissimulé et superficiel à la fois, ou une série de raies et d’entailles semblent décrire un dessin secret, ainsi qu’il le découvre lorsque Monti passe menotté devant lui et qu’il en profite pour examiner la surface comme moquettée de son crâne. »
Bien des années plus tard, toujours incertain et obsédé par l’allure de ses cheveux, le narrateur tombe dans un salon sur Celso, le coiffeur absolu. La coupe semble durer un temps infini, à tel point qu’il imagine ses cheveux blanchir tandis qu’on les lui coupe. Mais à la fin pas de doute, Celso est un génie.
Dans ce récit comique, par ses personnages excentriques tous un peu déjantés, la mort est toujours là, tapie derrière chaque mèche, au détour de chaque phrase, comme attendant son heure. À travers cette rencontre avec un coiffeur génial et avec Monti, qu’il continue de croiser par hasard au fil des années, c’est l’histoire de l’Argentine qui affleure tout au long du récit, ses épisodes noirs et de destruction, mais aussi la décadence du corps avec les années et la maladie.
Moins riche et moins profond que l’Histoire de l’argent, ce roman d’une légèreté funèbre prend par ses personnages incertains des accents de Bolaño. Alan Pauls est un vrai magicien des sentiments ténus, dans lesquels la grande Histoire vient se refléter.
Ayant gagné une bourse d’écriture pour un séjour de trois mois en France avec sa femme Tellas, un écrivain argentin, hypocondriaque sans doute, se retrouve à Saint-Nazaire tourmenté par divers maux, et en particulier un kyste dans la nuque qui grossit et se métamorphose, bizarrerie qu’il semble accepter comme un appendice étranger à son propre corps.
Pour soigner néanmoins cette excroissance surprenante, une homéopathe lui prescrit une pommade au wasabi. Il goûte la pommade avec sa femme et tous deux développent une forte addiction pour l’euphorie qu’elle génère.
«Les premières minutes passées, lorsque la rafale avait cessé de produire son effet anesthésique dans le nez, une convulsion vorace s’emparait de nous. Nous devenions chair, chair réduite à son état de pureté maximale, pure chair crue.»
Le narrateur souffre aussi d’une narcolepsie caractérisée par des périodes de sommeil d’exactement sept minutes, et il se retrouve ainsi chaque jour confronté à l’énigme (et à la recherche) de ce temps perdu. Bien sûr il n’arrive pas à écrire et devient obsédé par Pierre Klossowski – qu’Alan Pauls admire beaucoup par ailleurs - suite à une proposition de Bouthemy, son éditeur redoutable, de prendre un des tableaux du grand homme comme couverture de son livre.
Le kyste, son traitement au wasabi, les périodes de sommeil, agissant comme des courts-circuits, et l’obsession de Klossowski entraînent par la suite une spirale d’événements improbables, autour de la vie de couple et du destin d’écrivain du narrateur.
Beaucoup moins abouti que ses livres ultérieurs mais très drôle, piquant comme un récit d’Eric Chevillard, ce court roman déjanté de 1994 se termine en extase et célèbre le pouvoir délirant de la fiction, ou comment l’écrivain se débarrasse des grandes ombres qui l’empêchent de créer, et transforme ses insuffisances en pouvoir surnaturel.
Pour soigner néanmoins cette excroissance surprenante, une homéopathe lui prescrit une pommade au wasabi. Il goûte la pommade avec sa femme et tous deux développent une forte addiction pour l’euphorie qu’elle génère.
«Les premières minutes passées, lorsque la rafale avait cessé de produire son effet anesthésique dans le nez, une convulsion vorace s’emparait de nous. Nous devenions chair, chair réduite à son état de pureté maximale, pure chair crue.»
Le narrateur souffre aussi d’une narcolepsie caractérisée par des périodes de sommeil d’exactement sept minutes, et il se retrouve ainsi chaque jour confronté à l’énigme (et à la recherche) de ce temps perdu. Bien sûr il n’arrive pas à écrire et devient obsédé par Pierre Klossowski – qu’Alan Pauls admire beaucoup par ailleurs - suite à une proposition de Bouthemy, son éditeur redoutable, de prendre un des tableaux du grand homme comme couverture de son livre.
Le kyste, son traitement au wasabi, les périodes de sommeil, agissant comme des courts-circuits, et l’obsession de Klossowski entraînent par la suite une spirale d’événements improbables, autour de la vie de couple et du destin d’écrivain du narrateur.
Beaucoup moins abouti que ses livres ultérieurs mais très drôle, piquant comme un récit d’Eric Chevillard, ce court roman déjanté de 1994 se termine en extase et célèbre le pouvoir délirant de la fiction, ou comment l’écrivain se débarrasse des grandes ombres qui l’empêchent de créer, et transforme ses insuffisances en pouvoir surnaturel.
Remplace avantageusement les somnifères.
Alan Pauls, écrivain né en 1959, était un enfant en cette période troublée des années 1970 en Argentine, comme le héros du livre, un jeune garçon à l’acuité extrême frappé par l’énigme de l’argent.
Au début du roman, l’enfant, alors âgé de quatorze ans, voit arriver dans la maison de son beau-père le cadavre d’un ami de la famille, mort dans un accident d’hélicoptère alors qu’il emportait un attaché-case plein d’argent dans une puissante entreprise sidérurgique touchée par un conflit syndical, un argent obscur censé dénouer la situation, capable de tout résoudre ou de tout faire exploser. Pour l’enfant les traces de l’accident sont le cadavre, et cette mallette étrangement volatilisée dans le crash, parabole de l’obscurité et l’irrationalité de l’argent.
L’histoire de l’Argentine des années 70, celle de la lutte armée et de la violence d’état, n’est ici qu’un prétexte. La grande histoire est présente par la démence inflationniste, contexte à cette histoire d’une famille de la classe moyenne. C’est le récit du rapport intime, de la passion spécifique ou bien de la souffrance que génère pour chacun le rapport à l’argent : le père magnifique, passionné de nombres, de calcul et de jeu, la mère, héritière aride dont on ne découvre réellement le rapport à l’argent qu’à la toute fin du livre, et l’enfant tentant de déchiffrer le pathos de l’argent, le délire de ces nombres qui loin de rationaliser l’émotion l’amplifient en folie multiforme, filtre à l’aune duquel se mesurent la mort, l’amour, la vieillesse et la vie.
« Mais compter, en plus, au sens de l’action physique, comme lorsque l’on dit compter des billets, est quelque chose qui le saisit depuis qu’il est tout jeune, une fois qu’il a un après-midi libre et accompagne son père lors de son périple au centre-ville, où celui-ci travaille, et qu’il le voit encaisser des chèques dans les banques, payer des billets dans les compagnies aériennes, acheter ou vendre des devises étrangères dans les bureaux de change, et qui le saisira toujours, jusqu’aux derniers jours lorsque, quarante-deux ans plus tard, à l’hôpital, un peu avant l’infection pulmonaire qui va le condamner au masque à oxygène et à l’intubation, son père choisira dans une liasse déjà considérablement écornée, les deux billets de cinquante pesos qu’il a décidé de donner comme pourboire « avant qu’il ne soit trop tard », comme il le dit lui-même, à l’infirmière du matin qui, à sa grande surprise, lui parle allemand tandis qu’elle lui change la sonde, lui fait un piqûre ou lui prend la température. Personne n’arbore un tel aplomb, une telle efficacité élégante et hautaine, qui transforme le fait de payer en une action souveraine et fait oublier le caractère de réponse, toujours secondaire, qu’il possède en réalité. »
Dernier roman d’une trilogie, après Histoire des larmes et Histoire des cheveux, Histoire de l’argent est un roman éblouissant par la phrase d’Alan Pauls, cette phrase héritière de Proust, sinueuse et truffée de sens, capable d’embrasser en quelques lignes tout l’espace entre naissance et mort.
Au début du roman, l’enfant, alors âgé de quatorze ans, voit arriver dans la maison de son beau-père le cadavre d’un ami de la famille, mort dans un accident d’hélicoptère alors qu’il emportait un attaché-case plein d’argent dans une puissante entreprise sidérurgique touchée par un conflit syndical, un argent obscur censé dénouer la situation, capable de tout résoudre ou de tout faire exploser. Pour l’enfant les traces de l’accident sont le cadavre, et cette mallette étrangement volatilisée dans le crash, parabole de l’obscurité et l’irrationalité de l’argent.
L’histoire de l’Argentine des années 70, celle de la lutte armée et de la violence d’état, n’est ici qu’un prétexte. La grande histoire est présente par la démence inflationniste, contexte à cette histoire d’une famille de la classe moyenne. C’est le récit du rapport intime, de la passion spécifique ou bien de la souffrance que génère pour chacun le rapport à l’argent : le père magnifique, passionné de nombres, de calcul et de jeu, la mère, héritière aride dont on ne découvre réellement le rapport à l’argent qu’à la toute fin du livre, et l’enfant tentant de déchiffrer le pathos de l’argent, le délire de ces nombres qui loin de rationaliser l’émotion l’amplifient en folie multiforme, filtre à l’aune duquel se mesurent la mort, l’amour, la vieillesse et la vie.
« Mais compter, en plus, au sens de l’action physique, comme lorsque l’on dit compter des billets, est quelque chose qui le saisit depuis qu’il est tout jeune, une fois qu’il a un après-midi libre et accompagne son père lors de son périple au centre-ville, où celui-ci travaille, et qu’il le voit encaisser des chèques dans les banques, payer des billets dans les compagnies aériennes, acheter ou vendre des devises étrangères dans les bureaux de change, et qui le saisira toujours, jusqu’aux derniers jours lorsque, quarante-deux ans plus tard, à l’hôpital, un peu avant l’infection pulmonaire qui va le condamner au masque à oxygène et à l’intubation, son père choisira dans une liasse déjà considérablement écornée, les deux billets de cinquante pesos qu’il a décidé de donner comme pourboire « avant qu’il ne soit trop tard », comme il le dit lui-même, à l’infirmière du matin qui, à sa grande surprise, lui parle allemand tandis qu’elle lui change la sonde, lui fait un piqûre ou lui prend la température. Personne n’arbore un tel aplomb, une telle efficacité élégante et hautaine, qui transforme le fait de payer en une action souveraine et fait oublier le caractère de réponse, toujours secondaire, qu’il possède en réalité. »
Dernier roman d’une trilogie, après Histoire des larmes et Histoire des cheveux, Histoire de l’argent est un roman éblouissant par la phrase d’Alan Pauls, cette phrase héritière de Proust, sinueuse et truffée de sens, capable d’embrasser en quelques lignes tout l’espace entre naissance et mort.
Alan Pauls est un écrivain argentin né à Buenos Aires en 1959. Fils d'un émigré allemand qui a fui le nazisme en 1936 il n'a jamais réussi à maîtriser la langue allemande, en dépit de son intérêt pour la littérature allemande. Il a fait ses études au lycée français de Buenos Aires et parfaitement francophone, il est un bon connaisseur des œuvres de Stendhal, Proust et Barthes, qui l'ont inspiré pour la composition de ses propres œuvres. Professeur de théorie littéraire, traducteur, scénariste, critique de cinéma, il a notamment publié un essai sur Borges, plusieurs nouvelles et une dizaine de romans dont celui-ci qui vient de paraître.
Savoy, notre héros, semble un peu perdu dans le monde et n’a trouvé qu’une solution pour contrer son ennui et sa solitude assumée, il visite des appartements, non pas pour les lieux précisément mais pour rencontrer des gens, les faire parler, voir comment ils vivent. Par le biais de Renée, une ex devenue son amie, il découvre internet, les sites de ventes entre particuliers qui là encore lui permettent de se rendre chez des gens où il achète n’importe quoi, juste pour le plaisir de la visite, puis il découvre les sites de rencontres où il se lie avec Clara, une Hollandaise. Une nouvelle bizarrerie dans la vie de Savoy car Clara ne vit quasiment jamais près de lui, son job consistant à garder les maisons de particuliers devant s’en absenter et ce, dans le monde entier ! Un moyen comme un autre, pour elle, de voyager.
Je ne vais pas vous mentir, je me suis ennuyé comme c’est pas possible à lire ce bouquin qui me tombait perpétuellement des mains après les cinquante premières pages.
Je ne dis pas que le roman est mauvais, il trouvera son public mais il ne se passe rien de notable et le peu n’a guère d’intérêt. Il paraît que Marcel Proust l’inspire et c’est vrai. Autant j’aime le Français, autant cet Argentin m’ennuie et certainement pour les mêmes raisons que celles qui font ne pas aimer Proust pour ceux qui s’y ennuient : l’écriture est dense, les digressions sur des points de détail allongent les phrases à n’en plus finir et noient hélas, l’humour discret et sous-jacent qui rythme le récit, bref c’est asphyxiant.
Quant au(x) sujet(s) du livre je ne sais pas trop, certes il y a une critique/moquerie de la modernité et de ses nouvelles technologies, du mode de vie qu’elles nous imposent etc. mais c’est tellement léger, déjà lu ailleurs et noyé dans tant de blablas que ça passe presque inaperçu. Ne reste que l’ennui… pour moi.
Savoy, notre héros, semble un peu perdu dans le monde et n’a trouvé qu’une solution pour contrer son ennui et sa solitude assumée, il visite des appartements, non pas pour les lieux précisément mais pour rencontrer des gens, les faire parler, voir comment ils vivent. Par le biais de Renée, une ex devenue son amie, il découvre internet, les sites de ventes entre particuliers qui là encore lui permettent de se rendre chez des gens où il achète n’importe quoi, juste pour le plaisir de la visite, puis il découvre les sites de rencontres où il se lie avec Clara, une Hollandaise. Une nouvelle bizarrerie dans la vie de Savoy car Clara ne vit quasiment jamais près de lui, son job consistant à garder les maisons de particuliers devant s’en absenter et ce, dans le monde entier ! Un moyen comme un autre, pour elle, de voyager.
Je ne vais pas vous mentir, je me suis ennuyé comme c’est pas possible à lire ce bouquin qui me tombait perpétuellement des mains après les cinquante premières pages.
Je ne dis pas que le roman est mauvais, il trouvera son public mais il ne se passe rien de notable et le peu n’a guère d’intérêt. Il paraît que Marcel Proust l’inspire et c’est vrai. Autant j’aime le Français, autant cet Argentin m’ennuie et certainement pour les mêmes raisons que celles qui font ne pas aimer Proust pour ceux qui s’y ennuient : l’écriture est dense, les digressions sur des points de détail allongent les phrases à n’en plus finir et noient hélas, l’humour discret et sous-jacent qui rythme le récit, bref c’est asphyxiant.
Quant au(x) sujet(s) du livre je ne sais pas trop, certes il y a une critique/moquerie de la modernité et de ses nouvelles technologies, du mode de vie qu’elles nous imposent etc. mais c’est tellement léger, déjà lu ailleurs et noyé dans tant de blablas que ça passe presque inaperçu. Ne reste que l’ennui… pour moi.
« Le Facteur Borges » est un petit essai de Alan Pauls, traduit par Vincent Raynaud et publié en français (2006, Christian Bourgois Editeur 196 p.).
Comme il est écrit au quatrième de couverture « Ce livre n'est pas un roman d'espionnage. C'est un essai consacré à la lecture ». On s’en serait douté, mais avec les auteurs argentins contemporains, et donc post-Borges, on ne sait jamais. Surtout que le texte embraye aussitôt sur le Saint Graal (quel rapport avec les « Monty Python », ou Moby Dick (idem, quel rapport avec Pierre Senges et son « Achab (séqelles) »). Celà continue avec « les traces du facteur Borges pour capturer la propriété, l'empreinte digitale, la molécule qui fait que Borges est Borges ». On en déduirait presque que Rhésus est Rhésus, et que sa société a connu douze apôtres. Tout comme Alan Pauls démontre qu’il existe (ou ont existé) plusieurs Borges.
« Un essai qui montre le côté le plus ludique et le moins solennel ». Tiens, il n’y a pas de note pour ludique. Les futurs bacheliers vont encore être désorientés. Mais, il y a ensuite des # pour faire moderne ( #originalité, tradition, bibliothèque# ) pour cartographier le cœur de ses textes. Peut-être est-ce pour cela que Jorge Luis se fait naître en 1900, pour être du siècle, lui qui est né le 24 août 1899, au 840 Calle Tucuman à Buenos Aires, tout de même. Quitte à suivre ses parents en Suisse, à Lugano, puis Genève par la suite, avant de revenir à ses sources portègnes. Pa la suite, on apprendra que l'espace « Aleph » est caché parmi les eucalyptus du Barrio Palermo, entre Calle Serrano et Calle Guatemala, pas si loin que cela de Calle Tucuman, plus au Sud.
Un essai sur Jorge Luis Borges est toujours bon à prendre, même si les biographies, critiques ou essais ne manquent pas. University of Pittsburgh a d’ailleurs développé un site dédié, après avoir été hébergé par University of Aarhus, DK, puis University of Iowa. Ce site est géré par le Department of Hispanic Languages and Literature. Il collationne un journal trilingue, anglais, espagnol, français les « Variaciones Borges » ainsi qu’une importante collection d’article critiques, dans les trois langues, dont la plupart sont accessibles sous format pdf. Le tout est disponible dans leur boutique en ligne et ils peuvent être contactés à l’adresse mail suivante borges@pitt.edu. Si l’œuvre écrite de Borges est abondante, elle est disponible à la Bibliothèque de la Pléiade, sous forme d’un joli coffret cartonné jaune et noir, qui contient les deux tomes des « Œuvres Complètes » (2016, Gallimard, La Pléiade, 3440 p.). Ce coffret pourrait représenter l’édition définitive, si Borges lui-même n’avait écrit que « l'idée de texte définitif ne relève que de la religion ou de la fatigue ».
Pour revenir au « Facteur Borges », Alan Pauls donne un bon résumé de la biographie de Borges (1899-1986). Ce petit essai de presque deux cents pages est bien écrit, avec énormément de notes de bas de pages, qui explicitent, soit des termes purement argentins, soit des évènements spécifiques ou historiques. Le livre est organisé selon neuf chapitres, d’une vingtaine de pages chacun. Il n’est pas évident de faire une critique d’une biographie, sans faire de la redite, ni être accusé de spoiling.
Tout commence par le commencement avec « Un classique précoce ». C’est la jeunesse de Borges, son épisode de la naissance décalée, puis son retour à Buenos Aires. Son désir d’être et de faire partie de l’avant-garde. Il insiste particulièrement sur sa jeunesse et sa volonté de s’inscrire en termes d’auteur argentin « criollo », c’est-à-dire aux racines dans le passé historique du pays, où il a vécu, à son éducation trilingue, anglais, espagnol, portugais, de par ses parents.
Il revient tout d’abord sur l’épisode de sa naissance et sa volonté d’apparaitre comme étant du vingtième siècle, et non pas des années 1800 et quelques. Coquetterie qu’il aura dans les années 1926-27, auquel moment aussi il détruit deux pamphlets consacrés à sa ville Buenos Aires. Par contre, à son retour au pays, il va tacher de se montrer presque plus argentin que ses compatriotes. Il va pour cela farcir ses textes de néologismes typiques de Buenos Aires. Des mots comme « cordobesada, bochinchera, bondâ, incredulidâ, esplicable ». Mots qu’il invente, suggérant que « écrire consiste à inventer des détours précieux, des circonlocutions, des déguisements qui surprennent.
Il est surprenant de faire ici le parallèle avec James Joyce à la même époque. Ce dernier est alors, en famille, à Pola (1905), puis à Trieste, où il obtient un poste d'enseignant en anglais à l'école Berlitz. A Pola, ville navale actuellement en Croatie, sur la côte Adriatique, Joyce enseigne l’anglais à des officiers de la marine autrichienne. Il y restera jusqu’à la guerre où il partira pour Zurich. Cependant, ce passé triestin le suivra, jusque vers 1920, quand la famille part pour Paris. C'est là que Joyce fait la connaissance d'Ettore Schmit qui écrira plus tard sous le nom de Italo Svevo. Il s'inspire de son ami pour créer Leopold Bloom dans « Ulysse ». Livia, la femme de Svevo, nourrira le personnage d'Anna Livia Plurabelle dans « Finnegans Wake », notamment sa très longue chevelure que Joyce compare à la rivière Liffey de Dublin. De cette époque, date son goût pour Trieste. Il apprend à parler le dialecte triestin, fait qu’il partage avec sa fille préférée Lucia. Souvent dans sa correspondance avec elle, les mots en triestin servent de « code » ou complicité entre le père et la fille.
On en arrive à « Des livres comme armes ». L’Argentine des années 20-30 est en pleine évolution. C’est la période de l’immigration massive des européens « dont les premiers écrivains professionnels portent déjà des noms de famille espagnols ou italiens ». Le jeune Borges, lui insiste sur son passé argentin. De par sa mère, Leonor Acevedo, c’est une lignée militaire. « Je descends de Juan de Garay et d’Itala ». Il en rajoute peut-être un peu lorsqu’il prétend « J’ai des ancêtres parmi les premiers Espagnols qui arrivèrent ici ».
« L’autre lignée est paternelle et elle est fondamentalement intellectuelle, livresque et anglophone ». Un père avocat et anarchiste, disciple de Spencer, anglophone pur et dur. Mais, comme le remarque Ricardo Piglia, « ce que possède l’un des côtés manque à l’autre ».
Ses tout premiers textes sont centrés sur Buenos Aires avec « Ferveur de Buenos Aires », d’ailleurs dédiés à sa mère « A Leonor Acevedo de Borges ». Puis ce sera « Evaristo Carriego » dans lequel il décrit Palermo, le quartier chaud de Buenos Aires au début du siècle. C’est le monde de la milonga, des petites frappes avec les rixes à coups de couteaux, les maisons de passe et les prostituées tuberculeuses. Un peu plus tard, au début des années 50, ce sera l’époque de la tradition « gauchesque », avec la célébration du « Martin Fierro » de José Hernandez. Cependant, cela ne suffit pas à Borges. Il rajoute au texte initial un texte « La Fin », paru dans « Fictions » qu’il définit « non pas comme un emplâtre, mais comme un bon rajout ».
La poésie « gauchesque » n'était pas une poésie écrite par des gauchos, mais plus généralement par des écrivains urbains instruits qui adoptaient le vers de huit syllabes des « payadas » (ballades) rurales, mais en y fourrant des expressions folkloriques et des récits de la vie quotidienne. Borges, au contraire, estimait que ces expressions n’avaient pas de place dans les « payadas » qui devaient rester sérieuses. Seul à ses yeux, José Hernández (1834-1886) l’auteur de « Martín Fierro » était l'un des rares poètes gauchesques à avoir vécu en tant que gaucho.
À cet égard, Borges distingue la poésie « heureuse et vaillante » de Hilario Ascasubi (1807-1875) qu'il oppose à la lamentation tragique d'Hernández. Borges reconnait en Ascasubi un soldat avec une vaste expérience du combat et qui a décrit l'invasion indienne de la province de Buenos Aires, bien qu’il n’en ait pas été témoin. Il estime cependant son travail, parfois autobiographique. En effet, Ascasubi est né à l'arrière d'une charrette tirée par des chevaux pendant un orage, alors que sa mère se rendait à un mariage à Buenos Aires. On lui doit Santos Vega ou los mellizos de la Flor » publié en 1851, réimprimé depuis (2019, Wentworth Press, 480 p.). Le roman narre l’histoire de ntos Vega, un gaucho argentin mythique. Invincible « payador » qui a même vaincu la Diable, déguisé en « payador Juan sin Ropa »
Enfin, le troisième poète de la lignée gauchesque est Estanislao del Campo (1834-1880). Né à Buenos Aires dans une famille unitarienne. Ces derniers favorisaient un gouvernement central fort plutôt qu'une fédération. On lui doit un poème satirique « Fausto » (1866) qui décrit les impressions d'un gaucho qui va voir l'opéra « Faust » de Charles Gounod, croyant que les événements se sont réellement produits.
On est encore dans la jeunesse de Borges, mais tout reste dans la « Politique de la pudeur ». En 1925, il encense encore abondamment le côté « criollo ». « La nature espagnole s’offre à nous en tant que véhémence pure : on dirait qu’en s’installant dans la pampa elle s’est diluée et perdue. La manière d’en parler est devenue plus trainante, la platitude des horizons successifs a limité les ambitions », écrit-il dans « Quejas de todo criollo ». Il cultive de fait cette couleur locale. Cependant, il ne se met pas à la place du peuple. « Le peuple n’a pas besoin de prouver qu’il est ce qui est – mais quelqu’un qui entend prendre sa place »
Pour mieux faire valoir « Le parler argentin », c’est alors qu’il achète deux dictionnaires d’argentinismes, dont il se sert pour écrire « maderjon, espaldaña, estaca pampa ». Mais c’est aussi pour lui l’occasion, non plus d’écrire, mais de parler. Sa cécité commence à se développer. Et il est vrai que, pour beaucoup, Borges, surtout à la fin de sa vie, c’est une voix plutôt qu’un texte. Il faut lire « L’homme au coin du mur rose », paru dans « Histoire Naturelle de l’Infamie », avec sa scène de duel au couteau entre Francisco Real, dit « le Corralero » et Rosendo Juarez, dit « le Cogneux ».
« Chaque fois qu’un livre est lu ou relu, il se passe quelque chose avec ce livre ». C’est le constat de Borges. Alan Pauls traduit cette phrase au début de « Petite écriture » en « Qu’est-ce qui peut être suffisamment intense pour qu’un écrivain décrète que lire est un art plus élevé qu’écrire ». Cette dernière assertion étant reprise de « Eloge de l’Ombre ».
On en arrive au gros morceau de l’essai, avec un titre qui en dit long « Danger : bibliothèque ». On sait que Borges a été élevé dans la bibliothèque d son père, en Suisse. Borges est un lecteur très précoce. Il remplace le monde par des livres. Tout juste sorti de l'école, il consulte son ophtalmologiste, qui lui conseille de ménager ses yeux s'il ne veut pas accélérer la détérioration qui commence à les menacer. Aussitôt sorti de chez l’ophtalmologiste, il prend un tramway, rentre chez lui. Puis il se met à lire « La Divine Comédie ». La lumière est celle de sept heures du soir en Suisse.
A soixante-dix ans, Borges assure avoir oublié la plupart des visages de son enfance à cause de sa mauvaise vue, mais il garde un souvenir très net de bien des illustrations de l « Encyclopedia » de Chambers et de la « Britannica ».
La bibliothèque telle que la conçoit Borges, devient alors un labyrinthe un peu comme ces maisons avec escaliers de M.C. Escher (1898-1972). Même si ces idées sont un peu postérieures à Borges, ces idées d'auto-référence et de boucles étranges, forment des structures, peu probables dans la nature, mais fortement spectaculaires. Cela aboutira à « La bibliothèque totale » (1904), puis à « La bibliothèque de Babel » (944), publié dans « Fictions ».
On sait que ce concept a donné lieu au site « Library of Babel » afin de simuler partiellement la bibliothèque imaginée par Borges. L'algorithme lié à ce site permet de générer un livre de 410 pages avec 3200 caractères par page, par simple permutation des 26 lettres de l'alphabet, de la virgule, de l'espace et du point. Qu’importe le sens. Cela correspond au paradoxe du singe savant. Il s’agit d’un théorème selon lequel un singe qui tape indéfiniment et au hasard sur le clavier d'une machine à écrire pourra « presque sûrement » écrire un texte donné. Toujours à propos des bibliothèques. « Tout est déjà écrit : le monde a la structure d'une encyclopédie, d'une bibliothèque, d'une archive ». Alan Pauls raconte à merveille ceci : Borges ne consultait pas les encyclopédies, il les lisait. « Si tout est écrit, il est temps de faire autre chose. Ou plutôt, il est temps de changer le sens du faire en littérature. Passer du faire dans au faire avec ».
Puis, Alan Pauls passe à la question de la science-fiction, toujours par l’intermédiaire des bibliothèques. Après l’« Histoire universelle de l'infamie » (1936), Borges publie la série de « Tlön, Uqbar et Orbis Tertius » (1940-47). D’après une obscure encyclopédie, « The Anglo-American Cyclopedia », il existerait un monde différent nommé Uqbar. C’est une découverte que Borges fait après un diner avec Bioy Caceres, dans « une région de l’Irak ou de l’Asie Mineure ». La raison en est que pour les gnostiques anciens « les miroirs et la paternité sont abominables parce qu’ils multiplient les objets », résultat « l’univers visible est une illusion ». Pour déterminer son existence, le narrateur doit passer par un labyrinthe. « La littérature d'Uqbar [...] ne faisait jamais référence à la réalité, mais aux deux régions imaginaires de Mlajnas et de Tlön ». De même, en étudiant les langues de Tlön, on en vient à la question de savoir comment le langage pourrait avoir une emprise sur les pensées. C’est un thème récurrent chez Borges, mais abordé ici par la science-fiction. Donc cela dépasse « la simple identité entre livre et monde ». Pour vérifier cette hypothèse, les deux compères vont à la Bibliothèque Nationale, et « c’est en vain que nous fatiguâmes atlas, catalogues, annuaires de sociétés géographiques, mémoires de voyageurs et d’historien : personne n'était jamais allé à Uqbar ». Fin de la recherche, et fin du rêve, mais l’histoire est jolie. Les deux chercheurs discutent alors de « la réalisation d'un roman à la première personne, dont le narrateur omettrait ou défigurerait les faits et tomberait dans diverses contradictions ».
Autre clé que Alan Pauls suggère, c’est la reprise de thèmes ou sujets anciens, sous forme de « Deuxième main ». Non pas qu’il accuse formellement Borges « de vice (paresse) ou de délit (plagiat) », mais il prétend que ce fait Borges est de la « littérature parasitaire », ceci en prenant comme exemple le fameux Pierre Ménard qui s’est mis en tête de réécrire le « Quichotte ». Ouvrage considérable, mais Borges a bien poursuivi le « Martin Fierro », dans la même optique. Il ne faut donc pas s’étonner si le manuscrit final de Pierre Ménard ait été perdu, donc ne soit pas identifiable. « Copier Borges est un jeu d'enfant ; ce qui est impossible, toujours, c'est de cacher la copie ». Puis vient la phrase qui refroidit l’apprenti copieur. « Ainsi, l'imitabilité de Borges est à la fois le facteur qui induit l'imitation et celui qui frustre, ou ridiculise, toute tentative de l'imiter ; c'est le poison et le remède, le piège et la délivrance, la promesse et la déception ».
Vient à ce propos de la littérature parasitaire, une petite digression sur le bilinguisme, chose qui était naturelle, voire multilinguisme chez Borges. Selon Pauls, le multilinguisme entrainerait « la formation d’une nouvelle espèce de parasites : traducteurs infidèles, lecteurs strabiques, commentateurs distraits, préfaciers digressifs, correcteurs négligents, curateurs arrogants ». Ceci par paresse intellectuelle et quelquefois interférences entre les langues. A ce sujet, il convient de lire un intéressant ouvrage de Albert Costa, neurologue catalan « Le Cerveau Bilingue » (2022, Odile Jacob, 214 p.) traduit par Christophe Pallier de « The Bilingual Brain » (2021, Penguin Books Ltd, 176 p.), déjà traduit de l’original espagnol « El cerebro bilingüe. La neurociencia del lenguaje » (2017, Penguin Random House, 256 p.). Il y est écrit, après analyses de données IRM sur le cerveau, que les personnes bilingues tiennent parfois entre eux des conversations où les deux langues se confondent et cohabitent. Le passage de l’une à l’autre est immédiat, dans les deux sens. J’ai pu personnellement l'observer en particulier avec certains Alsaciens qui passent sans problème du français au dialecte alsacien, par exemple lorsque le mot ne vient pas spontanément dans une langue. Le retour s’effectue de même. J’ajouterai, contrairement à l’opinion répandue chez des personnes ne pratiquant pas ces dialectes (alsacien, breton, corse, par exemple) que ces « sauts de langue » ne sont pas du tout une façon de « camoufler » ou d’exclure les non-pratiquants, mais une spontanéité toute naturelle des bilingues. De même, pour l’apprentissage d’une langue, une personne bilingue ne peut pas être considérée simplement comme étant la simple addition de deux personnes monolingues. C’est un point important de l’étude. « L’expérience bilingue n’entraine pas de retard important dans l’acquisition du sens des mots ou du développement du vocabulaire ». On se souvient que Borges a été éduqué par sa mère en espagnol et portugais, et par son père en anglais. On se souvient aussi que Borges a traduit de nombreux auteurs dont Homère, ou « La Divine Comédie ». Donc pas de doute, son multilinguisme n’a pas été une gêne pour lui.
Suit une discussion intéressante sur le Borges éditeur et préfacier dans « Carton plein et métaphysique », qui reprend en partie les idées précédentes.
Ceci avant d’aborder le dernier chapitre « Folle érudition », qui fait que Borges fait parfois peur au lecteur débutant. C’est parfois vrai, mais n’est ce pas moins important que d’aborder James Joyce et son « Finnegans Wake ». Il est vrai que Borges rajoute à la culture une forme d’humour qui facilite les choses. D’où la question « Comment décrire Pierre Ménard. Comme le plus vif des génies ou le plus lent des idiots ? ».
« Les savants idiots de Borges ne sont pas des idiots qui jouent à la Pensée, ce sont des penseurs idiots par la pensée elle-même, par l'exercice implacable, intransigeant et brutal de la pensée : ils sont allés trop loin, ils ont poussé la Pensée et la pensée à l'extrême limite, la colombe la pensée coïncide avec l'impossibilité de penser, les colombes la pensée la plus profonde et l'idiot le plus idiot deviennent la même chose et sont rasées, dévastées, par une sorte d'interminable étourdissement ».
En conclusion, et il y a un certain nombre de choses à dire sur ce petit livre. Tout d’abord, c’est bien écrit et documenté. On s’en serait douté, connaissant un peu le parcours et style de Alan Pauls. C’est assurément un livre à lire pour tout lecteur qui veut aller plus loin avec Borges. Surtout, c’est poursuivre une poétique de la pudeur, où est l'ennemi de l'emphase, prend le non-sens dans la grandeur au lieu de la célébration. C’est aussi considérer l'intelligence imbécile de Bouvard et Pécuchet de Flaubert et la concilier avec l'obsession de héros mineurs et radicaux comme Pierre Ménard, ou Herbert Quain « mort à Roscommon », comparant son livre « The God of the Labyrinth » avec un roman d’Agatha Christie. Dans ces deux cas, le thème du doute est central. L'imprévisible, l'invisible ou l'indéchiffrable surgissent à tout moment.
Le thème de la maladie, en particulier de la progressive cécité de Borges, point délicat s’il en est, mériterait plus d’attention. Il y a bien un passage où la voix l’emporte sur la vue. Mais que représente pour Borges le fait de perdre la vue, même si on lui fait la lecture.
De même, j’ai été surpris de lire si peu sur Borges et les femmes. C’est important lorsque l’on sait la place tenue et maintenue par Maria Kodama-Schweizer. De son statut d’assistante littéra
Comme il est écrit au quatrième de couverture « Ce livre n'est pas un roman d'espionnage. C'est un essai consacré à la lecture ». On s’en serait douté, mais avec les auteurs argentins contemporains, et donc post-Borges, on ne sait jamais. Surtout que le texte embraye aussitôt sur le Saint Graal (quel rapport avec les « Monty Python », ou Moby Dick (idem, quel rapport avec Pierre Senges et son « Achab (séqelles) »). Celà continue avec « les traces du facteur Borges pour capturer la propriété, l'empreinte digitale, la molécule qui fait que Borges est Borges ». On en déduirait presque que Rhésus est Rhésus, et que sa société a connu douze apôtres. Tout comme Alan Pauls démontre qu’il existe (ou ont existé) plusieurs Borges.
« Un essai qui montre le côté le plus ludique et le moins solennel ». Tiens, il n’y a pas de note pour ludique. Les futurs bacheliers vont encore être désorientés. Mais, il y a ensuite des # pour faire moderne ( #originalité, tradition, bibliothèque# ) pour cartographier le cœur de ses textes. Peut-être est-ce pour cela que Jorge Luis se fait naître en 1900, pour être du siècle, lui qui est né le 24 août 1899, au 840 Calle Tucuman à Buenos Aires, tout de même. Quitte à suivre ses parents en Suisse, à Lugano, puis Genève par la suite, avant de revenir à ses sources portègnes. Pa la suite, on apprendra que l'espace « Aleph » est caché parmi les eucalyptus du Barrio Palermo, entre Calle Serrano et Calle Guatemala, pas si loin que cela de Calle Tucuman, plus au Sud.
Un essai sur Jorge Luis Borges est toujours bon à prendre, même si les biographies, critiques ou essais ne manquent pas. University of Pittsburgh a d’ailleurs développé un site dédié, après avoir été hébergé par University of Aarhus, DK, puis University of Iowa. Ce site est géré par le Department of Hispanic Languages and Literature. Il collationne un journal trilingue, anglais, espagnol, français les « Variaciones Borges » ainsi qu’une importante collection d’article critiques, dans les trois langues, dont la plupart sont accessibles sous format pdf. Le tout est disponible dans leur boutique en ligne et ils peuvent être contactés à l’adresse mail suivante borges@pitt.edu. Si l’œuvre écrite de Borges est abondante, elle est disponible à la Bibliothèque de la Pléiade, sous forme d’un joli coffret cartonné jaune et noir, qui contient les deux tomes des « Œuvres Complètes » (2016, Gallimard, La Pléiade, 3440 p.). Ce coffret pourrait représenter l’édition définitive, si Borges lui-même n’avait écrit que « l'idée de texte définitif ne relève que de la religion ou de la fatigue ».
Pour revenir au « Facteur Borges », Alan Pauls donne un bon résumé de la biographie de Borges (1899-1986). Ce petit essai de presque deux cents pages est bien écrit, avec énormément de notes de bas de pages, qui explicitent, soit des termes purement argentins, soit des évènements spécifiques ou historiques. Le livre est organisé selon neuf chapitres, d’une vingtaine de pages chacun. Il n’est pas évident de faire une critique d’une biographie, sans faire de la redite, ni être accusé de spoiling.
Tout commence par le commencement avec « Un classique précoce ». C’est la jeunesse de Borges, son épisode de la naissance décalée, puis son retour à Buenos Aires. Son désir d’être et de faire partie de l’avant-garde. Il insiste particulièrement sur sa jeunesse et sa volonté de s’inscrire en termes d’auteur argentin « criollo », c’est-à-dire aux racines dans le passé historique du pays, où il a vécu, à son éducation trilingue, anglais, espagnol, portugais, de par ses parents.
Il revient tout d’abord sur l’épisode de sa naissance et sa volonté d’apparaitre comme étant du vingtième siècle, et non pas des années 1800 et quelques. Coquetterie qu’il aura dans les années 1926-27, auquel moment aussi il détruit deux pamphlets consacrés à sa ville Buenos Aires. Par contre, à son retour au pays, il va tacher de se montrer presque plus argentin que ses compatriotes. Il va pour cela farcir ses textes de néologismes typiques de Buenos Aires. Des mots comme « cordobesada, bochinchera, bondâ, incredulidâ, esplicable ». Mots qu’il invente, suggérant que « écrire consiste à inventer des détours précieux, des circonlocutions, des déguisements qui surprennent.
Il est surprenant de faire ici le parallèle avec James Joyce à la même époque. Ce dernier est alors, en famille, à Pola (1905), puis à Trieste, où il obtient un poste d'enseignant en anglais à l'école Berlitz. A Pola, ville navale actuellement en Croatie, sur la côte Adriatique, Joyce enseigne l’anglais à des officiers de la marine autrichienne. Il y restera jusqu’à la guerre où il partira pour Zurich. Cependant, ce passé triestin le suivra, jusque vers 1920, quand la famille part pour Paris. C'est là que Joyce fait la connaissance d'Ettore Schmit qui écrira plus tard sous le nom de Italo Svevo. Il s'inspire de son ami pour créer Leopold Bloom dans « Ulysse ». Livia, la femme de Svevo, nourrira le personnage d'Anna Livia Plurabelle dans « Finnegans Wake », notamment sa très longue chevelure que Joyce compare à la rivière Liffey de Dublin. De cette époque, date son goût pour Trieste. Il apprend à parler le dialecte triestin, fait qu’il partage avec sa fille préférée Lucia. Souvent dans sa correspondance avec elle, les mots en triestin servent de « code » ou complicité entre le père et la fille.
On en arrive à « Des livres comme armes ». L’Argentine des années 20-30 est en pleine évolution. C’est la période de l’immigration massive des européens « dont les premiers écrivains professionnels portent déjà des noms de famille espagnols ou italiens ». Le jeune Borges, lui insiste sur son passé argentin. De par sa mère, Leonor Acevedo, c’est une lignée militaire. « Je descends de Juan de Garay et d’Itala ». Il en rajoute peut-être un peu lorsqu’il prétend « J’ai des ancêtres parmi les premiers Espagnols qui arrivèrent ici ».
« L’autre lignée est paternelle et elle est fondamentalement intellectuelle, livresque et anglophone ». Un père avocat et anarchiste, disciple de Spencer, anglophone pur et dur. Mais, comme le remarque Ricardo Piglia, « ce que possède l’un des côtés manque à l’autre ».
Ses tout premiers textes sont centrés sur Buenos Aires avec « Ferveur de Buenos Aires », d’ailleurs dédiés à sa mère « A Leonor Acevedo de Borges ». Puis ce sera « Evaristo Carriego » dans lequel il décrit Palermo, le quartier chaud de Buenos Aires au début du siècle. C’est le monde de la milonga, des petites frappes avec les rixes à coups de couteaux, les maisons de passe et les prostituées tuberculeuses. Un peu plus tard, au début des années 50, ce sera l’époque de la tradition « gauchesque », avec la célébration du « Martin Fierro » de José Hernandez. Cependant, cela ne suffit pas à Borges. Il rajoute au texte initial un texte « La Fin », paru dans « Fictions » qu’il définit « non pas comme un emplâtre, mais comme un bon rajout ».
La poésie « gauchesque » n'était pas une poésie écrite par des gauchos, mais plus généralement par des écrivains urbains instruits qui adoptaient le vers de huit syllabes des « payadas » (ballades) rurales, mais en y fourrant des expressions folkloriques et des récits de la vie quotidienne. Borges, au contraire, estimait que ces expressions n’avaient pas de place dans les « payadas » qui devaient rester sérieuses. Seul à ses yeux, José Hernández (1834-1886) l’auteur de « Martín Fierro » était l'un des rares poètes gauchesques à avoir vécu en tant que gaucho.
À cet égard, Borges distingue la poésie « heureuse et vaillante » de Hilario Ascasubi (1807-1875) qu'il oppose à la lamentation tragique d'Hernández. Borges reconnait en Ascasubi un soldat avec une vaste expérience du combat et qui a décrit l'invasion indienne de la province de Buenos Aires, bien qu’il n’en ait pas été témoin. Il estime cependant son travail, parfois autobiographique. En effet, Ascasubi est né à l'arrière d'une charrette tirée par des chevaux pendant un orage, alors que sa mère se rendait à un mariage à Buenos Aires. On lui doit Santos Vega ou los mellizos de la Flor » publié en 1851, réimprimé depuis (2019, Wentworth Press, 480 p.). Le roman narre l’histoire de ntos Vega, un gaucho argentin mythique. Invincible « payador » qui a même vaincu la Diable, déguisé en « payador Juan sin Ropa »
Enfin, le troisième poète de la lignée gauchesque est Estanislao del Campo (1834-1880). Né à Buenos Aires dans une famille unitarienne. Ces derniers favorisaient un gouvernement central fort plutôt qu'une fédération. On lui doit un poème satirique « Fausto » (1866) qui décrit les impressions d'un gaucho qui va voir l'opéra « Faust » de Charles Gounod, croyant que les événements se sont réellement produits.
On est encore dans la jeunesse de Borges, mais tout reste dans la « Politique de la pudeur ». En 1925, il encense encore abondamment le côté « criollo ». « La nature espagnole s’offre à nous en tant que véhémence pure : on dirait qu’en s’installant dans la pampa elle s’est diluée et perdue. La manière d’en parler est devenue plus trainante, la platitude des horizons successifs a limité les ambitions », écrit-il dans « Quejas de todo criollo ». Il cultive de fait cette couleur locale. Cependant, il ne se met pas à la place du peuple. « Le peuple n’a pas besoin de prouver qu’il est ce qui est – mais quelqu’un qui entend prendre sa place »
Pour mieux faire valoir « Le parler argentin », c’est alors qu’il achète deux dictionnaires d’argentinismes, dont il se sert pour écrire « maderjon, espaldaña, estaca pampa ». Mais c’est aussi pour lui l’occasion, non plus d’écrire, mais de parler. Sa cécité commence à se développer. Et il est vrai que, pour beaucoup, Borges, surtout à la fin de sa vie, c’est une voix plutôt qu’un texte. Il faut lire « L’homme au coin du mur rose », paru dans « Histoire Naturelle de l’Infamie », avec sa scène de duel au couteau entre Francisco Real, dit « le Corralero » et Rosendo Juarez, dit « le Cogneux ».
« Chaque fois qu’un livre est lu ou relu, il se passe quelque chose avec ce livre ». C’est le constat de Borges. Alan Pauls traduit cette phrase au début de « Petite écriture » en « Qu’est-ce qui peut être suffisamment intense pour qu’un écrivain décrète que lire est un art plus élevé qu’écrire ». Cette dernière assertion étant reprise de « Eloge de l’Ombre ».
On en arrive au gros morceau de l’essai, avec un titre qui en dit long « Danger : bibliothèque ». On sait que Borges a été élevé dans la bibliothèque d son père, en Suisse. Borges est un lecteur très précoce. Il remplace le monde par des livres. Tout juste sorti de l'école, il consulte son ophtalmologiste, qui lui conseille de ménager ses yeux s'il ne veut pas accélérer la détérioration qui commence à les menacer. Aussitôt sorti de chez l’ophtalmologiste, il prend un tramway, rentre chez lui. Puis il se met à lire « La Divine Comédie ». La lumière est celle de sept heures du soir en Suisse.
A soixante-dix ans, Borges assure avoir oublié la plupart des visages de son enfance à cause de sa mauvaise vue, mais il garde un souvenir très net de bien des illustrations de l « Encyclopedia » de Chambers et de la « Britannica ».
La bibliothèque telle que la conçoit Borges, devient alors un labyrinthe un peu comme ces maisons avec escaliers de M.C. Escher (1898-1972). Même si ces idées sont un peu postérieures à Borges, ces idées d'auto-référence et de boucles étranges, forment des structures, peu probables dans la nature, mais fortement spectaculaires. Cela aboutira à « La bibliothèque totale » (1904), puis à « La bibliothèque de Babel » (944), publié dans « Fictions ».
On sait que ce concept a donné lieu au site « Library of Babel » afin de simuler partiellement la bibliothèque imaginée par Borges. L'algorithme lié à ce site permet de générer un livre de 410 pages avec 3200 caractères par page, par simple permutation des 26 lettres de l'alphabet, de la virgule, de l'espace et du point. Qu’importe le sens. Cela correspond au paradoxe du singe savant. Il s’agit d’un théorème selon lequel un singe qui tape indéfiniment et au hasard sur le clavier d'une machine à écrire pourra « presque sûrement » écrire un texte donné. Toujours à propos des bibliothèques. « Tout est déjà écrit : le monde a la structure d'une encyclopédie, d'une bibliothèque, d'une archive ». Alan Pauls raconte à merveille ceci : Borges ne consultait pas les encyclopédies, il les lisait. « Si tout est écrit, il est temps de faire autre chose. Ou plutôt, il est temps de changer le sens du faire en littérature. Passer du faire dans au faire avec ».
Puis, Alan Pauls passe à la question de la science-fiction, toujours par l’intermédiaire des bibliothèques. Après l’« Histoire universelle de l'infamie » (1936), Borges publie la série de « Tlön, Uqbar et Orbis Tertius » (1940-47). D’après une obscure encyclopédie, « The Anglo-American Cyclopedia », il existerait un monde différent nommé Uqbar. C’est une découverte que Borges fait après un diner avec Bioy Caceres, dans « une région de l’Irak ou de l’Asie Mineure ». La raison en est que pour les gnostiques anciens « les miroirs et la paternité sont abominables parce qu’ils multiplient les objets », résultat « l’univers visible est une illusion ». Pour déterminer son existence, le narrateur doit passer par un labyrinthe. « La littérature d'Uqbar [...] ne faisait jamais référence à la réalité, mais aux deux régions imaginaires de Mlajnas et de Tlön ». De même, en étudiant les langues de Tlön, on en vient à la question de savoir comment le langage pourrait avoir une emprise sur les pensées. C’est un thème récurrent chez Borges, mais abordé ici par la science-fiction. Donc cela dépasse « la simple identité entre livre et monde ». Pour vérifier cette hypothèse, les deux compères vont à la Bibliothèque Nationale, et « c’est en vain que nous fatiguâmes atlas, catalogues, annuaires de sociétés géographiques, mémoires de voyageurs et d’historien : personne n'était jamais allé à Uqbar ». Fin de la recherche, et fin du rêve, mais l’histoire est jolie. Les deux chercheurs discutent alors de « la réalisation d'un roman à la première personne, dont le narrateur omettrait ou défigurerait les faits et tomberait dans diverses contradictions ».
Autre clé que Alan Pauls suggère, c’est la reprise de thèmes ou sujets anciens, sous forme de « Deuxième main ». Non pas qu’il accuse formellement Borges « de vice (paresse) ou de délit (plagiat) », mais il prétend que ce fait Borges est de la « littérature parasitaire », ceci en prenant comme exemple le fameux Pierre Ménard qui s’est mis en tête de réécrire le « Quichotte ». Ouvrage considérable, mais Borges a bien poursuivi le « Martin Fierro », dans la même optique. Il ne faut donc pas s’étonner si le manuscrit final de Pierre Ménard ait été perdu, donc ne soit pas identifiable. « Copier Borges est un jeu d'enfant ; ce qui est impossible, toujours, c'est de cacher la copie ». Puis vient la phrase qui refroidit l’apprenti copieur. « Ainsi, l'imitabilité de Borges est à la fois le facteur qui induit l'imitation et celui qui frustre, ou ridiculise, toute tentative de l'imiter ; c'est le poison et le remède, le piège et la délivrance, la promesse et la déception ».
Vient à ce propos de la littérature parasitaire, une petite digression sur le bilinguisme, chose qui était naturelle, voire multilinguisme chez Borges. Selon Pauls, le multilinguisme entrainerait « la formation d’une nouvelle espèce de parasites : traducteurs infidèles, lecteurs strabiques, commentateurs distraits, préfaciers digressifs, correcteurs négligents, curateurs arrogants ». Ceci par paresse intellectuelle et quelquefois interférences entre les langues. A ce sujet, il convient de lire un intéressant ouvrage de Albert Costa, neurologue catalan « Le Cerveau Bilingue » (2022, Odile Jacob, 214 p.) traduit par Christophe Pallier de « The Bilingual Brain » (2021, Penguin Books Ltd, 176 p.), déjà traduit de l’original espagnol « El cerebro bilingüe. La neurociencia del lenguaje » (2017, Penguin Random House, 256 p.). Il y est écrit, après analyses de données IRM sur le cerveau, que les personnes bilingues tiennent parfois entre eux des conversations où les deux langues se confondent et cohabitent. Le passage de l’une à l’autre est immédiat, dans les deux sens. J’ai pu personnellement l'observer en particulier avec certains Alsaciens qui passent sans problème du français au dialecte alsacien, par exemple lorsque le mot ne vient pas spontanément dans une langue. Le retour s’effectue de même. J’ajouterai, contrairement à l’opinion répandue chez des personnes ne pratiquant pas ces dialectes (alsacien, breton, corse, par exemple) que ces « sauts de langue » ne sont pas du tout une façon de « camoufler » ou d’exclure les non-pratiquants, mais une spontanéité toute naturelle des bilingues. De même, pour l’apprentissage d’une langue, une personne bilingue ne peut pas être considérée simplement comme étant la simple addition de deux personnes monolingues. C’est un point important de l’étude. « L’expérience bilingue n’entraine pas de retard important dans l’acquisition du sens des mots ou du développement du vocabulaire ». On se souvient que Borges a été éduqué par sa mère en espagnol et portugais, et par son père en anglais. On se souvient aussi que Borges a traduit de nombreux auteurs dont Homère, ou « La Divine Comédie ». Donc pas de doute, son multilinguisme n’a pas été une gêne pour lui.
Suit une discussion intéressante sur le Borges éditeur et préfacier dans « Carton plein et métaphysique », qui reprend en partie les idées précédentes.
Ceci avant d’aborder le dernier chapitre « Folle érudition », qui fait que Borges fait parfois peur au lecteur débutant. C’est parfois vrai, mais n’est ce pas moins important que d’aborder James Joyce et son « Finnegans Wake ». Il est vrai que Borges rajoute à la culture une forme d’humour qui facilite les choses. D’où la question « Comment décrire Pierre Ménard. Comme le plus vif des génies ou le plus lent des idiots ? ».
« Les savants idiots de Borges ne sont pas des idiots qui jouent à la Pensée, ce sont des penseurs idiots par la pensée elle-même, par l'exercice implacable, intransigeant et brutal de la pensée : ils sont allés trop loin, ils ont poussé la Pensée et la pensée à l'extrême limite, la colombe la pensée coïncide avec l'impossibilité de penser, les colombes la pensée la plus profonde et l'idiot le plus idiot deviennent la même chose et sont rasées, dévastées, par une sorte d'interminable étourdissement ».
En conclusion, et il y a un certain nombre de choses à dire sur ce petit livre. Tout d’abord, c’est bien écrit et documenté. On s’en serait douté, connaissant un peu le parcours et style de Alan Pauls. C’est assurément un livre à lire pour tout lecteur qui veut aller plus loin avec Borges. Surtout, c’est poursuivre une poétique de la pudeur, où est l'ennemi de l'emphase, prend le non-sens dans la grandeur au lieu de la célébration. C’est aussi considérer l'intelligence imbécile de Bouvard et Pécuchet de Flaubert et la concilier avec l'obsession de héros mineurs et radicaux comme Pierre Ménard, ou Herbert Quain « mort à Roscommon », comparant son livre « The God of the Labyrinth » avec un roman d’Agatha Christie. Dans ces deux cas, le thème du doute est central. L'imprévisible, l'invisible ou l'indéchiffrable surgissent à tout moment.
Le thème de la maladie, en particulier de la progressive cécité de Borges, point délicat s’il en est, mériterait plus d’attention. Il y a bien un passage où la voix l’emporte sur la vue. Mais que représente pour Borges le fait de perdre la vue, même si on lui fait la lecture.
De même, j’ai été surpris de lire si peu sur Borges et les femmes. C’est important lorsque l’on sait la place tenue et maintenue par Maria Kodama-Schweizer. De son statut d’assistante littéra
Un très grand roman, résolument proustien. De ces tourments d'amour qui ne cessent jamais, qui reviennent par la fenêtre quand on ferme la porte. L'écriture est dense et intime. Des années plus tard, repenser à ce roman me bouleverse encore.
A lire sur la plage.
Celui-ci est le deuxième tome d'une trilogie sur lArgentine des années 70. Premier livre de Pauls que je lis.
C'est le livre le moins intéressant lu dernièrement: un soliloque interminable, une digression sans fin autour de 4 personnages sans intérêt: le narrateur omniscient obsédé par son capital capillaire (son alter ego?), Monti l'ami d'enfance malmené par la vie qui apparaît et disparait au fil du récit, Celso le coiffeur de génie à qui cet obsédé du cheveu confie ses coupes, et le vétéran de guerre qui n'a pas de nom ni d'intérêt non plus.
Vraiment, lecture soporifique où il faudrait rechercher les métaphores allusives à l'Histoire de cette pauvre Argentine malmenée depuis pas mal de temps.
Il y a un jeu de mots bien à propos en espagnol: ce livre n'est pas Historia del pelo, mais "una tomadura de pelo" envers le lecteur. Voilà.(Zou).
Lien : http://pasiondelalectura.wor..
C'est le livre le moins intéressant lu dernièrement: un soliloque interminable, une digression sans fin autour de 4 personnages sans intérêt: le narrateur omniscient obsédé par son capital capillaire (son alter ego?), Monti l'ami d'enfance malmené par la vie qui apparaît et disparait au fil du récit, Celso le coiffeur de génie à qui cet obsédé du cheveu confie ses coupes, et le vétéran de guerre qui n'a pas de nom ni d'intérêt non plus.
Vraiment, lecture soporifique où il faudrait rechercher les métaphores allusives à l'Histoire de cette pauvre Argentine malmenée depuis pas mal de temps.
Il y a un jeu de mots bien à propos en espagnol: ce livre n'est pas Historia del pelo, mais "una tomadura de pelo" envers le lecteur. Voilà.(Zou).
Lien : http://pasiondelalectura.wor..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Alan Pauls
Lecteurs de Alan Pauls (97)Voir plus
Quiz
Voir plus
Histoire de Paris (2)
Paradoxalement, le Pont-Neuf est le plus vieux pont de Paris ...
c'est vrai
c'est faux
11 questions
34 lecteurs ont répondu
Thèmes :
histoire de france
, paris xixe siècle
, moyen-âge
, urbanisme
, Églises
, Vie intellectuelle
, musée
, histoire contemporaineCréer un quiz sur cet auteur34 lecteurs ont répondu