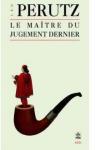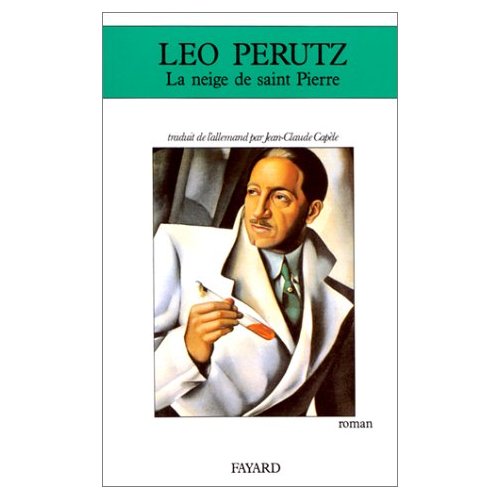Critiques de Leo Perutz (191)
Voici typiquement le genre de lecture que je n'aurais pas faite sans babélio et ses lecteurs, je découvre également Léo Perutz avec plaisir.
Le cavalier suédois est une œuvre qui tient du récit d'aventure, de la satire et du roman historique, le tout teinté de fantastique et conté dans un style agréable et très vivant, les pages se tournent pour ainsi dire toutes seules.
J'ai apprécié la note d'introduction qui nous parle de l'auteur ainsi que le prologue qui nous plonge idéalement dans l'ambiance.
J'ai apprécié aussi ces nombreuses notes de bas de pages indiquant "en français dans le texte", elles me font toujours sourire dans les éditions françaises (les seules que je sois capable de lire), elles témoignent aussi d'un temps où le français pouvait être une langue de référence, j'avoue que cela me procure un certain plaisir.
Il serait compliqué de parler du scénario sans dévoiler tout ou partie de l'intrigue qui en elle même n'est pas particulièrement originale, en passant je conseille d'éviter de lire la quatrième de couverture qui révèle d'emblée ce que l'on est supposé apprendre qu'aux deux tiers de la lecture...
L'histoire commence avec deux hommes frigorifiés et dans le plus grand dénuement, l'un est un voleur et l'autre un gentilhomme qui a déserté l'armée en plein conflit.
L'un est habitué à survivre quand l'autre croit encore que tout lui est dû, peut-on imaginer association plus improbable ?
j'ai beaucoup aimé cette lecture, aimé le rythme et le style ainsi que le scénario qui bien que prévisible est simplement bon.
Pour faire une analogie avec la musique et des airs souvent joués, je dirais qu'il s'agit d'une bonne interprétation sur un thème souvent évoqué.
Le cavalier suédois est une œuvre qui tient du récit d'aventure, de la satire et du roman historique, le tout teinté de fantastique et conté dans un style agréable et très vivant, les pages se tournent pour ainsi dire toutes seules.
J'ai apprécié la note d'introduction qui nous parle de l'auteur ainsi que le prologue qui nous plonge idéalement dans l'ambiance.
J'ai apprécié aussi ces nombreuses notes de bas de pages indiquant "en français dans le texte", elles me font toujours sourire dans les éditions françaises (les seules que je sois capable de lire), elles témoignent aussi d'un temps où le français pouvait être une langue de référence, j'avoue que cela me procure un certain plaisir.
Il serait compliqué de parler du scénario sans dévoiler tout ou partie de l'intrigue qui en elle même n'est pas particulièrement originale, en passant je conseille d'éviter de lire la quatrième de couverture qui révèle d'emblée ce que l'on est supposé apprendre qu'aux deux tiers de la lecture...
L'histoire commence avec deux hommes frigorifiés et dans le plus grand dénuement, l'un est un voleur et l'autre un gentilhomme qui a déserté l'armée en plein conflit.
L'un est habitué à survivre quand l'autre croit encore que tout lui est dû, peut-on imaginer association plus improbable ?
j'ai beaucoup aimé cette lecture, aimé le rythme et le style ainsi que le scénario qui bien que prévisible est simplement bon.
Pour faire une analogie avec la musique et des airs souvent joués, je dirais qu'il s'agit d'une bonne interprétation sur un thème souvent évoqué.
Comme beaucoup, j'ai l'habitude de me montrer injuste envers les nouvelles. Pour celles qui m'ont intéressé, je regrette qu'elles n'aient pas été mieux développées ; quant aux autres, c'est sûr, elles auraient gagné à se voir écourtées... Mais avec ce recueil de Leo Perutz, un petit miracle se produit : quatorze nouvelles dont les intrigues oscillent entre les contes de Canterbury ou le Décaméron et les récits fantastiques d'époque romantique, et aucune qui ne paraisse trop brève ou trop longue. Parmi les multiples secrets qu'elles renferment, il en est un qui explique cela. D'une nouvelle à l'autre, nous retrouvons les mêmes personnages dont les destins s'entrelacent dans cette Prague de la Renaissance que l'auteur fait revivre devant nous, avec ses misères et ses fulgurances. Ils nous sont racontés par fragments d'un chapitre à l'autre, dans un ordre savant. C'est finalement un véritable roman composé de récits emboîtés les uns dans les autres qui se révèle, éclairé par le mystère de l'amour rêvé entre Rodolphe II et la belle Esther.
Leo Perutz est un écrivain qui a vécu la fin de l'Autriche-Hongrie, il puise son inspiration dans l'histoire de la Bohème et les légendes juives pour dépeindre les rapports compliqués des habitants du ghetto avec les gens de la ville et du château, artisans, marchands, nobliaux, courtisans, serviteurs zélés ou intrigants et, au-dessus de tous, Rodolphe II, roi de Bohème, souverain du Saint-Empire romain germanique, prince fantasque, tourmenté, amoureux des arts, toujours endetté et qui n'assume pas sa tâche, laissant le royaume aux mains de sa suite. On croise tour à tour Kepler dans un rôle d'astrologue qui le désespère, Wallenstein à l'aube de sa carrière militaire, des musiciens de rue, des voleurs malchanceux, des chiens qui parlent, un bouffon expert en fourberies, un peintre qui ne dessine ni les saints ni les personnes respectables, un grand rabbin qui emploie son art magique contre son gré, un alchimiste désolé de ne pouvoir transformer le plomb en or. Mais il est pourtant un véritable alchimiste dans le quartier juif et il se nomme Mordechai Meisl. Banquier, prêteur sur gages, c'est lui le personnage central du livre, capable par les affaires de créer l'or ou l'argent à partir de rien. C'est chez lui que le roi vient clandestinement renflouer ses finances, ce roi dont il ne sait pas qu'il est son rival amoureux et dont il finira par se venger.
Tout au long du livre, on découvre avec fascination les pratiques magiques de la communauté juive. Même si la religion judaïque proscrit la sorcellerie au même titre que sa soeur chrétienne, ce ne sont pas seulement des diableries à exorciser que l'on y rencontre, mais tout un cortège de fantômes, esprits, anges, démons, qui forment un monde surnaturel, le grand rabbin connaît les sortilèges et formules à prononcer afin de les appeler ou les renvoyer, la kabbale n'est jamais loin. Ces croyances mystiques sur fond d'amour et de mort forment la substance du livre. En raison d'un sort jeté par le grand rabbin sous le pont de pierre, Rodolphe et Esther s'aiment dans leurs songes alors qu'ils ne se sont aperçus qu'une seule fois. Cela suffit à provoquer la colère du dieu terrible d'Israël qui envoie la peste aux âmes de la cité juive pour les punir de cet adultère, car oui, "Nuit après nuit, l'empereur rêvait qu'il tenait dans ses bras sa bien-aimée, la belle juive, et nuit après nuit, Esther, la femme de Mordechai Meisl, rêvait qu'elle était dans les bras de l'empereur."
Verbe subtil, atmosphère fantasmatique, tendresse et humour d'Europe centrale… une fois refermé, ce livre sans prétention mais au charme envoutant nous laisse parcourir encore longtemps les places et ruelles tortueuses de Prague à travers le dédale des pensées baroques de ses habitants d'autrefois.
Leo Perutz est un écrivain qui a vécu la fin de l'Autriche-Hongrie, il puise son inspiration dans l'histoire de la Bohème et les légendes juives pour dépeindre les rapports compliqués des habitants du ghetto avec les gens de la ville et du château, artisans, marchands, nobliaux, courtisans, serviteurs zélés ou intrigants et, au-dessus de tous, Rodolphe II, roi de Bohème, souverain du Saint-Empire romain germanique, prince fantasque, tourmenté, amoureux des arts, toujours endetté et qui n'assume pas sa tâche, laissant le royaume aux mains de sa suite. On croise tour à tour Kepler dans un rôle d'astrologue qui le désespère, Wallenstein à l'aube de sa carrière militaire, des musiciens de rue, des voleurs malchanceux, des chiens qui parlent, un bouffon expert en fourberies, un peintre qui ne dessine ni les saints ni les personnes respectables, un grand rabbin qui emploie son art magique contre son gré, un alchimiste désolé de ne pouvoir transformer le plomb en or. Mais il est pourtant un véritable alchimiste dans le quartier juif et il se nomme Mordechai Meisl. Banquier, prêteur sur gages, c'est lui le personnage central du livre, capable par les affaires de créer l'or ou l'argent à partir de rien. C'est chez lui que le roi vient clandestinement renflouer ses finances, ce roi dont il ne sait pas qu'il est son rival amoureux et dont il finira par se venger.
Tout au long du livre, on découvre avec fascination les pratiques magiques de la communauté juive. Même si la religion judaïque proscrit la sorcellerie au même titre que sa soeur chrétienne, ce ne sont pas seulement des diableries à exorciser que l'on y rencontre, mais tout un cortège de fantômes, esprits, anges, démons, qui forment un monde surnaturel, le grand rabbin connaît les sortilèges et formules à prononcer afin de les appeler ou les renvoyer, la kabbale n'est jamais loin. Ces croyances mystiques sur fond d'amour et de mort forment la substance du livre. En raison d'un sort jeté par le grand rabbin sous le pont de pierre, Rodolphe et Esther s'aiment dans leurs songes alors qu'ils ne se sont aperçus qu'une seule fois. Cela suffit à provoquer la colère du dieu terrible d'Israël qui envoie la peste aux âmes de la cité juive pour les punir de cet adultère, car oui, "Nuit après nuit, l'empereur rêvait qu'il tenait dans ses bras sa bien-aimée, la belle juive, et nuit après nuit, Esther, la femme de Mordechai Meisl, rêvait qu'elle était dans les bras de l'empereur."
Verbe subtil, atmosphère fantasmatique, tendresse et humour d'Europe centrale… une fois refermé, ce livre sans prétention mais au charme envoutant nous laisse parcourir encore longtemps les places et ruelles tortueuses de Prague à travers le dédale des pensées baroques de ses habitants d'autrefois.
Les éditions Libretto possèdent le don de rappeler à l’ordre la postérité quand cette dernière, tête en l’air… du temps, abandonne l’œuvre de certains auteurs importants à la poussière.
Ecrits il y quarante ans ou il y a un peu plus d’un siècle, je ne me lasse pas de découvrir les romans de Wilkie Collins, Vladimir Bartol, Max Aub, Erskine Childers, Robert Margerit ou Robert Penn Warren.
Leo Perutz, « le Kafka aventureux » selon Borges, appartient à cette confrérie prestigieuse dont il faut absolument momifier les mots sur du papier pour qu’ils traversent les siècles.
Né à Prague en 1882, de langue allemande, Leo Perutz s’est installé à Vienne. Blessé grièvement durant la première guerre mondiale, il a ensuite fui l’Anschluss en 1938 pour la Palestine. Il est revenu en Autriche en 1953 et y est mort quatre ans plus tard, dans un relatif anonymat.
Le Cavalier Suédois, son chef d’œuvre, écrit entre 1928 et 1936, est comme tous les grands romans, impossible à cadenasser dans un seul genre littéraire. Roman d’aventure, Roman historique, Roman d’amour, Roman fantastique, conte philosophique, manifeste politique contre les inégalités et l’hégémonisme. Une oeuvre "gigogne".
Le récit s’articule autour d’une imposture. Il nous transporte au début du XVIII ème siècle en Silésie, lorsque le jeune roi de Suède, Charles XII veut soumettre l’Europe Centrale et Orientale.
Dans les frimas de l’hiver et dans une campagne enneigée, un jeune noble, Christian von Tornefeld, parti pour rejoindre l’armée suédoise, en quête de gloire et de prestige, se réfugie dans un moulin pour se protéger du froid. Il est accompagné d’un voleur de grand chemin, plutôt de "petit sentier", surnommé Piège-à-poule. Les deux hommes ont en commun d’être pourchassés, l’un pour désertion, l’autre pour ses larcins.
Le moulin est hanté par son meunier, chasseur de têtes chargé d’alimenter les mines d’un Prince-Evêque, en forçats de travail et âmes égarées. L’offre ne fait pas rêver les deux fuyards quand on apprend que le Prince Evêque est surnommé « l’ambassadeur du diable » et qu’une légende raconte que son recruteur est un être maléfique, plus mort que vivant, qui se serait pendu quelques années plus tôt.
Profitant de la pédanterie et de la lâcheté du jeune noble, le voleur lui propose un pacte et les deux hommes échangent leur destin. Par couardise et naïveté, le jeune noble rejoint les forges de l’Evêché et Piège-à-poule endosse l’identité du noble Suédois.
Le roman suit les aventures du voleur qui va profiter de l’aubaine de cette noblesse inespérée. Le « Von » ouvre des perspectives. Pour faire fortune et venger son infortune, à la tête d’une poignée de brigands, il va multiplier les sacrilèges en pillant les églises, s’emparant d’objets du culte et de reliquaires.
Devenu riche, il va conquérir la jeune fille promise à Christian von Tornefeld et en tombera follement amoureux. Elle l’épouse, croyant avoir affaire au noble cousin.
Mais les beaux jours sont comptés et le Cavalier Suédois va être rattrapé par son passé.
Je vous rassure. Il ne s’agit pas du scénario d’un film de cape et d’épée avec Jean Marais.
Ici, les personnages ne sont pas binaires, il n’y a pas les gentils d’un côté et les méchants de l’autre. Le voleur sans scrupule et plutôt détestable du début évolue en bon père de famille, prêt aux plus grands sacrifices. Il ne recherche aucune absolution mais il acquiert une noblesse de cœur digne du titre qu’il a usurpé.
Les questions de l’identité et du jeu des apparences sont au coeur de l’ouvrage. Hitchcock aurait adoré en faire un film, même sans blonde platine à l'affiche. Les histoires de doubles et d’usurpateurs ne manquent pas mais Leo Perutz échappe à la tentation du manichéisme. Sur le sujet, je trouve qu’il prolonge et approfondit à sa manière et de façon très subtile les questionnements de Stevenson dans « L’Etrange cas du docteur Jekyll et de M.Hyde ».
Si le récit est haletant, les passages les plus réussis à mes yeux sont ceux qui expriment l’amour unissant le Cavalier suédois à sa petite fille. Ils sont d’une poésie incroyable pour un roman de ce genre et le petit soupçon de fantastique distillé avec parcimonie permet à l’auteur d’envelopper le récit d’un voile mystérieux qui ensorcelle le lecteur sans déshumaniser les personnages.
Ce roman ne fait que 200 pages mais ses mots pèseront dans ma mémoire .
Ecrits il y quarante ans ou il y a un peu plus d’un siècle, je ne me lasse pas de découvrir les romans de Wilkie Collins, Vladimir Bartol, Max Aub, Erskine Childers, Robert Margerit ou Robert Penn Warren.
Leo Perutz, « le Kafka aventureux » selon Borges, appartient à cette confrérie prestigieuse dont il faut absolument momifier les mots sur du papier pour qu’ils traversent les siècles.
Né à Prague en 1882, de langue allemande, Leo Perutz s’est installé à Vienne. Blessé grièvement durant la première guerre mondiale, il a ensuite fui l’Anschluss en 1938 pour la Palestine. Il est revenu en Autriche en 1953 et y est mort quatre ans plus tard, dans un relatif anonymat.
Le Cavalier Suédois, son chef d’œuvre, écrit entre 1928 et 1936, est comme tous les grands romans, impossible à cadenasser dans un seul genre littéraire. Roman d’aventure, Roman historique, Roman d’amour, Roman fantastique, conte philosophique, manifeste politique contre les inégalités et l’hégémonisme. Une oeuvre "gigogne".
Le récit s’articule autour d’une imposture. Il nous transporte au début du XVIII ème siècle en Silésie, lorsque le jeune roi de Suède, Charles XII veut soumettre l’Europe Centrale et Orientale.
Dans les frimas de l’hiver et dans une campagne enneigée, un jeune noble, Christian von Tornefeld, parti pour rejoindre l’armée suédoise, en quête de gloire et de prestige, se réfugie dans un moulin pour se protéger du froid. Il est accompagné d’un voleur de grand chemin, plutôt de "petit sentier", surnommé Piège-à-poule. Les deux hommes ont en commun d’être pourchassés, l’un pour désertion, l’autre pour ses larcins.
Le moulin est hanté par son meunier, chasseur de têtes chargé d’alimenter les mines d’un Prince-Evêque, en forçats de travail et âmes égarées. L’offre ne fait pas rêver les deux fuyards quand on apprend que le Prince Evêque est surnommé « l’ambassadeur du diable » et qu’une légende raconte que son recruteur est un être maléfique, plus mort que vivant, qui se serait pendu quelques années plus tôt.
Profitant de la pédanterie et de la lâcheté du jeune noble, le voleur lui propose un pacte et les deux hommes échangent leur destin. Par couardise et naïveté, le jeune noble rejoint les forges de l’Evêché et Piège-à-poule endosse l’identité du noble Suédois.
Le roman suit les aventures du voleur qui va profiter de l’aubaine de cette noblesse inespérée. Le « Von » ouvre des perspectives. Pour faire fortune et venger son infortune, à la tête d’une poignée de brigands, il va multiplier les sacrilèges en pillant les églises, s’emparant d’objets du culte et de reliquaires.
Devenu riche, il va conquérir la jeune fille promise à Christian von Tornefeld et en tombera follement amoureux. Elle l’épouse, croyant avoir affaire au noble cousin.
Mais les beaux jours sont comptés et le Cavalier Suédois va être rattrapé par son passé.
Je vous rassure. Il ne s’agit pas du scénario d’un film de cape et d’épée avec Jean Marais.
Ici, les personnages ne sont pas binaires, il n’y a pas les gentils d’un côté et les méchants de l’autre. Le voleur sans scrupule et plutôt détestable du début évolue en bon père de famille, prêt aux plus grands sacrifices. Il ne recherche aucune absolution mais il acquiert une noblesse de cœur digne du titre qu’il a usurpé.
Les questions de l’identité et du jeu des apparences sont au coeur de l’ouvrage. Hitchcock aurait adoré en faire un film, même sans blonde platine à l'affiche. Les histoires de doubles et d’usurpateurs ne manquent pas mais Leo Perutz échappe à la tentation du manichéisme. Sur le sujet, je trouve qu’il prolonge et approfondit à sa manière et de façon très subtile les questionnements de Stevenson dans « L’Etrange cas du docteur Jekyll et de M.Hyde ».
Si le récit est haletant, les passages les plus réussis à mes yeux sont ceux qui expriment l’amour unissant le Cavalier suédois à sa petite fille. Ils sont d’une poésie incroyable pour un roman de ce genre et le petit soupçon de fantastique distillé avec parcimonie permet à l’auteur d’envelopper le récit d’un voile mystérieux qui ensorcelle le lecteur sans déshumaniser les personnages.
Ce roman ne fait que 200 pages mais ses mots pèseront dans ma mémoire .
« Que m'importaient les querelles espagnoles dans le Nouveau Monde? Qu'avais-je à faire avec la campagne menée par Cortez contre les Indiens de ce pays? C'est vrai, les temps et les destinées étaient si étrangement confus et troublés que je fus mêlé moi aussi à ces querelles. Quelle folie s'était donc emparée de moi lorsque je poursuivais Cortez pour lui tirer une balle dans la tête? Etait-ce vraiment moi qui le poursuivais? »
Nous sommes en 1519 et Cortez est sur le point de vaincre l'Empereur Moctezuma, de faire tomber Tenochtitlán et de s'emparer de l'or des Aztèques. En Europe, Charles Quint va hériter de la couronne espagnole et d'un empire colonial en devenir, il sera bientôt le monarque le puissant du siècle.
Pourtant un homme veut faire barrage au conquistador et à Charles Quint.
Cet homme, c'est Franz Grumbach, un luthérien allemand qui hait les Espagnols, abhorre les catholiques, exècre les agissements des Européens sur le sol américain.
Que peut faire un homme seul contre une armada, alors qu'il ne possède qu'une arquebuse et trois balles? L'une est destinée au sanguinaire Cortez, la seconde au duc de Mendoza pour une histoire de femme, et la troisième, seule la fin de l'histoire nous le dira.
Trois pauvre balles pourraient-elles changer le cours de l'histoire et mettre fin aux agissements de l'Inquisition en terre mexicaine?
Du Charme, est le premier mot qui me vient à l'esprit à la fin de cette lecture, qui mêle savamment histoire et fantastique, comme dans le marquis de Bolibar.
Roman d'aventures qui nous emporte à la conquête de l'or des Aztèques, La troisième balle est une épopée sanglante pleine de batailles, de roueries, de violences, mais une histoire marquée aussi par les anathèmes, les pactes diaboliques et les prophéties.
Car le Diable se cache toujours dans les détails, et ce n'est pas la plume de Leo Perutz qui sait si bien distiller les symboles et composer de savantes intrigues qui nous prouvera le contraire.
Nous sommes en 1519 et Cortez est sur le point de vaincre l'Empereur Moctezuma, de faire tomber Tenochtitlán et de s'emparer de l'or des Aztèques. En Europe, Charles Quint va hériter de la couronne espagnole et d'un empire colonial en devenir, il sera bientôt le monarque le puissant du siècle.
Pourtant un homme veut faire barrage au conquistador et à Charles Quint.
Cet homme, c'est Franz Grumbach, un luthérien allemand qui hait les Espagnols, abhorre les catholiques, exècre les agissements des Européens sur le sol américain.
Que peut faire un homme seul contre une armada, alors qu'il ne possède qu'une arquebuse et trois balles? L'une est destinée au sanguinaire Cortez, la seconde au duc de Mendoza pour une histoire de femme, et la troisième, seule la fin de l'histoire nous le dira.
Trois pauvre balles pourraient-elles changer le cours de l'histoire et mettre fin aux agissements de l'Inquisition en terre mexicaine?
Du Charme, est le premier mot qui me vient à l'esprit à la fin de cette lecture, qui mêle savamment histoire et fantastique, comme dans le marquis de Bolibar.
Roman d'aventures qui nous emporte à la conquête de l'or des Aztèques, La troisième balle est une épopée sanglante pleine de batailles, de roueries, de violences, mais une histoire marquée aussi par les anathèmes, les pactes diaboliques et les prophéties.
Car le Diable se cache toujours dans les détails, et ce n'est pas la plume de Leo Perutz qui sait si bien distiller les symboles et composer de savantes intrigues qui nous prouvera le contraire.
À Prague en cette fin du XVIe siècle l'empereur Rodolphe II est tourmenté. Il est au bord de la faillite et certains voudraient voir à sa place un roi de religion reformé. Et loin de prendre les décisions indispensables Rodolphe laisse ses gens tenter de régler les problèmes à sa place, préférant aimer la belle Esther. L'épouse de Mordechai Meisl, un juif alchimiste que le commerce d'argent a rendu riche au point, dit-on, qu'il financerait la passion dispendieuse du roi pour les tableaux et les pièces rares.
Quatorze nouvelles pour peindre le monde grouillant d'une Prague où se côtoient marginaux et bouffons, astrologues et alchimistes, chrétiens et juifs, courtisans avides autour d'un roi chancelant obsédé par des amours aussi irréelles que fantasmées. Une Bohème à la croisée des chemins que l'écrivain autrichien Leo Perutz restitue dans une suite de tableaux qui, entre vieilles légendes juives et réalité historique, forme un tout fascinant.
Merci Dandine.
Quatorze nouvelles pour peindre le monde grouillant d'une Prague où se côtoient marginaux et bouffons, astrologues et alchimistes, chrétiens et juifs, courtisans avides autour d'un roi chancelant obsédé par des amours aussi irréelles que fantasmées. Une Bohème à la croisée des chemins que l'écrivain autrichien Leo Perutz restitue dans une suite de tableaux qui, entre vieilles légendes juives et réalité historique, forme un tout fascinant.
Merci Dandine.
J'avais poste a l'epoque un billet sur ce livre et je me souviens l'avoir traite de magistral. Je recidive après une relecture et je suppose que je vais me repeter, parce que, oui, il reste pour moi magistral.
Un roman qui se deguise en recueil de nouvelles ou chaque nouvelle se suffit a elle-meme, et ce n'est que quand on est bien avance dans la lecture qu'on s'apercoit qu'elles forment un tout coherent, que ce sont les pieces eparses d'un puzzle, ou l'auteur melange pieces reelles et pieces fantastiques. En plus, l'ironie est presente partout dans les marges (j'ai trouve ca tres Europe Centrale), et pour compliquer le puzzle il y a un jeu constant entre diverses versions de la meme histoire. le tout formule de facon captivante, sans points morts, en un style dynamique a souhait: magistral!
Perutz nous transporte a Prague, au debut du 17e siècle. A la cour de l'excentrique empereur Rodolphe II, ce passionne d'art et de sciences qui delaissait la politique (et la politique lui rendait cela au centuple). Dans son entourage nous croiserons le grand astronome Kepler, le belliqueux condottiere Wallenstein, qui s'illustra pendant la guerre de trente ans, et beaucoup d'autres personnages qui furent un temps reels. Mais Perutz nous promene aussi dans les ruelles du quartier juif, dominees par la mythique figure du rabbin Loew (celui qui aurait cree le golem, donnant vie a une poupee d'argile). Dans ces differents decors d'une meme realite, dans ce theatre, il met en scene des amours interdits, entre l'empereur Boheme et la belle Esther, epouse du financier juif Mordechai Meisl, qui ne peuvent se realiser qu'en reve, mais n'ont pas moins pour cela des consequences fatales pour toute la ville. Un reve cree par le kabbaliste Loew, et sitot reprouve par Dieu. Mais Dieu est a Prague, et Prague est une ville de reve…
Chaque nouvelle (chaque chapitre) est une histoire racontee au narrateur (quand il etait gosse) par son precepteur, Jakob Meisl, un etudiant en medicine fauche, qui, comme son nom l'indique, descend du financier. Des contes ou s'entrelacent des personnages et des faits historiques avec de vieilles legendes juives. Des contes par lesquels il entend temoigner d'une Histoire plus vraie que L Histoire des livres de classe, ou le cote magique, fantastique, rend mieux compte de la realite humaine. Parce que pour lui la litterature, orale ou ecrite, aide mieux que L Histoire savante a comprendre le passe, a se l'assimiler. (Memoire contre Histoire, un vieux dilemme juif, que Yosef Hayim Yerushalmi avait brillamment eclaire dans "Zakhor").
C'est vers la fin de sa vie que Perutz se tourne vers ces legendes. Juif ne a Prague, qui a etudie et vecu a Vienne jusqu'en 1938, quand il est force de s'exiler en Palestine, il a deja ecrit nombre de romans fantastiques qui ont eu un relatif succes a l'epoque. Non acclimate, ignore dans cette Palestine qui deviendra l'etat d'Israel, il cesse de publier sinon d'ecrire jusque dans les annees 50. En fait il avait ebauche un premier chapitre de ce livre des les annees 20, qu'il avait titre "La peste a Prague", mais l'avait laisse murir jusqu'en 1953, date de la sortie de la nuit sous le pont de pierre. C'est l'epoque ou il voyage beaucoup en Autriche, pour skier, pour retrouver sa langue natale, pour respirer un air qui lui est cher, malgre ce que cette Autriche lui a fait subir par le passé. Et c'est dans un de ces voyages qu'il mourra, a Bad Ischl, en 1957. Ironie du sort? Voeu (non exprime) exauce?
La nuit sous le pont de pierre, son dernier opus, est un opus magnum. Je me rappelle que je lui avais octroye cinq etoiles, bien qu'alors j'en etais tres radin. Aujourd'hui cela va de soi. Je l'avais emporte avec moi dans mon ile deserte; il pourra continuer a me tenir compagnie dans ma solitude.
Un roman qui se deguise en recueil de nouvelles ou chaque nouvelle se suffit a elle-meme, et ce n'est que quand on est bien avance dans la lecture qu'on s'apercoit qu'elles forment un tout coherent, que ce sont les pieces eparses d'un puzzle, ou l'auteur melange pieces reelles et pieces fantastiques. En plus, l'ironie est presente partout dans les marges (j'ai trouve ca tres Europe Centrale), et pour compliquer le puzzle il y a un jeu constant entre diverses versions de la meme histoire. le tout formule de facon captivante, sans points morts, en un style dynamique a souhait: magistral!
Perutz nous transporte a Prague, au debut du 17e siècle. A la cour de l'excentrique empereur Rodolphe II, ce passionne d'art et de sciences qui delaissait la politique (et la politique lui rendait cela au centuple). Dans son entourage nous croiserons le grand astronome Kepler, le belliqueux condottiere Wallenstein, qui s'illustra pendant la guerre de trente ans, et beaucoup d'autres personnages qui furent un temps reels. Mais Perutz nous promene aussi dans les ruelles du quartier juif, dominees par la mythique figure du rabbin Loew (celui qui aurait cree le golem, donnant vie a une poupee d'argile). Dans ces differents decors d'une meme realite, dans ce theatre, il met en scene des amours interdits, entre l'empereur Boheme et la belle Esther, epouse du financier juif Mordechai Meisl, qui ne peuvent se realiser qu'en reve, mais n'ont pas moins pour cela des consequences fatales pour toute la ville. Un reve cree par le kabbaliste Loew, et sitot reprouve par Dieu. Mais Dieu est a Prague, et Prague est une ville de reve…
Chaque nouvelle (chaque chapitre) est une histoire racontee au narrateur (quand il etait gosse) par son precepteur, Jakob Meisl, un etudiant en medicine fauche, qui, comme son nom l'indique, descend du financier. Des contes ou s'entrelacent des personnages et des faits historiques avec de vieilles legendes juives. Des contes par lesquels il entend temoigner d'une Histoire plus vraie que L Histoire des livres de classe, ou le cote magique, fantastique, rend mieux compte de la realite humaine. Parce que pour lui la litterature, orale ou ecrite, aide mieux que L Histoire savante a comprendre le passe, a se l'assimiler. (Memoire contre Histoire, un vieux dilemme juif, que Yosef Hayim Yerushalmi avait brillamment eclaire dans "Zakhor").
C'est vers la fin de sa vie que Perutz se tourne vers ces legendes. Juif ne a Prague, qui a etudie et vecu a Vienne jusqu'en 1938, quand il est force de s'exiler en Palestine, il a deja ecrit nombre de romans fantastiques qui ont eu un relatif succes a l'epoque. Non acclimate, ignore dans cette Palestine qui deviendra l'etat d'Israel, il cesse de publier sinon d'ecrire jusque dans les annees 50. En fait il avait ebauche un premier chapitre de ce livre des les annees 20, qu'il avait titre "La peste a Prague", mais l'avait laisse murir jusqu'en 1953, date de la sortie de la nuit sous le pont de pierre. C'est l'epoque ou il voyage beaucoup en Autriche, pour skier, pour retrouver sa langue natale, pour respirer un air qui lui est cher, malgre ce que cette Autriche lui a fait subir par le passé. Et c'est dans un de ces voyages qu'il mourra, a Bad Ischl, en 1957. Ironie du sort? Voeu (non exprime) exauce?
La nuit sous le pont de pierre, son dernier opus, est un opus magnum. Je me rappelle que je lui avais octroye cinq etoiles, bien qu'alors j'en etais tres radin. Aujourd'hui cela va de soi. Je l'avais emporte avec moi dans mon ile deserte; il pourra continuer a me tenir compagnie dans ma solitude.
"La nature a, peut-être, ses raisons de faire des coeurs impitoyables."
(W. Shakespeare)
Mon premier roman de Perutz. D'après un tas d'avis divers, ce n'est peut-être pas le meilleur, mais pour l'instant il m'est impossible de comparer. Et j'ai plutôt apprécié ses prétendues "faiblesses". L'intrigue pleine de quiproquos et de retournements "digne des comédies italiennes" ne m'a pas gênée, bien au contraire - j'ai toujours aimé ces histoires un peu tordues, où rien n'est comme il semble au premier abord. Un peu comme chez Shakespeare... Et les dialogues hauts en couleur (qui m'on fait parfois penser aux "Trois mousquetaires") vont bien avec tout ça.
Perutz a l'humour subtil et le détail riche dans cette histoire apocryphe sur le Judas de Léonard.
Dans un contexte bien précis - Milan de la Renaissance - deux histoires sont imbriquées ensemble avec finesse...
Seul le respect que les Milanais ressentent envers Maître Léonard empêche les prélats de la Santa Maria delle Grazie de montrer ouvertement leur mécontentement. La Cène du réfectoire n'est toujours pas finie, car le Maître ne trouve pas le modèle idéal pour incarner le personnage de Judas. Léonard est un perfectionniste. Il s'interroge sur les motivations de l'apôtre maudit, et il est à la recherche d'un homme qui lui permettra de montrer l'âme même de Judas dans un seul geste, une seule expression figée pour toujours sur le mur de couvent des dominicains. Et puis, il n'a pas que ça à faire... les machines de guerre prodigieuses, les statues équestres géantes... sans oublier les observations des oiseaux pour avancer dans sa quête de toujours - l'appareil volant.
Chez le duc Ludovic Sforza, Léonard fait connaissance de Joachim Behaim, un riche négociant de Bohême. Un homme irréprochable de belle prestance, Behaim vient à Milan pour affaires, mais aussi pour récupérer une vieille dette familiale auprès d'un certain Boccetta. Une chose impossible, selon les Milanais !
Ce Boccetta, usurier pingre et misanthrope, qui a des excuses toutes prêtes pour éviter la moindre hospitalité ou lâcher le moindre obole - ne serait-il par hasard un modèle rêvé pour Judas ?
Perutz devient machiavélique...
Tout en réfléchissant comment récupérer sa dette, Behaim tombe amoureux de Niccola, une belle Milanaise. Un amour sincère et confiant, au point que le marchand commence à songer au mariage. Mais voilà qu'il apprend que sa belle n'est autre que la fille de son débiteur, l'abject Boccetta !
On pourrait s'en douter, mais quelque part on espère encore une fin heureuse... L'amour peut-il être plus fort que l'orgueil et le désir de vengeance ? Ce n'est pas le cas pour Behaim. Alors, il trahit... à cause de l'argent, de l'orgueil blessé, de peur de perdre la face en aimant trop...
Et Léonard peut commencer ses croquis.
J'ai bien aimé la fin malicieuse de Perutz. Et aussi les observations de Léonard sur la peinture et la nature, comme sorties tout droit de ses carnets.
Pour l'anecdote - j'ai lu ce livre dans l'avion. Avec cette vue quelconque sur l'aile, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'obsession de Léonard et à ses nombreuses expériences non-concluantes avec la machine volante. Et je me demandais dans quel état d'esprit il serait, lui, parmi tous ces voyageurs blasés...? Mais c'est une autre histoire.
(W. Shakespeare)
Mon premier roman de Perutz. D'après un tas d'avis divers, ce n'est peut-être pas le meilleur, mais pour l'instant il m'est impossible de comparer. Et j'ai plutôt apprécié ses prétendues "faiblesses". L'intrigue pleine de quiproquos et de retournements "digne des comédies italiennes" ne m'a pas gênée, bien au contraire - j'ai toujours aimé ces histoires un peu tordues, où rien n'est comme il semble au premier abord. Un peu comme chez Shakespeare... Et les dialogues hauts en couleur (qui m'on fait parfois penser aux "Trois mousquetaires") vont bien avec tout ça.
Perutz a l'humour subtil et le détail riche dans cette histoire apocryphe sur le Judas de Léonard.
Dans un contexte bien précis - Milan de la Renaissance - deux histoires sont imbriquées ensemble avec finesse...
Seul le respect que les Milanais ressentent envers Maître Léonard empêche les prélats de la Santa Maria delle Grazie de montrer ouvertement leur mécontentement. La Cène du réfectoire n'est toujours pas finie, car le Maître ne trouve pas le modèle idéal pour incarner le personnage de Judas. Léonard est un perfectionniste. Il s'interroge sur les motivations de l'apôtre maudit, et il est à la recherche d'un homme qui lui permettra de montrer l'âme même de Judas dans un seul geste, une seule expression figée pour toujours sur le mur de couvent des dominicains. Et puis, il n'a pas que ça à faire... les machines de guerre prodigieuses, les statues équestres géantes... sans oublier les observations des oiseaux pour avancer dans sa quête de toujours - l'appareil volant.
Chez le duc Ludovic Sforza, Léonard fait connaissance de Joachim Behaim, un riche négociant de Bohême. Un homme irréprochable de belle prestance, Behaim vient à Milan pour affaires, mais aussi pour récupérer une vieille dette familiale auprès d'un certain Boccetta. Une chose impossible, selon les Milanais !
Ce Boccetta, usurier pingre et misanthrope, qui a des excuses toutes prêtes pour éviter la moindre hospitalité ou lâcher le moindre obole - ne serait-il par hasard un modèle rêvé pour Judas ?
Perutz devient machiavélique...
Tout en réfléchissant comment récupérer sa dette, Behaim tombe amoureux de Niccola, une belle Milanaise. Un amour sincère et confiant, au point que le marchand commence à songer au mariage. Mais voilà qu'il apprend que sa belle n'est autre que la fille de son débiteur, l'abject Boccetta !
On pourrait s'en douter, mais quelque part on espère encore une fin heureuse... L'amour peut-il être plus fort que l'orgueil et le désir de vengeance ? Ce n'est pas le cas pour Behaim. Alors, il trahit... à cause de l'argent, de l'orgueil blessé, de peur de perdre la face en aimant trop...
Et Léonard peut commencer ses croquis.
J'ai bien aimé la fin malicieuse de Perutz. Et aussi les observations de Léonard sur la peinture et la nature, comme sorties tout droit de ses carnets.
Pour l'anecdote - j'ai lu ce livre dans l'avion. Avec cette vue quelconque sur l'aile, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'obsession de Léonard et à ses nombreuses expériences non-concluantes avec la machine volante. Et je me demandais dans quel état d'esprit il serait, lui, parmi tous ces voyageurs blasés...? Mais c'est une autre histoire.
Au début du XVIII siècle, en Silésie, deux compagnons d'infortune lient leur destin et tentent d'échapper au gibet, à la faim et au froid, et errent sur les routes. L'un est un voleur, piège-à-poules, l'autre, un jeune déserteur, un gentilhomme d'origine suédoise, Christian von Tornefeld. Ils trouvent refuge dans un moulin où un repas est servi... leur hôte est le fantôme d'un meunier qui s'est pendu. Celui-ci, afin de s'acquitter d'une dette, sert de roulier, une fois l'an, pour un évêque, un terrible despote, dont les forges sont comparées à l'enfer. C'est Tornefeld qui y sera conduit à la place du voleur. Piège-à-poules usurpe l'identité de son compagnon ainsi qu'un puissant arcane, un parchemin consacré, parvient à la fortune en devenant capitaine de brigands, puis en épousant la cousine de Tornefeld dont il gère le domaine. Mais le passé ne risque-t-il pas de resurgir? Léo Perutz nous offre un roman riche en péripéties, au style truculent, un roman picaresque en Europe centrale.
Le Baron Yosh a-t-il vraiment poussé Eugène Bischoff au suicide comme certains semblent le penser ? Ou bien, comme le soutient l’ingénieur Solgrub, le célèbre acteur a-t-il succombé aux forces obscures d’un monstre maléfique qui accule depuis des siècles les hommes à la mort en traversant l’espace et le temps?...
Une après-midi musicale réunissant autour de Bischoff, Dina, son épouse, Félix le frère de celle-ci, l’ingénieur Solgrub, le docteur Gorsky et le baron Yosh.
Tous se sont donné le mot pour cacher à Bischoff la faillite de la banque qui gérait l’intégralité de ses avoirs, le réduisant aussi par voie de conséquences, à la ruine. Tous tentent également de lui dissimuler que sa carrière est sur le déclin.
En début de soirée, Bischoff s’isole dans son pavillon au fond du jardin. Deux coups de feu retentissent. Le corps de l’acteur est au sol. Le revolver encore fumant dans sa main ne fait place à aucun doute. Bischoff s’est suicidé.
Dans un récit rédigé plusieurs années après les faits, le Baron Yosh, capitaine de cavalerie dans l’armée austro-hongroise, décrit les événements de l’automne 1909 tel qu’il pense les avoir vécus à l’époque, racontant ce qui conduisit l’ingénieur Solgrub, le docteur Gorski et lui-même à partir en quête d’un être mystérieux capable de pousser au suicide ceux que le destin mettait sur sa route…
Mais quel crédit accorder à ses propos lorsqu’on sait que Yosh n’a jamais accepté le mariage de Bischoff avec Dina, la femme qui a été sa maîtresse quelques années auparavant, la femme qu’il n’a jamais cessé d’aimer et pour laquelle il ressent toujours la brûlante douleur de l’amour trahi ?
Que penser des opinions de ses proches le décrivant comme un homme dur, intransigeant, « manquant d’égards jusqu’à en devenir brutal », une « superbe canaille » assurément « capable d’un meurtre » ?
Et comment se fait-il que sa pipe ait été retrouvée sur les lieux du suicide ?
Le baron n’aurait-t-il pas, par vengeance et jalousie, divulguer les mauvaises nouvelles au comédien, sachant pertinemment quelles fâcheuses et dramatiques conséquences elles auraient chez l’acteur aux nerfs déjà fragiles ?
Et pourtant…pourtant d’autres événements peuvent étayer une autre conception de l’affaire.
Ainsi, les cas de plusieurs suicides inexplicables commis dans des circonstances similaires à celles de la mort de Bischoff et qui prêtent à infirmer les accusations portées contre le baron Yosh.
Dans son récit, ce dernier s’emploie à raconter la chasse aventureuse que l’ingénieur Solgrub, le docteur Gorski et lui-même entreprirent, à la «poursuite d’un ennemi invisible qui n’était pas fait de chair et de sang, mais qui était un effrayant revenant des temps passés »…
Une histoire fantasmagorique qui va les mener sur la piste du « Maître du jugement dernier », un peintre de la Renaissance italienne, surnommé ainsi à cause de ses représentations hallucinées, saisissantes de réalité, des scènes de sentences divines.
Une histoire tragique également, puisqu’elle va couter la vie à l’ingénieur Solgrub, et, en leur faisant franchir la porte du temps, va les projeter dans ces lieux désolés où l’homme, en proie aux visions terrifiantes de sa propre inhumanité, en vient à ne plus supporter les marasmes de sa culpabilité et se soumet alors au jugement suprême de la justice divine…
Alors…fantastique funèbre ou affabulation d’un homme en plein déni ? Il se pourrait bien que vous en perdiez la tête !
Car tout le long de cette intrigue retorse et machiavélique, l’auteur autrichien Leo Perutz (1882-1957) s’ingénie à nous égarer, nous encourageant à emprunter une voie de l’esprit pour nous en détourner brusquement dans les toutes dernières pages dans un audacieux mais démoniaque final qui va annihiler toutes les réponses et tous les signes recueillis.
Le récit est bâti sur la récolte des indices qui innocenteront le baron Yosh ; l’incursion dans le fantastique sert ainsi à nous conforter dans l’opinion de son innocence et ce, malgré le caractère antipathique qu’il tend à revêtir.
Et quand, après avoir suivi aveuglément toutes les pistes réelles, irréelles, vraisemblables ou improbables, l’on peut enfin croire à l’entière et totale sincérité du baron, l’échafaudage construit au fil du récit s’écroule comme un vulgaire château de cartes et il ne nous reste plus qu’à revoir les choses à la lumière des nouveaux éléments…
Ce diable de Perutz nous mène par le bout du nez et fait tout pour tantôt corroborer, tantôt invalider la thèse de l’existence du monstre.
Borges disait qu’il était un écrivain génial.
Il est vrai qu’avec ce récit paru en 1923, l’auteur autrichien, en maître de la manipulation, réussit parfaitement à nous troubler dans un enchaînement démoniaque des faits. Balloté entre réel et fantastique, l’on ressort du roman, égaré, mystifié, confus, mais avec le sentiment que, quelles que soient les versions évoquées, réelles ou imaginaires, tous « nous portons en nous un ennemi terrible dont nous ne soupçonnons pas l’existence. Il ne bouge pas, il dort, il semble mort en nous. Oh, malheur quand il se réveille à la vie ! ». Car c’est le Maître du jugement dernier, celui qui gît au fond de nos consciences…prêt à nous mordre l’âme quand la culpabilité nous tenaille…
Une après-midi musicale réunissant autour de Bischoff, Dina, son épouse, Félix le frère de celle-ci, l’ingénieur Solgrub, le docteur Gorsky et le baron Yosh.
Tous se sont donné le mot pour cacher à Bischoff la faillite de la banque qui gérait l’intégralité de ses avoirs, le réduisant aussi par voie de conséquences, à la ruine. Tous tentent également de lui dissimuler que sa carrière est sur le déclin.
En début de soirée, Bischoff s’isole dans son pavillon au fond du jardin. Deux coups de feu retentissent. Le corps de l’acteur est au sol. Le revolver encore fumant dans sa main ne fait place à aucun doute. Bischoff s’est suicidé.
Dans un récit rédigé plusieurs années après les faits, le Baron Yosh, capitaine de cavalerie dans l’armée austro-hongroise, décrit les événements de l’automne 1909 tel qu’il pense les avoir vécus à l’époque, racontant ce qui conduisit l’ingénieur Solgrub, le docteur Gorski et lui-même à partir en quête d’un être mystérieux capable de pousser au suicide ceux que le destin mettait sur sa route…
Mais quel crédit accorder à ses propos lorsqu’on sait que Yosh n’a jamais accepté le mariage de Bischoff avec Dina, la femme qui a été sa maîtresse quelques années auparavant, la femme qu’il n’a jamais cessé d’aimer et pour laquelle il ressent toujours la brûlante douleur de l’amour trahi ?
Que penser des opinions de ses proches le décrivant comme un homme dur, intransigeant, « manquant d’égards jusqu’à en devenir brutal », une « superbe canaille » assurément « capable d’un meurtre » ?
Et comment se fait-il que sa pipe ait été retrouvée sur les lieux du suicide ?
Le baron n’aurait-t-il pas, par vengeance et jalousie, divulguer les mauvaises nouvelles au comédien, sachant pertinemment quelles fâcheuses et dramatiques conséquences elles auraient chez l’acteur aux nerfs déjà fragiles ?
Et pourtant…pourtant d’autres événements peuvent étayer une autre conception de l’affaire.
Ainsi, les cas de plusieurs suicides inexplicables commis dans des circonstances similaires à celles de la mort de Bischoff et qui prêtent à infirmer les accusations portées contre le baron Yosh.
Dans son récit, ce dernier s’emploie à raconter la chasse aventureuse que l’ingénieur Solgrub, le docteur Gorski et lui-même entreprirent, à la «poursuite d’un ennemi invisible qui n’était pas fait de chair et de sang, mais qui était un effrayant revenant des temps passés »…
Une histoire fantasmagorique qui va les mener sur la piste du « Maître du jugement dernier », un peintre de la Renaissance italienne, surnommé ainsi à cause de ses représentations hallucinées, saisissantes de réalité, des scènes de sentences divines.
Une histoire tragique également, puisqu’elle va couter la vie à l’ingénieur Solgrub, et, en leur faisant franchir la porte du temps, va les projeter dans ces lieux désolés où l’homme, en proie aux visions terrifiantes de sa propre inhumanité, en vient à ne plus supporter les marasmes de sa culpabilité et se soumet alors au jugement suprême de la justice divine…
Alors…fantastique funèbre ou affabulation d’un homme en plein déni ? Il se pourrait bien que vous en perdiez la tête !
Car tout le long de cette intrigue retorse et machiavélique, l’auteur autrichien Leo Perutz (1882-1957) s’ingénie à nous égarer, nous encourageant à emprunter une voie de l’esprit pour nous en détourner brusquement dans les toutes dernières pages dans un audacieux mais démoniaque final qui va annihiler toutes les réponses et tous les signes recueillis.
Le récit est bâti sur la récolte des indices qui innocenteront le baron Yosh ; l’incursion dans le fantastique sert ainsi à nous conforter dans l’opinion de son innocence et ce, malgré le caractère antipathique qu’il tend à revêtir.
Et quand, après avoir suivi aveuglément toutes les pistes réelles, irréelles, vraisemblables ou improbables, l’on peut enfin croire à l’entière et totale sincérité du baron, l’échafaudage construit au fil du récit s’écroule comme un vulgaire château de cartes et il ne nous reste plus qu’à revoir les choses à la lumière des nouveaux éléments…
Ce diable de Perutz nous mène par le bout du nez et fait tout pour tantôt corroborer, tantôt invalider la thèse de l’existence du monstre.
Borges disait qu’il était un écrivain génial.
Il est vrai qu’avec ce récit paru en 1923, l’auteur autrichien, en maître de la manipulation, réussit parfaitement à nous troubler dans un enchaînement démoniaque des faits. Balloté entre réel et fantastique, l’on ressort du roman, égaré, mystifié, confus, mais avec le sentiment que, quelles que soient les versions évoquées, réelles ou imaginaires, tous « nous portons en nous un ennemi terrible dont nous ne soupçonnons pas l’existence. Il ne bouge pas, il dort, il semble mort en nous. Oh, malheur quand il se réveille à la vie ! ». Car c’est le Maître du jugement dernier, celui qui gît au fond de nos consciences…prêt à nous mordre l’âme quand la culpabilité nous tenaille…
PAR L'AMOUR D'UNE ROSE ET D'UN ROMARIN.
Certains textes, qu'ils soient courts ou qu'ils soient longs, parviennent de temps à autre à laisser le lecteur pantois, béat d'admiration et d'émotion, exsangue. Tout juste en a-t-on achevé la dernière page, les dernières lignes, les ultimes mots qu'on a de suite envie de les reprendre, autant parce qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont embarqué vers d'autres rivages jusqu'alors méconnus, étranges, indociles - admirateur de Pessoa, on peine à s'abstenir d'une "intranquilité", tant on peut trouver d'équivalence entre l'attachement du portugais pour Lisbonne et de Perutz pour Prague, même si ce ne fut, finalement, que la ville de son enfance et de ses souvenirs -. On referme ce bref et dense ouvrage en se demandant, diable ! comment il est possible de composer un tel morceau de littérature, de rêve et d'humanité tout à la fois. On songe aussi, plus ou moins, à s'arracher les cheveux tant la tâche semble ardue, pour ne pas dire impossible, de tout en dire sans trop en révéler, de bien en dire, sans trop en oublier. Il est cependant temps de se lancer, et on nous pardonnera si c'est bien imparfait. Car voilà le type même d'oeuvre "irrésumable", ô! combien complexe sous des atours presque anecdotiques, qui emmène très loin sur les terres de l'imaginaire et du sens. Tâchons de ne pas trop mal faire :
La nuit sous le pont de pierre est donc un roman relativement bref (deux-cent quarante-sept pages en édition poche), composé d'une suite de récits - la dénomination "nouvelle", bien que souvent employée pour ces "chapitres" qui peinent tout autant à en être d'un point de vue des règles romanesques classiques, nous semble relever de l'erreur syntaxique ou de la trompeuse facilité contextuelle. Nous essaierons de voir plus loin pourquoi -, quatorze textes tous titrés pour être précis et suivis d'un épilogue censé nous donner la clé de l'ensemble. Celui-ci porte pourtant en lui presque autant de questions que de réponses à cet intrigant jeu de piste dans lequel le romancier de langue allemande Léo Perutz revient abondamment, avec un amour profond, beaucoup de tendresse, son lot d'humour décalé et un imaginaire débridé à ses propres racines pragoises et juives.
Dès le premier récit, nous voila plongé en plein cœur de cette cité juive de Prague (aujourd'hui presque totalement reconstruite, mais l'auteur pu la découvrir, enfant, avant sa destruction pour cause d'insalubrité notoire). Nous sommes avalés des les premières lignes par ce XVIIème siècle baroque, sous la domination excentrique de l'empereur des Romains et Roi de Hongrie et de Bohème, Rodolphe II. Mais Perutz nous accompagne d'abord auprès de ce petit peuple des juifs de la capitale, plus précisément à la rencontre de deux bateleurs traînant tout autant leurs traditions séculaires, leur art de vivre et de penser, leur foi, leur musique que leur récurrente misère vagabonde. Voilà donc les grandiloquents, drolatiques et désappointant Koppel-Bär et Jäckele-Narr qui, se promenant aux abords du cimetière, se lamentent de la perte de ceux qu'ils ont connus - tout particulièrement une jeune fille innocente et délicieuse, fille d'un artisan - des suites de cette horreur que fut la peste. Nos deux compères finissent par pénétrer dans "le jardin des morts" (Perutz, à la manière de ce vocable parfois ampoulé de l'époque, aime à imager, par petites touches discrètes, les mots les plus simples et crus), à la recherche - il faut bien vivre - de quelque piécette déposée là qui par une veuve qui par un père qui par un ami, en témoignage d'amitié et d'amour. Mais surtout, parce que le grand Rabbin leur a confié une mission terrible et sacrée. Or, on ne dérange pas impunément les morts ! C'est ainsi qu'ils vont voir Fleurette, la jeune demoiselle qu'ils appréciaient, nimbée de lumière et servant de lien entre les hommes et le prince des ténèbres, eux-mêmes, les artistes, étant les intercesseurs pour le monde des vivants. Ils vont lui poser la question pour laquelle ils sont venus déranger le repos éternel des chers disparus : connaitre la raison véritable de cette malédiction qui emporte le peuple élu de Dieu.
En quelques pages, tout ou presque est posé de ce qui fait l'essence même de ce roman si particulier et envoûtant : une ambiance, se situant entre le roman historique (Perutz était féru d'histoire), une certaine bouffonnerie douce et folle à la fois, le conte fantastique parfois gothique et la fable ésotérique ; des lieux : la cité juive qui était alors sise au pied des murs du château de Prague, le château, la rivière Vltava et son fameux pont de pierre ; des personnages : ces deux musiciens itinérants, le fameux Grand Rabbin Leow, celui-là même auquel l'histoire attribue la naissance du Golem, la belle Esther qui ne sera d'ailleurs jamais réellement incarnée, son époux l'usurier Mordechaï Meisl, l'un des représentants les plus célèbres de la communauté juive de l'époque, le plus riche indéniablement, qui fit rénover intégralement ce quartier déjà très largement insalubre et labyrinthique en ces temps lointains. Rodolphe II n'est encore qu'à peine évoqué mais on sent déjà un peu son ombre tutélaire planer au dessus de la ville.
Au fil des histoires, on va croiser une foule de personnages, des puissants et des gens de rien, tous guettés par la mort, par la folie ou la déréliction. La nouvelle Un Pichet d'eau-de-vie montre ainsi à nouveau nos deux musiciens pauvres, se disputant le pichet eau-de-vie que l'un des deux a dérobé lors d'une cérémonie. Ils sont à nouveau dans le cimetière, le jour où les fantômes des morts de l'année passée viennent appeler les morts de l'année à venir. Après toute une litanie de disparus dont les deux compères commentent les faits et gestes passés, Jäckele-Narr entend son nom ! Ainsi, la légende, les traditions et le rêve se mêlent à l'histoire contée tout aussi bien qu'à l'histoire telle qu'elle fut en un basculement permanent de la réalité. Pareillement, lorsque l'empereur succombe à la beauté d'Esther, l'épouse du riche usurier Meisl, le rabbin Loew use d'un charme pour que les amoureux ne puisse se rencontrent qu'en rêve. Cet amour traverse d'ailleurs tout le roman, il en est l'une des clés essentielles à défaut d'en être la seule. Il conte l'union impossible entre deux cultures, entre deux classes sociales inconciliables, dans une union pourtant radieuse, magique, purement onirique et puissamment transcendante que symbolisent la rose (attribuée à Rodolphe) et le romarin (qui représente Esther) enlacés, la nuit, sous le Pont de Pierre (cette "nouvelle" titre du roman est positionné à l'exact mitan de l'ouvrage, puisqu'elle en est la septième), ce symbole de Prague, en une histoire d'amour finalement tragique puisqu'elle condamne Esther à la mort : C'est elle qui a accompli le "péché de Moab", un adultère se positionnant au-dessus des règles et des lois, du mariage et de la tradition, au-dessus de la vie dans une certaine mesure, bien qu'il n'ait physiquement consisté qu'en deux brefs regards au court d'un bref instant... Mais des rêves, des rêves, des rêves, d'une inquiétante beauté magique.
On va encore croiser tout un peuple d'artisans, juifs ou chrétiens, de serviteurs zélés de l'empereur prenant leur mission parfois tant à cœur qu'on en finit par se demander s'ils ne dirigent pas réellement ce monarque perdu dans ses désirs, dans sa folie douce-amère de possessions artistiques ou de découverte alchimique, tel cet intrigant le valet de chambre de l'empereur, Philippe Lang. On y retrouve le grand astronome Johannes Kepler - dans l'ombre posthume de Tycho Brahé -, qui, parce que sa femme est malade et que lui-même a faim, va devoir produire des thèmes astraux dont il réfute pourtant tout sérieux scientifique. On rencontre ce grand personnage historique, incontournable pour qui visite Prague, l'archiduc guerrier Albrecht de Wallenstein, mais aussi l'alchimiste Jacobus van Delle et son ami Brouza, le fou, tous deux à la recherche de cette fameuse pierre philosophale pour laquelle Rodolphe, ce roi excentrique, dépensier et démesuré, dilapidera le trésor impérial presque autant que pour la constitution de sa fameuse "Kunstkammer" (un cabinet de curiosité relevant du musée privé) connue jusqu'à ce jour par ses catalogues complets. On y croise enfin cet ange, implacable et bouleversant, qui, se souvenant d'une femme disparue à l'aube du monde, laisse perler des larmes. Des larmes d'hommes...
Peu à peu, le lecteur se sent pris au piège de ce roman dédaléen dont on voit bien qu'il est constitué d'un vaste puzzle, mais qui vous entourloupe sans cesse, qui vous embarque sur tel rivage tandis que vous aviez la sensation d'en approcher un autre. Ainsi l'ordre chronologique n'est-il jamais respecté, idem pour tâcher d'y trouver une impossible succession dans les aventures des personnages rémanents. Pourtant, on se laisse prendre à la contemplation active de cette galerie de portraits, d'histoires inspirée de faits réels ou parfaitement inventés, les uns comblant les autres et inversement ! Bien sûr, il y a quelque chose là-dedans de ce "réalisme magique" dont on qualifiera l'oeuvre à venir du grand écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez. Sans hésitation pourra-t-on aussi songer à l'oeuvre d'un Jorge Luis Borges qui ne cachait d'ailleurs pas son admiration sans borne pour l'autrichien. Bien évidemment, il n'échappera pas au lecteur attentif que Léo Perutz se joue de nous et de la réalité comme purent le faire par la suite un Raymond Queneau, un Italo Calvino ou un Georges Perec. A y bien réfléchir, Léo Perutz n'est d'ailleurs pas si éloigné que cela de plusieurs règles développées un peu plus tard par l'OULIPO. Bien évidemment, La nuit sous le pont de pierre n'est pas un texte oulipien à proprement parler. Ce serait idiot de l'exprimer ainsi et parfaitement anachronique. Cependant, bien des points communs renvoient à ce mouvement littéraire. Ainsi, Perutz avait une formation de mathématicien (spécialisé en calcul des probabilités !) : nombre d'oulipiens ne cachent pas leur fascination pour la matière. L'oulipien Jacques Roubaud n'est-il d'ailleurs pas poète & mathématicien ? le roman présente par ailleurs une succession d'énigmes dans lesquelles sont distillées les indices d'un genre de méta-énigme : c'est encore incroyablement oulipien comme manière de pratiquer. On a par ailleurs le portrait en creux (et très amoureux) d'une ville, de sa vie trépidante procédant par étages, où l'on passe d'un lieu (quartier, maison, palais, pièce d'habitation, échoppe, etc) à un autre sans logique apparente mais pas sans lien. L'un des plus grands romans de l'Oulipo ne fonctionne-t-il pas sur ce modèle : La Vie mode d'emploi de Georges Pérec ? Enfin, ce grand oeuvre - comme on l'exprime en alchimie - procède d'une intention délibérée de l'auteur de suivre un cheminement narratif parfaitement inconnu et grandement novateur en matière romanesque.
Il y a du puzzle dans ce texte. Il y a ainsi toute une série de contraintes que Perutz semble s'être imposé à lui-même dans la composition - son grand oeuvre comme on l'exprimerait en alchimie - de cet ouvrage tout à la fois sombre et lumineux. Il y a encore cette manière si particulière, "évitante", de procéder pour raconter cette histoire belle comme un matin de printemps, la rencontre entre ce Romarin et cette Rose, plus forte que la vie, qui naît d'un simple regard et meurt chimériquement au-delà de l'existence, qui est pourtant à la fois ancrée en elle et bien au-dessus.
Par ailleurs, Perutz, qui ne mésestimait pas l'humour, fut-il grinçant ou même noir, semble ainsi agir avec son lecteur comme dans la parabole du sage et du fou : il met en avant, montre du doigt, toute une théorie de personnages, de détails, d'historiettes plus ou moins importants - le doigt du sage - que lecteur, un peu fou, découvre, admire, fasciné, tandis que c'est pourtant une toute autre lune qu'il essaie de nous montrer (il faut admettre que l'auteur fait tout, avec génie, pour qu'on ne regarde pas tellement plus loin que ce qui explose sous notre regard immédiat, nous perdant à l'intérieur d'une foule de détails rocambolesques au sein desquels il en répand quelques autres sans rapport immédiat, à la manière d'un petit Poucet génésiaque...). Pourtant, de page en page, il ne cesse de nous dire que l'amour est le plus puissant, le plus incroyable, le plus magique - au sens fort - des sentiments. Il ne cesse de nous faire entendre que seuls l'art et les artistes sont en mesure d'intercéder entre rêve et réalité, entre monde du dessus et monde du dessous, entre matérialisme et spiritualité, que la musique est un puissant médium, le plus puissant peut-être, entre imaginaire et vérité sensible. Il nous rappelle sans cesse - et dès la première histoire - que la mort rôde où que l'on se tourne et l'on ne saurait d'ailleurs oublier qu'il vient de là, ce grand écrivain, de ce petit monde des juifs d'Europe centrale qui ont payé un si lourd tribu à la mort abjecte et industrielle, qu'il rappelle ainsi la grande menace de la persécution, de l'antisémitisme. Comme l'oublier puisque les pires craintes se sont réalisées, ce texte ayant été écrit après la Shoah. Le titre de la première nouvelle en devient d'ailleurs hautement symbolique : La Peste dans la cité juive...
Il y a encore la déclaration d'amour incroyable d'un auteur au crépuscule de sa vie à cette ville immémoriale, qui plonge au plus profond de ses souvenirs adolescents pour nous la dépeindre. Voici ce qu'il en exprime, dans son épilogue : « Vers le début du siècle, alors que j'avais quinze ans et que je fréquentais le lycée, je vis la cité juive de Prague pour la dernière fois. Bien sûr, elle ne portait plus ce nom depuis longtemps : on l'appelait Josephstadt. Et elle reste dans mon souvenir telle que je la vis alors : de vieilles maisons blotties les unes contre les autres, des maisons au dernier stade de délabrement, avec des sailles et des ajouts qui encombraient les ruelles étroites, venelles tortueuses dans le dédale desquelles il m'arrivait de me perdre sans espoir lorsque je n'y prenais pas garde. Des passages obscures, des cours sombres, des brèches dans les murs, des voûtes, telles des cavernes où des brocanteurs vendaient leur marchandise, des puits et des citernes dont l'eau était contaminée par la maladie pragoise, le typhus - et dans les moindres recoins, à tous les carrefours, un tripot où se retrouvait la pègre de Prague. Oui je connaissais bien la vieille cité juive... »
Mais surtout - et pour le coup, on en revient strictement au pur génie, à la "patte", à l'originalité démiurgique de Leo Perutz - il y a une grâce infinie, une poésie certes qualifiable de baroque dans cette oeuvre (il ne serait sans doute pas vain de chercher aussi du côté de ce que fut, artistiquement, le mouvement baroque ainsi que la fameuse contre-réforme qu'il l'accompagne. Là aussi, en choisissant obstinément cette période, Perutz nous en dit beaucoup, l'air de rien. Sans oublier l'omniprésence du judaïsme et de la kabbale, bien entendu, et qui pose mille autres questions, renvoie à mille autres pistes), avec cette succession de noms de lieux inconnaissables, ces généalogies improbables qui font soudainement penser à quelque présentation inouïe de personnages tirés d'un roman de J.R.R. Tolkien ainsi que le suggère très judicieusement Jean-Philippe Depotte ; il y a encore ces phrases courtes, successives, presque sèches auxquelles va soudainement en succéder une plus ample, et belle, et ensorcelante, une de ces phrases se faisant tour à tour douce et poétique, sombre et violente. Une poésie du style, du verbe, de l'image infiniment puissante, insinuante (rien de tape à l’œil dans tout cela, malgré les innombrables fausses pistes en la matière) dont le but ultime est de servir, avec cette immense tendresse (qui se fait parfois terriblement mordante) que l'on retrouve de texte en texte, cette humanité grandement imparfaite mais tellement émouvante, pour ces personnages toujours plus ou moins hors du commun et pourtant tellement proches dans leur exotisme. Il y a quelque chose en tout cela qui vous rend immédiatement proche et connaissable ce petit monde pourtant si lointain, dans l'espace et le temps, induisant subtilement de cette nostalgie des âges perdus.
Cet art, Leo Perutz le dominait à la perfection en cette année 1953 et pour son ultime chef-d'oeuvre (Le Judas de Léonard est postérieur mais posthume), c'est un présent d'essence quasiment divine qu'il laisse derrière lui en témoignage de son humanité profonde. Une lecture qui vous gagne, lentement, prodigieusement, comme l'écoulement d'une large et profonde rivière - la pragoise rivière Vltava ? -, mais qui ne vous lâche plus jamais une fois que vous y avez goûté.
Certains textes, qu'ils soient courts ou qu'ils soient longs, parviennent de temps à autre à laisser le lecteur pantois, béat d'admiration et d'émotion, exsangue. Tout juste en a-t-on achevé la dernière page, les dernières lignes, les ultimes mots qu'on a de suite envie de les reprendre, autant parce qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont embarqué vers d'autres rivages jusqu'alors méconnus, étranges, indociles - admirateur de Pessoa, on peine à s'abstenir d'une "intranquilité", tant on peut trouver d'équivalence entre l'attachement du portugais pour Lisbonne et de Perutz pour Prague, même si ce ne fut, finalement, que la ville de son enfance et de ses souvenirs -. On referme ce bref et dense ouvrage en se demandant, diable ! comment il est possible de composer un tel morceau de littérature, de rêve et d'humanité tout à la fois. On songe aussi, plus ou moins, à s'arracher les cheveux tant la tâche semble ardue, pour ne pas dire impossible, de tout en dire sans trop en révéler, de bien en dire, sans trop en oublier. Il est cependant temps de se lancer, et on nous pardonnera si c'est bien imparfait. Car voilà le type même d'oeuvre "irrésumable", ô! combien complexe sous des atours presque anecdotiques, qui emmène très loin sur les terres de l'imaginaire et du sens. Tâchons de ne pas trop mal faire :
La nuit sous le pont de pierre est donc un roman relativement bref (deux-cent quarante-sept pages en édition poche), composé d'une suite de récits - la dénomination "nouvelle", bien que souvent employée pour ces "chapitres" qui peinent tout autant à en être d'un point de vue des règles romanesques classiques, nous semble relever de l'erreur syntaxique ou de la trompeuse facilité contextuelle. Nous essaierons de voir plus loin pourquoi -, quatorze textes tous titrés pour être précis et suivis d'un épilogue censé nous donner la clé de l'ensemble. Celui-ci porte pourtant en lui presque autant de questions que de réponses à cet intrigant jeu de piste dans lequel le romancier de langue allemande Léo Perutz revient abondamment, avec un amour profond, beaucoup de tendresse, son lot d'humour décalé et un imaginaire débridé à ses propres racines pragoises et juives.
Dès le premier récit, nous voila plongé en plein cœur de cette cité juive de Prague (aujourd'hui presque totalement reconstruite, mais l'auteur pu la découvrir, enfant, avant sa destruction pour cause d'insalubrité notoire). Nous sommes avalés des les premières lignes par ce XVIIème siècle baroque, sous la domination excentrique de l'empereur des Romains et Roi de Hongrie et de Bohème, Rodolphe II. Mais Perutz nous accompagne d'abord auprès de ce petit peuple des juifs de la capitale, plus précisément à la rencontre de deux bateleurs traînant tout autant leurs traditions séculaires, leur art de vivre et de penser, leur foi, leur musique que leur récurrente misère vagabonde. Voilà donc les grandiloquents, drolatiques et désappointant Koppel-Bär et Jäckele-Narr qui, se promenant aux abords du cimetière, se lamentent de la perte de ceux qu'ils ont connus - tout particulièrement une jeune fille innocente et délicieuse, fille d'un artisan - des suites de cette horreur que fut la peste. Nos deux compères finissent par pénétrer dans "le jardin des morts" (Perutz, à la manière de ce vocable parfois ampoulé de l'époque, aime à imager, par petites touches discrètes, les mots les plus simples et crus), à la recherche - il faut bien vivre - de quelque piécette déposée là qui par une veuve qui par un père qui par un ami, en témoignage d'amitié et d'amour. Mais surtout, parce que le grand Rabbin leur a confié une mission terrible et sacrée. Or, on ne dérange pas impunément les morts ! C'est ainsi qu'ils vont voir Fleurette, la jeune demoiselle qu'ils appréciaient, nimbée de lumière et servant de lien entre les hommes et le prince des ténèbres, eux-mêmes, les artistes, étant les intercesseurs pour le monde des vivants. Ils vont lui poser la question pour laquelle ils sont venus déranger le repos éternel des chers disparus : connaitre la raison véritable de cette malédiction qui emporte le peuple élu de Dieu.
En quelques pages, tout ou presque est posé de ce qui fait l'essence même de ce roman si particulier et envoûtant : une ambiance, se situant entre le roman historique (Perutz était féru d'histoire), une certaine bouffonnerie douce et folle à la fois, le conte fantastique parfois gothique et la fable ésotérique ; des lieux : la cité juive qui était alors sise au pied des murs du château de Prague, le château, la rivière Vltava et son fameux pont de pierre ; des personnages : ces deux musiciens itinérants, le fameux Grand Rabbin Leow, celui-là même auquel l'histoire attribue la naissance du Golem, la belle Esther qui ne sera d'ailleurs jamais réellement incarnée, son époux l'usurier Mordechaï Meisl, l'un des représentants les plus célèbres de la communauté juive de l'époque, le plus riche indéniablement, qui fit rénover intégralement ce quartier déjà très largement insalubre et labyrinthique en ces temps lointains. Rodolphe II n'est encore qu'à peine évoqué mais on sent déjà un peu son ombre tutélaire planer au dessus de la ville.
Au fil des histoires, on va croiser une foule de personnages, des puissants et des gens de rien, tous guettés par la mort, par la folie ou la déréliction. La nouvelle Un Pichet d'eau-de-vie montre ainsi à nouveau nos deux musiciens pauvres, se disputant le pichet eau-de-vie que l'un des deux a dérobé lors d'une cérémonie. Ils sont à nouveau dans le cimetière, le jour où les fantômes des morts de l'année passée viennent appeler les morts de l'année à venir. Après toute une litanie de disparus dont les deux compères commentent les faits et gestes passés, Jäckele-Narr entend son nom ! Ainsi, la légende, les traditions et le rêve se mêlent à l'histoire contée tout aussi bien qu'à l'histoire telle qu'elle fut en un basculement permanent de la réalité. Pareillement, lorsque l'empereur succombe à la beauté d'Esther, l'épouse du riche usurier Meisl, le rabbin Loew use d'un charme pour que les amoureux ne puisse se rencontrent qu'en rêve. Cet amour traverse d'ailleurs tout le roman, il en est l'une des clés essentielles à défaut d'en être la seule. Il conte l'union impossible entre deux cultures, entre deux classes sociales inconciliables, dans une union pourtant radieuse, magique, purement onirique et puissamment transcendante que symbolisent la rose (attribuée à Rodolphe) et le romarin (qui représente Esther) enlacés, la nuit, sous le Pont de Pierre (cette "nouvelle" titre du roman est positionné à l'exact mitan de l'ouvrage, puisqu'elle en est la septième), ce symbole de Prague, en une histoire d'amour finalement tragique puisqu'elle condamne Esther à la mort : C'est elle qui a accompli le "péché de Moab", un adultère se positionnant au-dessus des règles et des lois, du mariage et de la tradition, au-dessus de la vie dans une certaine mesure, bien qu'il n'ait physiquement consisté qu'en deux brefs regards au court d'un bref instant... Mais des rêves, des rêves, des rêves, d'une inquiétante beauté magique.
On va encore croiser tout un peuple d'artisans, juifs ou chrétiens, de serviteurs zélés de l'empereur prenant leur mission parfois tant à cœur qu'on en finit par se demander s'ils ne dirigent pas réellement ce monarque perdu dans ses désirs, dans sa folie douce-amère de possessions artistiques ou de découverte alchimique, tel cet intrigant le valet de chambre de l'empereur, Philippe Lang. On y retrouve le grand astronome Johannes Kepler - dans l'ombre posthume de Tycho Brahé -, qui, parce que sa femme est malade et que lui-même a faim, va devoir produire des thèmes astraux dont il réfute pourtant tout sérieux scientifique. On rencontre ce grand personnage historique, incontournable pour qui visite Prague, l'archiduc guerrier Albrecht de Wallenstein, mais aussi l'alchimiste Jacobus van Delle et son ami Brouza, le fou, tous deux à la recherche de cette fameuse pierre philosophale pour laquelle Rodolphe, ce roi excentrique, dépensier et démesuré, dilapidera le trésor impérial presque autant que pour la constitution de sa fameuse "Kunstkammer" (un cabinet de curiosité relevant du musée privé) connue jusqu'à ce jour par ses catalogues complets. On y croise enfin cet ange, implacable et bouleversant, qui, se souvenant d'une femme disparue à l'aube du monde, laisse perler des larmes. Des larmes d'hommes...
Peu à peu, le lecteur se sent pris au piège de ce roman dédaléen dont on voit bien qu'il est constitué d'un vaste puzzle, mais qui vous entourloupe sans cesse, qui vous embarque sur tel rivage tandis que vous aviez la sensation d'en approcher un autre. Ainsi l'ordre chronologique n'est-il jamais respecté, idem pour tâcher d'y trouver une impossible succession dans les aventures des personnages rémanents. Pourtant, on se laisse prendre à la contemplation active de cette galerie de portraits, d'histoires inspirée de faits réels ou parfaitement inventés, les uns comblant les autres et inversement ! Bien sûr, il y a quelque chose là-dedans de ce "réalisme magique" dont on qualifiera l'oeuvre à venir du grand écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez. Sans hésitation pourra-t-on aussi songer à l'oeuvre d'un Jorge Luis Borges qui ne cachait d'ailleurs pas son admiration sans borne pour l'autrichien. Bien évidemment, il n'échappera pas au lecteur attentif que Léo Perutz se joue de nous et de la réalité comme purent le faire par la suite un Raymond Queneau, un Italo Calvino ou un Georges Perec. A y bien réfléchir, Léo Perutz n'est d'ailleurs pas si éloigné que cela de plusieurs règles développées un peu plus tard par l'OULIPO. Bien évidemment, La nuit sous le pont de pierre n'est pas un texte oulipien à proprement parler. Ce serait idiot de l'exprimer ainsi et parfaitement anachronique. Cependant, bien des points communs renvoient à ce mouvement littéraire. Ainsi, Perutz avait une formation de mathématicien (spécialisé en calcul des probabilités !) : nombre d'oulipiens ne cachent pas leur fascination pour la matière. L'oulipien Jacques Roubaud n'est-il d'ailleurs pas poète & mathématicien ? le roman présente par ailleurs une succession d'énigmes dans lesquelles sont distillées les indices d'un genre de méta-énigme : c'est encore incroyablement oulipien comme manière de pratiquer. On a par ailleurs le portrait en creux (et très amoureux) d'une ville, de sa vie trépidante procédant par étages, où l'on passe d'un lieu (quartier, maison, palais, pièce d'habitation, échoppe, etc) à un autre sans logique apparente mais pas sans lien. L'un des plus grands romans de l'Oulipo ne fonctionne-t-il pas sur ce modèle : La Vie mode d'emploi de Georges Pérec ? Enfin, ce grand oeuvre - comme on l'exprime en alchimie - procède d'une intention délibérée de l'auteur de suivre un cheminement narratif parfaitement inconnu et grandement novateur en matière romanesque.
Il y a du puzzle dans ce texte. Il y a ainsi toute une série de contraintes que Perutz semble s'être imposé à lui-même dans la composition - son grand oeuvre comme on l'exprimerait en alchimie - de cet ouvrage tout à la fois sombre et lumineux. Il y a encore cette manière si particulière, "évitante", de procéder pour raconter cette histoire belle comme un matin de printemps, la rencontre entre ce Romarin et cette Rose, plus forte que la vie, qui naît d'un simple regard et meurt chimériquement au-delà de l'existence, qui est pourtant à la fois ancrée en elle et bien au-dessus.
Par ailleurs, Perutz, qui ne mésestimait pas l'humour, fut-il grinçant ou même noir, semble ainsi agir avec son lecteur comme dans la parabole du sage et du fou : il met en avant, montre du doigt, toute une théorie de personnages, de détails, d'historiettes plus ou moins importants - le doigt du sage - que lecteur, un peu fou, découvre, admire, fasciné, tandis que c'est pourtant une toute autre lune qu'il essaie de nous montrer (il faut admettre que l'auteur fait tout, avec génie, pour qu'on ne regarde pas tellement plus loin que ce qui explose sous notre regard immédiat, nous perdant à l'intérieur d'une foule de détails rocambolesques au sein desquels il en répand quelques autres sans rapport immédiat, à la manière d'un petit Poucet génésiaque...). Pourtant, de page en page, il ne cesse de nous dire que l'amour est le plus puissant, le plus incroyable, le plus magique - au sens fort - des sentiments. Il ne cesse de nous faire entendre que seuls l'art et les artistes sont en mesure d'intercéder entre rêve et réalité, entre monde du dessus et monde du dessous, entre matérialisme et spiritualité, que la musique est un puissant médium, le plus puissant peut-être, entre imaginaire et vérité sensible. Il nous rappelle sans cesse - et dès la première histoire - que la mort rôde où que l'on se tourne et l'on ne saurait d'ailleurs oublier qu'il vient de là, ce grand écrivain, de ce petit monde des juifs d'Europe centrale qui ont payé un si lourd tribu à la mort abjecte et industrielle, qu'il rappelle ainsi la grande menace de la persécution, de l'antisémitisme. Comme l'oublier puisque les pires craintes se sont réalisées, ce texte ayant été écrit après la Shoah. Le titre de la première nouvelle en devient d'ailleurs hautement symbolique : La Peste dans la cité juive...
Il y a encore la déclaration d'amour incroyable d'un auteur au crépuscule de sa vie à cette ville immémoriale, qui plonge au plus profond de ses souvenirs adolescents pour nous la dépeindre. Voici ce qu'il en exprime, dans son épilogue : « Vers le début du siècle, alors que j'avais quinze ans et que je fréquentais le lycée, je vis la cité juive de Prague pour la dernière fois. Bien sûr, elle ne portait plus ce nom depuis longtemps : on l'appelait Josephstadt. Et elle reste dans mon souvenir telle que je la vis alors : de vieilles maisons blotties les unes contre les autres, des maisons au dernier stade de délabrement, avec des sailles et des ajouts qui encombraient les ruelles étroites, venelles tortueuses dans le dédale desquelles il m'arrivait de me perdre sans espoir lorsque je n'y prenais pas garde. Des passages obscures, des cours sombres, des brèches dans les murs, des voûtes, telles des cavernes où des brocanteurs vendaient leur marchandise, des puits et des citernes dont l'eau était contaminée par la maladie pragoise, le typhus - et dans les moindres recoins, à tous les carrefours, un tripot où se retrouvait la pègre de Prague. Oui je connaissais bien la vieille cité juive... »
Mais surtout - et pour le coup, on en revient strictement au pur génie, à la "patte", à l'originalité démiurgique de Leo Perutz - il y a une grâce infinie, une poésie certes qualifiable de baroque dans cette oeuvre (il ne serait sans doute pas vain de chercher aussi du côté de ce que fut, artistiquement, le mouvement baroque ainsi que la fameuse contre-réforme qu'il l'accompagne. Là aussi, en choisissant obstinément cette période, Perutz nous en dit beaucoup, l'air de rien. Sans oublier l'omniprésence du judaïsme et de la kabbale, bien entendu, et qui pose mille autres questions, renvoie à mille autres pistes), avec cette succession de noms de lieux inconnaissables, ces généalogies improbables qui font soudainement penser à quelque présentation inouïe de personnages tirés d'un roman de J.R.R. Tolkien ainsi que le suggère très judicieusement Jean-Philippe Depotte ; il y a encore ces phrases courtes, successives, presque sèches auxquelles va soudainement en succéder une plus ample, et belle, et ensorcelante, une de ces phrases se faisant tour à tour douce et poétique, sombre et violente. Une poésie du style, du verbe, de l'image infiniment puissante, insinuante (rien de tape à l’œil dans tout cela, malgré les innombrables fausses pistes en la matière) dont le but ultime est de servir, avec cette immense tendresse (qui se fait parfois terriblement mordante) que l'on retrouve de texte en texte, cette humanité grandement imparfaite mais tellement émouvante, pour ces personnages toujours plus ou moins hors du commun et pourtant tellement proches dans leur exotisme. Il y a quelque chose en tout cela qui vous rend immédiatement proche et connaissable ce petit monde pourtant si lointain, dans l'espace et le temps, induisant subtilement de cette nostalgie des âges perdus.
Cet art, Leo Perutz le dominait à la perfection en cette année 1953 et pour son ultime chef-d'oeuvre (Le Judas de Léonard est postérieur mais posthume), c'est un présent d'essence quasiment divine qu'il laisse derrière lui en témoignage de son humanité profonde. Une lecture qui vous gagne, lentement, prodigieusement, comme l'écoulement d'une large et profonde rivière - la pragoise rivière Vltava ? -, mais qui ne vous lâche plus jamais une fois que vous y avez goûté.
Quand j’arrive à un nombre de critique qui est un multiple de cent, j’aime à marquer le coup avec une un peu spéciale, sur un livre qui m’a particulièrement marqué d’une façon ou d’une autre. Mais tout à mon hiver parisien et son tunnel de rhumes et de gastros (le revers de la médaille quand on a miraculeusement réussi à décrocher une place en crèche) j’ai laissé passer la quatre-centième. Qu’à cela ne tienne, je célèbrerai donc la quatre-cent-troisième comme il se doit.
Nous sommes au XVIIème siècle, quelque part dans les plaines de Silésie. La Suède domine le monde. Elle a vaincu Danemark, Pologne, Saxe, et maintenant son roi fou et implacable, Charles XII, poursuit le tsar de toutes les Russies à travers les steppes infinies. Mais ici, un déserteur de son armée, un gentilhomme qui n’est encore qu’un gamin trop gâté, erre dans la neige en compagnie d’un vagabond. Il demande à ce dernier d’aller à plusieurs lieux de là, jusqu’au domaine où réside sa jeune cousine à laquelle il est fiancé, et de quérir du secours. Mais pendant sa visite le vagabond aperçoit la jeune fille, et en tombe instantanément amoureux. Pour elle, il va concevoir un incroyable plan…
Non loin de là, une gigantesque mine de fer engloutit les hommes par dizaines. Bien souvent des condamnés, les autres on ne se soucie pas trop de savoir s’ils sont volontaires. Par précaution on les enchaine tous, et on abat ceux qui essayent de s’enfuir avant d’avoir fait leurs années. Parfait pour se débarrasser du jeune gentilhomme. Le vagabond se met ensuite à la tête d’une bande de brigands, et entreprend de détrousser églises, monastères et bourgeois. Pendant des années ils sévissent et terrorisent la région, puis du jour au lendemain on n’en entend plus parler. Quelques jours plus tard, au domaine de la jeune cousine qui entre temps est devenu femme, un visiteur inattendu se présente : son cousin est de retour pour l’épouser ! Ses poches débordent d’écus pour sauver les terres hypothéquées, et son cœur d’amour pour sa fiancée. Mais le vagabond peut-il ainsi faire la nique au destin et se décharger à jamais de sa condition ? Voila qui est moins sûr…
Une fabuleuse aventure au souffle mystique à travers les plaines et les collines enneigées de l’Europe centrale. Le gentilhomme se fera vagabond et le vagabond se fera noble, le blé continuera de murir et la guerre de rugir au loin. Et de tout cela, il ne restera que l’amour d’une petite fille et ses souvenirs de l’être merveilleux qui, défiant l’impossible et la mort, venait la nuit toquer à ses volets pour l’embrasser.
Nous sommes au XVIIème siècle, quelque part dans les plaines de Silésie. La Suède domine le monde. Elle a vaincu Danemark, Pologne, Saxe, et maintenant son roi fou et implacable, Charles XII, poursuit le tsar de toutes les Russies à travers les steppes infinies. Mais ici, un déserteur de son armée, un gentilhomme qui n’est encore qu’un gamin trop gâté, erre dans la neige en compagnie d’un vagabond. Il demande à ce dernier d’aller à plusieurs lieux de là, jusqu’au domaine où réside sa jeune cousine à laquelle il est fiancé, et de quérir du secours. Mais pendant sa visite le vagabond aperçoit la jeune fille, et en tombe instantanément amoureux. Pour elle, il va concevoir un incroyable plan…
Non loin de là, une gigantesque mine de fer engloutit les hommes par dizaines. Bien souvent des condamnés, les autres on ne se soucie pas trop de savoir s’ils sont volontaires. Par précaution on les enchaine tous, et on abat ceux qui essayent de s’enfuir avant d’avoir fait leurs années. Parfait pour se débarrasser du jeune gentilhomme. Le vagabond se met ensuite à la tête d’une bande de brigands, et entreprend de détrousser églises, monastères et bourgeois. Pendant des années ils sévissent et terrorisent la région, puis du jour au lendemain on n’en entend plus parler. Quelques jours plus tard, au domaine de la jeune cousine qui entre temps est devenu femme, un visiteur inattendu se présente : son cousin est de retour pour l’épouser ! Ses poches débordent d’écus pour sauver les terres hypothéquées, et son cœur d’amour pour sa fiancée. Mais le vagabond peut-il ainsi faire la nique au destin et se décharger à jamais de sa condition ? Voila qui est moins sûr…
Une fabuleuse aventure au souffle mystique à travers les plaines et les collines enneigées de l’Europe centrale. Le gentilhomme se fera vagabond et le vagabond se fera noble, le blé continuera de murir et la guerre de rugir au loin. Et de tout cela, il ne restera que l’amour d’une petite fille et ses souvenirs de l’être merveilleux qui, défiant l’impossible et la mort, venait la nuit toquer à ses volets pour l’embrasser.
Quand Leo Perutz s'attaque à la guerre d'Indépendance espagnole, il place à La Bisbal, petite ville imaginaire perdue dans les montagnes des Asturies, des soldats et officiers des régiments de Nassau et de Hesse chargés d'éradiquer la guérilla espagnole. En cet hiver 1812, les troupes allemandes doivent faire face à l'armée hétéroclite du colonel Saracho, alias "La fosse à tanner" et enragent face à cette nouvelle forme de conflit.
Cinq jeunes hommes liés par les mêmes rêves de gloire et leur fidélité à l'Empereur, tentent de briser la résistance espagnole. Ils sont également liés par un secret, celui d'une passion commune pour feue la belle Françoise-Marie, l'épouse de leur colonel, dont ils ont partagé les faveurs. Perutz parsème ça et là quelques éléments incontournables du roman historique, le clivage entre les "afrancesados" et les guérilleros, le mouvement des troupes qui progressent, les souvenirs des campagnes précédentes... Mais voilà, le régiment de Nassau est anéanti dans les terres asturiennes, sans que L Histoire n'en garde trace.
Jusqu'à ce que, bien des années plus tard, à la mort d'Edouard de Jochberg, "un vieux soldat qui, au temps de sa jeunesse, avait vécu une partie des campagnes de Napoléon Ier", on ne trouve ses mémoires. Jochberg, à peine dix huit ans en 1812, fut, comme il le mentionne, un des seuls survivants de son régiment. Quelle valeur critique accorder à un récit qui n'a pour seule caution que le pacte tacite entre le lecteur et le mémorialiste, pacte mis à l'épreuve par les extraordinaires révélations d'un homme qui affirme avoir rencontré en Espagne le Juif errant, ainsi que le mystérieux Marquis de Bolibar?
Chez Perutz, le fantastique s'invite dans L Histoire et l'asservit. Face aux troupes de Napoléon baignées dans une atmosphère onirique se dressent des fantômes métamorphes. La fulgurance des rêves s'oppose au lent processus temporel de la perception. S'appuyant sur une structure narrative complexe, Leo Perutz échafaude un plan machiavélique que les héros, asservis par leurs passions et leur aveuglement auront bien du mal à percevoir. A La Bisbal, une intelligence omnisciente préside à leur destinée.
Le lecteur béotien, manipulé comme les personnages du roman, tombe sous le charme du Marquis de Bolibar (qui nous rappelle parfois le Manuscrit trouvé à Saragosse de Potocki ou La légende de Pendragon de Szerb). Le roman comblera aussi les puristes qui connaissent la couleur des boutons de l'uniforme de Sébastiani à la bataille de Talavera de la Reina.
Cinq jeunes hommes liés par les mêmes rêves de gloire et leur fidélité à l'Empereur, tentent de briser la résistance espagnole. Ils sont également liés par un secret, celui d'une passion commune pour feue la belle Françoise-Marie, l'épouse de leur colonel, dont ils ont partagé les faveurs. Perutz parsème ça et là quelques éléments incontournables du roman historique, le clivage entre les "afrancesados" et les guérilleros, le mouvement des troupes qui progressent, les souvenirs des campagnes précédentes... Mais voilà, le régiment de Nassau est anéanti dans les terres asturiennes, sans que L Histoire n'en garde trace.
Jusqu'à ce que, bien des années plus tard, à la mort d'Edouard de Jochberg, "un vieux soldat qui, au temps de sa jeunesse, avait vécu une partie des campagnes de Napoléon Ier", on ne trouve ses mémoires. Jochberg, à peine dix huit ans en 1812, fut, comme il le mentionne, un des seuls survivants de son régiment. Quelle valeur critique accorder à un récit qui n'a pour seule caution que le pacte tacite entre le lecteur et le mémorialiste, pacte mis à l'épreuve par les extraordinaires révélations d'un homme qui affirme avoir rencontré en Espagne le Juif errant, ainsi que le mystérieux Marquis de Bolibar?
Chez Perutz, le fantastique s'invite dans L Histoire et l'asservit. Face aux troupes de Napoléon baignées dans une atmosphère onirique se dressent des fantômes métamorphes. La fulgurance des rêves s'oppose au lent processus temporel de la perception. S'appuyant sur une structure narrative complexe, Leo Perutz échafaude un plan machiavélique que les héros, asservis par leurs passions et leur aveuglement auront bien du mal à percevoir. A La Bisbal, une intelligence omnisciente préside à leur destinée.
Le lecteur béotien, manipulé comme les personnages du roman, tombe sous le charme du Marquis de Bolibar (qui nous rappelle parfois le Manuscrit trouvé à Saragosse de Potocki ou La légende de Pendragon de Szerb). Le roman comblera aussi les puristes qui connaissent la couleur des boutons de l'uniforme de Sébastiani à la bataille de Talavera de la Reina.
Par une froide nuit de blizzard de 1701, deux hommes cheminent en direction de la frontière séparant la Pologne de la Suède. Le premier est un voleur, un pauvre hère si dégouté de sa vie de misère qu’il a pris la résolution de s’engager dans les forges du Prince-archevêque, véritable enfer sur terre et refuge de tous les repris de justice du pays. Le second est un nobliau suédois ayant déserté les armées de Pologne pour rejoindre les forces du roi de Suède. Bien qu’ils n’aient rien en commun, la neige et la faim les ont réunis pour quelques heures et le sort s’apprête à leur jouer un bien mauvais tour : dans un moulin abandonné et hanté par le fantôme de son meunier suicidé, leurs deux destins vont bifurquer, empruntant des voies dramatiques et inattendues... Huit ans plus tard durant un hiver fort semblable à celui-ci, une fillette est visitée chaque nuit par le spectre de son père, un noble propriétaire pourtant parti guerroyer à des centaines de kilomètres de là. Quels liens, quelle toile de mensonges, d’intrigues et de traquenards habilement tramés unissent par-delà les années ces deux curieux événements ? C’est ce que « Le Cavalier Suédois » de Leo Perutz nous invite à découvrir.
On m’avait tant vanté ce roman que je n’ai pu m’empêcher de grommeler dans ma barbe en l’ouvrant pour la première fois : « Toi, mon gars, t’as intérêt à tenir tes promesses… » Béni soit le sieur Perutz, il a amplement répondu à mes attentes et je sors de cette lecture tout à fait enchantée ! Roman historique savamment saupoudré de fantastique, « Le Cavalier Suédois » est une œuvre pleine de charme et de mystère, dotée en sus d’une intrigue remarquablement construite, de celle qui nous mène du début à la fin par le bout du nez et ceci pour notre plus grand plaisir. L’histoire est délicieusement prenante, le style simple et poétique à la fois, le personnage principal attachant (malgré une moralité souvent déficiente et un très très gros complexe social), les dialogues spirituels et finement écrits, l’atmosphère mélancolique et envoutante… La présence du merveilleux est particulièrement bien dosée, imprégnant tout le récit sans jamais que celui-ci ne verse dans le fantastique pur et dur. Pour ne rien gâcher, les thématiques abordées ne manquent pas d’intérêt et de profondeur : impuissance des hommes face à la destinée, usurpation d’identité, culpabilité et quête de rédemption, ravages du désir et de la jalousie...
En conclusion, une belle fable, poétique et intrigante à souhait ! J’ai noté qu’une adaptation BD avait été réalisée par l'illustrateur Jean-Pierre Mourey et peut-être me laisserai-je tenter, mais ce sera après avoir parcouru le reste du l’œuvre du sieur Perutz. « Le Marquis de Bolibar » me tente particulièrement – les guerres napoléoniennes : miam miam !
On m’avait tant vanté ce roman que je n’ai pu m’empêcher de grommeler dans ma barbe en l’ouvrant pour la première fois : « Toi, mon gars, t’as intérêt à tenir tes promesses… » Béni soit le sieur Perutz, il a amplement répondu à mes attentes et je sors de cette lecture tout à fait enchantée ! Roman historique savamment saupoudré de fantastique, « Le Cavalier Suédois » est une œuvre pleine de charme et de mystère, dotée en sus d’une intrigue remarquablement construite, de celle qui nous mène du début à la fin par le bout du nez et ceci pour notre plus grand plaisir. L’histoire est délicieusement prenante, le style simple et poétique à la fois, le personnage principal attachant (malgré une moralité souvent déficiente et un très très gros complexe social), les dialogues spirituels et finement écrits, l’atmosphère mélancolique et envoutante… La présence du merveilleux est particulièrement bien dosée, imprégnant tout le récit sans jamais que celui-ci ne verse dans le fantastique pur et dur. Pour ne rien gâcher, les thématiques abordées ne manquent pas d’intérêt et de profondeur : impuissance des hommes face à la destinée, usurpation d’identité, culpabilité et quête de rédemption, ravages du désir et de la jalousie...
En conclusion, une belle fable, poétique et intrigante à souhait ! J’ai noté qu’une adaptation BD avait été réalisée par l'illustrateur Jean-Pierre Mourey et peut-être me laisserai-je tenter, mais ce sera après avoir parcouru le reste du l’œuvre du sieur Perutz. « Le Marquis de Bolibar » me tente particulièrement – les guerres napoléoniennes : miam miam !
JUDAS L'ORGUEILLEUX
Nous sommes en 1498, en plein basculement entre ce que les siècles futurs nommeront, par dédain et une certaine méconnaissance, "le moyen-âge", voire "les âges sombres" (chez les britanniques) et la belle renaissance italienne dont nous allons croiser l'une des figures parmi les plus universelles. C'est un prieur relativement mal embouché qui nous introduit en plein cœur de la cour de l'un des plus manifestes représentants de ces temps nouveaux, le fameux Ludovic Sforza, dit le More. Ce prieur est celui du couvent de dominicains Santa Maria delle Grazie, et il n'a de cesse de se plaindre auprès du célèbre duc de Milan. Il a payé le plus immense de tous les maîtres de son temps à peindre une Cène, or l'oeuvre reste inachevée. Pire : l'artiste semble franchement se désintéresser de sa commande, ne passant guère de temps devant le mur du réfectoire qu'il doit recouvrir de son génie, si ce n'est à bailler aux corneilles et à griffonner quelque mystère qui lui appartient, dans son carnet. L'artiste plaide avec intelligence et non sans un peu de rouerie qu'il ne pourra poursuivre son travail que lorsqu'il aura trouvé un modèle pour le personnage de Judas que ses plongées dans les bas-fonds de la ville ne lui ont pas permis de découvrir la figure du traître idéal. Car le génial Leonardo da Vinci, il ne pouvait s'agir que de lui, ne peut se contenter de découvrir une "gueule", il lui faut aussi peindre une âme, et celle de son futur Judas ne peut QUE ressembler à celle de l'homme le plus honni de toute la chrétienté.
Leo Perutz aimant désorienter son lecteur, Léonard est très vite abandonné à ses infructueuses pérégrinations. Nous voici dès lors sur les traces de Joachim Behaim, un commerçant étranger - il se prétend allemand tandis qu'il vient de Bohème : déjà, sous l'apparence honnête se déguise le mensonge - venu vendre des chevaux d'exception aux écuries du More. Il n'a plus rien à faire de particulier à Milan lorsque, au détour de ses déambulations dans les rues et places pleines de vie de la plus grande ville italienne de l'époque, il croise le regard d'une jeune femme dont il tombe, immédiatement, éperdument amoureux, ce sentiment paraissant, quoi que fort fugacement, partagé. le jeune homme, fier et même franchement orgueilleux, ne parvient à s'avouer qu'il devra demeurer en ville tant qu'il n'aura pas retrouvé cette confondante jeune femme (qui a laissé tomber son châle à ses pieds, avant de se perdre dans la foule). Ainsi, il va se souvenir, à bon compte, qu'un usurier local est encore en dette auprès de feu son père. Il n'aura dès lors de cesse de récupérer l'argent que son géniteur avait prêté à un vieil homme, un certain messire Boccetta. Ce dernier désir provoque l'hilarité ou la compassion : Boccetta, très riche sous son apparence de pauvreté, est le plus grand avare que la Terre ait jamais porté. Jamais on ne l'a vu rendre de l'argent aux naïfs à qui il en a emprunté. le lecteur, de même que Léonard, dans un premier temps, songe que Boccetta constituerait un modèle de Judas idéal, celui-ci ayant vendu le Christ pour trente deniers, somme dérisoire même au temps de cet Israël mythique sous domination romaine.
Leo Perutz est évidemment plus subtil que ce à quoi le lecteur pouvait s'attendre en lisant un tel (titre de) roman. le romancier tchèque aime perdre son lecteur, lui faire prendre des vessies pour mille lanternes. On peut même affirmer que rien ne le satisfait plus que de le promener ailleurs qu'en ces chemins tellement rassurant du roman classique. Il faut ainsi attendre la dernière partie du roman et un de ces basculements dont l'écrivain est friand pour relier les deux trames et comprendre le véritable sens de l'oeuvre. Comprendre que le génial Léonard - à travers l'un de ses disciples, dont il nous reste, entre autre, une reproduction sur toile de cette Cène qui a tant souffert des ravages du temps - est sans cesse présent. Comprendre qu'il scrute chaque parcelle de l'âme humaine, dans ce qu'elle a de plus magnifique, dans ce qu'elle a de plus ignominieux. Ainsi, cet amoureux - glacial - apparaît-il peu à peu comme l'être le plus calculateur qui puisse être. Et pourtant il est indéniable qu'il est amoureux. De même cette théorie de malandrins, d'artistes en devenir, de mathématiciens, de peintres sans le sous, de buveurs fantastiques peuvent-ils revêtir tous les attributs des pêcheurs - luxure, paresse, gourmandise, colère, avarice, envie - sans qu'aucun ne puisse être parfaitement impardonnable, ce qui ne peut-être le cas de ce jeune homme froid, calculateur, et qui finit par faire passer son orgueil bien avant l'amour - certainement sincère - qu'il éprouve pour la fille de son pire ennemi du moment.
Au-delà de la réflexion sur l'art, de l'impossibilité de créer sans attache avec la réalité, au-delà du cadre historique que traversent des peintres célèbres ou obscurs mais aussi la figure de François Villon (qu'on croise sans cesse et dont Perutz nous avoue en manière de postface qu'il fut le modèle d'un des personnages essentiels de cet ouvrage), c'est à une réflexion sur l'homme et sur le mal que nous convie une fois encore Leo Perutz. Le diable n'est jamais tout à fait là où on le cherche. Un malandrin peut se comporter comme un homme d'honneur. Et de la même manière, un supposé honnête homme peut avoir l'âme la plus noire. Le lecteur attentif notera également, vers la fin, ce passage où celui qui, pourtant devrait être le pire des hommes, poète à ses heures, meurt " réconcilié avec le Grand Tout, échappant à l'imperfection terrestre". Leo Perutz succombera peu de temps après avoir tracé les derniers mots de ce roman posthume.
Quant à nous, il est possible que nous n'en retiendrons pas l'oeuvre la plus sublime qui soit, ni même la plus convaincante parmi les créations de son auteur - que l'on songe à Le Cavalier suédois, à La troisième balle où encore à La nuit sous le pont de pierre, époustouflant , mais, comme à son habitude, et pour l'ultime fois, Leo Perutz aura su embarquer son lecteur au-delà des plates apparences, des certitudes faciles, des linéarités trop attendues, jouant un cache-cache incessant avec ses personnages tout autant qu'avec son lecteur. Rien que pour cela, sans oublier cette virtualité stylistique permanente, incroyable, dont il fit toujours preuve, Leo Perutz est inimitable !
Nous sommes en 1498, en plein basculement entre ce que les siècles futurs nommeront, par dédain et une certaine méconnaissance, "le moyen-âge", voire "les âges sombres" (chez les britanniques) et la belle renaissance italienne dont nous allons croiser l'une des figures parmi les plus universelles. C'est un prieur relativement mal embouché qui nous introduit en plein cœur de la cour de l'un des plus manifestes représentants de ces temps nouveaux, le fameux Ludovic Sforza, dit le More. Ce prieur est celui du couvent de dominicains Santa Maria delle Grazie, et il n'a de cesse de se plaindre auprès du célèbre duc de Milan. Il a payé le plus immense de tous les maîtres de son temps à peindre une Cène, or l'oeuvre reste inachevée. Pire : l'artiste semble franchement se désintéresser de sa commande, ne passant guère de temps devant le mur du réfectoire qu'il doit recouvrir de son génie, si ce n'est à bailler aux corneilles et à griffonner quelque mystère qui lui appartient, dans son carnet. L'artiste plaide avec intelligence et non sans un peu de rouerie qu'il ne pourra poursuivre son travail que lorsqu'il aura trouvé un modèle pour le personnage de Judas que ses plongées dans les bas-fonds de la ville ne lui ont pas permis de découvrir la figure du traître idéal. Car le génial Leonardo da Vinci, il ne pouvait s'agir que de lui, ne peut se contenter de découvrir une "gueule", il lui faut aussi peindre une âme, et celle de son futur Judas ne peut QUE ressembler à celle de l'homme le plus honni de toute la chrétienté.
Leo Perutz aimant désorienter son lecteur, Léonard est très vite abandonné à ses infructueuses pérégrinations. Nous voici dès lors sur les traces de Joachim Behaim, un commerçant étranger - il se prétend allemand tandis qu'il vient de Bohème : déjà, sous l'apparence honnête se déguise le mensonge - venu vendre des chevaux d'exception aux écuries du More. Il n'a plus rien à faire de particulier à Milan lorsque, au détour de ses déambulations dans les rues et places pleines de vie de la plus grande ville italienne de l'époque, il croise le regard d'une jeune femme dont il tombe, immédiatement, éperdument amoureux, ce sentiment paraissant, quoi que fort fugacement, partagé. le jeune homme, fier et même franchement orgueilleux, ne parvient à s'avouer qu'il devra demeurer en ville tant qu'il n'aura pas retrouvé cette confondante jeune femme (qui a laissé tomber son châle à ses pieds, avant de se perdre dans la foule). Ainsi, il va se souvenir, à bon compte, qu'un usurier local est encore en dette auprès de feu son père. Il n'aura dès lors de cesse de récupérer l'argent que son géniteur avait prêté à un vieil homme, un certain messire Boccetta. Ce dernier désir provoque l'hilarité ou la compassion : Boccetta, très riche sous son apparence de pauvreté, est le plus grand avare que la Terre ait jamais porté. Jamais on ne l'a vu rendre de l'argent aux naïfs à qui il en a emprunté. le lecteur, de même que Léonard, dans un premier temps, songe que Boccetta constituerait un modèle de Judas idéal, celui-ci ayant vendu le Christ pour trente deniers, somme dérisoire même au temps de cet Israël mythique sous domination romaine.
Leo Perutz est évidemment plus subtil que ce à quoi le lecteur pouvait s'attendre en lisant un tel (titre de) roman. le romancier tchèque aime perdre son lecteur, lui faire prendre des vessies pour mille lanternes. On peut même affirmer que rien ne le satisfait plus que de le promener ailleurs qu'en ces chemins tellement rassurant du roman classique. Il faut ainsi attendre la dernière partie du roman et un de ces basculements dont l'écrivain est friand pour relier les deux trames et comprendre le véritable sens de l'oeuvre. Comprendre que le génial Léonard - à travers l'un de ses disciples, dont il nous reste, entre autre, une reproduction sur toile de cette Cène qui a tant souffert des ravages du temps - est sans cesse présent. Comprendre qu'il scrute chaque parcelle de l'âme humaine, dans ce qu'elle a de plus magnifique, dans ce qu'elle a de plus ignominieux. Ainsi, cet amoureux - glacial - apparaît-il peu à peu comme l'être le plus calculateur qui puisse être. Et pourtant il est indéniable qu'il est amoureux. De même cette théorie de malandrins, d'artistes en devenir, de mathématiciens, de peintres sans le sous, de buveurs fantastiques peuvent-ils revêtir tous les attributs des pêcheurs - luxure, paresse, gourmandise, colère, avarice, envie - sans qu'aucun ne puisse être parfaitement impardonnable, ce qui ne peut-être le cas de ce jeune homme froid, calculateur, et qui finit par faire passer son orgueil bien avant l'amour - certainement sincère - qu'il éprouve pour la fille de son pire ennemi du moment.
Au-delà de la réflexion sur l'art, de l'impossibilité de créer sans attache avec la réalité, au-delà du cadre historique que traversent des peintres célèbres ou obscurs mais aussi la figure de François Villon (qu'on croise sans cesse et dont Perutz nous avoue en manière de postface qu'il fut le modèle d'un des personnages essentiels de cet ouvrage), c'est à une réflexion sur l'homme et sur le mal que nous convie une fois encore Leo Perutz. Le diable n'est jamais tout à fait là où on le cherche. Un malandrin peut se comporter comme un homme d'honneur. Et de la même manière, un supposé honnête homme peut avoir l'âme la plus noire. Le lecteur attentif notera également, vers la fin, ce passage où celui qui, pourtant devrait être le pire des hommes, poète à ses heures, meurt " réconcilié avec le Grand Tout, échappant à l'imperfection terrestre". Leo Perutz succombera peu de temps après avoir tracé les derniers mots de ce roman posthume.
Quant à nous, il est possible que nous n'en retiendrons pas l'oeuvre la plus sublime qui soit, ni même la plus convaincante parmi les créations de son auteur - que l'on songe à Le Cavalier suédois, à La troisième balle où encore à La nuit sous le pont de pierre, époustouflant , mais, comme à son habitude, et pour l'ultime fois, Leo Perutz aura su embarquer son lecteur au-delà des plates apparences, des certitudes faciles, des linéarités trop attendues, jouant un cache-cache incessant avec ses personnages tout autant qu'avec son lecteur. Rien que pour cela, sans oublier cette virtualité stylistique permanente, incroyable, dont il fit toujours preuve, Leo Perutz est inimitable !
SOMMES NOUS VRAIMENT CE QUE NOUS SOMMES ?
Entamer un roman de Leo Perutz, c'est à coup sûr se retrouver dans une autre part de soi, de nous. C'est aller au-delà du vraisemblant tout en s'escrimant à y rester inconfortablement accroché. La Neige de saint Pierre ne déroge pas à cette règle, qui nous emmène aux confins de la réalité et du rêve, entre certitudes et questionnements, entre manipulation et expérimentation, entre conviction et doute.
Et la confrontation violente de tous ces antagonismes, le jeune médecin Georg Friedrich Amberg va l'éprouver dès les premières pages de ce roman confession, tandis qu'il reprend ses esprits dans un hôpital où il est convaincu s'être retrouvé suite à une véritable scène de pugilat et de révolte - au cours de laquelle il est persuadé avec récolté une balle qui ne lui était pas destinée - scène d'émeute qui aurait eu lieu moins d'une semaine auparavant, en cette fin janvier neigeuse, tandis que les praticiens qui l'entourent, en particulier un ancien collègue de recherche, ne cessent de lui affirmer qu'il est là depuis un peu plus de cinq semaines suite à un malheureux accident de la circulation au cours duquel il a bien failli perdre la vie !
Bien évidemment, Amberg est persuadé détenir la vérité, SA vérité. Alors, dans le silence de sa chambre d’hôpital, tout juste troublé par les soins qu'il doit subir, ainsi que par les regards en biais d'un homme qu'il est certain de reconnaître comme étant l'un des principaux protagoniste de cette étrange affaire - un prince russe en exil et réduit à la misère comme nombre de ses semblables depuis la révolution bolchevique, nommé Praxatine -, Georg Friedrich tâche de se remémorer les événements des supposés jours derniers.
Il se souvient de son existence et de ses études berlinoises, la médecine, entamée sans vocation sur les injonctions de la tante qui l'a recueilli après le décès prématuré de son père, un historien connu mais vivant chichement. De sa rencontre, dans un centre de recherche, d'avec une belle et fascinante jeune femme d'origine grecque, Kallisto Tsanaris, surnommée Bibiche. De son départ plus ou moins précipité de Berlin où il ne trouve pas de clientèle, étant parfaitement désargenté, pour une offre d'emploi obtenue sans grand engouement au cœur d'un petit village perdu de la triste campagne de Westphalie, non loin d'Osnabrück.
Là l'y attendent le baron von Malchin, une ancienne et étrange connaissance de son père, le fameux Prince russe devenu son régisseur, cette Bibiche tant chérie - de manière parfaitement platonique et secrète - par le jeune médecin et requise dans cette aventure pour ses connaissances en biologie, un vieux curé débonnaire mais sans force, un instituteur complotiste, une populace pauvre, sans grand rêve ni désir, la fille du baron, malade de la scarlatine et d'une constitution fragile (que l'on verra fort peu), et de son fils adoptif, Frederico, supposé être l'ultime descendant direct de l'empereur Frédéric II.
Permettez une petite digression historique : mort en 1250, Frédéric II fut un régnant hors du commun au point qu'il fut surnommé, entre autre, la « Stupeur du monde ». Aucun de ses fils ne parvenant à reprendre sa succession, il sera le dernier empereur Hohenstaufen du Saint Empire Romain Germanique. Après son décès se profila ce qu'on appellera le "Grand interrègne", laissant place à une lutte sans merci entre les guelfe et les gibelins - à laquelle se mêlèrent activement les papes d'alors, contre les Hohenstaufen - et à la fin duquel ce fut la famille des Habsbourg qui se retrouva sur le trône impérial. Même si ce n'est qu'en filigrane dans le roman de Leo Perutz, et méconnu des français, cette idée de rétablir un grand Reich originel et supposé pur et parfait, sur une base totalement fantasmatique, abracadabrante, était assurément d'une parfaite limpidité aux yeux du lecteur germanophone et, bien entendu, des autorités nazis en Allemagne. Un exemple de plus de cet humour fin mais très grinçant qu'affectionnait tant le pragois...
Si ce Frederico, descendant supposé bien que terriblement lointain de son homonyme germanique a été adopté par ce baron un peu dérangé c'est que ce dernier espère lui redonner son trône ! Pour se faire, il veut manipuler les foules afin qu'elles retrouvent le niveau de foi religieuse qu'elle connaissait en ces temps immémoriaux et médiévaux. Mais si le baron est pris d'une idée fixe, il n'est pas totalement fou : il sait bien que son époque est top légère, trop frivole pour retrouver la foi "pure" des ancêtres. Aussi espère-t-il produire cet intangible renouveau spirituel par le biais d'une substance chimique, La Neige de saint Pierre, encore appelée ailleurs "le moine mendiant", la "moisissure de saint Jean" ou encore "le feu de la Sainte Vierge"...!
Cette moisissure, ce champignon microscopique, s’amalgamant à la farine du blé dont elle était issue, aurait provoqué de véritable crises mystiques à grande échelle et c'est donc ce que le baron, malgré la désapprobation définitive de son ami le curé du village - qui craint plutôt l'émergence de Moloch, la foi ne pouvant être pour lui que le fruit d'une longue recherche intime - souhaite faire renaître afin de recréer de toute pièce, et par la volonté d'une populace sous dopant, l'antique Saint Empire...
Au passage, il est fort probable que Leo Perutz se soit inspiré des ravages longtemps causés par un autre champignon parasite, l'ergot du seigle, qui rendait "fou" ceux qui en avaient ingurgité. Le surnom donné à ce mal était "mal des ardents" ou "feu de saint Antoine", bien entendu attribué à de la sorcellerie ou à des pouvoirs démoniaques. Faisant à nouveau jouer son sens de l'humour indémontable, l'auteur du roman "Le Maître du Jugement dernier" inverse ainsi les valeurs, transformant donc une moisissure qui fit jadis des centaines de milliers de morts en bénédiction pour la foi, se moquant finalement de tout cela avec un rire que l'on imagine aussi discret qu'immensément sarcastique. Cet homme-là est -
généreusement - diabolique ! Notons au passage que la substance présente dans cet ergot est un des composant du... LSD !
Sans en donner les détails, au risque de trop en divulguer, est-il utile de préciser que le résultat des recherches du baron ne sera non seulement pas à la hauteur de ses espérances absurdes mais qu'elles provoqueront même, en quelque sorte, son exact contraire...
Et Amberg de se retrouver une fois encore confronté à ses médecins qui lui affirment sans trêve, les yeux dans les yeux, que tout ce qu'il pense avoir vécu n'a pu arriver puisqu’il est là depuis plus de cinq semaines, qu'il n'est jamais allé plus loin que le parvis de la gare d'Osnabrück, qu'une telle émeute aurait fait grand bruit, etc.
Comme chaque fois avec Leo Perutz, souvent comparé à Kafka pour certains aspects de leurs œuvres (dont il partage aussi une même ville d'origine : Prague, et même un premier emploi dans la même compagnie d'assurance !), il n'y a jamais qu'un tout petit fil tendu entre la réalité et, plutôt que ce que l'on pourrait qualifier de rêve, une sorte de réalité alternative et concomitante.
Car si ce roman intrigant, décalé, au rythme sans doute moins époustouflant, moins échevelé que son texte probablement le plus connu en France, Le Cavalier suédois, retient autant l'attention du lecteur, c'est que, par son tempo d'abord faussement alangui mais nous dirigeant imperceptiblement vers une forme de climax irrépressible - n'a-t-on pas affaire aux souvenirs d'abord hésitants d'un convalescent ? -, par la forme narrative employée, digne des meilleurs polars, par cette sensation d'inconfort permanent, mais jubilatoire, dans lequel il fait mariner le lecteur, il nous plonge au beau milieu d'une double manipulation : Celle voulue par un seul sur l'ensemble d'une population, celle d'un petit groupe de gens de l'art sur l'esprit d'un seul. Ainsi surgit cette question transcendantale, métempirique : Ce que je vis, ou crois vivre, ou encore me souvenir est-elle la "Vraie" vie, la seule possible puisque je l'ai personnellement ressentie, intériorisée, expérimentée, ou bien celles perçues par l'entourage, parfois totalement antagoniste avec ma propre perception sont-elles plus vraies, plus exactes ? Ne sommes-nous pas simplement les rêves d'un autre ? Ou bien, a contrario, les êtres qui m’entourent ne prennent-ils vie que par ma propre volonté...? Ces questions, bien plus cruciales qu'elles ne peuvent le sembler dans un monde pourtant pas encore "virtuel" alors, fait de connexions instantanées mais physiquement invérifiables, comme celui que nous connaissons aujourd'hui, préfigurent bien les interrogations que se poseront plus tard un Philip K. Dick, dans le domaine de la Science Fiction, par exemple, mais aussi, dans une certaine mesure, rejoint ce qu'Albert Einstein affirmait, que la réalité n'est qu'une illusion, ou encore certains travaux d'Edgar Morin en philosophie.
Il serait injuste de ne pas aussi rappeler que cet ouvrage, paru en 1933, fut aussitôt interdit en Allemagne nouvellement nazie. A la lumière de ce que nous venons de voir - manipulation à grande échelle par un petit nombre, esprits faibles subjugués, références moqueuses au premier Reich dont le IIIème se réclamait évidemment, etc. Sans oublier les origines juives de son auteur, même si les grandes lois antisémites ne sont pas encore toutes en place - il ne pouvait en aller autrement.
Un autre aspect du roman mérite qu'on s'y arrête un instant : celui, tourné en un certain ridicule, de la foi, des croyances, de la religion pour lesquelles il suffirait donc d'un genre de LSD pour lui (re)donner toute l'énergie voulue. Mais aussi, la foi comme ultime ressource quand on a plus rien. Et puis, ultime clin d’œil de Leo Perutz, difficile à évoquer en détail ici sans risquer de "divulgâcher" - comme on dit, parait-il, au Québec -, la foi, n'importe quelle, comme éternel opium du peuple. Un opium fonctionnant sous dope...? L'humour sarcastique et à tiroirs multiples de cet immense écrivain de la Mittel Europa de l'entre deux guerres (il ne publiera quasiment plus rien après son installation en Palestine en 1938, jusqu'à son décès en 1954) est lui aussi une arme de destruction massive de nos certitudes, de nos faiblesses, de nos fausses idoles et de nos aberrations : Lire Perutz, c'est tout simplement Jubilatoire !
Entamer un roman de Leo Perutz, c'est à coup sûr se retrouver dans une autre part de soi, de nous. C'est aller au-delà du vraisemblant tout en s'escrimant à y rester inconfortablement accroché. La Neige de saint Pierre ne déroge pas à cette règle, qui nous emmène aux confins de la réalité et du rêve, entre certitudes et questionnements, entre manipulation et expérimentation, entre conviction et doute.
Et la confrontation violente de tous ces antagonismes, le jeune médecin Georg Friedrich Amberg va l'éprouver dès les premières pages de ce roman confession, tandis qu'il reprend ses esprits dans un hôpital où il est convaincu s'être retrouvé suite à une véritable scène de pugilat et de révolte - au cours de laquelle il est persuadé avec récolté une balle qui ne lui était pas destinée - scène d'émeute qui aurait eu lieu moins d'une semaine auparavant, en cette fin janvier neigeuse, tandis que les praticiens qui l'entourent, en particulier un ancien collègue de recherche, ne cessent de lui affirmer qu'il est là depuis un peu plus de cinq semaines suite à un malheureux accident de la circulation au cours duquel il a bien failli perdre la vie !
Bien évidemment, Amberg est persuadé détenir la vérité, SA vérité. Alors, dans le silence de sa chambre d’hôpital, tout juste troublé par les soins qu'il doit subir, ainsi que par les regards en biais d'un homme qu'il est certain de reconnaître comme étant l'un des principaux protagoniste de cette étrange affaire - un prince russe en exil et réduit à la misère comme nombre de ses semblables depuis la révolution bolchevique, nommé Praxatine -, Georg Friedrich tâche de se remémorer les événements des supposés jours derniers.
Il se souvient de son existence et de ses études berlinoises, la médecine, entamée sans vocation sur les injonctions de la tante qui l'a recueilli après le décès prématuré de son père, un historien connu mais vivant chichement. De sa rencontre, dans un centre de recherche, d'avec une belle et fascinante jeune femme d'origine grecque, Kallisto Tsanaris, surnommée Bibiche. De son départ plus ou moins précipité de Berlin où il ne trouve pas de clientèle, étant parfaitement désargenté, pour une offre d'emploi obtenue sans grand engouement au cœur d'un petit village perdu de la triste campagne de Westphalie, non loin d'Osnabrück.
Là l'y attendent le baron von Malchin, une ancienne et étrange connaissance de son père, le fameux Prince russe devenu son régisseur, cette Bibiche tant chérie - de manière parfaitement platonique et secrète - par le jeune médecin et requise dans cette aventure pour ses connaissances en biologie, un vieux curé débonnaire mais sans force, un instituteur complotiste, une populace pauvre, sans grand rêve ni désir, la fille du baron, malade de la scarlatine et d'une constitution fragile (que l'on verra fort peu), et de son fils adoptif, Frederico, supposé être l'ultime descendant direct de l'empereur Frédéric II.
Permettez une petite digression historique : mort en 1250, Frédéric II fut un régnant hors du commun au point qu'il fut surnommé, entre autre, la « Stupeur du monde ». Aucun de ses fils ne parvenant à reprendre sa succession, il sera le dernier empereur Hohenstaufen du Saint Empire Romain Germanique. Après son décès se profila ce qu'on appellera le "Grand interrègne", laissant place à une lutte sans merci entre les guelfe et les gibelins - à laquelle se mêlèrent activement les papes d'alors, contre les Hohenstaufen - et à la fin duquel ce fut la famille des Habsbourg qui se retrouva sur le trône impérial. Même si ce n'est qu'en filigrane dans le roman de Leo Perutz, et méconnu des français, cette idée de rétablir un grand Reich originel et supposé pur et parfait, sur une base totalement fantasmatique, abracadabrante, était assurément d'une parfaite limpidité aux yeux du lecteur germanophone et, bien entendu, des autorités nazis en Allemagne. Un exemple de plus de cet humour fin mais très grinçant qu'affectionnait tant le pragois...
Si ce Frederico, descendant supposé bien que terriblement lointain de son homonyme germanique a été adopté par ce baron un peu dérangé c'est que ce dernier espère lui redonner son trône ! Pour se faire, il veut manipuler les foules afin qu'elles retrouvent le niveau de foi religieuse qu'elle connaissait en ces temps immémoriaux et médiévaux. Mais si le baron est pris d'une idée fixe, il n'est pas totalement fou : il sait bien que son époque est top légère, trop frivole pour retrouver la foi "pure" des ancêtres. Aussi espère-t-il produire cet intangible renouveau spirituel par le biais d'une substance chimique, La Neige de saint Pierre, encore appelée ailleurs "le moine mendiant", la "moisissure de saint Jean" ou encore "le feu de la Sainte Vierge"...!
Cette moisissure, ce champignon microscopique, s’amalgamant à la farine du blé dont elle était issue, aurait provoqué de véritable crises mystiques à grande échelle et c'est donc ce que le baron, malgré la désapprobation définitive de son ami le curé du village - qui craint plutôt l'émergence de Moloch, la foi ne pouvant être pour lui que le fruit d'une longue recherche intime - souhaite faire renaître afin de recréer de toute pièce, et par la volonté d'une populace sous dopant, l'antique Saint Empire...
Au passage, il est fort probable que Leo Perutz se soit inspiré des ravages longtemps causés par un autre champignon parasite, l'ergot du seigle, qui rendait "fou" ceux qui en avaient ingurgité. Le surnom donné à ce mal était "mal des ardents" ou "feu de saint Antoine", bien entendu attribué à de la sorcellerie ou à des pouvoirs démoniaques. Faisant à nouveau jouer son sens de l'humour indémontable, l'auteur du roman "Le Maître du Jugement dernier" inverse ainsi les valeurs, transformant donc une moisissure qui fit jadis des centaines de milliers de morts en bénédiction pour la foi, se moquant finalement de tout cela avec un rire que l'on imagine aussi discret qu'immensément sarcastique. Cet homme-là est -
généreusement - diabolique ! Notons au passage que la substance présente dans cet ergot est un des composant du... LSD !
Sans en donner les détails, au risque de trop en divulguer, est-il utile de préciser que le résultat des recherches du baron ne sera non seulement pas à la hauteur de ses espérances absurdes mais qu'elles provoqueront même, en quelque sorte, son exact contraire...
Et Amberg de se retrouver une fois encore confronté à ses médecins qui lui affirment sans trêve, les yeux dans les yeux, que tout ce qu'il pense avoir vécu n'a pu arriver puisqu’il est là depuis plus de cinq semaines, qu'il n'est jamais allé plus loin que le parvis de la gare d'Osnabrück, qu'une telle émeute aurait fait grand bruit, etc.
Comme chaque fois avec Leo Perutz, souvent comparé à Kafka pour certains aspects de leurs œuvres (dont il partage aussi une même ville d'origine : Prague, et même un premier emploi dans la même compagnie d'assurance !), il n'y a jamais qu'un tout petit fil tendu entre la réalité et, plutôt que ce que l'on pourrait qualifier de rêve, une sorte de réalité alternative et concomitante.
Car si ce roman intrigant, décalé, au rythme sans doute moins époustouflant, moins échevelé que son texte probablement le plus connu en France, Le Cavalier suédois, retient autant l'attention du lecteur, c'est que, par son tempo d'abord faussement alangui mais nous dirigeant imperceptiblement vers une forme de climax irrépressible - n'a-t-on pas affaire aux souvenirs d'abord hésitants d'un convalescent ? -, par la forme narrative employée, digne des meilleurs polars, par cette sensation d'inconfort permanent, mais jubilatoire, dans lequel il fait mariner le lecteur, il nous plonge au beau milieu d'une double manipulation : Celle voulue par un seul sur l'ensemble d'une population, celle d'un petit groupe de gens de l'art sur l'esprit d'un seul. Ainsi surgit cette question transcendantale, métempirique : Ce que je vis, ou crois vivre, ou encore me souvenir est-elle la "Vraie" vie, la seule possible puisque je l'ai personnellement ressentie, intériorisée, expérimentée, ou bien celles perçues par l'entourage, parfois totalement antagoniste avec ma propre perception sont-elles plus vraies, plus exactes ? Ne sommes-nous pas simplement les rêves d'un autre ? Ou bien, a contrario, les êtres qui m’entourent ne prennent-ils vie que par ma propre volonté...? Ces questions, bien plus cruciales qu'elles ne peuvent le sembler dans un monde pourtant pas encore "virtuel" alors, fait de connexions instantanées mais physiquement invérifiables, comme celui que nous connaissons aujourd'hui, préfigurent bien les interrogations que se poseront plus tard un Philip K. Dick, dans le domaine de la Science Fiction, par exemple, mais aussi, dans une certaine mesure, rejoint ce qu'Albert Einstein affirmait, que la réalité n'est qu'une illusion, ou encore certains travaux d'Edgar Morin en philosophie.
Il serait injuste de ne pas aussi rappeler que cet ouvrage, paru en 1933, fut aussitôt interdit en Allemagne nouvellement nazie. A la lumière de ce que nous venons de voir - manipulation à grande échelle par un petit nombre, esprits faibles subjugués, références moqueuses au premier Reich dont le IIIème se réclamait évidemment, etc. Sans oublier les origines juives de son auteur, même si les grandes lois antisémites ne sont pas encore toutes en place - il ne pouvait en aller autrement.
Un autre aspect du roman mérite qu'on s'y arrête un instant : celui, tourné en un certain ridicule, de la foi, des croyances, de la religion pour lesquelles il suffirait donc d'un genre de LSD pour lui (re)donner toute l'énergie voulue. Mais aussi, la foi comme ultime ressource quand on a plus rien. Et puis, ultime clin d’œil de Leo Perutz, difficile à évoquer en détail ici sans risquer de "divulgâcher" - comme on dit, parait-il, au Québec -, la foi, n'importe quelle, comme éternel opium du peuple. Un opium fonctionnant sous dope...? L'humour sarcastique et à tiroirs multiples de cet immense écrivain de la Mittel Europa de l'entre deux guerres (il ne publiera quasiment plus rien après son installation en Palestine en 1938, jusqu'à son décès en 1954) est lui aussi une arme de destruction massive de nos certitudes, de nos faiblesses, de nos fausses idoles et de nos aberrations : Lire Perutz, c'est tout simplement Jubilatoire !
FATALITAS !
«La fatalité, c'est ce que nous voulons» affirmait sans l'ombre d'une hésitation le romancier et essayiste bourguignon Romain Rolland. Si le héros malheureux du roman le Cavalier suédois eût sans aucun doute rejeté de toutes ses forces - de toute son âme - une telle allégation, son créateur, l'écrivain pragois de langue allemande Leo Perutz, ne l'aurait certainement pas déniée.
De quoi s'agit-il donc ici ? Par l'entremise d'un prologue, un narrateur anonyme se substitue brutalement à une mémorialiste, enchâssant ainsi l'histoire qu'il va nous conter à l'intérieur de la sienne, procédant ainsi dès les première pages à ce qui fera l'un des thèmes majeurs du texte : l'imposture. Et il entame ainsi son propos :
«C'est l'histoire de deux hommes, lesquels se rencontrèrent dans une grange, un jour de l'hiver 1701 où il gelait à pierre fendre. Ils y scellèrent un pacte d'amitié. Après quoi tous deux cheminèrent de compagnie, sur la route qui va d'Opole jusqu'à la frontière de Pologne, à travers les campagnes enneigées de Silésie.»
Le décors est ainsi succinctement planté, mais il y manque tout de même quelques détails d'importance. Ainsi, notre premier larron, le jeune Christian von Tornefeld, noble suédois de petite extraction, est en fuite et recherché pour désertion après avoir giflé son supérieur qui avait proféré quelque malheureuse parole à l'encontre du Roi Charles XII de Suède dont il souhaite rejoindre les troupes afin de s'y faire une réputation, un prénom (son aïeul sauva la vie à un précédent Roi de Suède), mais sans y laisser trop de plumes, notre jeune homme étant aussi pédant et prétentieux, même dans l'affliction, qu'il est pusillanime. Le second n'a ni nom ni prénom, tout juste un sobriquet : Piège-à-Poule ! C'est un voleur misérable et sans envergure, vivotant de petits larcins, recherché cependant par les Dragons afin de le mener au gibet - punition fort fâcheuse et généralement définitive qui attend aussi le jeune freluquet -, et qui s'est résolu à abandonner sa liberté pour mener une vie de forçat consentant dans les mines du Prince-Évêque local, surnommé «l'ambassadeur du Diable». Le diable, d'ailleurs, n'est jamais bien éloigné de notre histoire ébouriffante, les pas de nos deux fuyards croisant celui d'un meunier des plus funestes et mystérieux, réputé suicidé, qui s'annonce plus simplement comme le recruteur de l'évêque et qui mettrait bien la main pour son maître sur ce chapardeur, étique mais bien bâti. Le jeune homme de son côté, s'accrochant à cette idée fixe de rejoindre les troupes de son roi, s'aperçoit qu'ils sont proches des terres de son riche parrain, père de la jeune fille à laquelle il avait jadis promis le mariage. Cependant, aussi arrogant que peu courageux, il missionne son compagnon de fortune afin qu'il demande aide, or et vêtements à ce noble de province. Mal lui en prend car, accomplissant parfaitement sa mission, Piège-à-Poule va apprendre que l'ancien maître est mort, que les gens de ferme, de l'intendant au plus simple des valets de basse-cour, profitent abondamment de la situation pour ruiner cette anciennement riche demeure, qu'un vieux bougre de bouffi nobliau local, usurier et avare, contribue à ruiner par toute une série de prêts à taux honteux, acculant la jeune et candide héritière à sa perte (dans l'espoir avoué de la pousser au mariage) et que le jeune freluquet que le filou a promit d'aider est toujours dans le cœur de la belle.
L'idée, fatale, peut naître : par tous les moyens possibles, il prendra la place du jouvenceau, rachètera les terres du château, éconduira tous les profiteurs du dernier manant au gros seigneur, se fera aimer de la charmante héritière et l'épousera. Mais demeure toutefois un problème majeur... C'est qu'il n'est pas Christian von Tornefeld ! C'est avec un art consommé de la rouerie, d'une intelligence et d'une vivacité certaine, d'un sens profond de l'auto-justification de ses actes - les bons comme les mauvais - que notre indigent va parvenir à ses fins, réussissant par ruse à envoyer le (vrai) cavalier suédois dans les mines de l'enfer, s'enrichissant en accomplissant un genre de vol auquel nul n'avait songé avant lui - par crainte de la punition divine - à savoir le cambriolage des biens précieux, statues dorées, ciboires d'argent et autres reliquaires présents dans le saint des saints des églises de la région. Il sauvera ainsi la belle ingénue des griffes de son Harpagon, l'épousant et lui donnant dans la foulée une fille, qu'il adore comme sa vie, et sans doute bien plus encore. Mais la destinée veille. La fatalité ne peut laisser celui s'étant substitué à un autre vieillir tranquillement et mourir, satisfait, dans son lit entouré des siens. Et la chute est aussi fracassante, diabolique, irréversible que l'élévation fut rapide et évidente. Le lecteur le pressent dès l'émergence de l'idée machiavélique mais il espère tout de même jusqu'au bout une rémission... pour services rendus !
Il ne faut que quelques pages pour se laisser totalement embarquer par le Cavalier suédois dont l'auteur lui-même estimait que c'était sa meilleure réussite, son oeuvre la mieux accomplie. En fait d'accomplissement, c'est effectivement une pure merveille.
Qu'on en juge un peu : L'ouvrage peut se lire comme un pur roman picaresque - ce personnage de Piège-à-poule en est une espèce de parangon, un miséreux magnifique, un indigent rusé comme goupil et, s'il n'a pas froid aux yeux, si sa morale personnelle n'est pas dans les clous habituels, ses méfaits semblent assez rapidement aussi justifiables que les actes d'une immoralité insupportable, toute légale, que mène le bal des hypocrites, ces nobles ou ces prélats qui sont à la fois les maîtres, les diseurs de loi et les exploiteurs de ce monde sans pitié ni honneur véritable (il est évident que la description de Leo Perutz de ce monde supposément ancien n'est en rien gratuite). En un mot comme en cent, on fini très rapidement par s'y attacher à cet archétype de déclassé, même si l'on peine à oublier totalement la faute originelle. On est indéniablement dans la lignée de ces romans ébouriffants comme le Diable boiteux de Velez de Guevara, le Paysan parvenu du français Marivaux ou encore du fabuleux Manuscrit trouvé à Saragosse de Jan Potocki (que l'on peut aussi classer dans le genre "gothique").
Si le Cavalier suédois n'est pas à proprement parler un roman historique, les rappels incessants à ce que fut "La Grande Guerre du Nord" au début du XVIIIème, mettant aux prises, pour aller très vite, la Russie et ses alliés polonais, Danois ainsi que certains états allemands contre l'Empire Suédois hégémonique de l'époque donne une saveur, une couleur qui plaira assurément aux amateurs du genre.
Roman pour partie fantastique aussi, il semble parfois faire un hommage discret mais appuyé aux romans gothiques allemands du début du XIXème. N'y croise-t-on pas un meunier maléfique, ancien suicidé, dont on ne sait s'il dit vrai lorsqu'il affirme avoir été sauvé in extremis de son acte maudit de Dieu, mais qui, depuis, est redevable à l'évêque de ce sauvetage, cherchant et trouvant sans fin de futurs hommes de charge promis à une vie infernale ? Leo Perutz est bien top malin lui-même pour sombrer dans un fantastique de pacotille, qui s'exhiberait avec force magie ou autres manifestations d'épouvante inutiles, grotesques. Son fantastique à lui est presque crédible. Il laisse au lecteur la possibilité de croire à la présence physique réelle, directe ainsi que le jeune gentilhomme conçoit l'apparition tranquille de ce valet supposé des enfers par d'aucuns. Tandis que c'est l'homme perdu, à l'existence déjà riche d'expérience mais sans verni culturel et qui ne cache pourtant pas une foi à géométrie très variable, qui s'avérera le plus superstitieux ou, selon l'interprétation qu'on en veut, le plus ouvert à la présence des incarnations d'un autre monde. Pour autant, c'est le jeune prétentieux qui apparaîtra le plus crédule des deux hommes aux yeux du lecteur, et pour son plus grand malheur.
Roman métaphysique, enfin - n'oublions pas que Leo Perutz était juif, dans un monde, la Mittel Europa de l'entre-deux guerres, où l'on entendait gronder ce Léviathan bien vivant, monstrueux de l'Allemagne Nazie (la première publication de ce texte date de 1936) -, qui nous parle de destin, de faute, de fatalité, du rachat de l'ignominie par toutes les souffrances possibles jusqu'à la mort expiatrice (thème chrétien s'il en est mais Perutz n'était-il pas à la rédaction d'un ultime texte intitulé le Judas de Léonard, signe que ce thème revêt une importance capitale tout au long de son oeuvre ?), de la tragédie ontologique de l'homme (du moins dans l'univers perutzien) confronté à un dilemme, à un paradoxe éternel et insoluble, d'être à la fois maître de son libre-arbitre et entièrement à la merci de l'omnipotence divine.
Accessoirement sans doute, mais certainement pas en vain, c'est enfin une histoire d'amour tragique ainsi qu'un magnifique témoignage d'amour d'un père pour son enfant. Ceci est très loin d'en être le thème essentiel, mais c'est un aspect suffisamment peu présent ailleurs, dans la littérature dite "classique" pour se permettre de le signaler.
Cette multiplicité de niveaux de lecture et de sujets, du roman d'aventure picaresques complètement échevelé et jubilatoire à la réflexion la plus profonde sur le sens de l'existence humaine et ses ressorts, porte indéniablement ce roman très haut au panthéon des ouvrages incontournables du XXème siècle. Celui que Jorge-Luis Borges surnommait le "Kafka aventureux" est un maître du style, de la forme, du suspense dont la lecture est d'un dépaysement grisant, salutaire, d'une vivacité inouï, d'un rythme trépident et sauvage. C'est plein de révérences et pourtant parfaitement original. C'est d'une absolue évidence de lecture et pourtant d'une complexité d'analyse impressionnante, mais sans la moindre lourdeur. On ne s'y ennuie tellement pas le moindre instant (ce qui est finalement plus rare qu'il y parait, même avec certains "grands" livres) qu'à peine est-il refermé... On en redemande !
«La fatalité, c'est ce que nous voulons» affirmait sans l'ombre d'une hésitation le romancier et essayiste bourguignon Romain Rolland. Si le héros malheureux du roman le Cavalier suédois eût sans aucun doute rejeté de toutes ses forces - de toute son âme - une telle allégation, son créateur, l'écrivain pragois de langue allemande Leo Perutz, ne l'aurait certainement pas déniée.
De quoi s'agit-il donc ici ? Par l'entremise d'un prologue, un narrateur anonyme se substitue brutalement à une mémorialiste, enchâssant ainsi l'histoire qu'il va nous conter à l'intérieur de la sienne, procédant ainsi dès les première pages à ce qui fera l'un des thèmes majeurs du texte : l'imposture. Et il entame ainsi son propos :
«C'est l'histoire de deux hommes, lesquels se rencontrèrent dans une grange, un jour de l'hiver 1701 où il gelait à pierre fendre. Ils y scellèrent un pacte d'amitié. Après quoi tous deux cheminèrent de compagnie, sur la route qui va d'Opole jusqu'à la frontière de Pologne, à travers les campagnes enneigées de Silésie.»
Le décors est ainsi succinctement planté, mais il y manque tout de même quelques détails d'importance. Ainsi, notre premier larron, le jeune Christian von Tornefeld, noble suédois de petite extraction, est en fuite et recherché pour désertion après avoir giflé son supérieur qui avait proféré quelque malheureuse parole à l'encontre du Roi Charles XII de Suède dont il souhaite rejoindre les troupes afin de s'y faire une réputation, un prénom (son aïeul sauva la vie à un précédent Roi de Suède), mais sans y laisser trop de plumes, notre jeune homme étant aussi pédant et prétentieux, même dans l'affliction, qu'il est pusillanime. Le second n'a ni nom ni prénom, tout juste un sobriquet : Piège-à-Poule ! C'est un voleur misérable et sans envergure, vivotant de petits larcins, recherché cependant par les Dragons afin de le mener au gibet - punition fort fâcheuse et généralement définitive qui attend aussi le jeune freluquet -, et qui s'est résolu à abandonner sa liberté pour mener une vie de forçat consentant dans les mines du Prince-Évêque local, surnommé «l'ambassadeur du Diable». Le diable, d'ailleurs, n'est jamais bien éloigné de notre histoire ébouriffante, les pas de nos deux fuyards croisant celui d'un meunier des plus funestes et mystérieux, réputé suicidé, qui s'annonce plus simplement comme le recruteur de l'évêque et qui mettrait bien la main pour son maître sur ce chapardeur, étique mais bien bâti. Le jeune homme de son côté, s'accrochant à cette idée fixe de rejoindre les troupes de son roi, s'aperçoit qu'ils sont proches des terres de son riche parrain, père de la jeune fille à laquelle il avait jadis promis le mariage. Cependant, aussi arrogant que peu courageux, il missionne son compagnon de fortune afin qu'il demande aide, or et vêtements à ce noble de province. Mal lui en prend car, accomplissant parfaitement sa mission, Piège-à-Poule va apprendre que l'ancien maître est mort, que les gens de ferme, de l'intendant au plus simple des valets de basse-cour, profitent abondamment de la situation pour ruiner cette anciennement riche demeure, qu'un vieux bougre de bouffi nobliau local, usurier et avare, contribue à ruiner par toute une série de prêts à taux honteux, acculant la jeune et candide héritière à sa perte (dans l'espoir avoué de la pousser au mariage) et que le jeune freluquet que le filou a promit d'aider est toujours dans le cœur de la belle.
L'idée, fatale, peut naître : par tous les moyens possibles, il prendra la place du jouvenceau, rachètera les terres du château, éconduira tous les profiteurs du dernier manant au gros seigneur, se fera aimer de la charmante héritière et l'épousera. Mais demeure toutefois un problème majeur... C'est qu'il n'est pas Christian von Tornefeld ! C'est avec un art consommé de la rouerie, d'une intelligence et d'une vivacité certaine, d'un sens profond de l'auto-justification de ses actes - les bons comme les mauvais - que notre indigent va parvenir à ses fins, réussissant par ruse à envoyer le (vrai) cavalier suédois dans les mines de l'enfer, s'enrichissant en accomplissant un genre de vol auquel nul n'avait songé avant lui - par crainte de la punition divine - à savoir le cambriolage des biens précieux, statues dorées, ciboires d'argent et autres reliquaires présents dans le saint des saints des églises de la région. Il sauvera ainsi la belle ingénue des griffes de son Harpagon, l'épousant et lui donnant dans la foulée une fille, qu'il adore comme sa vie, et sans doute bien plus encore. Mais la destinée veille. La fatalité ne peut laisser celui s'étant substitué à un autre vieillir tranquillement et mourir, satisfait, dans son lit entouré des siens. Et la chute est aussi fracassante, diabolique, irréversible que l'élévation fut rapide et évidente. Le lecteur le pressent dès l'émergence de l'idée machiavélique mais il espère tout de même jusqu'au bout une rémission... pour services rendus !
Il ne faut que quelques pages pour se laisser totalement embarquer par le Cavalier suédois dont l'auteur lui-même estimait que c'était sa meilleure réussite, son oeuvre la mieux accomplie. En fait d'accomplissement, c'est effectivement une pure merveille.
Qu'on en juge un peu : L'ouvrage peut se lire comme un pur roman picaresque - ce personnage de Piège-à-poule en est une espèce de parangon, un miséreux magnifique, un indigent rusé comme goupil et, s'il n'a pas froid aux yeux, si sa morale personnelle n'est pas dans les clous habituels, ses méfaits semblent assez rapidement aussi justifiables que les actes d'une immoralité insupportable, toute légale, que mène le bal des hypocrites, ces nobles ou ces prélats qui sont à la fois les maîtres, les diseurs de loi et les exploiteurs de ce monde sans pitié ni honneur véritable (il est évident que la description de Leo Perutz de ce monde supposément ancien n'est en rien gratuite). En un mot comme en cent, on fini très rapidement par s'y attacher à cet archétype de déclassé, même si l'on peine à oublier totalement la faute originelle. On est indéniablement dans la lignée de ces romans ébouriffants comme le Diable boiteux de Velez de Guevara, le Paysan parvenu du français Marivaux ou encore du fabuleux Manuscrit trouvé à Saragosse de Jan Potocki (que l'on peut aussi classer dans le genre "gothique").
Si le Cavalier suédois n'est pas à proprement parler un roman historique, les rappels incessants à ce que fut "La Grande Guerre du Nord" au début du XVIIIème, mettant aux prises, pour aller très vite, la Russie et ses alliés polonais, Danois ainsi que certains états allemands contre l'Empire Suédois hégémonique de l'époque donne une saveur, une couleur qui plaira assurément aux amateurs du genre.
Roman pour partie fantastique aussi, il semble parfois faire un hommage discret mais appuyé aux romans gothiques allemands du début du XIXème. N'y croise-t-on pas un meunier maléfique, ancien suicidé, dont on ne sait s'il dit vrai lorsqu'il affirme avoir été sauvé in extremis de son acte maudit de Dieu, mais qui, depuis, est redevable à l'évêque de ce sauvetage, cherchant et trouvant sans fin de futurs hommes de charge promis à une vie infernale ? Leo Perutz est bien top malin lui-même pour sombrer dans un fantastique de pacotille, qui s'exhiberait avec force magie ou autres manifestations d'épouvante inutiles, grotesques. Son fantastique à lui est presque crédible. Il laisse au lecteur la possibilité de croire à la présence physique réelle, directe ainsi que le jeune gentilhomme conçoit l'apparition tranquille de ce valet supposé des enfers par d'aucuns. Tandis que c'est l'homme perdu, à l'existence déjà riche d'expérience mais sans verni culturel et qui ne cache pourtant pas une foi à géométrie très variable, qui s'avérera le plus superstitieux ou, selon l'interprétation qu'on en veut, le plus ouvert à la présence des incarnations d'un autre monde. Pour autant, c'est le jeune prétentieux qui apparaîtra le plus crédule des deux hommes aux yeux du lecteur, et pour son plus grand malheur.
Roman métaphysique, enfin - n'oublions pas que Leo Perutz était juif, dans un monde, la Mittel Europa de l'entre-deux guerres, où l'on entendait gronder ce Léviathan bien vivant, monstrueux de l'Allemagne Nazie (la première publication de ce texte date de 1936) -, qui nous parle de destin, de faute, de fatalité, du rachat de l'ignominie par toutes les souffrances possibles jusqu'à la mort expiatrice (thème chrétien s'il en est mais Perutz n'était-il pas à la rédaction d'un ultime texte intitulé le Judas de Léonard, signe que ce thème revêt une importance capitale tout au long de son oeuvre ?), de la tragédie ontologique de l'homme (du moins dans l'univers perutzien) confronté à un dilemme, à un paradoxe éternel et insoluble, d'être à la fois maître de son libre-arbitre et entièrement à la merci de l'omnipotence divine.
Accessoirement sans doute, mais certainement pas en vain, c'est enfin une histoire d'amour tragique ainsi qu'un magnifique témoignage d'amour d'un père pour son enfant. Ceci est très loin d'en être le thème essentiel, mais c'est un aspect suffisamment peu présent ailleurs, dans la littérature dite "classique" pour se permettre de le signaler.
Cette multiplicité de niveaux de lecture et de sujets, du roman d'aventure picaresques complètement échevelé et jubilatoire à la réflexion la plus profonde sur le sens de l'existence humaine et ses ressorts, porte indéniablement ce roman très haut au panthéon des ouvrages incontournables du XXème siècle. Celui que Jorge-Luis Borges surnommait le "Kafka aventureux" est un maître du style, de la forme, du suspense dont la lecture est d'un dépaysement grisant, salutaire, d'une vivacité inouï, d'un rythme trépident et sauvage. C'est plein de révérences et pourtant parfaitement original. C'est d'une absolue évidence de lecture et pourtant d'une complexité d'analyse impressionnante, mais sans la moindre lourdeur. On ne s'y ennuie tellement pas le moindre instant (ce qui est finalement plus rare qu'il y parait, même avec certains "grands" livres) qu'à peine est-il refermé... On en redemande !
TOUJOURS SE MÉFIER DES APPARENCES.
Tic-Tac... Tic-Tac...
Mais quelle mouche a donc piqué le jeune Stanislas Memba ? D'abord étrange voire passablement inquiétant lorsqu'il se présente devant une épicière pour obtenir de quoi se sustenter, il profite de l'absence momentanée de cette dernière pour la régler en douce et s'enfuir avec les quelques tranches de pain beurré et de cervelas pour aller les dévorer dans le premier parc municipal venu où, hélas, un chien s'en régale avant lui sans qu'il donne seulement l'impression de vouloir se débarrasser de l'importun canidé ! Un peu plus loin, c'est avec une jeune fille qu'il engage une conversation littéraire passionnée avec une jeune fille à laquelle il fini par avouer qu'il a perdu l'usage de ses mains, tandis qu'elle s'étonne de son attitude pour le moins étrange et rocambolesque... A-t-il avalé quelque substance hallucinogène ? Est-il simplement devenu fou à lier (sic !) ?
Tic-Tac... Tic-Tac...
Subitement, tandis que le lecteur un peu désemparé ne sait trop à quoi devoir s'attendre, Leo Perutz semble enfin accepter de nous en donner pour notre argent - manière de parler car le narrateur ne nous a pas laissé un instant de répit depuis les premières lignes jusqu'à la fin de ces sept premiers chapitres rocambolesques, énigmatiques et endiablés - et s'en sort brillamment à l'aide d'une analepse nous faisant plonger dans le passé relativement récent du jeune homme, la veille de ce jour dément, à neuf heures précise, où l'on comprend qu'il est amoureux - du moins, c'est ce qu'il s'évertue à se faire croire - d'une jeune femme sur le point de le quitter pour un autre, plus fortuné, qui lui a promis un fameux voyage ; que, depuis, il court après un improbable pécule qui lui permettrait de proposer à cette jeune femme un périple autrement plus enthousiasmant et retrouver ainsi ses faveurs ; que cette course poursuite après ses débiteurs puis chez un brocanteur auquel il propose trois ouvrages rares ne lui appartenant pas va lui être fatale car des policiers prévenus par le commerçant vont être prévenu du caractère délictueux de la transaction...
Tic-Tac... Tic-Tac...
Éberlué, éreinté, sans pause ni recul possible tant le rythme imposé par l'auteur est sans trêve, le lecteur ne peut faire autrement que de suivre le jeune homme, qui est parvenu à faire faux bond à ses geôliers malgré les menottes, dans cette course poursuite infernale contre le temps, contre l'arrestation probable, contre la malchance et cette chasse au trésor sans succès possible - la boucle se bouclant peu à peu, tout semble enfin s'éclairer quant à ses interrogations des premières pages de cet inquiétant Tour du cadran...
Tic-Tac... Tic-Tac...
En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Leo Perutz nous donne une véritable leçon de littérature pour ce qui fut, seulement, son troisième roman (paru en 1918, au lendemain de la fin de la Première Guerre Mondiale) ainsi qu'un beau succès de librairie. Même si le cadre, la Vienne d'avant-guerre, ainsi que les personnages, le milieu "petit-bourgeois" de l'époque peut aujourd'hui sembler aussi désuet que peu évocateur, tout dans l'action, la trame ainsi que la construction quasi diabolique de ce récit concours à faire de ce roman, Le tour du cadran, un objet fascinant d'un auteur encore en devenir mais presque déjà au sommet de son art. On y trouvera, déjà, un personnage que le poids du destin, les divers instruments du salut ou, a contrario de la perte, la profondeur du mensonge et son corollaire souvent impossible, la vérité environnent de toute leur puissance, de toute leur ironique intransigeance. On y décèlera, comme nombre d'autres plus tard, deux personnages féminins antagonistes : celle, innocente et pure, qui aime dans l'ombre mais qui pourrait être la clé du salut (même si le jeune Stanislas Semba semble refuser de s'en apercevoir vraiment) ainsi que, figure plus régulière encore dans l'oeuvre du pragois, celle par qui tout advient, même si elle ne l'a pas ardemment ni perversement souhaité, déclencheur presque autant que conséquence de la chute du "héros", de sa fin irrémédiable, à moins qu'il ne s'agisse ici que de la plus élémentaire survie, d'un simple mais incroyable délire onirique, d'une réalité falsifiée ou cruellement exacte ?
Tic-Tac... Tic-Tac...
On a souvent comparé Léo Perutz à son compatriote Franz Kafka - un peu rapidement car en omettant le caractère plus ironiquement enjoué des ses œuvres. Ce qui ne signifie pas qu'à leur manière, elles ne sont pas tout aussi désespérées et teintes d'absurde -, on pourrait aussi trouver un certain nombre de points communs avec le très grand Joseph Roth - cet humour décapant, baroque, ce fantastique du quotidien ainsi qu'une certaine vision de l'humanité, du temps et du destin -. Ici, l'on pourrait aisément ajouter une dimension policière, dans la veine d'une Agatha Christie, tant l'auteur parvient à jouer au chat et à la souris tant avec sa trame qu'avec son lecteur. Que pourrait-on ajouter, sinon que la conclusion donnée dans un prologue aussi ramassé qu'inattendu est peut-être bien la stricte vérité autant que la plus éblouissante manière de se moquer de nous, de lui-même et de ses créatures de papier ? N'oublions pas, non plus, que le titre original en allemand n'est en rien une histoire de tour du cadran - ce qui, malgré tout, donne aussi une certaine idée de la trame générale ou apparente, tout en lui conférant une interprétation possiblement erronée - mais une indication chronologique d'une grande précision : «Entre neuf et neuf» sous entendu neuf heures... Le lecteur avide comprendra comme cette indication est à la fois des plus neutres et la plus strictement exacte, d'un point de vue scénaristique. D'ailleurs, à propos de scénario, et nous achèverons cette modeste chronique sur cette ultime remarque, la mécanique de Le tour du cadran est d'une telle rigueur qu'elle ne pouvait échapper à l'un des plus grands cinéaste qui fut, maître parmi les maîtres, le redoutable Alfred Hitchock qui reconnu s'en être inspiré pour la célèbre scène des menottes de son film «The Lodger». C'était bien le moins que cet exquis et fantasque roman de Léo Perutz (qui se dévore en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire et peut se lire sans aucun a priori métaphysique) pouvait mériter de reconnaissance posthume.
Mais jamais n'oubliez ceci qu'il est essentiel de se méfier des plus évidentes apparences !
Tic-Tac... Tic-Tac...
Tic-Tac... Tic-Tac...
Mais quelle mouche a donc piqué le jeune Stanislas Memba ? D'abord étrange voire passablement inquiétant lorsqu'il se présente devant une épicière pour obtenir de quoi se sustenter, il profite de l'absence momentanée de cette dernière pour la régler en douce et s'enfuir avec les quelques tranches de pain beurré et de cervelas pour aller les dévorer dans le premier parc municipal venu où, hélas, un chien s'en régale avant lui sans qu'il donne seulement l'impression de vouloir se débarrasser de l'importun canidé ! Un peu plus loin, c'est avec une jeune fille qu'il engage une conversation littéraire passionnée avec une jeune fille à laquelle il fini par avouer qu'il a perdu l'usage de ses mains, tandis qu'elle s'étonne de son attitude pour le moins étrange et rocambolesque... A-t-il avalé quelque substance hallucinogène ? Est-il simplement devenu fou à lier (sic !) ?
Tic-Tac... Tic-Tac...
Subitement, tandis que le lecteur un peu désemparé ne sait trop à quoi devoir s'attendre, Leo Perutz semble enfin accepter de nous en donner pour notre argent - manière de parler car le narrateur ne nous a pas laissé un instant de répit depuis les premières lignes jusqu'à la fin de ces sept premiers chapitres rocambolesques, énigmatiques et endiablés - et s'en sort brillamment à l'aide d'une analepse nous faisant plonger dans le passé relativement récent du jeune homme, la veille de ce jour dément, à neuf heures précise, où l'on comprend qu'il est amoureux - du moins, c'est ce qu'il s'évertue à se faire croire - d'une jeune femme sur le point de le quitter pour un autre, plus fortuné, qui lui a promis un fameux voyage ; que, depuis, il court après un improbable pécule qui lui permettrait de proposer à cette jeune femme un périple autrement plus enthousiasmant et retrouver ainsi ses faveurs ; que cette course poursuite après ses débiteurs puis chez un brocanteur auquel il propose trois ouvrages rares ne lui appartenant pas va lui être fatale car des policiers prévenus par le commerçant vont être prévenu du caractère délictueux de la transaction...
Tic-Tac... Tic-Tac...
Éberlué, éreinté, sans pause ni recul possible tant le rythme imposé par l'auteur est sans trêve, le lecteur ne peut faire autrement que de suivre le jeune homme, qui est parvenu à faire faux bond à ses geôliers malgré les menottes, dans cette course poursuite infernale contre le temps, contre l'arrestation probable, contre la malchance et cette chasse au trésor sans succès possible - la boucle se bouclant peu à peu, tout semble enfin s'éclairer quant à ses interrogations des premières pages de cet inquiétant Tour du cadran...
Tic-Tac... Tic-Tac...
En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Leo Perutz nous donne une véritable leçon de littérature pour ce qui fut, seulement, son troisième roman (paru en 1918, au lendemain de la fin de la Première Guerre Mondiale) ainsi qu'un beau succès de librairie. Même si le cadre, la Vienne d'avant-guerre, ainsi que les personnages, le milieu "petit-bourgeois" de l'époque peut aujourd'hui sembler aussi désuet que peu évocateur, tout dans l'action, la trame ainsi que la construction quasi diabolique de ce récit concours à faire de ce roman, Le tour du cadran, un objet fascinant d'un auteur encore en devenir mais presque déjà au sommet de son art. On y trouvera, déjà, un personnage que le poids du destin, les divers instruments du salut ou, a contrario de la perte, la profondeur du mensonge et son corollaire souvent impossible, la vérité environnent de toute leur puissance, de toute leur ironique intransigeance. On y décèlera, comme nombre d'autres plus tard, deux personnages féminins antagonistes : celle, innocente et pure, qui aime dans l'ombre mais qui pourrait être la clé du salut (même si le jeune Stanislas Semba semble refuser de s'en apercevoir vraiment) ainsi que, figure plus régulière encore dans l'oeuvre du pragois, celle par qui tout advient, même si elle ne l'a pas ardemment ni perversement souhaité, déclencheur presque autant que conséquence de la chute du "héros", de sa fin irrémédiable, à moins qu'il ne s'agisse ici que de la plus élémentaire survie, d'un simple mais incroyable délire onirique, d'une réalité falsifiée ou cruellement exacte ?
Tic-Tac... Tic-Tac...
On a souvent comparé Léo Perutz à son compatriote Franz Kafka - un peu rapidement car en omettant le caractère plus ironiquement enjoué des ses œuvres. Ce qui ne signifie pas qu'à leur manière, elles ne sont pas tout aussi désespérées et teintes d'absurde -, on pourrait aussi trouver un certain nombre de points communs avec le très grand Joseph Roth - cet humour décapant, baroque, ce fantastique du quotidien ainsi qu'une certaine vision de l'humanité, du temps et du destin -. Ici, l'on pourrait aisément ajouter une dimension policière, dans la veine d'une Agatha Christie, tant l'auteur parvient à jouer au chat et à la souris tant avec sa trame qu'avec son lecteur. Que pourrait-on ajouter, sinon que la conclusion donnée dans un prologue aussi ramassé qu'inattendu est peut-être bien la stricte vérité autant que la plus éblouissante manière de se moquer de nous, de lui-même et de ses créatures de papier ? N'oublions pas, non plus, que le titre original en allemand n'est en rien une histoire de tour du cadran - ce qui, malgré tout, donne aussi une certaine idée de la trame générale ou apparente, tout en lui conférant une interprétation possiblement erronée - mais une indication chronologique d'une grande précision : «Entre neuf et neuf» sous entendu neuf heures... Le lecteur avide comprendra comme cette indication est à la fois des plus neutres et la plus strictement exacte, d'un point de vue scénaristique. D'ailleurs, à propos de scénario, et nous achèverons cette modeste chronique sur cette ultime remarque, la mécanique de Le tour du cadran est d'une telle rigueur qu'elle ne pouvait échapper à l'un des plus grands cinéaste qui fut, maître parmi les maîtres, le redoutable Alfred Hitchock qui reconnu s'en être inspiré pour la célèbre scène des menottes de son film «The Lodger». C'était bien le moins que cet exquis et fantasque roman de Léo Perutz (qui se dévore en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire et peut se lire sans aucun a priori métaphysique) pouvait mériter de reconnaissance posthume.
Mais jamais n'oubliez ceci qu'il est essentiel de se méfier des plus évidentes apparences !
Tic-Tac... Tic-Tac...
Je voudrais citer Olivier Cena qui parle de Léo Perutz en ces termes
Perutz est un prestidigitateur magnifique, un manipulateur de l’étrange, un maître du récit.
Il aime, comme arme suprême, utiliser l’Histoire, l’officielle et la petite. Entendez par là : dans un contexte historique bien précis, il s’insinue à travers une faille obscure dans le monde de la fiction. Là, on retrouve les thèmes privilégiés de Perutz, l’amour, la mort, la fatalité et le destin entrant dans la construction d’un jeu machiavélique de substitution.
Autant dire qu’on ne peut raconter un roman de Perutz sans gâcher le plaisir du lecteur. On ne dévoile pas la science d’un magicien. »
Je suis en accord total avec ces quelques lignes citées à la fin du roman. Je me sens incapable d’ écrire une critique équivalente
Un seul conseil: lisez Perutz. C’ est magique
Perutz est un prestidigitateur magnifique, un manipulateur de l’étrange, un maître du récit.
Il aime, comme arme suprême, utiliser l’Histoire, l’officielle et la petite. Entendez par là : dans un contexte historique bien précis, il s’insinue à travers une faille obscure dans le monde de la fiction. Là, on retrouve les thèmes privilégiés de Perutz, l’amour, la mort, la fatalité et le destin entrant dans la construction d’un jeu machiavélique de substitution.
Autant dire qu’on ne peut raconter un roman de Perutz sans gâcher le plaisir du lecteur. On ne dévoile pas la science d’un magicien. »
Je suis en accord total avec ces quelques lignes citées à la fin du roman. Je me sens incapable d’ écrire une critique équivalente
Un seul conseil: lisez Perutz. C’ est magique
Le dernier roman publié du vivant de l’auteur, il a connu une longue gestation. Commencé en 1924 en Autriche, il n’a été terminé qu’en 1951, et publié en 1953. Il faut noter qu’après son départ de l’Autriche pour la Palestine en 1928, après l’Anschluss, Perutz a arrêté l’écriture, et il est revenu à son métier d’origine, celui d’actuaire. Après la fin de la seconde guerre, il partageait son temps entre le proche Orient et Vienne, où il n’était plus toutefois qu’un écrivain bien oublié.
La nuit sous un pont de pierre se déroule à Prague, la ville où est né Perutz, ville qui faisait encore partie de l’empire austro-hongrois qui vivait ses dernières heures. C’est un livre à la structure savamment élaborée : quatorze récits, suivis d’un épilogue, récits qui se répondent, dans lesquels nous retrouvons des personnages qui reviennent ; si certains paraissent pouvoir se suffire à eux-mêmes, il y a néanmoins, à chaque fois, au moins des éléments, des indices, indispensables au lecteur pour saisir la trame principale. Les deux figures essentielles sont l’empereur Rodolphe II et Mordechai Meisl, un riche juif. Les deux lieux centraux du récit sont le château où demeure l’empereur et le ghetto juif où vit Meisl. Le roman se déroule sur cinquante ans entre 1571 et 1621, et l’épilogue vers 1900. Les récits ne suivent pas un ordre chronologique, il y a des retours en arrière, des sauts importants dans le futur. Et certains récits ne peuvent pas être datés avec précision. C’est donc une sorte de puzzle que le lecteur doit reconstituer, en essayant de trouver à chaque fois les éléments signifiants, essentiels. En dehors d’un aspect évident de roman historique ( l’effondrement du royaume de Bohême), le livre présente aussi des éléments fantastiques, surnaturels, en particulier par l’entremise du grand rabbin Loew.
Il y a bien sûr le charme de Prague, une Prague en partie disparue, mais il ne faut pas penser que Leo Perutz dans ce livre à la forme atypique, qu’il a mis si longtemps à écrire, et qui est le dernier paru de son vivant, s’abandonne aux douceurs de la nostalgie et du souvenir. Ses thématiques et sa vision du monde n’ont pas changées. Les personnages sont aliénés par le passé dont ils n’arrivent pas à se libérer, ce qui bloque leur présent : Jakob Meisl, le dernier descendant de la famille de Mordechai n’a pas fait le deuil de la fortune disparue de son lointain parent : il collecte les souvenirs de cette époque en espérant rentrer en possession de l’or envolé plutôt que de vivre sa vie. Les personnages historiques, tels qu’ils nous apparaissent, sont impuissants et ne peuvent influer sur le cours de l’histoire. Même l’empereur. Le désastre final, le déclenchement de la guerre de Trente Ans ne signe pas l’échec d’un grand dessein, mais est le résultat d’une vacuité politique, d’une désertion du pouvoir lié à la poursuites d’intérêts individuels, de chaque protagoniste, chacun à son niveau. Chacun y participe à sa manière, sans le vouloir réellement, par aveuglement et par un soucis de son intérêt individuel, à très court terme. L’histoire ne progresse pas, elle piétine, tourne en rond, au gré de petits appétits médiocres des hommes. Les mêmes malheurs sont donc toujours à redouter de nouveau. Une fatalité est inscrite dans la nature humaine, et provoque un tragique dans des existences sans grandeur.
Cela semble bien sombre, et c’est pourtant un livre magnifique, touchant dans ses personnages, troublant dans ce qu’il raconte, qui ne manque pas d’humour et de second degré, merveilleusement écrit et construit. Mais d’une redoutable lucidité, sans les douces consolations fallacieuses d’une rédemption, et surtout d’une possibilités pour les hommes d’arriver à maîtriser leur destin.
La nuit sous un pont de pierre se déroule à Prague, la ville où est né Perutz, ville qui faisait encore partie de l’empire austro-hongrois qui vivait ses dernières heures. C’est un livre à la structure savamment élaborée : quatorze récits, suivis d’un épilogue, récits qui se répondent, dans lesquels nous retrouvons des personnages qui reviennent ; si certains paraissent pouvoir se suffire à eux-mêmes, il y a néanmoins, à chaque fois, au moins des éléments, des indices, indispensables au lecteur pour saisir la trame principale. Les deux figures essentielles sont l’empereur Rodolphe II et Mordechai Meisl, un riche juif. Les deux lieux centraux du récit sont le château où demeure l’empereur et le ghetto juif où vit Meisl. Le roman se déroule sur cinquante ans entre 1571 et 1621, et l’épilogue vers 1900. Les récits ne suivent pas un ordre chronologique, il y a des retours en arrière, des sauts importants dans le futur. Et certains récits ne peuvent pas être datés avec précision. C’est donc une sorte de puzzle que le lecteur doit reconstituer, en essayant de trouver à chaque fois les éléments signifiants, essentiels. En dehors d’un aspect évident de roman historique ( l’effondrement du royaume de Bohême), le livre présente aussi des éléments fantastiques, surnaturels, en particulier par l’entremise du grand rabbin Loew.
Il y a bien sûr le charme de Prague, une Prague en partie disparue, mais il ne faut pas penser que Leo Perutz dans ce livre à la forme atypique, qu’il a mis si longtemps à écrire, et qui est le dernier paru de son vivant, s’abandonne aux douceurs de la nostalgie et du souvenir. Ses thématiques et sa vision du monde n’ont pas changées. Les personnages sont aliénés par le passé dont ils n’arrivent pas à se libérer, ce qui bloque leur présent : Jakob Meisl, le dernier descendant de la famille de Mordechai n’a pas fait le deuil de la fortune disparue de son lointain parent : il collecte les souvenirs de cette époque en espérant rentrer en possession de l’or envolé plutôt que de vivre sa vie. Les personnages historiques, tels qu’ils nous apparaissent, sont impuissants et ne peuvent influer sur le cours de l’histoire. Même l’empereur. Le désastre final, le déclenchement de la guerre de Trente Ans ne signe pas l’échec d’un grand dessein, mais est le résultat d’une vacuité politique, d’une désertion du pouvoir lié à la poursuites d’intérêts individuels, de chaque protagoniste, chacun à son niveau. Chacun y participe à sa manière, sans le vouloir réellement, par aveuglement et par un soucis de son intérêt individuel, à très court terme. L’histoire ne progresse pas, elle piétine, tourne en rond, au gré de petits appétits médiocres des hommes. Les mêmes malheurs sont donc toujours à redouter de nouveau. Une fatalité est inscrite dans la nature humaine, et provoque un tragique dans des existences sans grandeur.
Cela semble bien sombre, et c’est pourtant un livre magnifique, touchant dans ses personnages, troublant dans ce qu’il raconte, qui ne manque pas d’humour et de second degré, merveilleusement écrit et construit. Mais d’une redoutable lucidité, sans les douces consolations fallacieuses d’une rédemption, et surtout d’une possibilités pour les hommes d’arriver à maîtriser leur destin.
Publié en 1933 et aussitôt interdit pas les nazis, c’est l’avant dernier roman de Leo Perutz, auteur autrichien d’origine juive, publié de son vivant. Un jeune médecin, Georg Friedrich Amberg, se réveille mal en point dans un hôpital. Les souvenirs qu’il a des cinq dernières semaines écoulées, ainsi que de ses raisons de se retrouver en mauvais état et alité, différent sensiblement du discours qu’on lui tient à l’hôpital : renversé par une voiture, il aurait passé ce temps dans son lit, plus ou moins comateux.
Or Amberg a des souvenirs très précis des événements qui se seraient déroulés dans le village de Morwede, dans lequel il a pris ses fonctions de médecin. Le village est régi par le baron von Malchin, un ami du défunt père d’Amberg. Le baron a d’étranges lubies et projets : il rêve de restaurer le Saint Empire Germanique, et pour ce faire imagine de se servir de la science, et utiliser une étrange substance, qui pourrait agir sur l’esprit des hommes, et lui permettre de les manipuler. Il est aidé dans ses recherches par une jeune femme, qui a déjà croisé la route d’Amberg et dont il est amoureux. Le jeune médecin assiste en tant que spectateur aux menées du baron et de sa collaboratrice, qui n’ont pas forcément les mêmes objectifs. Sceptique et refusant de s’engager, il sera toutefois aux premières loges pour suivre les faits jusqu’aux événements graves et tragiques, dont il sera finalement une des victimes. Mais c’est un tout autre discours qu’il entend à l’hôpital : tous ces événements ne seraient-ils que le résultat d’un délire ? ou certains ont-ils intérêt à cacher ce qui s’est passé à Morwede ?
Nous ne pourrons répondre avec certitude à cette dernière question, chaque lecteur est libre de choisir l’option qui lui convient le mieux, ou de se dire que l’incertitude est inévitable. L’essentiel est dans le tableau halluciné et hallucinant d’une communauté vivant d’une manière rétrograde, dans laquelle un appétit de puissance et de manipulation voit le jour, et rend toutes les atrocités possibles. Le village a des allures de cauchemar, à la limite du fantastique et de l’horreur, le roman joue aussi avec des techniques de romans policiers, sans oublier la science-fiction. Mais tout cela est utilisé en permanence par Perutz avec une sorte de distanciation, de second degré. Toutes les pistes sont incertaines et ne mènent à aucune solution solide. L’étrange labyrinthe de l’esprit humain ne semble pas avoir de sortie.
L’auteur crée un univers fantasmagorique, avec ironie et maestria, mais qui en même temps pose des questions qui n’ont rien d’irréel, la manipulation des masses, la façon dont le fanatisme peut se traduire en fonction de la société dans laquelle il émerge, par exemple, sont d’une brûlante actualité, et non seulement à l’époque où le livre a été écrit.
Brillant, dérangeant, frustrant, mais aussi très jouissif et posant plein de piste de réflexion, c’est encore une grande réussite dans l’oeuvre de Leo Perutz.
Or Amberg a des souvenirs très précis des événements qui se seraient déroulés dans le village de Morwede, dans lequel il a pris ses fonctions de médecin. Le village est régi par le baron von Malchin, un ami du défunt père d’Amberg. Le baron a d’étranges lubies et projets : il rêve de restaurer le Saint Empire Germanique, et pour ce faire imagine de se servir de la science, et utiliser une étrange substance, qui pourrait agir sur l’esprit des hommes, et lui permettre de les manipuler. Il est aidé dans ses recherches par une jeune femme, qui a déjà croisé la route d’Amberg et dont il est amoureux. Le jeune médecin assiste en tant que spectateur aux menées du baron et de sa collaboratrice, qui n’ont pas forcément les mêmes objectifs. Sceptique et refusant de s’engager, il sera toutefois aux premières loges pour suivre les faits jusqu’aux événements graves et tragiques, dont il sera finalement une des victimes. Mais c’est un tout autre discours qu’il entend à l’hôpital : tous ces événements ne seraient-ils que le résultat d’un délire ? ou certains ont-ils intérêt à cacher ce qui s’est passé à Morwede ?
Nous ne pourrons répondre avec certitude à cette dernière question, chaque lecteur est libre de choisir l’option qui lui convient le mieux, ou de se dire que l’incertitude est inévitable. L’essentiel est dans le tableau halluciné et hallucinant d’une communauté vivant d’une manière rétrograde, dans laquelle un appétit de puissance et de manipulation voit le jour, et rend toutes les atrocités possibles. Le village a des allures de cauchemar, à la limite du fantastique et de l’horreur, le roman joue aussi avec des techniques de romans policiers, sans oublier la science-fiction. Mais tout cela est utilisé en permanence par Perutz avec une sorte de distanciation, de second degré. Toutes les pistes sont incertaines et ne mènent à aucune solution solide. L’étrange labyrinthe de l’esprit humain ne semble pas avoir de sortie.
L’auteur crée un univers fantasmagorique, avec ironie et maestria, mais qui en même temps pose des questions qui n’ont rien d’irréel, la manipulation des masses, la façon dont le fanatisme peut se traduire en fonction de la société dans laquelle il émerge, par exemple, sont d’une brûlante actualité, et non seulement à l’époque où le livre a été écrit.
Brillant, dérangeant, frustrant, mais aussi très jouissif et posant plein de piste de réflexion, c’est encore une grande réussite dans l’oeuvre de Leo Perutz.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Le réalisme magique
GabySensei
40 livres

ESOTERISME ET THRILLERS
wellibus2
52 livres
Auteurs proches de Leo Perutz
Lecteurs de Leo Perutz (1244)Voir plus
Quiz
Voir plus
Les titres des œuvres de Paul Auster
Quel est le titre correct ?
Mr. Psycho
Mr. Notorious
Mr. Vertigo
Mr. Frenzy
12 questions
114 lecteurs ont répondu
Thème :
Paul AusterCréer un quiz sur cet auteur114 lecteurs ont répondu