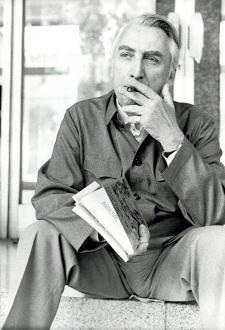Critiques de Roland Barthes (184)
Une lecture qui poignarde le cœur.
Beaucoup de vide, peu de mots mais, bordel, qu’ils sont dévastateurs.
Sans jamais tomber dans le pathos, R. Barthes décrit ici ses nuances de chagrin. C’est infiniment triste et extrêmement bouleversant. J’en sors déchiré et assommé.
Beaucoup de vide, peu de mots mais, bordel, qu’ils sont dévastateurs.
Sans jamais tomber dans le pathos, R. Barthes décrit ici ses nuances de chagrin. C’est infiniment triste et extrêmement bouleversant. J’en sors déchiré et assommé.
Un beau livre sur le deuil, la mort, la solitude et le sentiment d’être abandonné face à soi. Belle entrée en matière avec ce grand Monsieur
« Neige, beaucoup de neige sur Paris; c'est étrange.
Je me dis et j'en souffre: elle ne sera jamais plus là pour le voir, pour que je le lui raconte. »
Suite à la perte de sa mère, Roland Barthes écrit sur le décès qui bouleversera sa vie et rassemble ses feuillets en un journal.
Je me dis et j'en souffre: elle ne sera jamais plus là pour le voir, pour que je le lui raconte. »
Suite à la perte de sa mère, Roland Barthes écrit sur le décès qui bouleversera sa vie et rassemble ses feuillets en un journal.
Journal de deuil.
Des petites phrases posées comme des petits cailloux sur une tombe, pour dire... voilà, je suis encore près de toi.
«Après-midi triste. Brève course. Chez le pâtissier (futilité) j’achète un financier. Servant une cliente, la petite serveuse dit «Voilà». c’était le mot que je disais en apportant quelque chose à maman quand je la soignais. Une fois, vers la fin, à demi inconsciente, elle répéta en écho « Voilà» ( je suis là, mot que nous nous sommes dit l’un à l’autre toute la la vie).
Ce mot de la serveuse me fait venir les larmes aux yeux. Je pleure longtemps (rentré dans l’appartement insonore )»
Des mots pour dire pour dire, voilà ... vois la, encore un peu.
Un chagrin pareil aux barthes de l’Adour, zones marécageuses laissés par la crue, près de Urt, en pays basque, où l’auteur résidait parfois.
Ce livre de deuil n’est pas le livre d’un écrivain. C’est la lente mélopée d’un fils qui vient de perdre sa mère. Le quotidien qu’il faut affronter seul. Voilà, c’est tout.
La maison de Roland Barthes s'ouvre une fois l'an au public pendant les journées du patrimoine. Urt - pyrénées atlantiques - 64.
Des petites phrases posées comme des petits cailloux sur une tombe, pour dire... voilà, je suis encore près de toi.
«Après-midi triste. Brève course. Chez le pâtissier (futilité) j’achète un financier. Servant une cliente, la petite serveuse dit «Voilà». c’était le mot que je disais en apportant quelque chose à maman quand je la soignais. Une fois, vers la fin, à demi inconsciente, elle répéta en écho « Voilà» ( je suis là, mot que nous nous sommes dit l’un à l’autre toute la la vie).
Ce mot de la serveuse me fait venir les larmes aux yeux. Je pleure longtemps (rentré dans l’appartement insonore )»
Des mots pour dire pour dire, voilà ... vois la, encore un peu.
Un chagrin pareil aux barthes de l’Adour, zones marécageuses laissés par la crue, près de Urt, en pays basque, où l’auteur résidait parfois.
Ce livre de deuil n’est pas le livre d’un écrivain. C’est la lente mélopée d’un fils qui vient de perdre sa mère. Le quotidien qu’il faut affronter seul. Voilà, c’est tout.
La maison de Roland Barthes s'ouvre une fois l'an au public pendant les journées du patrimoine. Urt - pyrénées atlantiques - 64.
Il est de ces livres qui entrent quelques fois totalement en résonance avec ce que l'on peut vivre sur une période donnée, celui-ci en fait partie. Publié en 2009, près de 30 ans après sa rédaction, Roland Barthes nous fait part de son chagrin à la disparition de sa mère survenue le 25 octobre 1977. C'est en fin de compte une sorte de travail nécessaire et salutaire pour faire son deuil.
Ce livre de Roland Barthes, d'une grande impudeur, n'était certainement pas destiné à être publié mais le lecteur est de cette race avide, il est comme les vers rongeant la peau d'un cadavre, il se repaît de la chair même de ses écrivains favoris, oubliant peut-être que parfois les textes sont rédigés avec le sang même de leurs auteurs. La preuve en est la publication du roman inachevé de Nabokov édité la première fois en 2009 ou bien « Le premier homme » d'Albert Camus.
C'est le premier livre de Roland Barthes que je lis, il m'est donc difficile de pouvoir juger son style par rapport à son œuvre. Je puis juste en dire qu'il est rédigé dans un style clair, précis, sans esbroufe d'aucune sorte et surtout, très important, ne versant jamais vers un pathos qui serait ici malvenu et indécent au vu du sujet traité tant l'auteur se montre à découvert, tel qu'il est, en homme acculé par le tragique de la vie.
Épictète disait qu'il fallait considérer chaque chose sur cette terre comme des emprunts, y compris les êtres chers trop tôt disparus afin d'en être le moins affecté possible. Tâche au combien difficile ! Mais si on y parvient, on passera au mieux pour un fils indigne, au pire pour un sans-cœur, pour un Meursault incapable de pleurer aux funérailles de sa mère.
Livre donc très personnel d'une délicatesse et d'une beauté mélancolique, à ne pas lire sous le coups de la déprime.
Ce livre de Roland Barthes, d'une grande impudeur, n'était certainement pas destiné à être publié mais le lecteur est de cette race avide, il est comme les vers rongeant la peau d'un cadavre, il se repaît de la chair même de ses écrivains favoris, oubliant peut-être que parfois les textes sont rédigés avec le sang même de leurs auteurs. La preuve en est la publication du roman inachevé de Nabokov édité la première fois en 2009 ou bien « Le premier homme » d'Albert Camus.
C'est le premier livre de Roland Barthes que je lis, il m'est donc difficile de pouvoir juger son style par rapport à son œuvre. Je puis juste en dire qu'il est rédigé dans un style clair, précis, sans esbroufe d'aucune sorte et surtout, très important, ne versant jamais vers un pathos qui serait ici malvenu et indécent au vu du sujet traité tant l'auteur se montre à découvert, tel qu'il est, en homme acculé par le tragique de la vie.
Épictète disait qu'il fallait considérer chaque chose sur cette terre comme des emprunts, y compris les êtres chers trop tôt disparus afin d'en être le moins affecté possible. Tâche au combien difficile ! Mais si on y parvient, on passera au mieux pour un fils indigne, au pire pour un sans-cœur, pour un Meursault incapable de pleurer aux funérailles de sa mère.
Livre donc très personnel d'une délicatesse et d'une beauté mélancolique, à ne pas lire sous le coups de la déprime.
J'ai été déçu.
Fallait-il publier ce livre ? Je peux comprendre que tout ce que Barthes a écrit puisse intéresser, mais là ce ne sont que des fragments, des mots posés sur un cahier. C'est insuffisant pour moi.
Fallait-il publier ce livre ? Je peux comprendre que tout ce que Barthes a écrit puisse intéresser, mais là ce ne sont que des fragments, des mots posés sur un cahier. C'est insuffisant pour moi.
Ici sont rassemblées, par ordre chronologiques, les notes prises par Roland Barthes sur ses émotions, ses ressentis quant à la perte de sa mère. Des phrases emplies du chagrin douloureux de l'absence, pudiques et simples.
Un recueil émouvant, qui trouvera des échos chez tous ses lecteurs.
Un recueil émouvant, qui trouvera des échos chez tous ses lecteurs.
Au pays de : « Du 26 octobre 1977, lendemain de la mort de sa mère, au 15 septembre 1979, Roland Barthes a tenu un journal de deuil, 330 feuillets pour la plupart datés, et publiés pour la première fois en 2009. »
Journal de deuil, c’est le journal d’un deuil. La puissance de sa simplicité et la profondeur du dénuement qui s’en dégage le transforme, paradoxalement en un Journal universel, de la Vie.
Parce que les mots sont de Roland Barthes, j’aimerais penser que deuil ou non, tristesse ou non, perte et absence ou non, ce livre se range dans la pile des livres à avoir lu. Les mots sont sans artifices. Les phrases sont courtes. Ces « fiches » sont simples (quelques lignes).
Mais si vous êtes deuil, tristesse, perte, absence, alors ce livre se range dans la pile des livres à avoir vécu. Il est à vivre parce que vous vous y reconnaitrez dans ce que vous aurez déjà traversé. Vous entrerez alors dans un monde à découvrir et pourtant déjà passé. Vous serez confronté au déchirant paradoxe de la perte. Déjà au passé, elle est pourtant toujours présente.
« Ne pas dire Deuil. C’est trop psychanalytique. Je ne suis pas en deuil. J’ai du chagrin. » [ Suite de la chronique sur Starting Books
Journal de deuil, c’est le journal d’un deuil. La puissance de sa simplicité et la profondeur du dénuement qui s’en dégage le transforme, paradoxalement en un Journal universel, de la Vie.
Parce que les mots sont de Roland Barthes, j’aimerais penser que deuil ou non, tristesse ou non, perte et absence ou non, ce livre se range dans la pile des livres à avoir lu. Les mots sont sans artifices. Les phrases sont courtes. Ces « fiches » sont simples (quelques lignes).
Mais si vous êtes deuil, tristesse, perte, absence, alors ce livre se range dans la pile des livres à avoir vécu. Il est à vivre parce que vous vous y reconnaitrez dans ce que vous aurez déjà traversé. Vous entrerez alors dans un monde à découvrir et pourtant déjà passé. Vous serez confronté au déchirant paradoxe de la perte. Déjà au passé, elle est pourtant toujours présente.
« Ne pas dire Deuil. C’est trop psychanalytique. Je ne suis pas en deuil. J’ai du chagrin. » [ Suite de la chronique sur Starting Books
En emportant de la librairie le Journal de deuil, de Roland Barthes, je pensais que j’allais découvrir des pensées fortes, des réflexions profondes sur ce qu’un deuil révèle de soi et du lien rompu, sur ce que l’absence inflige et change, sur ce que l’on trouve, ou non, comme sens à ce traumatisme.
Mais le Journal de deuil de Roland Barthes n’est qu’un journal, je ne peux même pas dire banal à pleurer, puisqu’il m’a laissé indifférente. Et même agacée : R. Barthes constate, assez satisfait, à plusieurs reprises, qu’il n’«hystérise »pas son chagrin, qu’il en fait peu part à ceux qui l’approchent. Mais où avait-il vu que les gens en peine profonde allaient la raconter à tous vents ?
Et comment croire qu’il n’avait pas la réponse à cette question : « Pouvoir vivre sans quelqu’un qu’on aimait signifie-t-il qu’on l’aimait moins qu’on ne croyait… ? »
Mais le Journal de deuil de Roland Barthes n’est qu’un journal, je ne peux même pas dire banal à pleurer, puisqu’il m’a laissé indifférente. Et même agacée : R. Barthes constate, assez satisfait, à plusieurs reprises, qu’il n’«hystérise »pas son chagrin, qu’il en fait peu part à ceux qui l’approchent. Mais où avait-il vu que les gens en peine profonde allaient la raconter à tous vents ?
Et comment croire qu’il n’avait pas la réponse à cette question : « Pouvoir vivre sans quelqu’un qu’on aimait signifie-t-il qu’on l’aimait moins qu’on ne croyait… ? »
Après la mort de mam : de justes remarques sur la distinction entre le deuil, psychanalytique, et le chagrin qui ne se dialectise pas avec le temps.
Sur le fait que ce chagrin est inexprimable mais tout de même dicible.
Sur le besoin de solitude de qui a connu l'irrémédiable, sur l'acédie (la sécheresse de cœur) si contraire aux valeurs de mam, sur la dépression, sur la peur de ce qui a eu lieu ("La crainte de l'effondrement", Winnicott).
Sur le fait que ce chagrin est inexprimable mais tout de même dicible.
Sur le besoin de solitude de qui a connu l'irrémédiable, sur l'acédie (la sécheresse de cœur) si contraire aux valeurs de mam, sur la dépression, sur la peur de ce qui a eu lieu ("La crainte de l'effondrement", Winnicott).
Il y a le coup éditorial. Il y a la controverse. Mais il y a surtout la crainte de ces inédits de fond de tiroir qui viennent parfois écorner l’image d’un auteur, comme ce petit supplément auquel on n’a pas su résister et qui vient mêler de nausée le plaisir d’une dégustation.
Du Roland Barthes diariste, on pouvait déjà se faire une idée en lisant "Délibération", ce court extrait du journal publié dans le Bruissement de la langue, ou encore RB par RB. Et ceux qui regrettaient ce roman sur lequel Barthes "travaillait" dans les dernières années de sa vie pouvaient à loisir consulter les fiches énigmatiques publiées dans les œuvres complètes sous le titre "Vita nova". Ici, le Seuil édite 330 fiches rédigées par Barthes après la mort de sa mère, en 1977, peu avant d’entreprendre l’écriture de La Chambre claire. Un exercice littéraire de domestication de la douleur, entre autres : "je peux, tant bien que mal (c’est-à-dire avec le sentiment de ne pas y arriver) parler [mon chagrin], le phraser. Ma culture, mon goût de l’écriture me donne ce pouvoir apotropaïque, ou d’intégration : j’intègre, par le langage". Cependant, les tics, les habituelles préciosités (italiques, vocabulaire psychanalytique, etc.) ont tôt fait de placer le lecteur en terrain familier : illisibles, ces notes ? qui prétend que le Tombeau d’Anatole de Mallarmé soit lisible ?
Lire la suite : http://ivressedupalimpseste.blogspot.com/2009/03/roland-barthes-journal-de-deuil.html
Lien : http://ivressedupalimpseste...
Du Roland Barthes diariste, on pouvait déjà se faire une idée en lisant "Délibération", ce court extrait du journal publié dans le Bruissement de la langue, ou encore RB par RB. Et ceux qui regrettaient ce roman sur lequel Barthes "travaillait" dans les dernières années de sa vie pouvaient à loisir consulter les fiches énigmatiques publiées dans les œuvres complètes sous le titre "Vita nova". Ici, le Seuil édite 330 fiches rédigées par Barthes après la mort de sa mère, en 1977, peu avant d’entreprendre l’écriture de La Chambre claire. Un exercice littéraire de domestication de la douleur, entre autres : "je peux, tant bien que mal (c’est-à-dire avec le sentiment de ne pas y arriver) parler [mon chagrin], le phraser. Ma culture, mon goût de l’écriture me donne ce pouvoir apotropaïque, ou d’intégration : j’intègre, par le langage". Cependant, les tics, les habituelles préciosités (italiques, vocabulaire psychanalytique, etc.) ont tôt fait de placer le lecteur en terrain familier : illisibles, ces notes ? qui prétend que le Tombeau d’Anatole de Mallarmé soit lisible ?
Lire la suite : http://ivressedupalimpseste.blogspot.com/2009/03/roland-barthes-journal-de-deuil.html
Lien : http://ivressedupalimpseste...
Comme beaucoup ,le Japon et sa culture me fascinent et je cherche des guides pour mediriger dans sa découverte . Quand j'ai ouvert , dans les années 80 ce livre de Barthes , je crus avoir trouvé le Graal doublement ébloui par le brillant de l'expression (un peu maniérée tout de même) et l'aura de l'auteur . Depuis j'ai ,grâce à d'autres lectures , pris mes distances avec l'ouvrage ,curieux hybride de récit de voyage et d'essai de sémiologie , dont les assertions sont sérieusement mis en cause (voir Simon Leys et le colloque de lINALCO en 2016) .Mais il reste agréable à lire.
Divagation d'un écrivain en Pays Japon. Telle aurait dû être le titre de ce livre.
D'habitude ravie de découvrir de nouvelles choses, ici ce ne fut pas le cas pour moi. Les chapitres, ou plutôt thème se suivent, s'entre croisent mais jamais ne s'harmonisent. Seul fil conducteur, on parle du Japon sublimé de l'auteur.
Difficile d'accès pour moi, je n'ai trouvé aucun charme à la lecture, mais sans doute cela vient t-il de mon habitude des fictions.
Un classique, dur d'accès.
D'habitude ravie de découvrir de nouvelles choses, ici ce ne fut pas le cas pour moi. Les chapitres, ou plutôt thème se suivent, s'entre croisent mais jamais ne s'harmonisent. Seul fil conducteur, on parle du Japon sublimé de l'auteur.
Difficile d'accès pour moi, je n'ai trouvé aucun charme à la lecture, mais sans doute cela vient t-il de mon habitude des fictions.
Un classique, dur d'accès.
« L'Empire des signes » est paru en 1970. Les nombreuses études sur Roland Barthes considèrent souvent cet ouvrage comme un de ses chefs d'oeuvre, un tournant décisif dans son itinéraire. Il s'inscrit dans une tradition où les auteurs ont en commun d'avoir dépeint l'orient avec des mots ou des couleurs influencés par leurs regards occidentaux. L'approche de Roland Barthes se veut novatrice tant dans la forme que du point de vue du contenu.
C'est le livre d'une époque, celle d'un état singulier des relations internationales, de la France, du Japon, alors que le monde, à peine sorti de l'après-guerre, finit de se décoloniser. « L'Empire des signes » ne prétend « en rien représenter ou analyser la moindre réalité », mais « prélever quelque part dans le monde un certain nombre de traits ». Que penser de ces éléments ainsi saisis ? de leur vraisemblance ?
Le Japon est le « pays des signes » de toutes sortes où l'étranger se trouve sans cesse dépaysé, souvent désemparé. Ce pays atteint un haut niveau de raffinement dans de nombreux domaines que Roland Barthes explore avec élégance et finesse. le livre est enrichi de nombreuses illustrations. A travers les attitudes, la nourriture, la photographie, le haïku, l'écriture, Roland Barthes échappe aux comparaisons caricaturalement binaires habituelles des auteurs occidentaux, opposant sans cesse un « chez nous » à un « là-bas » mais flatte sans réserve certains stéréotypes de l'empire du soleil levant.
Selon Maurice Pinguet, alors directeur de l'Institut franco-japonais à Tokyo : « le Japon, ce Japon, son Japon, — ce fut pour Roland Barthes l'utopie du désirable ».
C'est le livre d'une époque, celle d'un état singulier des relations internationales, de la France, du Japon, alors que le monde, à peine sorti de l'après-guerre, finit de se décoloniser. « L'Empire des signes » ne prétend « en rien représenter ou analyser la moindre réalité », mais « prélever quelque part dans le monde un certain nombre de traits ». Que penser de ces éléments ainsi saisis ? de leur vraisemblance ?
Le Japon est le « pays des signes » de toutes sortes où l'étranger se trouve sans cesse dépaysé, souvent désemparé. Ce pays atteint un haut niveau de raffinement dans de nombreux domaines que Roland Barthes explore avec élégance et finesse. le livre est enrichi de nombreuses illustrations. A travers les attitudes, la nourriture, la photographie, le haïku, l'écriture, Roland Barthes échappe aux comparaisons caricaturalement binaires habituelles des auteurs occidentaux, opposant sans cesse un « chez nous » à un « là-bas » mais flatte sans réserve certains stéréotypes de l'empire du soleil levant.
Selon Maurice Pinguet, alors directeur de l'Institut franco-japonais à Tokyo : « le Japon, ce Japon, son Japon, — ce fut pour Roland Barthes l'utopie du désirable ».
Il y a un peu de tout, comme un ensemble de méditations sur certains aspects de la culture japonaise. Il me semble toutefois (mais je ne suis pas spécialiste) qu'il fait parfois des rapprochements avec la culture occidentale un peu clichés: là-bas tout est bien, spirituel et profond et ici s'est l'inverse. Il paraît parfois un peu exalté, c'est dommage. Mais à part ça c'est bien. Le récit est bref mais présenté de manière intéressante, il y a aussi quelques illustrations sur les thèmes abordés: la langue, la nourriture, les courbettes, la gare, la paupière, le centre-ville,...
Un petit livre de Roland Barthes acheté au musée Cernuschi je crois.
Le titre et la couverture m’ont attiré étant fan du Japon
Les images sont très belles,le texte intelligent forcément même si un peu opaque pour moi.
Évidemment je manque de référence pour tout comprendre ,néanmoins j’ai apprécié cette lecture qui ne se compare à rien d’autre dans ma bibliothèque!!
Le titre et la couverture m’ont attiré étant fan du Japon
Les images sont très belles,le texte intelligent forcément même si un peu opaque pour moi.
Évidemment je manque de référence pour tout comprendre ,néanmoins j’ai apprécié cette lecture qui ne se compare à rien d’autre dans ma bibliothèque!!
Un livre très subtil et magnifiquement écrit.
Le 24 novembre 2015, conférence sur le sujet, à la Maison de la Culture du Japon à Paris : http://www.mcjp.fr/francais/conferences/l-empire-des-signes-de-roland-barthes-le-temps-d-un-recadrage/l-empire-des-signes-de-roland-barthes-le-temps-d-un-recadrage
Voyager, c'est partir à la rencontre. A la rencontre de tout autre et à l'encontre de soi. Tout autre que soi même. C'est avoir la capacité de se mettre en demeure de l'autre. Et pour approcher cet état d'esprit il faut tenter - tenter est le seul verbe acceptable, tant les archétypes de nos pensées et langage nous pétrissent - de se débarrasser de notre intelligibilité, de l' articulation de nos idées que nous avons apprise, et qui nous donnerait fausse démarche pour nous rendre « là-bas » .
Préparer un voyage s'est peut être d'abord se décharger. Se décharger de ce que nous emportons.
Savoir se préparer à Être telle une entité martienne unijambiste et manchote découvrant une boite à chaussure. Comment imaginer cette boite au delà de sa nature, et de ce fait comprendre son langage, ses fonctionnalités, l'ordre ou le désordre dans laquelle elle s'inscrit, si on ne peut penser la marche, le pied, la main, le couvercle de cette boite et donc la chaussure...Le martien, là bas aurait bien vu et même touché une boite. Boite dont il peut se représenter l'image mais non l'idée. Il pourra vous le dire avec toute sa bonne foi d'entité martienne : « j'ai vu un machin, plein de machins, d’extraordinaires machins... » Mais qu'est ce que machin vient faire « là-bas » ?... Il faut déposer les armes qui nous tiennent, qui nous donnent stature martienne.
Il faut accepter d'être nouveau né. Pas de savoir, pas de mot, pas de doute, pas de grammaire, entrer dans une autre dimension. Entrer sans comparaison, sans vouloir y placarder notre raison. Se mouvoir, en appeler à nos sens et ne vouloir jamais y traduire un sens. Roland Barthes s'est rendu en ce « là-bas ». Pour lui ce monde qui jusqu’à lors se trouvait dans l'idée, dans l'image et non dans le fait même d'exister. Et c'est à ce fait qu'il est venu connaitre ce monde, cet « empire des signes ».
Tout « martien » qui veut se rendre en « un là-bas », ou qui veut en son « là-bas » accueillir ceux qu'il nomme « martiens », et cela où que « ces là-bas » puissent se trouver, devrait avoir en tête ce livre.
Le Japon est donné à titre d'illustration. Vous ne connaitrez pas le Japon après l'avoir lu, vous ne connaitrez pas non plus le Japon de Roland Barthes. C'est un livre qui vous racontera l'expérience qu'il s'est proposé de vivre. Dans « un système symphonique inouï, entièrement dépris du nôtre ».
Un « Satori », qu'il a tenté de mettre en écrit, le compte rendu d'un événement, « un seïsme qui fait vaciller la la connaissance, et qui laisse le sujet vide de parole ». A blank. Notre culture entraîne son histoire, et notre histoire nous ramène à notre nature. Tout devient « impossible », « inconcevable », « intraduisible ». Là le sujet n'a pas sa place, mais il peut avoir conscience de sa position. Le Japon recèle d'esprits, de fantômes, d'entité célestes. Un monde fantasmagorique et fantomatique pour le martien. Lui qui n'a de cesse de positionner le sujet - qui le plus souvent n'est personne d'autre que lui même - au centre de ses phrases comment peut il concevoir que « là-bas » l'inanimé et l'animé soient totalement dissocié ? Au point que le fantôme ne fut jamais. Ne fut dans le sens auquel nous rattachons l'esprit de vie. Non il n'existe pas. La bas. Pourtant il en fait partie. C'est la syntaxe, le verbe, la structure, l'architecture du langage qui est différent. Différent au point de renverser des millénaires de concepts de pensée martienne.
Là-bas le sujet n'est pas le socle de la phrase, il n'est pas l'objet du propos, il s'intègre dans la phrase. Comme pied jambe ou œil dans un corps. Et cela entraîne un niveau de communication tout autre. Le corps est signifiant. Habitudes, gestes, postures, codes, font partie du langage de ce là- bas. La vie est une phrase, un chemin de pensée. Le manger est un acte, un fait, mais également une parole. On compose, on picore, on se livre à la becquée, on ne coupe ni ne tranche. Voilà un signe de conduite.
Rite, peut être mais sans sacralisation. D'où peut être ce rapport à la « crudité » de l'aliment. Crudité du vivant qui nous étonne, nous repousse. Car nous n'avons pas nous les martiens le même rapport entre l'animé ét l'inanimé. La bas les villes sont différentes, d'un genre qui au pays des martiens n'existe pas. Nos villes sont concentriques. Elles s'enroulent sur elle même. Nous plaçons en son centre notre réalité, notre vérité. Le cœur sur la planète des martiens doit être plein, et tout doit tendre à atteindre, à connaître et à se reconnaître en ce cœur, le centre de la cité.
Là- bas, dans une cité que nous nommons Tokyo, le centre est vide, un sacré interdit. C'est autour de ce vide central que là- bas tout se meut. On gravite autour. « Un déploiement circulaire autour d'un centre vide ». Là- bas les villes sont excentriques. Du moins elles le furent avant que ne soient rasé nombre de ville japonaises à la fin de la seconde guerre mondiale...
Le raisonnement se situe au niveau de l'espace et du volume. Sur Mars c'est la masse qui déterminera la place prise. Cela se retrouve dans les nouvelles cités du Japon puisque la modularité est l'une de leurs particularités, au même titre que celle de l'intérieur des demeures.
On peut retrouver l'écho de cette architecture mentale jusque dans la fabrication d'un cadeau. Ainsi voit on que l'enveloppe d'un paquet a valeur d'expression du sens. Les enveloppes des cadeaux sont précieux, riches, ouvragés. Et peu importe ce qu'elles contiennent. Le présent est l'objet. Dans le geste de ce qu'il signifie. Sur mars, l'enveloppe n'est que l'impression de ce qu'elle renferme. Nous cachons. La bas tout est dans la totalité du geste. Autre signe.
Et cela rappelle la structure du langage. Le sujet n'est pas le socle, au même titre que l'objet dans l’enveloppe n'est pas le présent. Il fait partie du tout.
La langue contient l'esprit. C'est ainsi que la traduction d'un texte ne peut être fidèle sans une connaissance approfondie de la culture. Interrogeons nous sur la place du verbe par exemple dans la phrase allemande. Le verbe clôt la phrase. L'action verrouille en quelque sorte. Qu'en est il de notre propre langage ? Quel est donc la colonne cérébral de notre sujet suivi de son verbe, parfois complètement noyé et non dilué dans un ou plusieurs compléments?
« Là bas » on est au sujet de ce qui se prononce, on n'est pas le sujet de ce qui est prononcé.
Ce qui là-bas permet la dilution totale du sujet dans la phrase. Cette architecture phénoménale de la pensée peut supporter de par son esprit « l’événement du Haïku ». Ce drapé de l'esprit qui dévet soudainement un des éclats du corps de la langue, cette « soie du langage », cet « événement bref qui trouve d'un coup sa forme juste ». Cette diffraction du langage qui n'est pas le reflet d'une image mais une réverbération d'un ensemble de geste. Le haïku doit être entendu comme la claquement du geste, qui n'a pas précisément de timbre propre mais qui doit permettre d'en saisir un des tons. Une note articulée. Ainsi peut on rendre possible « le geste de l'idée » et non son contraire. Ce geste de l'idée on le retrouve dans le théâtre japonais là on l'acteur qui, pour nous martiens « se travestie » en femme, n'évoque que le signifié, par une combinaison de geste. Le rôle de la femme n'est pas représentée, mais signifié. On ne joue pas d'artifice, on ne fait pas semblant d'être, on est pas, personne n'est dupe, parce que la puissance des signes suffit au signifiant pour signifier.
Aucune pensée n'est vierge, mais on peut tenter cet exercice. Ne pas juste se contenter « d'arriver à » mais espérer « d'en arrivée à ».
En lisant ce livre nous ne connaissons toujours pas le Japon, mais nous en avons peut être appris beaucoup sur nous mêmes. C'est peut être là la principale raison pour laquelle tout bon martien devrait se rendre là-bas, au sujet même de ce qu'il n'est pas, pour trouver peut être la réalité de son propre sujet.
Astrid Shriqui Garain
Préparer un voyage s'est peut être d'abord se décharger. Se décharger de ce que nous emportons.
Savoir se préparer à Être telle une entité martienne unijambiste et manchote découvrant une boite à chaussure. Comment imaginer cette boite au delà de sa nature, et de ce fait comprendre son langage, ses fonctionnalités, l'ordre ou le désordre dans laquelle elle s'inscrit, si on ne peut penser la marche, le pied, la main, le couvercle de cette boite et donc la chaussure...Le martien, là bas aurait bien vu et même touché une boite. Boite dont il peut se représenter l'image mais non l'idée. Il pourra vous le dire avec toute sa bonne foi d'entité martienne : « j'ai vu un machin, plein de machins, d’extraordinaires machins... » Mais qu'est ce que machin vient faire « là-bas » ?... Il faut déposer les armes qui nous tiennent, qui nous donnent stature martienne.
Il faut accepter d'être nouveau né. Pas de savoir, pas de mot, pas de doute, pas de grammaire, entrer dans une autre dimension. Entrer sans comparaison, sans vouloir y placarder notre raison. Se mouvoir, en appeler à nos sens et ne vouloir jamais y traduire un sens. Roland Barthes s'est rendu en ce « là-bas ». Pour lui ce monde qui jusqu’à lors se trouvait dans l'idée, dans l'image et non dans le fait même d'exister. Et c'est à ce fait qu'il est venu connaitre ce monde, cet « empire des signes ».
Tout « martien » qui veut se rendre en « un là-bas », ou qui veut en son « là-bas » accueillir ceux qu'il nomme « martiens », et cela où que « ces là-bas » puissent se trouver, devrait avoir en tête ce livre.
Le Japon est donné à titre d'illustration. Vous ne connaitrez pas le Japon après l'avoir lu, vous ne connaitrez pas non plus le Japon de Roland Barthes. C'est un livre qui vous racontera l'expérience qu'il s'est proposé de vivre. Dans « un système symphonique inouï, entièrement dépris du nôtre ».
Un « Satori », qu'il a tenté de mettre en écrit, le compte rendu d'un événement, « un seïsme qui fait vaciller la la connaissance, et qui laisse le sujet vide de parole ». A blank. Notre culture entraîne son histoire, et notre histoire nous ramène à notre nature. Tout devient « impossible », « inconcevable », « intraduisible ». Là le sujet n'a pas sa place, mais il peut avoir conscience de sa position. Le Japon recèle d'esprits, de fantômes, d'entité célestes. Un monde fantasmagorique et fantomatique pour le martien. Lui qui n'a de cesse de positionner le sujet - qui le plus souvent n'est personne d'autre que lui même - au centre de ses phrases comment peut il concevoir que « là-bas » l'inanimé et l'animé soient totalement dissocié ? Au point que le fantôme ne fut jamais. Ne fut dans le sens auquel nous rattachons l'esprit de vie. Non il n'existe pas. La bas. Pourtant il en fait partie. C'est la syntaxe, le verbe, la structure, l'architecture du langage qui est différent. Différent au point de renverser des millénaires de concepts de pensée martienne.
Là-bas le sujet n'est pas le socle de la phrase, il n'est pas l'objet du propos, il s'intègre dans la phrase. Comme pied jambe ou œil dans un corps. Et cela entraîne un niveau de communication tout autre. Le corps est signifiant. Habitudes, gestes, postures, codes, font partie du langage de ce là- bas. La vie est une phrase, un chemin de pensée. Le manger est un acte, un fait, mais également une parole. On compose, on picore, on se livre à la becquée, on ne coupe ni ne tranche. Voilà un signe de conduite.
Rite, peut être mais sans sacralisation. D'où peut être ce rapport à la « crudité » de l'aliment. Crudité du vivant qui nous étonne, nous repousse. Car nous n'avons pas nous les martiens le même rapport entre l'animé ét l'inanimé. La bas les villes sont différentes, d'un genre qui au pays des martiens n'existe pas. Nos villes sont concentriques. Elles s'enroulent sur elle même. Nous plaçons en son centre notre réalité, notre vérité. Le cœur sur la planète des martiens doit être plein, et tout doit tendre à atteindre, à connaître et à se reconnaître en ce cœur, le centre de la cité.
Là- bas, dans une cité que nous nommons Tokyo, le centre est vide, un sacré interdit. C'est autour de ce vide central que là- bas tout se meut. On gravite autour. « Un déploiement circulaire autour d'un centre vide ». Là- bas les villes sont excentriques. Du moins elles le furent avant que ne soient rasé nombre de ville japonaises à la fin de la seconde guerre mondiale...
Le raisonnement se situe au niveau de l'espace et du volume. Sur Mars c'est la masse qui déterminera la place prise. Cela se retrouve dans les nouvelles cités du Japon puisque la modularité est l'une de leurs particularités, au même titre que celle de l'intérieur des demeures.
On peut retrouver l'écho de cette architecture mentale jusque dans la fabrication d'un cadeau. Ainsi voit on que l'enveloppe d'un paquet a valeur d'expression du sens. Les enveloppes des cadeaux sont précieux, riches, ouvragés. Et peu importe ce qu'elles contiennent. Le présent est l'objet. Dans le geste de ce qu'il signifie. Sur mars, l'enveloppe n'est que l'impression de ce qu'elle renferme. Nous cachons. La bas tout est dans la totalité du geste. Autre signe.
Et cela rappelle la structure du langage. Le sujet n'est pas le socle, au même titre que l'objet dans l’enveloppe n'est pas le présent. Il fait partie du tout.
La langue contient l'esprit. C'est ainsi que la traduction d'un texte ne peut être fidèle sans une connaissance approfondie de la culture. Interrogeons nous sur la place du verbe par exemple dans la phrase allemande. Le verbe clôt la phrase. L'action verrouille en quelque sorte. Qu'en est il de notre propre langage ? Quel est donc la colonne cérébral de notre sujet suivi de son verbe, parfois complètement noyé et non dilué dans un ou plusieurs compléments?
« Là bas » on est au sujet de ce qui se prononce, on n'est pas le sujet de ce qui est prononcé.
Ce qui là-bas permet la dilution totale du sujet dans la phrase. Cette architecture phénoménale de la pensée peut supporter de par son esprit « l’événement du Haïku ». Ce drapé de l'esprit qui dévet soudainement un des éclats du corps de la langue, cette « soie du langage », cet « événement bref qui trouve d'un coup sa forme juste ». Cette diffraction du langage qui n'est pas le reflet d'une image mais une réverbération d'un ensemble de geste. Le haïku doit être entendu comme la claquement du geste, qui n'a pas précisément de timbre propre mais qui doit permettre d'en saisir un des tons. Une note articulée. Ainsi peut on rendre possible « le geste de l'idée » et non son contraire. Ce geste de l'idée on le retrouve dans le théâtre japonais là on l'acteur qui, pour nous martiens « se travestie » en femme, n'évoque que le signifié, par une combinaison de geste. Le rôle de la femme n'est pas représentée, mais signifié. On ne joue pas d'artifice, on ne fait pas semblant d'être, on est pas, personne n'est dupe, parce que la puissance des signes suffit au signifiant pour signifier.
Aucune pensée n'est vierge, mais on peut tenter cet exercice. Ne pas juste se contenter « d'arriver à » mais espérer « d'en arrivée à ».
En lisant ce livre nous ne connaissons toujours pas le Japon, mais nous en avons peut être appris beaucoup sur nous mêmes. C'est peut être là la principale raison pour laquelle tout bon martien devrait se rendre là-bas, au sujet même de ce qu'il n'est pas, pour trouver peut être la réalité de son propre sujet.
Astrid Shriqui Garain
Va-et-Vient du bout du Monde
Cette étude amoureuse du pays du soleil levant peut paraître un peu intellectuelle voire rébarbative de prime abord : le style théorisant de Roland Barthes ne gâche heureusement pas la finesse de ses observations sur le Japon.
Ce livre se présente comme des fragments d'étude comparée entre le Japon et l'Occident : preuve que la fascination qu'exerce ce pays a été (et est toujours) tenace, profonde. Les courts chapitres qui rythment la lecture sont autant de morceaux choisis de la vie quotidienne du Japonais, de la scène la plus banale au rituel le plus lointain. Ce que souligne avec brio Barthes dans cet ouvrage, c'est la différence de paradigmes et de valeur qui distinguent la culture japonaise de la culture occidentale. Sous le regard presque anthologique, on sent rapidement l'enthousiasme de l'auteur, son amour pour ce pays mystérieux, si étrange en apparence.
Comme toutes les valeurs se renversent pour le Français en voyage au Japon, l'intellectualisme de Barthes aussi se renverse dans ce livre, pour tendre vers une sensualité amoureuse, caressante. Amoureux du Japon, passionné de cultures, amateurs d'énigmes : ce livre est un amuse-bouche raffiné.
Cette étude amoureuse du pays du soleil levant peut paraître un peu intellectuelle voire rébarbative de prime abord : le style théorisant de Roland Barthes ne gâche heureusement pas la finesse de ses observations sur le Japon.
Ce livre se présente comme des fragments d'étude comparée entre le Japon et l'Occident : preuve que la fascination qu'exerce ce pays a été (et est toujours) tenace, profonde. Les courts chapitres qui rythment la lecture sont autant de morceaux choisis de la vie quotidienne du Japonais, de la scène la plus banale au rituel le plus lointain. Ce que souligne avec brio Barthes dans cet ouvrage, c'est la différence de paradigmes et de valeur qui distinguent la culture japonaise de la culture occidentale. Sous le regard presque anthologique, on sent rapidement l'enthousiasme de l'auteur, son amour pour ce pays mystérieux, si étrange en apparence.
Comme toutes les valeurs se renversent pour le Français en voyage au Japon, l'intellectualisme de Barthes aussi se renverse dans ce livre, pour tendre vers une sensualité amoureuse, caressante. Amoureux du Japon, passionné de cultures, amateurs d'énigmes : ce livre est un amuse-bouche raffiné.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Roland Barthes
Quiz
Voir plus
Le roi Arthur
Comment s'appelle l’inconnu ?
Arthur
Michel
Kay
10 questions
359 lecteurs ont répondu
Thème : Le roi Arthur de
Michael MorpurgoCréer un quiz sur cet auteur359 lecteurs ont répondu