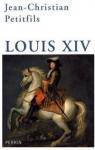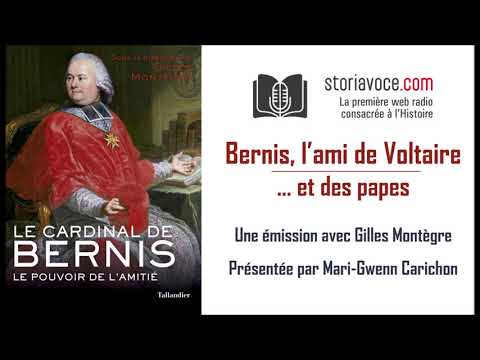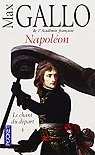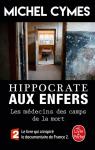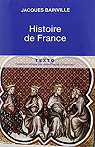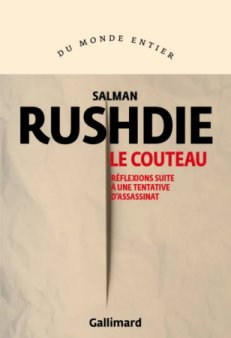Storia Voce - 27 février 2020
Bernis : l'ami de Voltaire et des papes ou le charme d'un ambassadeur
Dans ses Promenades dans Rome, Stendhal constate que l’« on parle encore à Rome du cardinal de Bernis [car] ce souvenir est l’un des plus imposants qu’aient conservés les vieillards de ce pays ». Médisances ou louanges ? on est peut-être en droit de se le demander lorsque l’on lit la littérature consacrée à ce personnage du haut clergé. Poète pour servir ses projets politiques, (il est élu à l’Académie française en 1744), le cardinal de Bernis était avant tout un homme d’Etat et un fin diplomate. Il a joué un rôle majeur dans le renversement des alliances de 1756 qui enterra la rivalité entre la France et l’Autriche des Habsbourg, un conflit qui secouait l’Europe depuis Charles Quint. Puis il devient ambassadeur de la France à Rome. Qui était vraiment ce clérical à qui la littérature a prêté des relations plus ou moins suspectes avec Casanova ? Pouvait-on présager que cet ami des Lumières s’opposerait à la Constitution civile du clergé ? Quelle leçon de diplomatie le cardinal Bernis nous apprend-il en tant que responsable des relations entre le Vatican et la France ? Comment cet homme raffiné, sensible et intuitif à t-il compris ce changement de siècle, voire de civilisation ?
Un collectif de grands historiens s’est réuni pour signer un ouvrage complet et fouillé sur le cardinal de Bernis et son rôle dans la diplomatie de la fin XVIIIème siècle. Le cardinal de Bernis, le pouvoir de l’amitié est paru en octobre 2019 aux éditions Tallandier en partenariat avec l’École française de Rome. L’ouvrage est dirigé par Gilles Montègre ici interrogé par Mari-Gwenn Carichon.
L’invité: historien, maître de conférences à l’université Grenoble-Alpes et spécialiste de la diplomatie à l’époque moderne. Il notamment signé un livre sur la Rome des Français au temps des Lumières en 2011 (Publication de l’École française de Rome) et Les circulations internationales en Europe. 1680-1780, avec Albane Cogné et Stéphane Blond (Atlande, 2011). Dans son dernier ouvrage, il nous propose un tour dans l’Europe des Lumières à travers la figure du Cardinal de Bernis : Le cardinal de Bernis, le pouvoir de l’amitié (2019, Tallandier/Publications de l’École française de Rome, 864 pages, 32.9 €).

Gilles Montègre
EAN : 9791021050136
Tallandier (15/02/2024)
/5
1 notes
Tallandier (15/02/2024)
Résumé :
Voilà une histoire entièrement renouvelée du voyage en Europe au siècle des Lumières. Suivant les pas de Voltaire, de Casanova mais aussi d’un mystérieux voyageur qui pourrait avoir été le fils caché de Montesquieu, on découvre qu’en dehors du « Grand Tour » bien connu des aristocrates, un voyage émancipateur a vu le jour, ouvrant la voie à une approche inédite de la nature et des sociétés humaines.Femmes, artisans, savants, domestiques, aventuriers ou philosophes :... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Voyager en Europe au temps des lumières: Les émotions de la libertéVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Avec le retour des beaux jours, on a comme des envies de voyage. C'est donc le moment opportun pour se demander comment voyageaient nos ancêtres au temps des Lumières. Et cela tombe bien puisque Gilles Montègre, dans cet ouvrage, répond à toutes nos questions.
Ce qui semble anecdotique aujourd'hui, c'est-à-dire se déplacer pour le plaisir de la découverte que ce soit en avion, en train ou en voiture, ne l'était pas jusqu'au XVIIIe siècle. En raison du manque de moyen de transport et des prix élevés des déplacements, les gens ne partaient pas souvent vagabonder pour le plaisir. Mais, à l'orée de l'Europe des Lumières, le voyage devient l'outil de découverte par excellence et un moyen d'évasion qui commence à se répandre. En parallèle du Grand Tour, très prisé des aristocrates, qui y voyaient un moyen de se former et de s'éduquer avant la vie active, une autre sorte de voyage voit le jour : le voyage émancipateur, celui de la découverte de la nature et des sociétés humaines.
En s'appuyant sur les écrits du Bordelais François de Paule Latapie et de 254 autres récits de voyageurs du temps des Lumières, Gilles Montègre nous livre une autre vision du voyage et de sa capacité formatrice. On découvre ainsi que le XVIIIe siècle marque l'avènement du voyage d'exploration et du tourisme, ce qui est explicité par le nombre accru de récits de voyage.
Ce livre est un retour dans le passé, dans un temps où le voyage n'était pas encore considéré comme nuisible pour la planète, où le tourisme de masse n'était pas la norme et où l'acte de voyager était indissociablement lié à la curiosité intellectuelle et à une recherche de connaissances. Ainsi, je vous recommande ce livre pour découvrir, au delà du Grand Tour, les prémices du voyage d'exploration.
Ce qui semble anecdotique aujourd'hui, c'est-à-dire se déplacer pour le plaisir de la découverte que ce soit en avion, en train ou en voiture, ne l'était pas jusqu'au XVIIIe siècle. En raison du manque de moyen de transport et des prix élevés des déplacements, les gens ne partaient pas souvent vagabonder pour le plaisir. Mais, à l'orée de l'Europe des Lumières, le voyage devient l'outil de découverte par excellence et un moyen d'évasion qui commence à se répandre. En parallèle du Grand Tour, très prisé des aristocrates, qui y voyaient un moyen de se former et de s'éduquer avant la vie active, une autre sorte de voyage voit le jour : le voyage émancipateur, celui de la découverte de la nature et des sociétés humaines.
En s'appuyant sur les écrits du Bordelais François de Paule Latapie et de 254 autres récits de voyageurs du temps des Lumières, Gilles Montègre nous livre une autre vision du voyage et de sa capacité formatrice. On découvre ainsi que le XVIIIe siècle marque l'avènement du voyage d'exploration et du tourisme, ce qui est explicité par le nombre accru de récits de voyage.
Ce livre est un retour dans le passé, dans un temps où le voyage n'était pas encore considéré comme nuisible pour la planète, où le tourisme de masse n'était pas la norme et où l'acte de voyager était indissociablement lié à la curiosité intellectuelle et à une recherche de connaissances. Ainsi, je vous recommande ce livre pour découvrir, au delà du Grand Tour, les prémices du voyage d'exploration.
critiques presse (2)
Pourquoi lire « Voyager en Europe au temps des Lumières »? Pour en savourer les aléas, calèches, déboires et mauvaises routes
Lire la critique sur le site : SudOuestPresse
Un ouvrage sur l'art du voyage à travers l'Europe au XVIIIe siècle.
Lire la critique sur le site : LeFigaro
Citations et extraits (11)
Voir plus
Ajouter une citation
Dans une page de son journal de voyage, Latapie prend soin d'extraire et de traduire une phrase lue dans un ouvrage du médecin napolitain Michele Sarcone : "Tout observer n'est pas l'œuvre d'un seul, et observer n'est pas l'œuvre de tous" .
Un milliard et demi de touristes internationaux par couraient la planète en tous sens. Et en l’espace d’un instant, ils disparurent. Confinés dans nos lieux d’habitation avec l’injonction de ne les quitter que pour des raisons vitales, nous avons observé, incrédules devant nos écrans, les images fantomatiques de Times Square ou de la place Saint-Marc entièrement désertés. Ces images avaient alors assez de force pour asseoir en nous une impression fausse mais irrépressible : le monde semblait devenu immobile. Dans l’histoire longue des mobilités humaines, l’expérience née de la pandémie de 2020 doit-elle être considérée comme un épisode exceptionnel ou comme la préfiguration d’une évolution qui enjoindra à l’humanité de demeurer de plus en plus sédentaire ? Une chose déjà semble certaine : le modèle du « tourisme de masse », apparu au XXe siècle dans le sillage de la révolution des transports, est arrivé à bout de souffle.Cet essoufflement est d’abord lié à la saturation des espaces et à la dégradation des milieux naturels. Ceux qui arpentent aujourd’hui l’île de Délos forment ainsi la dernière génération de touristes à pouvoir observer à pieds secs l’un des plus importants sanctuaires de la Grèce antique : ses vestiges étant proches de l’altitude zéro, le lieu de naissance d’Apollon et Artémis sera bientôt englouti par la montée des eaux de la Méditerranée. [...]
L’essoufflement du modèle touristique revêt parallèlement une dimension philosophique. À l’heure de la cannibalisation des lieux du voyage par les mêmes enseignes de grande consommation, de l’uniformisation des espaces de visite au prisme des labels patrimoniaux, et de l’artificialisation des rencontres au gré du travestissement folklorique des populations autochtones, le dépaysement auquel aspirent les voyageurs est de moins en moins au rendez-vous. Que l’on vienne d’Europe ou de Chine, l’ère de la mobilité heureuse, insouciante et réparatrice est définitivement révolue. Dans ces circonstances, comment redonner un sens à la pratique des voyages ? Assurément, les historiens peuvent y aider, parce qu’ils savent que les voyageurs ont parcouru le monde bien avant l’époque de la révolution industrielle. Ce livre est donc une invitation à remonter le temps, à une époque où le déplacement des voyageurs n’était pas prédateur pour l’environnement, et où l’expérience du voyage était associée à une entreprise de connaissance indissolublement individuelle et collective.
(INCIPIT)
L’essoufflement du modèle touristique revêt parallèlement une dimension philosophique. À l’heure de la cannibalisation des lieux du voyage par les mêmes enseignes de grande consommation, de l’uniformisation des espaces de visite au prisme des labels patrimoniaux, et de l’artificialisation des rencontres au gré du travestissement folklorique des populations autochtones, le dépaysement auquel aspirent les voyageurs est de moins en moins au rendez-vous. Que l’on vienne d’Europe ou de Chine, l’ère de la mobilité heureuse, insouciante et réparatrice est définitivement révolue. Dans ces circonstances, comment redonner un sens à la pratique des voyages ? Assurément, les historiens peuvent y aider, parce qu’ils savent que les voyageurs ont parcouru le monde bien avant l’époque de la révolution industrielle. Ce livre est donc une invitation à remonter le temps, à une époque où le déplacement des voyageurs n’était pas prédateur pour l’environnement, et où l’expérience du voyage était associée à une entreprise de connaissance indissolublement individuelle et collective.
(INCIPIT)
Les recommandations de l'abbé de Mably, dont les écrits connaitront à l'instar de ceux de Rousseau une grande influence au am temps de la Révolution française, montrent que les philosophes considérèrent les voyageurs de leur temps comme des adjuvants essentiels pour penser la société en vue de la transformer et de la rendre plus juste. Mais les voyageurs du XVIIIe siècle, appartenant le plus souvent au monde des élites, se sont-ils vraiment donné les moyens de rencontrer ce « peuple » que les philosophes ont si souvent prétendu éclairer sans jamais véritablement le connaître ? Dans quelle mesure ces voyageurs lettrés et cultivés, à défaut d'être toujours bien nés, sont-ils parvenus à franchit des frontières non plus géographiques, mais sociales et psychologiques, afin d'explorer la société de leur temps ?
Latapie en offre de saisissants témoignages, comme lorsqu'il consacre à la « Beauté de la Méditerranée» un passage de son journal de voyage écrit au moment de la traversée maritime qui le conduit de Civitavecchia à Naples :
J'avais peu d'envie de dormir hier au soir. Je me mis à regarder la mer. C'est une superbe chose que cette longue trace brillante que laissent les vaisseaux derrière eux, C'est comme une flamme mêlée d'une infinité de diamants. Toute l'écume qui environne le vaisseau ressemble au sillon et présente un magnifique spectacle
J'avais peu d'envie de dormir hier au soir. Je me mis à regarder la mer. C'est une superbe chose que cette longue trace brillante que laissent les vaisseaux derrière eux, C'est comme une flamme mêlée d'une infinité de diamants. Toute l'écume qui environne le vaisseau ressemble au sillon et présente un magnifique spectacle
Les milieux naturels en général et la montagne en particulier n'ont certes pas attendu le siècle des Lumières pour être appréhendés, observés et étudiés. Mais le XVIIIe siècle constitue une phase d'épanouissement sans pareille de ce long apprivoisement, dans la mesure où des voyageurs viennent désormais en nombre et de très loin pour s'adonner à l'observation spécifique d'îles, de volcans, de glaciers ou de prismes basaltiques. Le regard qu'ils portent sur les richesses naturelles dont regorge le Vieux Continent se nourrit de trois approches qui se complètent, s'interpénètrent ou se contre disent, sans cependant jamais s'exclure totalement : celles de la théologie naturelle, des sciences de la Terre et du spectacle esthétique.
Videos de Gilles Montègre (3)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Gilles Montègre (1)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3230 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3230 lecteurs ont répondu