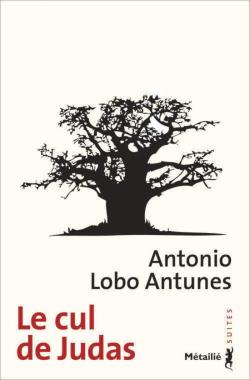Critiques filtrées sur 5 étoiles
Le Cul de Judas eut une portée retentissante à sa sortie en 1979 dans le Portugal post-Salazar. Il raconte en effet avec force le cauchemar que constitua la guerre coloniale (1961-1974) pour le pays. Antonio Lobo Antunes alors tout jeune psychiatre fraîchement marié passa vingt-sept mois de service militaire en Angola comme médecin militaire. Il revint traumatisé dans un pays qui avait entre-temps changé.
le narrateur est dans un bar, ivre d'alcool, de rage et de désespoir. Il raconte à une inconnue le voyage au coeur des ténèbres que fut pour lui son service en Angola. On peut penser à Conrad ou à Céline mais la langue d'Antunes n'a pas d'équivalent et fait toute la puissance du livre. Les phrases sont longues, riches et denses, gorgées d'images saisissantes qui vous embarquent complètement. La réalité crue est transfigurée par une créativité débordante. le ton irrévérencieux, aigre ou cynique traduit sa rage, son mépris et sa solitude.
le roman est un monologue constitué de 23 chapitres intitulés par une lettre de l'alphabet portugais. le narrateur raconte à sa confidente sa guerre de A à Z telle qu'elle lui vient par vagues successives qu'il ressasse. Sa famille confite dans les traditions militaires et le catholicisme ; ses femmes (le mariage à la va vite, la petite fille qui ne le reconnait pas, Sofia une Africaine pleine de vie) ; sa guerre dans toute son horreur vécue comme médecin : les corps torturés, piétinés, amputés, les cadavres amoncelés, les hurlements. Il tourne en dérision les corps vivants déjà morts, celui de sa confidente qui deviendra grosse, le sien futur gros chat châtré. Il parle de ce retour impossible et désespérant dans ce Portugal étroit, figé et poussiéreux qu'il oppose à l'immensité et à la beauté naturelle de l'Angola. le cul de Judas c'est bien sûr le trou pourri dans lequel on l'a jeté mais c'est aussi le cul bien gras de la Mère patrie qui l'a trahi.
Merci Chrystèle de m'avoir fait découvrir Antonio Lobo Antunes.
le narrateur est dans un bar, ivre d'alcool, de rage et de désespoir. Il raconte à une inconnue le voyage au coeur des ténèbres que fut pour lui son service en Angola. On peut penser à Conrad ou à Céline mais la langue d'Antunes n'a pas d'équivalent et fait toute la puissance du livre. Les phrases sont longues, riches et denses, gorgées d'images saisissantes qui vous embarquent complètement. La réalité crue est transfigurée par une créativité débordante. le ton irrévérencieux, aigre ou cynique traduit sa rage, son mépris et sa solitude.
le roman est un monologue constitué de 23 chapitres intitulés par une lettre de l'alphabet portugais. le narrateur raconte à sa confidente sa guerre de A à Z telle qu'elle lui vient par vagues successives qu'il ressasse. Sa famille confite dans les traditions militaires et le catholicisme ; ses femmes (le mariage à la va vite, la petite fille qui ne le reconnait pas, Sofia une Africaine pleine de vie) ; sa guerre dans toute son horreur vécue comme médecin : les corps torturés, piétinés, amputés, les cadavres amoncelés, les hurlements. Il tourne en dérision les corps vivants déjà morts, celui de sa confidente qui deviendra grosse, le sien futur gros chat châtré. Il parle de ce retour impossible et désespérant dans ce Portugal étroit, figé et poussiéreux qu'il oppose à l'immensité et à la beauté naturelle de l'Angola. le cul de Judas c'est bien sûr le trou pourri dans lequel on l'a jeté mais c'est aussi le cul bien gras de la Mère patrie qui l'a trahi.
Merci Chrystèle de m'avoir fait découvrir Antonio Lobo Antunes.
À Lisbonne, une nuit, dans un bar, un homme parle à une femme qui lui était jusqu'alors inconnue... Nous allons suivre ce narrateur omniscient dans les méandres d'un long soliloque nocturne et éthylique.
Le titre en dit déjà long... Sans avoir versé dans les saintes écritures des Évangiles, j'avais déjà une vague idée de ce versant retors de l'humanité, voilà qu'une métaphore anatomique vient préciser l'endroit où veut nous entraîner l'auteur et nous donne ainsi le ton.
Entrer dans le cul de Judas, - pardonnez-moi l'expression imagée, c'est comme entrer dans un tableau de Jérôme Bosch avec les odeurs et les effluves qui viennent jusqu'à vous et vous emportent jusqu'au bout de la nuit.
Cet homme a besoin de parler, c'est comme une catharsis. Évoquer son séjour comme médecin en Angola. Parler de ses souvenirs, c'est comme évoquer un cauchemar horrible et destructeur dont on ne revient jamais indemne. Alors il invite cette femme, son interlocutrice d'un soir, dans un voyage à la fois cru et onirique, dans cette tendresse désespérée de la nuit où nous nous apprêtons à écouter son monologue comme des passagers clandestins.
Il n'est pas besoin d'aller chercher très loin la source qui a inspiré ce livre : António Lobo Antunes a écrit le cul de Judas au cours des années qui ont suivi son retour, en 1973, de la guerre coloniale en Angola. Il y a passé vingt-sept mois, tout comme le narrateur, « vingt-sept mois d'esclavage sanglant », il en est revenu vieilli, cynique, désabusé, peut-être mort aussi, en tous cas naufragé à jamais, revenu d'une Afrique mise à feu et à sang, jeté ce soir sur le rivage de ce bar où l'alcool l'aide à délier cette parole vitale comme on tient debout, survivant parmi les cadavres en putréfaction au milieu d'un charnier.
Est-ce ainsi que les hommes rêvent d'amour, apprivoisent le désir, rencontrent le sexe et les guerres puis en reviennent avec comme seul bagage la folie avant d'être anéantis par la mort ?
Le narrateur évoque l'horreur d'un monde, mais le monde n'est pas laid, ce sont les hommes qui s'en arrangent... À quoi tient la fabrique irrationnelle des dictatures, tandis que certains s'y soumettent de bonne grâce ?
Le cul de Judas, c'est la métamorphose d'un homme dans ce monde à la dérive. Un homme qui fut enfant, qui rêva devant les animaux d'un jardin zoologique de Benfica, peut-être fuyait-il déjà les injonctions de ses tantes lui intimant de devenir un homme, un vrai, grandir, partir là-bas jeté dans la poudrière de l'Angola, découvrir les lépreux, les ventres gonflés de faim des enfants immobiles, entrevoir le silence humide des cases, rêver aux corps d'autres femmes, se saigner les doigts sur des barbelés sanglants, enjamber les membres déchiquetés par les mines, être oublié avec les siens, trahi, se sentir passif, résigné, fautif peut-être...
Tout d'abord c'est une écriture au service d'une sidération, une écriture qui m'a envoûté.
C'est une écriture imbibée d'alcools, jonchée de plaies et de furoncles nauséabonds, qui traverse les nuits putrides et tente de comprendre la cruelle inutilité de la souffrance.
Cette écriture, c'est la langue d'António Lobo Antunes, âpre, baroque, sensuelle. Dans chaque mot j'ai senti le sang battre à mes tempes. J'ai vu des processions de fantômes se lever devant moi, des spectres couverts de gangrènes qui revenaient de ce trou perdu, là-bas, oubliés. J'ai entendu les plaintes des soldats agonisants qui reviennent comme des fantômes. J'ai deviné des ténèbres inhabitées, l'insomnie des morts, la peur et le dégoût, le rire répugnant des défunts qui continuera de poursuivre le narrateur du soir au matin jusque dans ses rêves. J'ai entrevu le désir dans des chambres sordides, des lits comme des naufrages, l'abandon des corps comme un remède fugitif à la douleur inexorable qui ne se refermera jamais...
Cette écriture m'a fait penser à celle de Faulkner, de Giono, de Louis-Ferdinand Céline...
Le cul de Judas, c'est une plongée en apnée.
C'est une écriture qui dit la misère et méchanceté obstinée de la guerre, la révolte qui dénonce les exactions d'un régime colonial, c'est une écriture tordue de douleurs, de résignation mais aussi d'indignation, c'est une écriture qui dit aussi l'impossibilité d'aimer.
J'ai vu cet homme d'un soir accroché au bastingage du comptoir, comme un naufragé bousculé par les tangages de sa mémoire, si incertain d'être encore en vie.
Et puis j'ai vu brusquement cette femme africaine, Sofia, qui se tenait debout devant lui, debout parmi les morts et les survivants, comme un soleil d'Afrique, ultime rêve d'un soir, d'une passion brûlée, anéantie, ensevelie dans les décombres du temps.
Cette écriture, comme un long poème en prose, est autant traversée de rage que de lumières.
Entrer dans le cul de Judas, c'est accepter de se perdre dans l'étrange labyrinthe du passé d'un homme qui n'en est jamais revenu.
J'y ai vu un magnifique plaidoyer contre les guerres, les régimes coloniaux, contre la bêtise humaine qui fabrique les dictatures, mais c'est aussi un hymne à l'amour dans cette Afrique miraculeuse, ardente et sacrifiée.
Le cul de Judas, c'est un cri.
Le titre en dit déjà long... Sans avoir versé dans les saintes écritures des Évangiles, j'avais déjà une vague idée de ce versant retors de l'humanité, voilà qu'une métaphore anatomique vient préciser l'endroit où veut nous entraîner l'auteur et nous donne ainsi le ton.
Entrer dans le cul de Judas, - pardonnez-moi l'expression imagée, c'est comme entrer dans un tableau de Jérôme Bosch avec les odeurs et les effluves qui viennent jusqu'à vous et vous emportent jusqu'au bout de la nuit.
Cet homme a besoin de parler, c'est comme une catharsis. Évoquer son séjour comme médecin en Angola. Parler de ses souvenirs, c'est comme évoquer un cauchemar horrible et destructeur dont on ne revient jamais indemne. Alors il invite cette femme, son interlocutrice d'un soir, dans un voyage à la fois cru et onirique, dans cette tendresse désespérée de la nuit où nous nous apprêtons à écouter son monologue comme des passagers clandestins.
Il n'est pas besoin d'aller chercher très loin la source qui a inspiré ce livre : António Lobo Antunes a écrit le cul de Judas au cours des années qui ont suivi son retour, en 1973, de la guerre coloniale en Angola. Il y a passé vingt-sept mois, tout comme le narrateur, « vingt-sept mois d'esclavage sanglant », il en est revenu vieilli, cynique, désabusé, peut-être mort aussi, en tous cas naufragé à jamais, revenu d'une Afrique mise à feu et à sang, jeté ce soir sur le rivage de ce bar où l'alcool l'aide à délier cette parole vitale comme on tient debout, survivant parmi les cadavres en putréfaction au milieu d'un charnier.
Est-ce ainsi que les hommes rêvent d'amour, apprivoisent le désir, rencontrent le sexe et les guerres puis en reviennent avec comme seul bagage la folie avant d'être anéantis par la mort ?
Le narrateur évoque l'horreur d'un monde, mais le monde n'est pas laid, ce sont les hommes qui s'en arrangent... À quoi tient la fabrique irrationnelle des dictatures, tandis que certains s'y soumettent de bonne grâce ?
Le cul de Judas, c'est la métamorphose d'un homme dans ce monde à la dérive. Un homme qui fut enfant, qui rêva devant les animaux d'un jardin zoologique de Benfica, peut-être fuyait-il déjà les injonctions de ses tantes lui intimant de devenir un homme, un vrai, grandir, partir là-bas jeté dans la poudrière de l'Angola, découvrir les lépreux, les ventres gonflés de faim des enfants immobiles, entrevoir le silence humide des cases, rêver aux corps d'autres femmes, se saigner les doigts sur des barbelés sanglants, enjamber les membres déchiquetés par les mines, être oublié avec les siens, trahi, se sentir passif, résigné, fautif peut-être...
Tout d'abord c'est une écriture au service d'une sidération, une écriture qui m'a envoûté.
C'est une écriture imbibée d'alcools, jonchée de plaies et de furoncles nauséabonds, qui traverse les nuits putrides et tente de comprendre la cruelle inutilité de la souffrance.
Cette écriture, c'est la langue d'António Lobo Antunes, âpre, baroque, sensuelle. Dans chaque mot j'ai senti le sang battre à mes tempes. J'ai vu des processions de fantômes se lever devant moi, des spectres couverts de gangrènes qui revenaient de ce trou perdu, là-bas, oubliés. J'ai entendu les plaintes des soldats agonisants qui reviennent comme des fantômes. J'ai deviné des ténèbres inhabitées, l'insomnie des morts, la peur et le dégoût, le rire répugnant des défunts qui continuera de poursuivre le narrateur du soir au matin jusque dans ses rêves. J'ai entrevu le désir dans des chambres sordides, des lits comme des naufrages, l'abandon des corps comme un remède fugitif à la douleur inexorable qui ne se refermera jamais...
Cette écriture m'a fait penser à celle de Faulkner, de Giono, de Louis-Ferdinand Céline...
Le cul de Judas, c'est une plongée en apnée.
C'est une écriture qui dit la misère et méchanceté obstinée de la guerre, la révolte qui dénonce les exactions d'un régime colonial, c'est une écriture tordue de douleurs, de résignation mais aussi d'indignation, c'est une écriture qui dit aussi l'impossibilité d'aimer.
J'ai vu cet homme d'un soir accroché au bastingage du comptoir, comme un naufragé bousculé par les tangages de sa mémoire, si incertain d'être encore en vie.
Et puis j'ai vu brusquement cette femme africaine, Sofia, qui se tenait debout devant lui, debout parmi les morts et les survivants, comme un soleil d'Afrique, ultime rêve d'un soir, d'une passion brûlée, anéantie, ensevelie dans les décombres du temps.
Cette écriture, comme un long poème en prose, est autant traversée de rage que de lumières.
Entrer dans le cul de Judas, c'est accepter de se perdre dans l'étrange labyrinthe du passé d'un homme qui n'en est jamais revenu.
J'y ai vu un magnifique plaidoyer contre les guerres, les régimes coloniaux, contre la bêtise humaine qui fabrique les dictatures, mais c'est aussi un hymne à l'amour dans cette Afrique miraculeuse, ardente et sacrifiée.
Le cul de Judas, c'est un cri.
Je découvre depuis peu la littérature portugaise.
Après José Saramago et le titre « L'aveuglement » qui lui a valu le prix Nobel de littérature, j'ai eu envie de lire António Lobo Antunes, l'auteur préféré d'une amie sur Babelio. Je remercie mes ami.es Babelionautes pour cette lecture partagée riche d'échanges constructifs.
*
« le cul de Judas » est une oeuvre poignante qui sonne tellement juste que je suis allée voir lire très succinctement la biographie de l'auteur : j'ai appris que António Lobo Antunes avait suivi des études de médecine avec une spécialisation en psychiatrie avant de débuter une carrière d'écrivain. Dans les années 70, il a été envoyé en Angola en tant que médecin et cette expérience de la guerre lui a servi de base pour plusieurs de ces romans, dont « le cul de Judas » publié en 1979.
Dans un style sombre et douloureux, morcelé et écorché, Antonio Lobo Antunes raconte les souvenirs de la guerre coloniale en Angola du point de vue d'un ancien médecin militaire portugais venu y faire son service militaire entre 1971 et 1973.
Le narrateur rencontre une femme dans un bar à Lisbonne et durant toute la nuit, entre boissons et sexe dénué de sens, il décrit la violence meurtrière dont il a été témoin : la souffrance et l'agonie des blessés, les relations détachées et froides avec les autres soldats, l'abus d'alcool, ses liens avec la population locale, avec les femmes.
« Attendez encore un peu, laissez-moi vous enlacer lentement, sentir le battement de vos veines sur mon ventre, la croissance de la vague de désir qui se répand sur notre peau et qui chante, les jambes qui pédalent sur les draps et qui attendent, anxieuses. Laissez la chambre se peupler des sons ténus des gémissements qui cherchent une bouche pour s'y ancrer. Laissez-moi revenir d'Afrique et me sentir heureux, presque heureux, vous caressant les fesses, le dos, l'intérieur frais et doux des jambes, à la fois tendre et ferme comme un fruit. Laissez-moi oublier en vous regardant bien, ce que je n'arrive pas à oublier : la violence meurtrière sur la terre enceinte de l'Afrique, et prenez-moi dans vous quand du cercle de mes prunelles étonnées, tachées du désir de vous dont je suis fait maintenant, surgiront les orbites concaves de faim des enfants des villages noirs, suspendus aux barbelés, tendant vers vos seins blancs, dans le matin de Lisbonne, leurs boîtes en fer rouillées. »
Dans ce long monologue intérieur de 200 pages, il remonte également dans des souvenirs plus lointains, ceux de son enfance et de sa jeunesse dans la Lisbonne salazariste.
« … il pleuvait, et nous allions mourir, nous allions mourir et il pleuvait, il pleuvait, et assis dans la cabine de la camionnette, à côté du chauffeur, le béret sur les yeux, la vibration d'une cigarette infinie à la main, j'ai commencé mon douloureux apprentissage de l'agonie. »
*
En ouvrant la première page du livre, c'est une phrase immense qui m'a cueillie, un flot de mots qui s'écoule et serpente comme un long fleuve impétueux et puissant. J'ai été emportée par sa force, attirée dans les profondeurs de son lit, ballottée dans ses courants qui s'inversent et bondissent sans cesse entre passé et présent, entre l'Angola et Lisbonne.
Ce roman m'a donné l'impression d'être enfermée dans un huis-clos à ciel ouvert : je me suis sentie oppressée par les souvenirs obsessionnels et traumatisants de son personnage que la guerre a détruits ; par ses états d'âme et sa conscience ; par ses valeurs brisées dans la violence sourde, en suspension ; par l'inquiétude et la solitude ambiantes qui posent leur chape de plomb.
L'atmosphère est lourde, dense, tellement immersive que c'est comme si j'entendais le bruit des armes, le silence révolté des morts ; c'est comme si je sentais les odeurs corporelles, celle des corps en décomposition ; c'est comme si je voyais l'inexprimable misère des Angolais ; c'est comme si je me sentais également prisonnière des barbelés du camp militaire, naufragée de mon histoire, engluée dans l'inquiétude et la monotonie de jours sans fin.
Et en même temps, très étrangement, l'écriture de l'auteur, riche en métaphores et figures de style, saturée de couleurs, d'odeurs et de sonorités, crée une ambiance poétique, onirique presque irréelle. Réalité et fantasmes, poésie et macabre, ombre et lumière, sexe et corps suppliciés se mélangent dans de magnifiques flux de conscience.
Mais malgré la beauté du texte, je garde cette impression de pessimisme, de tristesse, de résignation. Dans ce monde, la réalité est angoissante, vertigineuse, cauchemardesque. Il n'y a pas d'espoir, seulement des désillusions et de l'amertume, seulement une béance, un vide.
Vide de sens. Vide d'amour. Vide de sentiments.
« Là, pendant un an, nous sommes morts, non pas de la mort de la guerre qui nous dépeuple soudain le crâne dans un fracas fulminant et laisse autour de soi un désert désarticulé de gémissements et une confusion de panique et de coups de feu, mais de la lente, angoissante, torturante agonie de l'attente, l'attente des mois, l'attente des mines sur la piste, l'attente du paludisme, l'attente du chaque-fois-plus-improbable retour avec famille et amis à l'aéroport ou sur le quai, l'attente du courrier, l'attente de la jeep de la PIDE qui passait hebdomadairement en allant vers les informateurs de la frontière, et qui transportait trois ou quatre prisonniers qui creusaient leur propre fosse, s'y tassaient, fermaient les yeux avec force, et s'écroulaient après la balle comme un soufflé qui s'affaisse, une fleur rouge de sang ouvrant ses pétales sur leur front… »
*
En effet, le style d'Antonio Lobo Antunes est très original et m'a particulièrement plu. Je dirais même que j'ai eu un coup de coeur pour cette écriture très sensorielle, intimiste, violente, crue qui s'affranchit de la syntaxe et de la ponctuation.
Pourtant, ce récit non linéaire et fragmenté m'a demandé des efforts de concentration et un temps d'adaptation. Mais, comme bien souvent, ce sont les livres complexes qui au final se révèlent les plus beaux. J'ai réussi à trouver un rythme, une musicalité dans cette narration inhabituelle faite de longues phrases libres de la ponctuation, d'images et de personnifications, de sauts dans le temps et dans la pensée.
*
Le titre reprend une expression très familière, voire vulgaire, pour évoquer l'Angola et cette région perdue au milieu de nulle part où le narrateur a vécu pendant vingt-cinq mois.
Il fait aussi référence aux sentiments de cet homme qui s'est senti abandonné, isolé, perdu, trahi.
« J'en avais marre, Sofia, et tout mon corps implorait le calme que l'on ne rencontre que dans les corps sereins des femmes, dans la courbure des épaules des femmes où nous pouvons reposer notre désespoir et notre peur, dans la tendresse sans sarcasme des femmes, dans leur douce générosité, concave comme un berceau pour mon angoisse d'homme, mon angoisse chargée de la haine de l'homme seul, le poids insupportable de ma propre mort sur le dos. »
Ainsi, le roman explore la mémoire à travers les souvenirs indélébiles et traumatisants du narrateur, l'identité et la condition humaine, l'isolement et l'aliénation, l'absurdité de la guerre.
L'auteur exprime sa rancoeur face à l'indifférence des politiciens portugais qui n'ont pas hésité à envoyer à la guerre de jeunes soldats tout juste sortis de l'adolescence et à en faire de la chair à canon.
Mais face à l'homme qu'il est devenu, il ne cache pas non plus sa honte, sa culpabilité, son dénuement. Dans un jeu de miroir, l'homme se met littéralement à nu et montre combien il se sent seul, faible, torturé, lâche, médiocre, soumis, démuni face à l'inhumanité, aux maladies, à l'ennui du quotidien qui tuent autant que les combats.
« … nous promenions sur la piste de sable autour de la caserne nos rêves incommunicables, notre angoisse sans forme, nos passés vus par le petit bout de la lorgnette que sont les lettres et les photos gardées au fond des valises, sous le lit : vestiges préhistoriques, à partir desquels nous pouvions concevoir, tel un biologiste examinant une phalange, le monstrueux squelette de notre amertume. »
*
J'ai été sensible aux nombreuses références artistiques et littéraires, Dali, Chagall, Vermeer, Magritte, Bosch, Matisse, … Les images évoquées par les tableaux servent les propos de l'auteur avec justesse.
« … seriez-vous capable de respirer dans un tableau de Bosch, en suffoquant sous les démons, les lézards, les gnomes nés de coquilles d'oeuf, les orbites gélatineuses et effrayées ? »
*
Pour conclure, « le cul de Judas », par sa structure narrative fragmentée, par son style unique, est une expérience littéraire marquante.
Même si ce roman n'a pas été une lecture facile tant par la forme que par les émotions qu'il véhicule, j'ai aimé l'atmosphère intense et introspective, l'écriture visuelle et sensorielle, poétique et imagée.
Une jolie découverte qui donne envie d'aller plus loin et de découvrir ses autres romans pour y retrouver cette puissance narrative.
Après José Saramago et le titre « L'aveuglement » qui lui a valu le prix Nobel de littérature, j'ai eu envie de lire António Lobo Antunes, l'auteur préféré d'une amie sur Babelio. Je remercie mes ami.es Babelionautes pour cette lecture partagée riche d'échanges constructifs.
*
« le cul de Judas » est une oeuvre poignante qui sonne tellement juste que je suis allée voir lire très succinctement la biographie de l'auteur : j'ai appris que António Lobo Antunes avait suivi des études de médecine avec une spécialisation en psychiatrie avant de débuter une carrière d'écrivain. Dans les années 70, il a été envoyé en Angola en tant que médecin et cette expérience de la guerre lui a servi de base pour plusieurs de ces romans, dont « le cul de Judas » publié en 1979.
Dans un style sombre et douloureux, morcelé et écorché, Antonio Lobo Antunes raconte les souvenirs de la guerre coloniale en Angola du point de vue d'un ancien médecin militaire portugais venu y faire son service militaire entre 1971 et 1973.
Le narrateur rencontre une femme dans un bar à Lisbonne et durant toute la nuit, entre boissons et sexe dénué de sens, il décrit la violence meurtrière dont il a été témoin : la souffrance et l'agonie des blessés, les relations détachées et froides avec les autres soldats, l'abus d'alcool, ses liens avec la population locale, avec les femmes.
« Attendez encore un peu, laissez-moi vous enlacer lentement, sentir le battement de vos veines sur mon ventre, la croissance de la vague de désir qui se répand sur notre peau et qui chante, les jambes qui pédalent sur les draps et qui attendent, anxieuses. Laissez la chambre se peupler des sons ténus des gémissements qui cherchent une bouche pour s'y ancrer. Laissez-moi revenir d'Afrique et me sentir heureux, presque heureux, vous caressant les fesses, le dos, l'intérieur frais et doux des jambes, à la fois tendre et ferme comme un fruit. Laissez-moi oublier en vous regardant bien, ce que je n'arrive pas à oublier : la violence meurtrière sur la terre enceinte de l'Afrique, et prenez-moi dans vous quand du cercle de mes prunelles étonnées, tachées du désir de vous dont je suis fait maintenant, surgiront les orbites concaves de faim des enfants des villages noirs, suspendus aux barbelés, tendant vers vos seins blancs, dans le matin de Lisbonne, leurs boîtes en fer rouillées. »
Dans ce long monologue intérieur de 200 pages, il remonte également dans des souvenirs plus lointains, ceux de son enfance et de sa jeunesse dans la Lisbonne salazariste.
« … il pleuvait, et nous allions mourir, nous allions mourir et il pleuvait, il pleuvait, et assis dans la cabine de la camionnette, à côté du chauffeur, le béret sur les yeux, la vibration d'une cigarette infinie à la main, j'ai commencé mon douloureux apprentissage de l'agonie. »
*
En ouvrant la première page du livre, c'est une phrase immense qui m'a cueillie, un flot de mots qui s'écoule et serpente comme un long fleuve impétueux et puissant. J'ai été emportée par sa force, attirée dans les profondeurs de son lit, ballottée dans ses courants qui s'inversent et bondissent sans cesse entre passé et présent, entre l'Angola et Lisbonne.
Ce roman m'a donné l'impression d'être enfermée dans un huis-clos à ciel ouvert : je me suis sentie oppressée par les souvenirs obsessionnels et traumatisants de son personnage que la guerre a détruits ; par ses états d'âme et sa conscience ; par ses valeurs brisées dans la violence sourde, en suspension ; par l'inquiétude et la solitude ambiantes qui posent leur chape de plomb.
L'atmosphère est lourde, dense, tellement immersive que c'est comme si j'entendais le bruit des armes, le silence révolté des morts ; c'est comme si je sentais les odeurs corporelles, celle des corps en décomposition ; c'est comme si je voyais l'inexprimable misère des Angolais ; c'est comme si je me sentais également prisonnière des barbelés du camp militaire, naufragée de mon histoire, engluée dans l'inquiétude et la monotonie de jours sans fin.
Et en même temps, très étrangement, l'écriture de l'auteur, riche en métaphores et figures de style, saturée de couleurs, d'odeurs et de sonorités, crée une ambiance poétique, onirique presque irréelle. Réalité et fantasmes, poésie et macabre, ombre et lumière, sexe et corps suppliciés se mélangent dans de magnifiques flux de conscience.
Mais malgré la beauté du texte, je garde cette impression de pessimisme, de tristesse, de résignation. Dans ce monde, la réalité est angoissante, vertigineuse, cauchemardesque. Il n'y a pas d'espoir, seulement des désillusions et de l'amertume, seulement une béance, un vide.
Vide de sens. Vide d'amour. Vide de sentiments.
« Là, pendant un an, nous sommes morts, non pas de la mort de la guerre qui nous dépeuple soudain le crâne dans un fracas fulminant et laisse autour de soi un désert désarticulé de gémissements et une confusion de panique et de coups de feu, mais de la lente, angoissante, torturante agonie de l'attente, l'attente des mois, l'attente des mines sur la piste, l'attente du paludisme, l'attente du chaque-fois-plus-improbable retour avec famille et amis à l'aéroport ou sur le quai, l'attente du courrier, l'attente de la jeep de la PIDE qui passait hebdomadairement en allant vers les informateurs de la frontière, et qui transportait trois ou quatre prisonniers qui creusaient leur propre fosse, s'y tassaient, fermaient les yeux avec force, et s'écroulaient après la balle comme un soufflé qui s'affaisse, une fleur rouge de sang ouvrant ses pétales sur leur front… »
*
En effet, le style d'Antonio Lobo Antunes est très original et m'a particulièrement plu. Je dirais même que j'ai eu un coup de coeur pour cette écriture très sensorielle, intimiste, violente, crue qui s'affranchit de la syntaxe et de la ponctuation.
Pourtant, ce récit non linéaire et fragmenté m'a demandé des efforts de concentration et un temps d'adaptation. Mais, comme bien souvent, ce sont les livres complexes qui au final se révèlent les plus beaux. J'ai réussi à trouver un rythme, une musicalité dans cette narration inhabituelle faite de longues phrases libres de la ponctuation, d'images et de personnifications, de sauts dans le temps et dans la pensée.
*
Le titre reprend une expression très familière, voire vulgaire, pour évoquer l'Angola et cette région perdue au milieu de nulle part où le narrateur a vécu pendant vingt-cinq mois.
Il fait aussi référence aux sentiments de cet homme qui s'est senti abandonné, isolé, perdu, trahi.
« J'en avais marre, Sofia, et tout mon corps implorait le calme que l'on ne rencontre que dans les corps sereins des femmes, dans la courbure des épaules des femmes où nous pouvons reposer notre désespoir et notre peur, dans la tendresse sans sarcasme des femmes, dans leur douce générosité, concave comme un berceau pour mon angoisse d'homme, mon angoisse chargée de la haine de l'homme seul, le poids insupportable de ma propre mort sur le dos. »
Ainsi, le roman explore la mémoire à travers les souvenirs indélébiles et traumatisants du narrateur, l'identité et la condition humaine, l'isolement et l'aliénation, l'absurdité de la guerre.
L'auteur exprime sa rancoeur face à l'indifférence des politiciens portugais qui n'ont pas hésité à envoyer à la guerre de jeunes soldats tout juste sortis de l'adolescence et à en faire de la chair à canon.
Mais face à l'homme qu'il est devenu, il ne cache pas non plus sa honte, sa culpabilité, son dénuement. Dans un jeu de miroir, l'homme se met littéralement à nu et montre combien il se sent seul, faible, torturé, lâche, médiocre, soumis, démuni face à l'inhumanité, aux maladies, à l'ennui du quotidien qui tuent autant que les combats.
« … nous promenions sur la piste de sable autour de la caserne nos rêves incommunicables, notre angoisse sans forme, nos passés vus par le petit bout de la lorgnette que sont les lettres et les photos gardées au fond des valises, sous le lit : vestiges préhistoriques, à partir desquels nous pouvions concevoir, tel un biologiste examinant une phalange, le monstrueux squelette de notre amertume. »
*
J'ai été sensible aux nombreuses références artistiques et littéraires, Dali, Chagall, Vermeer, Magritte, Bosch, Matisse, … Les images évoquées par les tableaux servent les propos de l'auteur avec justesse.
« … seriez-vous capable de respirer dans un tableau de Bosch, en suffoquant sous les démons, les lézards, les gnomes nés de coquilles d'oeuf, les orbites gélatineuses et effrayées ? »
*
Pour conclure, « le cul de Judas », par sa structure narrative fragmentée, par son style unique, est une expérience littéraire marquante.
Même si ce roman n'a pas été une lecture facile tant par la forme que par les émotions qu'il véhicule, j'ai aimé l'atmosphère intense et introspective, l'écriture visuelle et sensorielle, poétique et imagée.
Une jolie découverte qui donne envie d'aller plus loin et de découvrir ses autres romans pour y retrouver cette puissance narrative.
J'ai d'abord vu ce texte - en fait un long monologue éthylique et halluciné- au théâtre.Quand il est dit par un acteur extraordinaire, un texte paraît toujours extraordinaire. On est donc parfois déçu quand on le lit: ce n'était que cela? la magie du jeu ou de la mise en scène, nous a fait prendre des vessies pour des lanternes. J'ai donc acheté le cul de Judas, et l'ai lu, d'une traite, comme on plonge, sur un coup de tête, d'un rocher très haut, très tourmenté, sans voir s'il y a du fond...ou des récifs...
Plongeon en apnée, plongeon en eau profonde, tourbillon de sensations fortes...j'ai dû palmer très fort pour remonter de ce gouffre-là (oui, je sais, elle est con, ma métaphore, on ne plonge pas avec des palmes, mais vous avez compris! )
Toute l'horreur de la colonisation dans les remugles de l'alcool et du dégoût de soi...
Le Narrateur, ancien médecin aux armées, parle à une inconnue,un soir, dans un bar, et , entre deux bouteilles de whisky, il lui dit son désespoir, son enfer dans ce "cul de Judas", le bourbier angolais où s'est enferrée l'armée coloniale portugaise au début des années 1970.
Il a tenté d'exercer la médecine et d'oublier la femme qu'il a aimée et perdue, se sent rempli de honte devant les peuples misérables auxquels eux, les colons, n'ont apporté que le malheur et la déchéance...
C'est toute la colonisation qui se trouve ici mise en accusation et vomie dans un torrent de paroles pleines de boue et d'injure.
On ne sort pas indemne de cette lecture-là, pas plus qu'on ne sort indemne du spectacle bouleversant qu'en a tiré le comédien François Duval...
Plongeon en apnée, plongeon en eau profonde, tourbillon de sensations fortes...j'ai dû palmer très fort pour remonter de ce gouffre-là (oui, je sais, elle est con, ma métaphore, on ne plonge pas avec des palmes, mais vous avez compris! )
Toute l'horreur de la colonisation dans les remugles de l'alcool et du dégoût de soi...
Le Narrateur, ancien médecin aux armées, parle à une inconnue,un soir, dans un bar, et , entre deux bouteilles de whisky, il lui dit son désespoir, son enfer dans ce "cul de Judas", le bourbier angolais où s'est enferrée l'armée coloniale portugaise au début des années 1970.
Il a tenté d'exercer la médecine et d'oublier la femme qu'il a aimée et perdue, se sent rempli de honte devant les peuples misérables auxquels eux, les colons, n'ont apporté que le malheur et la déchéance...
C'est toute la colonisation qui se trouve ici mise en accusation et vomie dans un torrent de paroles pleines de boue et d'injure.
On ne sort pas indemne de cette lecture-là, pas plus qu'on ne sort indemne du spectacle bouleversant qu'en a tiré le comédien François Duval...
Merci à Nastasia-B et mcd30 de m'avoir fait connaître cet auteur même si nos avis peuvent différer du tout au tout.
Dès la première phrase, les mots, telle une jungle de plantes exotiques, de sombres algues ou de solides lianes, s'élèvent inexorablement depuis le sol narratif pour enlacer nos membres, nos bras, nos mains qui s'accrochent désespérément aux pages du livre, et nous plongent sans remords dans l'atmosphère lourde de la dictature de Salazar, l'étouffante absurdité de la colonisation, dans la sanglante horreur de la répression de cette guerre d'indépendance angolaise.
Avec le jeune et encore naïf narrateur-médecin, nous tâchons, comme de proto-amphibiens qui se débattent pour atteindre la terre ferme et son air purificateur, de survivre à l'absurdité quotidienne de la guerre, nous nous débattons dans le cauchemar de ces bourreaux de l'Afrique et leurs victimes. Tout cela nous est raconté, des années plus tard, par ce même narrateur, rescapé de l'horreur et définitivement blasé, dans un monologue débité à une femme dans un bar en guise de discours de séduction.
Si le narrateur parvient à ses fins dans son effort de charmer, ce ne peut être que métaphore de notre parcours paradoxal, à nous lecteurs, captivés par le style baroque de l'écriture mais honteux de l'implacable horreur de notre passé colonial: nous restons fascinés-prisonniers de la logique absurde de ce récit comme ces animaux du jardin zoologique de Lisbonne évoqués dès la première page.
En effet, cette guerre coloniale ne peut que briser les âmes des jeunes recrues et ne leur laisser que peu de chances de revenir intacts et se bâtir un avenir paisible dans leur pays natal. Tout définitivement, chaque regard, chaque pas, chaque rencontre désormais, pour le narrateur aura cet aspect délabré, cette odeur oxydée, cette atmosphère sclérosée d'un destin brisé.
"J'écouterai à nouveau la fermentation du réfrigérateur qui ronronne de son sommeil de mammouth, les gouttes qui s'échappent du bord des robinets comme les larmes des vieux, lourdes d'une conjonctivite rouillée." nous raconte-t-il en guise de seule évocation du retour à son quotidien occidental.
Lire Lobo Antunes, c'est donc être prêt à affronter un réalisme violent tissé de perles hyper-allégoriques où s'enfilent les comparaisons et les métaphores, toujours plus étourdissantes mais sordides.
"Tout est réel : je passe ma main sur mon visage et le papier de verre de ma barbe me hérisse la peau, la vessie pleine enfle mon ventre de son liquide tiède, lourde comme foetus rond qui gémit."
Qui comparerait sa vessie à un foetus ? Quel autre écrivain ose user d'un tel réalisme pourtant si imagé ? Qui intitulerait son roman le Cul de Judas? Dites-le moi!
Comme ces colonnes de style manuélin du couvent des hiéronymes, les somptueuses phrases en volutes de Lobo Antunes nous enracinent dans cette terre féconde de brutalité pour enfin, plus que tout, nous inspirer la plus noble des empathies pour ceux des humains broyés par l'histoire, la guerre, l'impardonnable torture mentale et physique du fascisme et du pouvoir aveugle en général.
À la fin du récit, nous lecteurs, tout autant perturbés sinon brisés que le narrateur par son récit de guerre, nous ne levons plus les yeux sur notre quotidien, ne portons plus le même regard sur notre histoire mais tentons désormais de nous éveiller d'une parole qui plus que la vérité crue a su nous bouleverser.
Adieu ces souvenirs de Lisboa, adieu ces paysages du Douro. Adieu aussi ma nostalgie de la Belgique de mon enfance, tout cela repose sur un terreau de cruauté et de violence !
Dès la première phrase, les mots, telle une jungle de plantes exotiques, de sombres algues ou de solides lianes, s'élèvent inexorablement depuis le sol narratif pour enlacer nos membres, nos bras, nos mains qui s'accrochent désespérément aux pages du livre, et nous plongent sans remords dans l'atmosphère lourde de la dictature de Salazar, l'étouffante absurdité de la colonisation, dans la sanglante horreur de la répression de cette guerre d'indépendance angolaise.
Avec le jeune et encore naïf narrateur-médecin, nous tâchons, comme de proto-amphibiens qui se débattent pour atteindre la terre ferme et son air purificateur, de survivre à l'absurdité quotidienne de la guerre, nous nous débattons dans le cauchemar de ces bourreaux de l'Afrique et leurs victimes. Tout cela nous est raconté, des années plus tard, par ce même narrateur, rescapé de l'horreur et définitivement blasé, dans un monologue débité à une femme dans un bar en guise de discours de séduction.
Si le narrateur parvient à ses fins dans son effort de charmer, ce ne peut être que métaphore de notre parcours paradoxal, à nous lecteurs, captivés par le style baroque de l'écriture mais honteux de l'implacable horreur de notre passé colonial: nous restons fascinés-prisonniers de la logique absurde de ce récit comme ces animaux du jardin zoologique de Lisbonne évoqués dès la première page.
En effet, cette guerre coloniale ne peut que briser les âmes des jeunes recrues et ne leur laisser que peu de chances de revenir intacts et se bâtir un avenir paisible dans leur pays natal. Tout définitivement, chaque regard, chaque pas, chaque rencontre désormais, pour le narrateur aura cet aspect délabré, cette odeur oxydée, cette atmosphère sclérosée d'un destin brisé.
"J'écouterai à nouveau la fermentation du réfrigérateur qui ronronne de son sommeil de mammouth, les gouttes qui s'échappent du bord des robinets comme les larmes des vieux, lourdes d'une conjonctivite rouillée." nous raconte-t-il en guise de seule évocation du retour à son quotidien occidental.
Lire Lobo Antunes, c'est donc être prêt à affronter un réalisme violent tissé de perles hyper-allégoriques où s'enfilent les comparaisons et les métaphores, toujours plus étourdissantes mais sordides.
"Tout est réel : je passe ma main sur mon visage et le papier de verre de ma barbe me hérisse la peau, la vessie pleine enfle mon ventre de son liquide tiède, lourde comme foetus rond qui gémit."
Qui comparerait sa vessie à un foetus ? Quel autre écrivain ose user d'un tel réalisme pourtant si imagé ? Qui intitulerait son roman le Cul de Judas? Dites-le moi!
Comme ces colonnes de style manuélin du couvent des hiéronymes, les somptueuses phrases en volutes de Lobo Antunes nous enracinent dans cette terre féconde de brutalité pour enfin, plus que tout, nous inspirer la plus noble des empathies pour ceux des humains broyés par l'histoire, la guerre, l'impardonnable torture mentale et physique du fascisme et du pouvoir aveugle en général.
À la fin du récit, nous lecteurs, tout autant perturbés sinon brisés que le narrateur par son récit de guerre, nous ne levons plus les yeux sur notre quotidien, ne portons plus le même regard sur notre histoire mais tentons désormais de nous éveiller d'une parole qui plus que la vérité crue a su nous bouleverser.
Adieu ces souvenirs de Lisboa, adieu ces paysages du Douro. Adieu aussi ma nostalgie de la Belgique de mon enfance, tout cela repose sur un terreau de cruauté et de violence !
Lors d'une rencontre (plusieurs rencontres ?) avec une femme (plusieurs femmes ?) devant un verre (plusieurs !) à Lisbonne, le narrateur raconte ses années en Angola comme médecin militaire, pendant la guerre d'indépendance.
Le titre vous a déjà renseigné : il fait très sombre dans ce roman.
Pas au début : le narrateur est alors jeune, avec une certaine candeur, une certaine innocence il se remémore la Lisbonne de son enfance, ou bien le salon de ses tantes plein de bibelots et de napperons crochetés.
Mais au retour, finie l'innocence. Ce qu'il rapporte de la guerre, c'est une lucidité désespérée, "la lucidité sans illusions des ivrognes d'Hemingway qui sont passés, gorgée par gorgée, de l'autre côté de l'angoisse."
Lucidité face à l'inanité de cette guerre, de ces morts "au nom d'idéaux cyniques auxquels personne ne croit, un bataillon ravagé d'avoir défendu l'argent des trois ou quatre familles qui soutiennent le régime."
Son impuissance de médecin à sauver des vies. Sa honte, sa culpabilité. Et puis l'impossibilité de retrouver sa place dans le monde, le vieillissement, la solitude.
Et puis il y a l'écriture.
L'écriture de Lobo Antunes !
Vous savez, ces phrases sur lesquelles on tombe, parfois, si belles qu'on a aussitôt envie de les mettre en citation ? Dans ce roman, c'est chaque phrase qui déclenche ce sentiment ; chaque phrase, chacune d'entre elles.
Ces images saisissantes : "...des édifices de cent étages que les ascenseurs, comme des pommes d'Adam, parcourent continuellement de bas en haut en déglutitions incessantes."
Ce "délire contrôlé", évoquant un Claude Simon qui serait atteint de stress post-traumatique.
C'est seulement son deuxième roman, le délire est encore contrôlé, pas aussi halluciné que dans les romans plus tardifs ; il utilise encore la ponctuation, même.
(La première fois que j'avais lu Lobo Antunes, je m'étais dit, je m'en souviens, "ça devrait être interdit d'écrire comme ça !" Et j'en avais aussitôt, fascinée, lu un autre.)
La traduction de Pierre Léglise-Costa est très bien malgré quelques fautes d'orthographe.
Et merci à tou·tes les participant·es de cette si belle lecture commune.
Challenge gourmand (Baba au rhum : le personnage principal a un problème avec l'alcool)
Le titre vous a déjà renseigné : il fait très sombre dans ce roman.
Pas au début : le narrateur est alors jeune, avec une certaine candeur, une certaine innocence il se remémore la Lisbonne de son enfance, ou bien le salon de ses tantes plein de bibelots et de napperons crochetés.
Mais au retour, finie l'innocence. Ce qu'il rapporte de la guerre, c'est une lucidité désespérée, "la lucidité sans illusions des ivrognes d'Hemingway qui sont passés, gorgée par gorgée, de l'autre côté de l'angoisse."
Lucidité face à l'inanité de cette guerre, de ces morts "au nom d'idéaux cyniques auxquels personne ne croit, un bataillon ravagé d'avoir défendu l'argent des trois ou quatre familles qui soutiennent le régime."
Son impuissance de médecin à sauver des vies. Sa honte, sa culpabilité. Et puis l'impossibilité de retrouver sa place dans le monde, le vieillissement, la solitude.
Et puis il y a l'écriture.
L'écriture de Lobo Antunes !
Vous savez, ces phrases sur lesquelles on tombe, parfois, si belles qu'on a aussitôt envie de les mettre en citation ? Dans ce roman, c'est chaque phrase qui déclenche ce sentiment ; chaque phrase, chacune d'entre elles.
Ces images saisissantes : "...des édifices de cent étages que les ascenseurs, comme des pommes d'Adam, parcourent continuellement de bas en haut en déglutitions incessantes."
Ce "délire contrôlé", évoquant un Claude Simon qui serait atteint de stress post-traumatique.
C'est seulement son deuxième roman, le délire est encore contrôlé, pas aussi halluciné que dans les romans plus tardifs ; il utilise encore la ponctuation, même.
(La première fois que j'avais lu Lobo Antunes, je m'étais dit, je m'en souviens, "ça devrait être interdit d'écrire comme ça !" Et j'en avais aussitôt, fascinée, lu un autre.)
La traduction de Pierre Léglise-Costa est très bien malgré quelques fautes d'orthographe.
Et merci à tou·tes les participant·es de cette si belle lecture commune.
Challenge gourmand (Baba au rhum : le personnage principal a un problème avec l'alcool)
Deuxième volet d'une trilogie inspirée directement de l'expérience de l'auteur pendant la guerre d'Angola, en tant que médecin militaire, de 1971 à 1973. Avec «Mémoire d'Eléphant», «Le Cul de Judas» et «Connaissance de l'Enfer», publiés entre 1979 et 1980, Antonio Lobo Antunes bénéficiera assez rapidement d'une grande notoriété, reconnu comme étant un des auteurs les plus novateurs et importants de la littérature de langue portugaise contemporaine.
Des années plus tard, il déclarera : «un bon écrivain, c'est celui qui donne un ordre au délire». La matière première de OS CUS DE JUDAS semble être bien de cet nature-là, constituée par un flux ininterrompu de représentations mentales envahissantes, liées essentiellement aux souvenirs de guerre traumatiques de l'auteur-narrateur. Ne disposant par ailleurs de plus grand' chose qui puisse véritablement le raccrocher au présent, notamment suite à son divorce survenu peu de temps après son retour au Portugal, errant dans une «Lisbonne revisited» qu'il ne reconnaît plus et où les derniers relents nauséabonds du régime totalitaire de Salazar, juste avant sa chute définitive en 1974, empestent encore l'atmosphère et aiguisent son sentiment de révolte, le narrateur se voit malgré lui emporté par un torrent subjectif violent et désordonné, fait d'évocations douloureuses, de nihilisme et de déréliction de son être-dans-le-monde. Sa conscience s'épuise à tenter d'endiguer cette effrayante matière brute remontant par effraction, menaçant à tout moment de trouer irrémédiablement ce fragile tissu avec lequel nous essayons d'habiller quotidiennement le sentiment si délicat d'habiter le présent.
Par le truchement de l'écriture et d'une sorte de syntaxe baroque, propre aux âmes en perdition, l'auteur-narrateur recherche probablement une forme de catharsis, lui permettant de s'agripper à nouveau au moment présent et, pourquoi pas, de se projeter éventuellement dans un après-coup possible. Pourtant, en réactualisant ses souvenirs dans une superposition temporelle complexe, le présent ne peut provisoirement être conjugué qu'au futur du passé. de superbes constructions de paragraphes, hélicoïdales, époustouflantes, où les événements passés, présents et les projections futures du narrateur se confondent et s'entremêlent, parcourent ainsi ce récit, obligeant souvent le lecteur à y revenir pour être en mesure de savourer complètement toute la mystérieuse beauté qui s'en dégage. Ce sera en fin de compte par l'accumulation de figures de style, excessives, entortillées et fantasques, dans lesquels il enrobe ses souvenirs, suivant une esthétique dérisoire du désenchantement, que le narrateur cherchera à apaiser les blessures de son âme. Rien n'y fera pourtant : à chacune de ces tentatives maladroites d'exorcisme, il sera invariablement ramené aux mêmes territoires mentaux dévastés, aux mêmes zones d'ombre peuplées de morts et d'images douloureuses où son être profond s'obstine à camper.
Ainsi, aucune rédemption à l'horizon non plus pour le narrateur dans ce deuxième volume. Nous le retrouvons tel que dans «Mémoire d'Eléphant», encore prisonnier des barbelés qui avaient entouré le jeune médecin militaire terrorisé, retranché dans de positions militaires avancées, en ces culs de Judas situés au fin fond de l'Angola, particulièrement exposés aux attaques ennemies. Envoûté aussi, en même temps, par le souvenir toujours vivant des forces telluriques et vitales émanant du sol et des habitants du continent africain, forces omniprésentes malgré tous les ravages et les privations provoqués par guerre, et qui avaient exercé sur son esprit et son éducation européenne et bourgeoise une fascination dont il n'arrive plus à se départir. Aussi, OS CUS DE JUDAS poursuit et approfondit l'immersion entamée dans «Mémoire d'Eléphant».
Tout comme dans le premier roman de la trilogie, le présent et l'évènementiel n'ont guère d'importance ici. Rien ne se passe, rien ne peut se passer, ou très peu : des rencontres fortuites, des femmes de passage, une carrière professionnelle en stand by. Dans OS CUS DE JUDAS, l'intrigue se résumera encore davantage au strict minimum : un long discours adressé à une inconnue rencontrée dans un bar. Ou plutôt un long monologue (on n'entendra d'autres voix que celles du narrateur) d'où toute véritable notion d'altérité semble exclue. A un tel point que l'on finit tout de même par se demander si tout cela ne serait qu'un faux-semblant permettant au narrateur de trouver un fil rouge à ses délires et élucubrations solitaires et interminables...
En tant que lecteur, je poursuis, moi aussi médusé, la découverte de cette oeuvre convulsive, à la musicalité hypnotique et entêtante, sorte de ronde infernale, obsédante et redondante, qui, de par sa radicalité affichée et assumée, je peux le comprendre parfaitement, est susceptible d'éreinter les nerfs de certains lecteurs.
Si néanmoins, comme le prône à juste titre Antonio Lobo Antunes, un bon écrivain est celui qui saurait avant tout mettre de l'ordre à son délire, quel prodigieux auteur avons-nous là!! Quel art consommé à extraire de la beauté d'une âme à ce point asséchée par la désespérance, à puiser dans son sol rocailleux un tel lyrisme, aussi luxuriant que désabusé, aussi enivrant que vénéneux... ! Quelle ardeur ne couve-t-il sous cette couche de glace cérébrale et malgré tout protectrice, à l'intérieur de cette machinerie implacable et froide, créée par une syntaxe foisonnante, complexe, emberlificotée et s'employant à travestir systématiquement la douleur en dérision?
Pour pouvoir apprécier pleinement une telle oeuvre, il semble donc indispensable d'accepter d'être déconcerté par ce qui peut ressembler de prime abord à du désordre, à un style où la digression paraît avoir été érigée en principe général, mais qui révèlera, en filigrane, non seulement une extraordinaire acuité, mais aussi une sensibilité à fleur de peau et un formidable effort de pensée pour donner du sens et ordonner le chaos d'une réalité elle-même trop souvent borderline...
Des années plus tard, il déclarera : «un bon écrivain, c'est celui qui donne un ordre au délire». La matière première de OS CUS DE JUDAS semble être bien de cet nature-là, constituée par un flux ininterrompu de représentations mentales envahissantes, liées essentiellement aux souvenirs de guerre traumatiques de l'auteur-narrateur. Ne disposant par ailleurs de plus grand' chose qui puisse véritablement le raccrocher au présent, notamment suite à son divorce survenu peu de temps après son retour au Portugal, errant dans une «Lisbonne revisited» qu'il ne reconnaît plus et où les derniers relents nauséabonds du régime totalitaire de Salazar, juste avant sa chute définitive en 1974, empestent encore l'atmosphère et aiguisent son sentiment de révolte, le narrateur se voit malgré lui emporté par un torrent subjectif violent et désordonné, fait d'évocations douloureuses, de nihilisme et de déréliction de son être-dans-le-monde. Sa conscience s'épuise à tenter d'endiguer cette effrayante matière brute remontant par effraction, menaçant à tout moment de trouer irrémédiablement ce fragile tissu avec lequel nous essayons d'habiller quotidiennement le sentiment si délicat d'habiter le présent.
Par le truchement de l'écriture et d'une sorte de syntaxe baroque, propre aux âmes en perdition, l'auteur-narrateur recherche probablement une forme de catharsis, lui permettant de s'agripper à nouveau au moment présent et, pourquoi pas, de se projeter éventuellement dans un après-coup possible. Pourtant, en réactualisant ses souvenirs dans une superposition temporelle complexe, le présent ne peut provisoirement être conjugué qu'au futur du passé. de superbes constructions de paragraphes, hélicoïdales, époustouflantes, où les événements passés, présents et les projections futures du narrateur se confondent et s'entremêlent, parcourent ainsi ce récit, obligeant souvent le lecteur à y revenir pour être en mesure de savourer complètement toute la mystérieuse beauté qui s'en dégage. Ce sera en fin de compte par l'accumulation de figures de style, excessives, entortillées et fantasques, dans lesquels il enrobe ses souvenirs, suivant une esthétique dérisoire du désenchantement, que le narrateur cherchera à apaiser les blessures de son âme. Rien n'y fera pourtant : à chacune de ces tentatives maladroites d'exorcisme, il sera invariablement ramené aux mêmes territoires mentaux dévastés, aux mêmes zones d'ombre peuplées de morts et d'images douloureuses où son être profond s'obstine à camper.
Ainsi, aucune rédemption à l'horizon non plus pour le narrateur dans ce deuxième volume. Nous le retrouvons tel que dans «Mémoire d'Eléphant», encore prisonnier des barbelés qui avaient entouré le jeune médecin militaire terrorisé, retranché dans de positions militaires avancées, en ces culs de Judas situés au fin fond de l'Angola, particulièrement exposés aux attaques ennemies. Envoûté aussi, en même temps, par le souvenir toujours vivant des forces telluriques et vitales émanant du sol et des habitants du continent africain, forces omniprésentes malgré tous les ravages et les privations provoqués par guerre, et qui avaient exercé sur son esprit et son éducation européenne et bourgeoise une fascination dont il n'arrive plus à se départir. Aussi, OS CUS DE JUDAS poursuit et approfondit l'immersion entamée dans «Mémoire d'Eléphant».
Tout comme dans le premier roman de la trilogie, le présent et l'évènementiel n'ont guère d'importance ici. Rien ne se passe, rien ne peut se passer, ou très peu : des rencontres fortuites, des femmes de passage, une carrière professionnelle en stand by. Dans OS CUS DE JUDAS, l'intrigue se résumera encore davantage au strict minimum : un long discours adressé à une inconnue rencontrée dans un bar. Ou plutôt un long monologue (on n'entendra d'autres voix que celles du narrateur) d'où toute véritable notion d'altérité semble exclue. A un tel point que l'on finit tout de même par se demander si tout cela ne serait qu'un faux-semblant permettant au narrateur de trouver un fil rouge à ses délires et élucubrations solitaires et interminables...
En tant que lecteur, je poursuis, moi aussi médusé, la découverte de cette oeuvre convulsive, à la musicalité hypnotique et entêtante, sorte de ronde infernale, obsédante et redondante, qui, de par sa radicalité affichée et assumée, je peux le comprendre parfaitement, est susceptible d'éreinter les nerfs de certains lecteurs.
Si néanmoins, comme le prône à juste titre Antonio Lobo Antunes, un bon écrivain est celui qui saurait avant tout mettre de l'ordre à son délire, quel prodigieux auteur avons-nous là!! Quel art consommé à extraire de la beauté d'une âme à ce point asséchée par la désespérance, à puiser dans son sol rocailleux un tel lyrisme, aussi luxuriant que désabusé, aussi enivrant que vénéneux... ! Quelle ardeur ne couve-t-il sous cette couche de glace cérébrale et malgré tout protectrice, à l'intérieur de cette machinerie implacable et froide, créée par une syntaxe foisonnante, complexe, emberlificotée et s'employant à travestir systématiquement la douleur en dérision?
Pour pouvoir apprécier pleinement une telle oeuvre, il semble donc indispensable d'accepter d'être déconcerté par ce qui peut ressembler de prime abord à du désordre, à un style où la digression paraît avoir été érigée en principe général, mais qui révèlera, en filigrane, non seulement une extraordinaire acuité, mais aussi une sensibilité à fleur de peau et un formidable effort de pensée pour donner du sens et ordonner le chaos d'une réalité elle-même trop souvent borderline...
Fragments et tourments résument à eux seuls cette lecture.
Deuxième livre, pour moi, d'Antonio Lobo Antunes, et ce sont de curieux sentiments qui m'étreignent au moment de rédiger ce billet.
À la fois le bonheur de retrouver cette écriture si particulière et reconnaissable entre mille...
Comme un sentiment de manque car une fois qu'on a goûté , il y a comme une envie irrépressible de devoir y revenir...
Malgré la difficulté d'approche de son écriture, il y a un je ne sais quoi qui aimante irrésistiblement le lecteur..
Et puis c'est une lecture qui nécessite des pauses salvatrices, des échappatoires bienvenues...
Un récit décomposé en 23 chapitres de À à Z, vous allez me dire il en manque 3 et bien car jusqu'en 1990, l'alphabet portugais ne comprenait pas les lettres K, W et Y, et depuis elles ne sont utilisées que dans des cas particuliers, comme dans les mots d'origine étrangère . Et ce livre a été publié en 1979. CQFD
Fragments car on y retrouve les fragments d'une expérience de la guerre que nous livre le narrateur. Fragments d'une mémoire personnelle, mais aussi collective, que le lecteur devra tenter de reconstituer pour y trouver un fil conducteur.
Mais existe t-il un fil conducteur à l'horreur de la guerre, est-il possible d'y trouver une cohérence, alors que l'homme lui-même a sa vie qui ne tient qu'à un fil, et que sa vie n'est devenue qu'un ramassis d'incohérences, d'images, de métamorphoses au point qu'il ne se reconnaît pas lui-même :
"De sorte que, lorsque je me suis embarqué pour l'Angola, à bord d'un navire bourré de troupes, afin de devenir, enfin, un homme, la tribu reconnaissante envers le Gouvernement, qui m'offrait la possibilité de bénéficier gratuitement d'une telle métamorphose, a comparu en bloc sur le quai, consentant dans un élan de ferveur patriotique à être bousculée par une foule agitée et anonyme semblable à celle du tableau de la guillotine et qui venait là assister impuissante à sa propre mort"
Et puis il y ces tourments des questions qui restent sans réponse, et dont le narrateur ne trouve en lui-même aucune réponse :
"Le peloton qui sortait la nuit pour protéger la caserne, tapi dans les taillis ras jaunis qui poussaient dans le sable, anémiés et tordus, s'approchait dans le noir, passait sous la lampe couverte d'un abat-jour d'insectes, se dispersait sans bruit parmi les baraques des casernements, dans lesquels la profondeur du sommeil se mesurait à l'intensité de l'odeur des corps entassés au hasard comme dans les fossés d'Auschwitz, et moi, je demandais au capitaine Qu'a-t-on fait de mon peuple, Qu'a-t-on fait de nous, assis là, en attente, dans ce paysage sans mer, prisonniers de trois rangs de barbelés, dans un pays qui ne nous appartient pas, mourant de paludisme et de balles dont le parcours sifflant s'apparente à un nerf de nylon qui vibre, nourris par des colonnes aléatoires dont l'arrivée dépend de constants accidents de parcours, d'embuscades et de mines, luttant contre un ennemi invisible, contre les jours qui ne se succèdent pas et qui s'allongent indéfiniment, contre le mal du pays, contre l'indignation et le remords, contre l'épaisseur des ténèbres aussi opaques qu'un voile de deuil et que je tire par-dessus ma tête pour dormir, comme lorsque j'étais petit je le faisais avec l'ourlet du drap pour me défendre des pupilles de phosphore bleu de mes fantasmes."
Les fragments de l'art, quel qu'il soit, qui ponctuent cet ouvrage, mais des fragments comme des messages ou des réminiscences les démons de Bosch, les machines de Temps Modernes qui torturent, les joueurs de cartes de Cézanne comme un respiration, Guernica symbole ultime de la déstructuration dûe à la guerre, la dénonciation des régimes totalitaires, la cruauté dont est capable l'homme.
Les tourments de l'apprentissage de la guerre qui devient pour le narrateur un apprentissage de l'agonie qui ne touche jamais à sa fin. Il affirme à plusieurs reprises que la guerre a fait de lui un individu qu'il refuse d'être, une personne angoissée et abandonnée qui attend la mort. Les mots choisis par Antunes sont forts
"J'ai envie de vomir dans les w.-c. l'inconfort de la mort quotidienne que je porte sur moi comme une pierre d'acide dans l'estomac, qui se ramifie dans mes veines et qui glisse le long de mes membres avec une fluidité huilée de terreur." Ou encore "Évidemment, au fond, c'est notre propre mort que nous craignons en vivant celle des autres, et c'est face à elle et par elle que nous devenons docilement des lâches. "
Les fragments de l'histoire, du pays colonisateur et surtout du pays colonisé. Chacun y décrit dans les tourments ceux provoqués par les généraux qui "inventaient la guerre dont nous mourions et dont ils vivaient", et ceux qui exécutaient sans être préparés. Et ceux qui en sont les victimes, considérés par ces mêmes dirigeants comme les "projection" d'une crise identitaire nationale, d'une mémoire collective qui se délite...
À moins que ce ne soit la renaissance d'une mémoire collective trop longtemps opprimée qui soit les prémices d'une identité nationale.
L'auteur ne cache nullement ses prises de position..
Les tourments de l'innocence perdue :
"et il me semblait que la photo de moi enfant avait dévoré l'adulte que je suis et celui qui, en fait, existait véritablement c'était celui qui, avec une mèche de cheveux blonds sur un tablier à rayures, me regardait d'un air accusateur à travers le brouillard diffus des années qui nous séparaient. Nous ne sommes jamais où nous sommes, vous ne trouvez pas ?"
Et puis une fois la guerre terminée ce sont ces deux sentiments qui entrent en collision :
" Si bizarre, vous entendez, que je me demande parfois si la guerre est vraiment terminée ou si elle continue encore, quelque part dans moi avec ses odeurs dégoûtantes de sueur et de poudre et de sang, ses corps désarticulés, ses cercueils qui m'attendent. Je pense que, quand je mourrai, l'Afrique coloniale reviendra à ma rencontre, et je chercherai, en vain, dans la niche du dieu Zumbi, les yeux de bois qui n'y sont plus, que je verrai, à nouveau, la caserne de Mangando en train de se dissoudre dans la chaleur, les noirs des villages dans le lointain, la manche à air de la piste d'aviation s'envolant en signes d'au revoir moqueurs que personne ne recevait. À nouveau ce sera la nuit et je descendrai de l'unimog en direction du poste de secours où le type sans visage agonise, éclairé par le petromax qu'un caporal tient à la hauteur de ma tête et contre lequel les insectes se défont dans un petit bruit chitineux de friture."
La force de ce livre réside également dans la fait que l'auteur démontre avec maestria, que nul besoin de scènes de bataille, ni généraux empreints de gloire, ni soldats ou gradés héroïques ne sont nécessaires pour dépeindre l'absurdité de la guerre, sa violence pourtant le blessés existent bien, les destructions son bien réelles, le sadisme et la perversité ne sont jamais bien loins...
Et cette question qui claque comme une injonction : “Comment vas-tu tenir, à Lisbonne, après ce cul de Judas ?”
La réponse de nos jours serait ce que l'on appelle stress post-traumatique, les mots qui suivent en son une magnifique expression :
"À la porte du poste de secours, mal réveillé et nu, j'ai vu les soldats courir, l'arme au poing, en direction des barbelés, et ensuite les voix, les cris, les jets rouges qui sortaient des fusils qui tiraient, tout, la tension, le manque de nourriture décente, le logement précaire, l'eau que les filtres transformaient en une indigeste soupe de carton mâché, la gigantesque et incroyable absurdité de la guerre, me donnait la même sensation d'atmosphère irréelle, flottante et insolite, que j'ai trouvée plus tard dans les hôpitaux psychiatriques, îles de misère désespérantes, dont Lisbonne se défendait en les encerclant de murs et de grilles, tout comme les tissus se prémunissent contre les corps étrangers en les enveloppant de capsules de fibrose. Internés dans des infirmeries qui s'écroulaient, vêtus de l'uniforme des malades, nous promenions sur la piste de sable autour de la caserne nos rêves incommunicables, notre angoisse sans forme, nos passés vus par le petit bout de la lorgnette que sont les lettres et les photos gardées au fond des valises, sous le lit : vestiges préhistoriques, à partir desquels nous pouvions concevoir, tel un biologiste examinant une phalange, le monstrueux squelette de notre amertume."
L'auteur a écrit « Ce que je voudrais, ce n'est pas qu'on me lise, mais qu'on vive le livre. Mon but, c'est de faire en sorte que les mots signifient ces émotions.». Et bien c'est mission réussie tant c'est une lecture de laquelle on ne ressort pas indemne...
Deuxième livre, pour moi, d'Antonio Lobo Antunes, et ce sont de curieux sentiments qui m'étreignent au moment de rédiger ce billet.
À la fois le bonheur de retrouver cette écriture si particulière et reconnaissable entre mille...
Comme un sentiment de manque car une fois qu'on a goûté , il y a comme une envie irrépressible de devoir y revenir...
Malgré la difficulté d'approche de son écriture, il y a un je ne sais quoi qui aimante irrésistiblement le lecteur..
Et puis c'est une lecture qui nécessite des pauses salvatrices, des échappatoires bienvenues...
Un récit décomposé en 23 chapitres de À à Z, vous allez me dire il en manque 3 et bien car jusqu'en 1990, l'alphabet portugais ne comprenait pas les lettres K, W et Y, et depuis elles ne sont utilisées que dans des cas particuliers, comme dans les mots d'origine étrangère . Et ce livre a été publié en 1979. CQFD
Fragments car on y retrouve les fragments d'une expérience de la guerre que nous livre le narrateur. Fragments d'une mémoire personnelle, mais aussi collective, que le lecteur devra tenter de reconstituer pour y trouver un fil conducteur.
Mais existe t-il un fil conducteur à l'horreur de la guerre, est-il possible d'y trouver une cohérence, alors que l'homme lui-même a sa vie qui ne tient qu'à un fil, et que sa vie n'est devenue qu'un ramassis d'incohérences, d'images, de métamorphoses au point qu'il ne se reconnaît pas lui-même :
"De sorte que, lorsque je me suis embarqué pour l'Angola, à bord d'un navire bourré de troupes, afin de devenir, enfin, un homme, la tribu reconnaissante envers le Gouvernement, qui m'offrait la possibilité de bénéficier gratuitement d'une telle métamorphose, a comparu en bloc sur le quai, consentant dans un élan de ferveur patriotique à être bousculée par une foule agitée et anonyme semblable à celle du tableau de la guillotine et qui venait là assister impuissante à sa propre mort"
Et puis il y ces tourments des questions qui restent sans réponse, et dont le narrateur ne trouve en lui-même aucune réponse :
"Le peloton qui sortait la nuit pour protéger la caserne, tapi dans les taillis ras jaunis qui poussaient dans le sable, anémiés et tordus, s'approchait dans le noir, passait sous la lampe couverte d'un abat-jour d'insectes, se dispersait sans bruit parmi les baraques des casernements, dans lesquels la profondeur du sommeil se mesurait à l'intensité de l'odeur des corps entassés au hasard comme dans les fossés d'Auschwitz, et moi, je demandais au capitaine Qu'a-t-on fait de mon peuple, Qu'a-t-on fait de nous, assis là, en attente, dans ce paysage sans mer, prisonniers de trois rangs de barbelés, dans un pays qui ne nous appartient pas, mourant de paludisme et de balles dont le parcours sifflant s'apparente à un nerf de nylon qui vibre, nourris par des colonnes aléatoires dont l'arrivée dépend de constants accidents de parcours, d'embuscades et de mines, luttant contre un ennemi invisible, contre les jours qui ne se succèdent pas et qui s'allongent indéfiniment, contre le mal du pays, contre l'indignation et le remords, contre l'épaisseur des ténèbres aussi opaques qu'un voile de deuil et que je tire par-dessus ma tête pour dormir, comme lorsque j'étais petit je le faisais avec l'ourlet du drap pour me défendre des pupilles de phosphore bleu de mes fantasmes."
Les fragments de l'art, quel qu'il soit, qui ponctuent cet ouvrage, mais des fragments comme des messages ou des réminiscences les démons de Bosch, les machines de Temps Modernes qui torturent, les joueurs de cartes de Cézanne comme un respiration, Guernica symbole ultime de la déstructuration dûe à la guerre, la dénonciation des régimes totalitaires, la cruauté dont est capable l'homme.
Les tourments de l'apprentissage de la guerre qui devient pour le narrateur un apprentissage de l'agonie qui ne touche jamais à sa fin. Il affirme à plusieurs reprises que la guerre a fait de lui un individu qu'il refuse d'être, une personne angoissée et abandonnée qui attend la mort. Les mots choisis par Antunes sont forts
"J'ai envie de vomir dans les w.-c. l'inconfort de la mort quotidienne que je porte sur moi comme une pierre d'acide dans l'estomac, qui se ramifie dans mes veines et qui glisse le long de mes membres avec une fluidité huilée de terreur." Ou encore "Évidemment, au fond, c'est notre propre mort que nous craignons en vivant celle des autres, et c'est face à elle et par elle que nous devenons docilement des lâches. "
Les fragments de l'histoire, du pays colonisateur et surtout du pays colonisé. Chacun y décrit dans les tourments ceux provoqués par les généraux qui "inventaient la guerre dont nous mourions et dont ils vivaient", et ceux qui exécutaient sans être préparés. Et ceux qui en sont les victimes, considérés par ces mêmes dirigeants comme les "projection" d'une crise identitaire nationale, d'une mémoire collective qui se délite...
À moins que ce ne soit la renaissance d'une mémoire collective trop longtemps opprimée qui soit les prémices d'une identité nationale.
L'auteur ne cache nullement ses prises de position..
Les tourments de l'innocence perdue :
"et il me semblait que la photo de moi enfant avait dévoré l'adulte que je suis et celui qui, en fait, existait véritablement c'était celui qui, avec une mèche de cheveux blonds sur un tablier à rayures, me regardait d'un air accusateur à travers le brouillard diffus des années qui nous séparaient. Nous ne sommes jamais où nous sommes, vous ne trouvez pas ?"
Et puis une fois la guerre terminée ce sont ces deux sentiments qui entrent en collision :
" Si bizarre, vous entendez, que je me demande parfois si la guerre est vraiment terminée ou si elle continue encore, quelque part dans moi avec ses odeurs dégoûtantes de sueur et de poudre et de sang, ses corps désarticulés, ses cercueils qui m'attendent. Je pense que, quand je mourrai, l'Afrique coloniale reviendra à ma rencontre, et je chercherai, en vain, dans la niche du dieu Zumbi, les yeux de bois qui n'y sont plus, que je verrai, à nouveau, la caserne de Mangando en train de se dissoudre dans la chaleur, les noirs des villages dans le lointain, la manche à air de la piste d'aviation s'envolant en signes d'au revoir moqueurs que personne ne recevait. À nouveau ce sera la nuit et je descendrai de l'unimog en direction du poste de secours où le type sans visage agonise, éclairé par le petromax qu'un caporal tient à la hauteur de ma tête et contre lequel les insectes se défont dans un petit bruit chitineux de friture."
La force de ce livre réside également dans la fait que l'auteur démontre avec maestria, que nul besoin de scènes de bataille, ni généraux empreints de gloire, ni soldats ou gradés héroïques ne sont nécessaires pour dépeindre l'absurdité de la guerre, sa violence pourtant le blessés existent bien, les destructions son bien réelles, le sadisme et la perversité ne sont jamais bien loins...
Et cette question qui claque comme une injonction : “Comment vas-tu tenir, à Lisbonne, après ce cul de Judas ?”
La réponse de nos jours serait ce que l'on appelle stress post-traumatique, les mots qui suivent en son une magnifique expression :
"À la porte du poste de secours, mal réveillé et nu, j'ai vu les soldats courir, l'arme au poing, en direction des barbelés, et ensuite les voix, les cris, les jets rouges qui sortaient des fusils qui tiraient, tout, la tension, le manque de nourriture décente, le logement précaire, l'eau que les filtres transformaient en une indigeste soupe de carton mâché, la gigantesque et incroyable absurdité de la guerre, me donnait la même sensation d'atmosphère irréelle, flottante et insolite, que j'ai trouvée plus tard dans les hôpitaux psychiatriques, îles de misère désespérantes, dont Lisbonne se défendait en les encerclant de murs et de grilles, tout comme les tissus se prémunissent contre les corps étrangers en les enveloppant de capsules de fibrose. Internés dans des infirmeries qui s'écroulaient, vêtus de l'uniforme des malades, nous promenions sur la piste de sable autour de la caserne nos rêves incommunicables, notre angoisse sans forme, nos passés vus par le petit bout de la lorgnette que sont les lettres et les photos gardées au fond des valises, sous le lit : vestiges préhistoriques, à partir desquels nous pouvions concevoir, tel un biologiste examinant une phalange, le monstrueux squelette de notre amertume."
L'auteur a écrit « Ce que je voudrais, ce n'est pas qu'on me lise, mais qu'on vive le livre. Mon but, c'est de faire en sorte que les mots signifient ces émotions.». Et bien c'est mission réussie tant c'est une lecture de laquelle on ne ressort pas indemne...
"Si nous étions, Madame, par exemple, vous et moi, des tamanoirs…"
Et débute un long soliloque chapitré de A à Z dans lequel Antonio Lobo Antunes s'adresse à une femme inconnue rencontrée dans un bar et lui raconte , tel qu'il lui revient à la mémoire, et avec nombre digressions, son séjour en Angola comme médecin militaire pendant la guerre déclenchée par Salazar ( « une croisade pour la défense des vraies valeurs de l'Occident: la patrie historique et l'Eglise. »)
Le livre commence par des souvenirs d'enfance et d'adolescence :
« Tu es maigre… Heureusement le service militaire fera de toi un homme. »
Cette vigoureuse prophétie , transmise tout au long de mon enfance et de mon adolescence par des dentiers d'une indiscutable autorité, se prolongeait en échos stridents sur les tables de canasta autour desquelles les femelles du clan offraient à la messe du dimanche un contrepoids païen , à deux centimes le point, somme nominale qui leur servait de prétexte pour expulser des haines anciennes patiemment secrétées. Les hommes de la famille, dont la pompeuse sérénité m'avait fasciné, avant ma première communion, quand je ne comprenais pas encore que leurs conciliabules murmurés, inaccessibles et vitaux comme des Assemblées de dieux, étaient uniquement destinés à discuter les tendres mérites des fesses de la bonne, soutenaient gravement les tantes avec l'intention d'éloigner de futures mains rivales qui les pinceraient furtivement pendant que l'on desservait le spectre de Salazar faisait planer sur les calvities les pieuses petites flammes du Saint Esprit Corporatif qui nous sauverait de l'idée ténébreuse et délétère du socialisme. La P.I.D.E. poursuivait courageusement sa valeureuse croisade contre la notion sinistre de démocratie, premier pas vers la disparition de la ménagère en Christofle dans la poche avide des journaliers et des petits commis. le Cardinal Cerejeira encadré, garantissait, dans un coin, la perpétuité de la conférence de Saint Vincent de Paul et, par inhérence, celle des pauvres domestiqués. le destin qui représentait le peuple hurlant d'une joie athée autour d'une guillotine libératrice avait été définitivement exilé au grenier parmi les vieux bidets et les chaises boiteuses qu'une fente poussiéreuse de soleil auréolait du mystère qui souligne les inutilités abandonnées. de sorte que, lorsque je me suis embarqué pour l'Angola, à bord d'un navire bourré de troupes, afin de devenir, enfin, un homme, la tribu reconnaissante envers le Gouvernement, qui m'offrait la possibilité de bénéficier gratuitement d'une telle métamorphose, a comparu en bloc sur le quai, consentant dans un élan de ferveur patriotique à être bousculée par une foule agitée et anonyme semblable à celle du tableau de la guillotine et qui venait là assister impuissante à sa propre mort."
Ce long extrait du chapitre A pour donner une idée du style, mais aussi de l'ironie constante, de l'humour désespéré qui sourd de chaque page , que l'auteur parle de la guerre et de la mort, de son impuissance complète , de ce que les guerres font des gamins qu'on y envoie, mais aussi de la vieillesse, de l'usure des couples, et de ses difficultés à survivre après cette épreuve.
Mais que l'on se rassure…
"J'ai rendu visite à mes tantes quelques semaines après en endossant un costume d'avant la guerre qui flottait autour de ma taille à la manière d'une auréole tombée, malgré les efforts des bretelles qui me tiraient les jambes vers le haut comme si elles étaient armées d'une hélice invisible…
« Tu as maigri. J‘ai toujours espéré que l‘armée ferait de toi un homme, mais, avec toi, il n‘y a rien à faire. ».
Et les portraits des généraux défunts , sur les consoles, approuvaient, dans un accord féroce, l'évidence de cette disgrâce."
Ce texte , presque un long poème en prose, tant il est magnifiquement écrit, donne souvent envie de sangloter de rage devant tant de bêtise humaine.. Rien de bien nouveau sous le soleil, mais certains savent l'écrire admirablement.
Et débute un long soliloque chapitré de A à Z dans lequel Antonio Lobo Antunes s'adresse à une femme inconnue rencontrée dans un bar et lui raconte , tel qu'il lui revient à la mémoire, et avec nombre digressions, son séjour en Angola comme médecin militaire pendant la guerre déclenchée par Salazar ( « une croisade pour la défense des vraies valeurs de l'Occident: la patrie historique et l'Eglise. »)
Le livre commence par des souvenirs d'enfance et d'adolescence :
« Tu es maigre… Heureusement le service militaire fera de toi un homme. »
Cette vigoureuse prophétie , transmise tout au long de mon enfance et de mon adolescence par des dentiers d'une indiscutable autorité, se prolongeait en échos stridents sur les tables de canasta autour desquelles les femelles du clan offraient à la messe du dimanche un contrepoids païen , à deux centimes le point, somme nominale qui leur servait de prétexte pour expulser des haines anciennes patiemment secrétées. Les hommes de la famille, dont la pompeuse sérénité m'avait fasciné, avant ma première communion, quand je ne comprenais pas encore que leurs conciliabules murmurés, inaccessibles et vitaux comme des Assemblées de dieux, étaient uniquement destinés à discuter les tendres mérites des fesses de la bonne, soutenaient gravement les tantes avec l'intention d'éloigner de futures mains rivales qui les pinceraient furtivement pendant que l'on desservait le spectre de Salazar faisait planer sur les calvities les pieuses petites flammes du Saint Esprit Corporatif qui nous sauverait de l'idée ténébreuse et délétère du socialisme. La P.I.D.E. poursuivait courageusement sa valeureuse croisade contre la notion sinistre de démocratie, premier pas vers la disparition de la ménagère en Christofle dans la poche avide des journaliers et des petits commis. le Cardinal Cerejeira encadré, garantissait, dans un coin, la perpétuité de la conférence de Saint Vincent de Paul et, par inhérence, celle des pauvres domestiqués. le destin qui représentait le peuple hurlant d'une joie athée autour d'une guillotine libératrice avait été définitivement exilé au grenier parmi les vieux bidets et les chaises boiteuses qu'une fente poussiéreuse de soleil auréolait du mystère qui souligne les inutilités abandonnées. de sorte que, lorsque je me suis embarqué pour l'Angola, à bord d'un navire bourré de troupes, afin de devenir, enfin, un homme, la tribu reconnaissante envers le Gouvernement, qui m'offrait la possibilité de bénéficier gratuitement d'une telle métamorphose, a comparu en bloc sur le quai, consentant dans un élan de ferveur patriotique à être bousculée par une foule agitée et anonyme semblable à celle du tableau de la guillotine et qui venait là assister impuissante à sa propre mort."
Ce long extrait du chapitre A pour donner une idée du style, mais aussi de l'ironie constante, de l'humour désespéré qui sourd de chaque page , que l'auteur parle de la guerre et de la mort, de son impuissance complète , de ce que les guerres font des gamins qu'on y envoie, mais aussi de la vieillesse, de l'usure des couples, et de ses difficultés à survivre après cette épreuve.
Mais que l'on se rassure…
"J'ai rendu visite à mes tantes quelques semaines après en endossant un costume d'avant la guerre qui flottait autour de ma taille à la manière d'une auréole tombée, malgré les efforts des bretelles qui me tiraient les jambes vers le haut comme si elles étaient armées d'une hélice invisible…
« Tu as maigri. J‘ai toujours espéré que l‘armée ferait de toi un homme, mais, avec toi, il n‘y a rien à faire. ».
Et les portraits des généraux défunts , sur les consoles, approuvaient, dans un accord féroce, l'évidence de cette disgrâce."
Ce texte , presque un long poème en prose, tant il est magnifiquement écrit, donne souvent envie de sangloter de rage devant tant de bêtise humaine.. Rien de bien nouveau sous le soleil, mais certains savent l'écrire admirablement.
Soliloque alcoolisé accoudé au zinc d'un bar de Lisbonne pour charmer une femme aux formes s'épanouissant au travers d'un verre de whisky qui se vide. Mais cherche-t-on réellement à séduire ? Non on ne s'illusionne plus sur les sentiments : on veut son carré de peau qu'on va pouvoir faire épanouir au rythme de ses propres pulsions. Car notre homme en a dans la besace, de quoi vous en faire dégorger les égouts de la Praça do Commércio des immondices en tous genres qui jonchent ses pensées. Pensées croupies dans cette sale guerre en Angola, borborygmes et flatulence de ce cul de Judas, soumission à l'incurie des généraux et à une société soumise dans une société uchronique où le goupillon dégoupille la grenade, et surtout foutre froid en ébullition distillant une solitude toujours plus difficile à voiler … Ce qui est vrai est palpable : le sexe moussu d'une femme mais aussi la jambe sectionnée par une mine, les boyaux à l'air …
Lobo Antunes, médecin perdu dans une sale guerre, fruit blet malade de cette société aux repères transcris dans une parodie de saints sacrements, m'a rappelé un certain Bardamu qui aurait étrangement reparu dans les années 70 dans le Portugal de Salazar …
Grand moment de lecture que je ne saurais toutefois conseiller à tous : le style est syncopé et il faut savoir plonger dans un chapitre sans pouvoir reprendre son souffle au risque de se retrouver complètement perdu (dans ce cul de Judas …)
Lobo Antunes, médecin perdu dans une sale guerre, fruit blet malade de cette société aux repères transcris dans une parodie de saints sacrements, m'a rappelé un certain Bardamu qui aurait étrangement reparu dans les années 70 dans le Portugal de Salazar …
Grand moment de lecture que je ne saurais toutefois conseiller à tous : le style est syncopé et il faut savoir plonger dans un chapitre sans pouvoir reprendre son souffle au risque de se retrouver complètement perdu (dans ce cul de Judas …)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Antonio Lobo Antunes (33)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Titres d'oeuvres célèbres à compléter
Ce conte philosophique de Voltaire, paru à Genève en 1759, s'intitule : "Candide ou --------"
L'Ardeur
L'Optimisme
10 questions
1295 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature française
, roman
, culture générale
, théâtre
, littérature
, livresCréer un quiz sur ce livre1295 lecteurs ont répondu