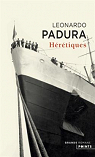Critiques filtrées sur 5 étoiles
L'eau de toutes parts c'est Leonardo Padura en personne. Qu'est-ce que vivre et écrire à Cuba. L'écrivain naît à Cuba et Cuba naît à son tour de Leonardo. Pourquoi êtes-vous resté à Cuba ? lui demande-t-on, plutôt que : pourquoi avez-vous quitté Cuba ? devrait-on formuler si toutefois il l'avait quitté, plus logiquement. Si quelqu'un meurt et qu'on aille le retrouver dans quelques pays, partant de souvenirs très précis, du concret solide de la mémoire, nous trouverons alors un paysage de désolation où chaque évocation sera amputée de l'âme de celui qu'on recherche et au plus haut degré s'il fut aimé. Il en est ainsi de l'être comme du pays, si bien que désillusionné, il vaut mieux rester en immersion de son destin comme de sa destinée. Partir c'est aussi revêtir une enveloppe supplémentaire d'expérience et de savoir, c'est progresser et s'enrichir mais c'est aussi s'emporter soi-même avec sa vérité et ses racines et fabriquer un tout de l'être et du pays ; ou, s'établir parfois dans un autre lieu car l'attachement n'a pas de frontière, seule l'identité perdure. La maison de Leonardo lui échoit de son père comme un héritage culturel dont il est lui-même la continuité et le lien historique. Ainsi nous parlera-t-il de sa ville, Mantilla, du parnassien José-Maria de Heredia, de José Lezama et de ses proches, amis, poètes, écrivains qui se reconnaissent chacun à leur façon d'une oeuvre littéraire différente et à la fois complémentaire. Mais aussi de découvrir, José María Heredia y Campuzano né à Santiago de Cuba en 1803 et décédé en 1839 au Mexique où il vécut en exil. Ce cousin germain De Heredia cité plus haut, fut le précurseur de la poésie cubaine et de l'âme patriotique qui lui naît de l'amour pour son pays. Il mourra peu après avoir revu Cuba qu'il emporte en au-delà. Cet aspect du choix de la patrie du tout jeune poète Heredia est absolument passionnant car, il résulte de la période historique d'un pays tout juste naissant et d'un homme, tous deux en constante évolution, mais qui se rejoignent toujours sous l'effet d'une imprégnation identitaire et affective, politique et culturelle. Puis, il invite au rappel de la réhabilitation posthume du poète dramaturge, Virgilio Piñera, récompensé en 1968 puis interdit de publication jusqu'à sa mort par le régime castriste, pour cause d'homosexualité.
Comme l'aurait dit José Martí, relève l'auteur : « Un aigle a survolé la mer », et près de 50 ans plus tard, de la batte et de la balle, il a substitué le foot, tué la musique et muselé la culture, soit dénaturé l'identité populaire tout cela accompagné d'une crise économique majeure, quoi de mieux pour s'octroyer la domination d'un peuple, le livrer à la décadence et à l'opprobre. Ainsi fut fait de Cuba qui perdit beaucoup de ses élites. Mais : « la vie est plus vaste » sur le plan éthique, souligne Gregorio Marañón, car oui, après un demi-siècle de grande crise du socialisme, l'ancestrale démesure nationale cubaine pousse les gens à chercher la normalité accessible ou la plus simple expression de la vie, boire une bière, écouter de la musique, faire avec, et se désintéresser de toute probation, de tout penchant vers la politique. Même si, même si l'espoir et le rêve du changement subsistent. Mais vivre ! S'attacher au réel, quel qu'il soit.
Vivre et écrire à Cuba s'est aussi s'atteler à franchir non pas le Rubicon mais le Malecón, cet asphalte de front de mer de 8 kilomètres de long qui sépare la ville de l'océan, afin que les mots nous atteignent, nous, et franchissent les domaines de l'universalité, puisqu'ici, à la Havane, il faut affronter l'insularité littéraire. Ainsi, quand l'auteur nous invite en son for intérieur, passant le pont-levis nous découvrons un personnage fort attachant. Et, lorsqu'on demande à Paul Auster de faire une analyse sur la situation de son pays, Leonardo Padura fait le constat que les questions qui lui sont soumises ne sont pas celles proposées au grand Paul quant au Cubain dont il se revendique, ce qui n'entache nullement l'admiration respectueuse qu'il voue à cet écrivain, comme d'ailleurs, à ses homologues en général. Pourtant le talent égalé de Leonardo Padura devrait être mis en exergue quand on songe aux outils mis à sa disposition et aux nombreux bouleversements qui l'empêchèrent de rejoindre Paris, par exemple, qui fut l'école de la vie de bon nombre d'écrivains et le fait de ne pas pouvoir franchir les frontières, appartenance/terre/mer comme il l'aurait souhaité. Soit, que finalement, il est devenu cet écrivain notoire et avéré que L'eau de toutes parts nous distille quand il nous est donné de le reconnaître et de l'apprécier en dépit du temps historique et de l'éloignement. Oui, j'ai aimé Mario Condé dans Les brumes du passé, les voies libertaires des Hérétiques et surtout ou bien autant, L'homme qui aimait les chiens.
Et puis, qu'est-ce qu'écrire ? Écrire un roman mais dans quel but ? Ainsi, de façon extraordinaire et sans jamais classer le roman dans une case restrictive, Leonardo Padura qui n'est pas un personnage autocentré, se réfère à Kundera qui évoque « la nature de l'âme » puis Houellebecq, qui lui parle de « la nécessité qui prend forme » et bien avant, de Flaubert, qui veut lui « atteindre l'âme des choses ». Autant dire, une multitude de perspectives dont la propension littéraire et l'exigence de qualité permet d'atteindre à des degrés de satisfecit très honorables.
Ainsi, l'écriture de Leonardo Padura est savante et sincère, lucide et douce. Elle procède comme je viens de le souligner, d'un enclin perfectible et c'est avec ravissement que j'ai lu cet ouvrage. Ceci, grâce à l'opération masse critique de Babelio et aux Éditions Métailié que je remercie vivement.
Comme l'aurait dit José Martí, relève l'auteur : « Un aigle a survolé la mer », et près de 50 ans plus tard, de la batte et de la balle, il a substitué le foot, tué la musique et muselé la culture, soit dénaturé l'identité populaire tout cela accompagné d'une crise économique majeure, quoi de mieux pour s'octroyer la domination d'un peuple, le livrer à la décadence et à l'opprobre. Ainsi fut fait de Cuba qui perdit beaucoup de ses élites. Mais : « la vie est plus vaste » sur le plan éthique, souligne Gregorio Marañón, car oui, après un demi-siècle de grande crise du socialisme, l'ancestrale démesure nationale cubaine pousse les gens à chercher la normalité accessible ou la plus simple expression de la vie, boire une bière, écouter de la musique, faire avec, et se désintéresser de toute probation, de tout penchant vers la politique. Même si, même si l'espoir et le rêve du changement subsistent. Mais vivre ! S'attacher au réel, quel qu'il soit.
Vivre et écrire à Cuba s'est aussi s'atteler à franchir non pas le Rubicon mais le Malecón, cet asphalte de front de mer de 8 kilomètres de long qui sépare la ville de l'océan, afin que les mots nous atteignent, nous, et franchissent les domaines de l'universalité, puisqu'ici, à la Havane, il faut affronter l'insularité littéraire. Ainsi, quand l'auteur nous invite en son for intérieur, passant le pont-levis nous découvrons un personnage fort attachant. Et, lorsqu'on demande à Paul Auster de faire une analyse sur la situation de son pays, Leonardo Padura fait le constat que les questions qui lui sont soumises ne sont pas celles proposées au grand Paul quant au Cubain dont il se revendique, ce qui n'entache nullement l'admiration respectueuse qu'il voue à cet écrivain, comme d'ailleurs, à ses homologues en général. Pourtant le talent égalé de Leonardo Padura devrait être mis en exergue quand on songe aux outils mis à sa disposition et aux nombreux bouleversements qui l'empêchèrent de rejoindre Paris, par exemple, qui fut l'école de la vie de bon nombre d'écrivains et le fait de ne pas pouvoir franchir les frontières, appartenance/terre/mer comme il l'aurait souhaité. Soit, que finalement, il est devenu cet écrivain notoire et avéré que L'eau de toutes parts nous distille quand il nous est donné de le reconnaître et de l'apprécier en dépit du temps historique et de l'éloignement. Oui, j'ai aimé Mario Condé dans Les brumes du passé, les voies libertaires des Hérétiques et surtout ou bien autant, L'homme qui aimait les chiens.
Et puis, qu'est-ce qu'écrire ? Écrire un roman mais dans quel but ? Ainsi, de façon extraordinaire et sans jamais classer le roman dans une case restrictive, Leonardo Padura qui n'est pas un personnage autocentré, se réfère à Kundera qui évoque « la nature de l'âme » puis Houellebecq, qui lui parle de « la nécessité qui prend forme » et bien avant, de Flaubert, qui veut lui « atteindre l'âme des choses ». Autant dire, une multitude de perspectives dont la propension littéraire et l'exigence de qualité permet d'atteindre à des degrés de satisfecit très honorables.
Ainsi, l'écriture de Leonardo Padura est savante et sincère, lucide et douce. Elle procède comme je viens de le souligner, d'un enclin perfectible et c'est avec ravissement que j'ai lu cet ouvrage. Ceci, grâce à l'opération masse critique de Babelio et aux Éditions Métailié que je remercie vivement.
Ceci n'est pas un roman, mais une succession d'essais qui porte avant tout sur Cuba, puis sur l'écriture. Leonardo Padura est un écrivain cubain qui a toujours vécu à Cuba, qui a vécu comme tous les autres cubains, qui a cru en les espoirs de son pays, qui, jeune, a coupé pendant deux mois de la canne à sucre « comme tout le monde » pour atteindre les objectifs fixés (et sortir le pays de la misère). Il a aussi été mis au placard, contraint de travailler dans un journal sportif, ce qui lui a permis, paradoxalement, de travailler son écriture et de ne pas être aussi malheureux que le pensait ceux qui l'ont relégué là. Il peut témoigner de la pauvreté de son pays, du fait qu'un chauffeur de taxi gagne mieux sa vie qu'un médecin (« mieux » ne veut aucunement dire « bien »), que s'acheter une voiture est très compliqué, faute de moyen. Je ne parle même pas des besoins « de base », comme se nourrir correctement, avoir accès à l'eau. Quant au système de santé si vanté, Padura admet qu'il est utile d'avoir un ami dans la place – pour se faire soigner plus facilement. Oui, le tableau qu'il dresse de son pays est sombre; Il est surtout réaliste, et c'est parce qu'il y vit qu'il peut en parler, qu'il peut aussi parler des écrivains qu'ils admirent et dont le talent n'a pu s'épanouir – écrire et publier à Cuba, toute une histoire. Padura voudrait d'ailleurs, quand il est interviewé, que les journalistes le considèrent comme un écrivain « ordinaire », comme Paul Auster, c'est à dire qu'on lui pose des questions littéraires, et pas des questions sur la politique cubaine. Etre écrivain, ce n'est pas être un spécialiste politique ou économique.
Il nous parle aussi de la genèse de ses oeuvres – ou comment est né Mario Conde, pourquoi il lui a fait quitter la police pour en faire un détective privé. Il nous parle aussi plus longuement de L'homme qui aimait les chiens, des cinq années de travail qu'il lui a fallu pour écrire ce roman historique, de sa connaissance de l'assassin de Trotski, qui passa les dernières années de sa vie à Cuba – et cette phrase est terriblement restrictive par rapport aux émotions exprimées par Padura, par la douloureuse prise de conscience de tout ce qui a été caché, de tout ce qui l'est encore à Cuba, pour peu que l'on ne lise que les organes officiels. Encore faut-il avoir la chance d'accéder à d'autres médias. Il nous parle aussi de pourquoi écrire, cette question que l'on pose souvent, et surtout, pourquoi avoir écrit ce livre, pourquoi avoir écrit ce sujet – voir l'écriture d'Hérétiques, qui s'imposa à lui juste après l'homme qui aimait les chiens.
J'ai failli oublier de parler du base-ball, ce sport national dont il est fan, et son père avant lui, au point de rêver que son fils aîné devint un excellent joueur de pelota. Il nous parle des clubs pour lesquels leurs coeurs battirent, mais aussi du désamour actuel des cubains au profit du football, sport qui n'est pourtant pas très pratiqué sur l'île.
L'eau de toutes parts ou la déclaration d'amour d'un auteur à son île, son quartier, qui se termine par une évocation de « Notre Havane quotidienne ». J'espère que cet ouvrage ne touchera pas seulement les lecteurs de Padura, mais aussi ceux qui veulent mieux connaitre Cuba.
Lien : https://deslivresetsharon.wo..
Il nous parle aussi de la genèse de ses oeuvres – ou comment est né Mario Conde, pourquoi il lui a fait quitter la police pour en faire un détective privé. Il nous parle aussi plus longuement de L'homme qui aimait les chiens, des cinq années de travail qu'il lui a fallu pour écrire ce roman historique, de sa connaissance de l'assassin de Trotski, qui passa les dernières années de sa vie à Cuba – et cette phrase est terriblement restrictive par rapport aux émotions exprimées par Padura, par la douloureuse prise de conscience de tout ce qui a été caché, de tout ce qui l'est encore à Cuba, pour peu que l'on ne lise que les organes officiels. Encore faut-il avoir la chance d'accéder à d'autres médias. Il nous parle aussi de pourquoi écrire, cette question que l'on pose souvent, et surtout, pourquoi avoir écrit ce livre, pourquoi avoir écrit ce sujet – voir l'écriture d'Hérétiques, qui s'imposa à lui juste après l'homme qui aimait les chiens.
J'ai failli oublier de parler du base-ball, ce sport national dont il est fan, et son père avant lui, au point de rêver que son fils aîné devint un excellent joueur de pelota. Il nous parle des clubs pour lesquels leurs coeurs battirent, mais aussi du désamour actuel des cubains au profit du football, sport qui n'est pourtant pas très pratiqué sur l'île.
L'eau de toutes parts ou la déclaration d'amour d'un auteur à son île, son quartier, qui se termine par une évocation de « Notre Havane quotidienne ». J'espère que cet ouvrage ne touchera pas seulement les lecteurs de Padura, mais aussi ceux qui veulent mieux connaitre Cuba.
Lien : https://deslivresetsharon.wo..
Il arrive parfois que l'écrivain (de romans policiers) s'aperçoive que, dans son domaine propre, l'universalité n'existe pas toute faite et qu'elle est encore à refaire. Il arrive parfois qu'il soit aussi le contempteur aventuré de la société dans laquelle il vit, le gardien hasardeux de fins fondamentales, le défenseur de l'opprimé contre l'hégémonie et contre l'opportunisme des appareils. Mais, l'activité de créateur, telle qu'elle transparait dans les pages de « L'eau de toutes parts », semble être et ne pas être de cet ordre-là. Et si la beauté de son oeuvre s'y dévoile, elle semble n'impliquer nullement la remise en cause partisane, systématique et banalement occidentale de la société cubaine.
Leonardo Padura est quelqu'un qui dans ses romans prend résolument les vies communes auxquelles il participe comme matériaux. le quartier de Mantilla et ses habitants, la maison familiale qu'il n'a jamais quittée, sont pour lui les plus significatifs de la Havane. Il prend ainsi le risque, dans un pays au régime autoritaire où il est tellement question de masses ou de peuple et si peu d'individus, de parler de la vie quotidienne des gens. Ces trente dernières années, le père de Mario Conde les a consacrées, avec d'autres écrivains de sa génération, à la déconstruction de sa ville, aux ruines matérielles et aux pertes morales de la Havane reflétées dans son architecture. Sous sa plume, ces vies communes-là, dans cette architecture-là ont indéniablement une grande densité, elles ne se résument jamais au seuls signifiés de prises de position tranchées ou d'analyse socio-politiques, elles débordent de sens et fluent, elles vaquent et imposent leur présence. C'est sans aucun doute ce qui a fait la formidable réussite du cycle « Les Quatre Saisons ».
Si l'écrivain adopte dans son oeuvre le mode de vie courant, populaire des existences communes ce n'est pas qu'il transmet du savoir ou de l'analyse mais c'est, au contraire, qu'aussi il n'en transmet pas. La Havane aujourd'hui avec son sens grandiose et tragique de la démesure, tiraillée entre ses extrêmes, affiche d'insolentes richesses et devient chaque jour un peu plus étrangère et lointaine au vieux Leonardo Padura. La Havane des éternels espoirs déçus et des perpétuelles angoisses d'un quotidien difficile, si elle est plus grande, plus populaire, plus réelle, plus cubaine que la précédente, si elle est plus attachante, plus indifférente et plus hostile aussi, n'est pourtant pas moins étrangère et lointaine à l'écrivain cubain. le plus objectif des auteurs souhaite être une présence invisible mais sentie dans ses livres. Leonardo Padura est dans ses romans, sans explication, cette ville vécue contradictoirement. le reggaeton havanais lascif, aliénant, étourdissant et violent, en place de la musique propagandiste latino, y crie maintenant par les fenêtres. le football mondialiste a supplanté de baseball où se retrouvaient sur un terrain de sport le rêve cubain : musique, culture, société et politique. Les verbes du quotidien cubain, ceux du manque et de l'enfermement ordinaires, ceux qui expriment le mieux l'habileté à survivre avec ses illégalismes, sont désormais : lutter, inventer, résoudre.
Le plus subjectif des auteurs, livre nécessairement la présence du monde. Et Cuba, qui maintient toujours sa condition d'État socialiste, est sans doute un pays plus grand que sa géographie. Leonardo Padura sur cette île, avec travaux agricole, récolte de la canne à sucre, préparation militaire et marxisme intensif, a grandi durant l'exaltante première décennie révolutionnaire. Il est entré dans l'âge adulte au cours des années 1970, une époque de grande solidarité internationaliste qui l'a conduit en Angola. Après beaucoup de sacrifice, d'étude, de travail mais aussi d'obscures obéissances et d'aveugles illusions, l'ascension du pas encore célèbre écrivain s'est révélée être un interminable faux plat gravit à petite vitesse. le passage d'une revue culturelle à un quotidien du soir pour cause de « nécessaire purification » idéologique dans les années 1980 constituaient pourtant pour lui que les prolégomènes de la vertigineuse descente des années 1990. Avec la chute du mur et la longiligne crise cubaine, le pays s'est mit à changer, le présent à s'éloigner de l'avenir de consommation et d'égalité fantasmé. le non savoir silencieux que Leonardo Padura communique, c'est donc dans tous les cas cette incontournable subjectivité là. Défendre ou dénoncer la politique ne le définissent certainement pas.
Ce qui occupe le premier plan, c'est son travail littéraire. Leonardo Padura ne se connait pas, il est le produit tout entier de la société qu'il décrit et regarde. Il ne peut voir le monde devant lui que si le monde l'a constitué voyant par derrière. Il est inséré irrémédiablement dans le monde cubain et ses écrits sont le type même de l'universel singulier : singularité de son être, universalité de sa visée ou, inversement, universalité de son être et singularité de sa visée. L'écrivain utilise donc sa vie commune pour produire un objet double, un objet singulier et universel. Il écrit des romans pour dire quelque chose d'universel de la perversion de ses idéaux égalitaires et des sources de son identité cubaine. Il écrit des romans pour dire quelque chose de singulier de sa vie et de la vie des autres. L'écriture de ses romans policiers est pour cela toujours un exercice esthétique plus complexe et plus responsable qu'il n'y parait. L'auteur s'y livre à une recherche poussée des circonstances contextuelles, sociétales et historiques. Dans ses polars, il crée un style très personnel, il soigne la structure du récit et il donne une vraie épaisseur aux personnages. Son héros Mario Conde, l'anti policier, le policier littéraire est de la même génération que l'auteur, il est originaire d'un quartier semblable au sien. L'enquêteur révèle une affaire mais il met aussi à jour les zones d'ombre de la réalité cubaine. Il dévoile la vie cubaine dans ses évolutions-involutions. Il formule depuis trente ans inlassablement les incertitudes, les craintes qui accompagnent toute sa génération. Il dit son désenchantement, ses échecs personnels, son incapacité à s'insérer dans un monde aux exigences économiques et morales différentes des siennes.
Ce qui fait la littérature, c'est donc d'être dans le monde, non pas tant que le monde est approché de l'extérieur mais en tant qu'il est intériorisé par l'écrivain. Et ce qui est son sujet, c'est l'unité du monde sans cesse remise en question par le double mouvement de l'intériorisation et de l'extériorisation. Leonardo Padura veut pouvoir « marcher le soir sur le Malecon (parapet qui longe la limite nord de la havane face au golfe du Mexique), s'assoir sur son mur tourné vers la ville pour observer la vie ; ou s'assoir sur son mur tourné vers la mer pour se voir lui-même ». Il veut comprendre pourquoi, à travers son expérience propre, les habitants de l'île ont décidé d'être cubains, de se comporter comme tels malgré les aspirations dévorantes du maternel empire colonial et malgré les attitudes étouffantes des Empires nord-américains et soviétiques. Il veut, après les grands devanciers que sont Domingo del Monte, Cirilo Villaverde, José María Heredia, José Martí, Alejo Carpentier ou Virgilio Pinera, avoir une meilleure compréhension de la nation cubaine à laquelle il appartient. Il veut à toutes fins créer une image possible du pays et de « la maudite circonstance de l'eau de toutes parts ». Il veut enfin témoigner des conséquences dramatiques endurées par l'homme quand il exerce sa liberté. L'écrivain en effet n'a pas fondamentalement pour but de communiquer du savoir ou de l'analyse, il ne témoigne que de son être propre et il donne à voir, à travers lui, la condition humaine comme être dans le monde. Simultanément ainsi, il objective et subjective. La beauté de l'oeuvre de Leonardo Padura n'est autre que la condition humaine produite par la liberté créatrice de l'auteur.
Leonardo Padura ne cesse de le répéter à son lecteur, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un écrivain cubain quitte son île ; ce qui est extraordinaire ce sont les causes qui le conduisent à cette décision. Il semble que l'accumulation de particularités, d'originalités voire de difficultés, de carences puissent fonctionner au contraire comme un puissant aimant capable d'attirer de nombreux créateurs cubains vers leur géographie, leur culture et leur présent. Leonardo Padura est de ceux-là qui restent sur leur formidable île. Cuba est un pays sans aucun doute plus grand que sa géographie, un pays où la culture, la politique, le sport ont un écho universel ; un pays où les gens peuvent se battre pour acheter un livre, entrer dans un cinéma ; un pays où les spectacles de ballet font salle comble. La traumatisante et séculaire circonstance de l'eau de toutes parts, qui donne son titre à l'ouvrage, y génère sans conteste un puissant sentiment d'appartenance de ses habitants qui favorise un développement culturel exceptionnel. L'oeuvre de de Leonardo Padura s'adressera à la créativité du lecteur qui la recomposera par sa lecture et saisira ainsi son propre être dans le monde comme s'il était le produit de sa liberté. Elle est la vie qui s'adresse à la liberté. Elle invite le lecteur à assurer sa propre vie en tant qu'elle exige de lui l'effort esthétique de la recomposer comme unité paradoxale de la singularité et de l'universalité. le lecteur occidental qui prend bonne note en lisant « La transparence du temps », « L'Homme qui aimait les chiens » ou bien « Hérétiques » du pour ou du contre de la révolution cubaine n'est peut-être qu'un dactylographe étranger à lui-même et aux autres ?
Leonardo Padura est quelqu'un qui dans ses romans prend résolument les vies communes auxquelles il participe comme matériaux. le quartier de Mantilla et ses habitants, la maison familiale qu'il n'a jamais quittée, sont pour lui les plus significatifs de la Havane. Il prend ainsi le risque, dans un pays au régime autoritaire où il est tellement question de masses ou de peuple et si peu d'individus, de parler de la vie quotidienne des gens. Ces trente dernières années, le père de Mario Conde les a consacrées, avec d'autres écrivains de sa génération, à la déconstruction de sa ville, aux ruines matérielles et aux pertes morales de la Havane reflétées dans son architecture. Sous sa plume, ces vies communes-là, dans cette architecture-là ont indéniablement une grande densité, elles ne se résument jamais au seuls signifiés de prises de position tranchées ou d'analyse socio-politiques, elles débordent de sens et fluent, elles vaquent et imposent leur présence. C'est sans aucun doute ce qui a fait la formidable réussite du cycle « Les Quatre Saisons ».
Si l'écrivain adopte dans son oeuvre le mode de vie courant, populaire des existences communes ce n'est pas qu'il transmet du savoir ou de l'analyse mais c'est, au contraire, qu'aussi il n'en transmet pas. La Havane aujourd'hui avec son sens grandiose et tragique de la démesure, tiraillée entre ses extrêmes, affiche d'insolentes richesses et devient chaque jour un peu plus étrangère et lointaine au vieux Leonardo Padura. La Havane des éternels espoirs déçus et des perpétuelles angoisses d'un quotidien difficile, si elle est plus grande, plus populaire, plus réelle, plus cubaine que la précédente, si elle est plus attachante, plus indifférente et plus hostile aussi, n'est pourtant pas moins étrangère et lointaine à l'écrivain cubain. le plus objectif des auteurs souhaite être une présence invisible mais sentie dans ses livres. Leonardo Padura est dans ses romans, sans explication, cette ville vécue contradictoirement. le reggaeton havanais lascif, aliénant, étourdissant et violent, en place de la musique propagandiste latino, y crie maintenant par les fenêtres. le football mondialiste a supplanté de baseball où se retrouvaient sur un terrain de sport le rêve cubain : musique, culture, société et politique. Les verbes du quotidien cubain, ceux du manque et de l'enfermement ordinaires, ceux qui expriment le mieux l'habileté à survivre avec ses illégalismes, sont désormais : lutter, inventer, résoudre.
Le plus subjectif des auteurs, livre nécessairement la présence du monde. Et Cuba, qui maintient toujours sa condition d'État socialiste, est sans doute un pays plus grand que sa géographie. Leonardo Padura sur cette île, avec travaux agricole, récolte de la canne à sucre, préparation militaire et marxisme intensif, a grandi durant l'exaltante première décennie révolutionnaire. Il est entré dans l'âge adulte au cours des années 1970, une époque de grande solidarité internationaliste qui l'a conduit en Angola. Après beaucoup de sacrifice, d'étude, de travail mais aussi d'obscures obéissances et d'aveugles illusions, l'ascension du pas encore célèbre écrivain s'est révélée être un interminable faux plat gravit à petite vitesse. le passage d'une revue culturelle à un quotidien du soir pour cause de « nécessaire purification » idéologique dans les années 1980 constituaient pourtant pour lui que les prolégomènes de la vertigineuse descente des années 1990. Avec la chute du mur et la longiligne crise cubaine, le pays s'est mit à changer, le présent à s'éloigner de l'avenir de consommation et d'égalité fantasmé. le non savoir silencieux que Leonardo Padura communique, c'est donc dans tous les cas cette incontournable subjectivité là. Défendre ou dénoncer la politique ne le définissent certainement pas.
Ce qui occupe le premier plan, c'est son travail littéraire. Leonardo Padura ne se connait pas, il est le produit tout entier de la société qu'il décrit et regarde. Il ne peut voir le monde devant lui que si le monde l'a constitué voyant par derrière. Il est inséré irrémédiablement dans le monde cubain et ses écrits sont le type même de l'universel singulier : singularité de son être, universalité de sa visée ou, inversement, universalité de son être et singularité de sa visée. L'écrivain utilise donc sa vie commune pour produire un objet double, un objet singulier et universel. Il écrit des romans pour dire quelque chose d'universel de la perversion de ses idéaux égalitaires et des sources de son identité cubaine. Il écrit des romans pour dire quelque chose de singulier de sa vie et de la vie des autres. L'écriture de ses romans policiers est pour cela toujours un exercice esthétique plus complexe et plus responsable qu'il n'y parait. L'auteur s'y livre à une recherche poussée des circonstances contextuelles, sociétales et historiques. Dans ses polars, il crée un style très personnel, il soigne la structure du récit et il donne une vraie épaisseur aux personnages. Son héros Mario Conde, l'anti policier, le policier littéraire est de la même génération que l'auteur, il est originaire d'un quartier semblable au sien. L'enquêteur révèle une affaire mais il met aussi à jour les zones d'ombre de la réalité cubaine. Il dévoile la vie cubaine dans ses évolutions-involutions. Il formule depuis trente ans inlassablement les incertitudes, les craintes qui accompagnent toute sa génération. Il dit son désenchantement, ses échecs personnels, son incapacité à s'insérer dans un monde aux exigences économiques et morales différentes des siennes.
Ce qui fait la littérature, c'est donc d'être dans le monde, non pas tant que le monde est approché de l'extérieur mais en tant qu'il est intériorisé par l'écrivain. Et ce qui est son sujet, c'est l'unité du monde sans cesse remise en question par le double mouvement de l'intériorisation et de l'extériorisation. Leonardo Padura veut pouvoir « marcher le soir sur le Malecon (parapet qui longe la limite nord de la havane face au golfe du Mexique), s'assoir sur son mur tourné vers la ville pour observer la vie ; ou s'assoir sur son mur tourné vers la mer pour se voir lui-même ». Il veut comprendre pourquoi, à travers son expérience propre, les habitants de l'île ont décidé d'être cubains, de se comporter comme tels malgré les aspirations dévorantes du maternel empire colonial et malgré les attitudes étouffantes des Empires nord-américains et soviétiques. Il veut, après les grands devanciers que sont Domingo del Monte, Cirilo Villaverde, José María Heredia, José Martí, Alejo Carpentier ou Virgilio Pinera, avoir une meilleure compréhension de la nation cubaine à laquelle il appartient. Il veut à toutes fins créer une image possible du pays et de « la maudite circonstance de l'eau de toutes parts ». Il veut enfin témoigner des conséquences dramatiques endurées par l'homme quand il exerce sa liberté. L'écrivain en effet n'a pas fondamentalement pour but de communiquer du savoir ou de l'analyse, il ne témoigne que de son être propre et il donne à voir, à travers lui, la condition humaine comme être dans le monde. Simultanément ainsi, il objective et subjective. La beauté de l'oeuvre de Leonardo Padura n'est autre que la condition humaine produite par la liberté créatrice de l'auteur.
Leonardo Padura ne cesse de le répéter à son lecteur, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un écrivain cubain quitte son île ; ce qui est extraordinaire ce sont les causes qui le conduisent à cette décision. Il semble que l'accumulation de particularités, d'originalités voire de difficultés, de carences puissent fonctionner au contraire comme un puissant aimant capable d'attirer de nombreux créateurs cubains vers leur géographie, leur culture et leur présent. Leonardo Padura est de ceux-là qui restent sur leur formidable île. Cuba est un pays sans aucun doute plus grand que sa géographie, un pays où la culture, la politique, le sport ont un écho universel ; un pays où les gens peuvent se battre pour acheter un livre, entrer dans un cinéma ; un pays où les spectacles de ballet font salle comble. La traumatisante et séculaire circonstance de l'eau de toutes parts, qui donne son titre à l'ouvrage, y génère sans conteste un puissant sentiment d'appartenance de ses habitants qui favorise un développement culturel exceptionnel. L'oeuvre de de Leonardo Padura s'adressera à la créativité du lecteur qui la recomposera par sa lecture et saisira ainsi son propre être dans le monde comme s'il était le produit de sa liberté. Elle est la vie qui s'adresse à la liberté. Elle invite le lecteur à assurer sa propre vie en tant qu'elle exige de lui l'effort esthétique de la recomposer comme unité paradoxale de la singularité et de l'universalité. le lecteur occidental qui prend bonne note en lisant « La transparence du temps », « L'Homme qui aimait les chiens » ou bien « Hérétiques » du pour ou du contre de la révolution cubaine n'est peut-être qu'un dactylographe étranger à lui-même et aux autres ?
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Leonardo Padura (21)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les classiques de la littérature sud-américaine
Quel est l'écrivain colombien associé au "réalisme magique"
Gabriel Garcia Marquez
Luis Sepulveda
Alvaro Mutis
Santiago Gamboa
10 questions
372 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature sud-américaine
, latino-américain
, amérique du sudCréer un quiz sur ce livre372 lecteurs ont répondu