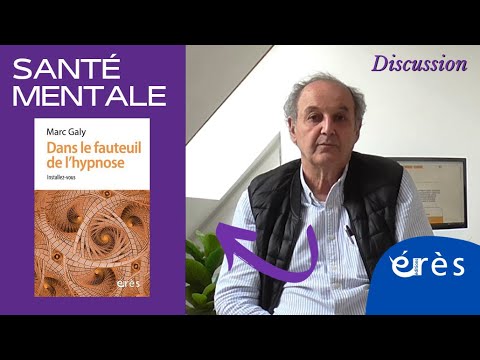Né(e) à : Loisey , le 23/04/1923
Mort(e) à : Paris , le 23/11/2016
François Roustang est un philosophe et hypnothérapeute français. Ancien jésuite, il a été psychanalyste durant plus de vingt ans avant de rompre avec cette discipline et de développer des travaux sur l'hypnose.
De 1956 à 1967, François Roustang contribue à la revue jésuite Christus, qu'il dirige, assisté par Michel de Certeau à partir de 1963.
De 1965 à 1981, il est membre de l'École freudienne de Paris de Jacques Lacan. Il suit une courte analyse de deux ans avec Serge Leclaire. En 1966, il publie un article, "Le troisième homme", dans lequel il démontre que le Concile Vatican II a favorisé l’émergence de chrétiens ne se reconnaissant ni conservateurs ni réformistes, mais tout simplement non pratiquants et, à terme, indifférents à l’Église et aux sacrements. La congrégation démet Roustang de ses fonctions. Quelque temps plus tard, il rompt avec la foi, quitte l'habit, se marie et devient psychanalyste. Alors qu'il vit cette expérience comme une libération, il est frappé de constater l'esprit de soumission qui règne au sein de l'École freudienne. Il s'intéresse alors à la question des relations maître-disciple dans l'histoire de la psychanalyse. En 1976, avec la publication de "Un destin si funeste", il fait une lecture critique des relations entre Sigmund Freud et certains de ses « disciples » tels Sandor Ferenczi, Carl Jung ou Georg Groddeck.
En 1978, il publie l'article "Suggestion au long cours" dans la Nouvelle Revue de Psychanalyse, dans lequel il souligne le rôle de la suggestion dans la cure analytique. Cet article sera repris en 1980 dans son livre "Elle ne le lâche plus...". Les contributions de François Roustang à la revue Critique dans les années 1980 illustrent sa prise de distances progressive avec la psychanalyse et son intérêt pour l'hypnose.
Il publie un article sur le livre du psychiatre Léon Chertok, "Le non-savoir des psy". En 1983 il publie un article sur deux livres d'Octave Mannoni. En 1985 il publie un article sur le livre du philosophe Michel Henry, "Généalogie de la psychanalyse". À cette même époque, en 1983, il participe à une rencontre sur l'hypnose à l'Hôpital Fernand-Widal en compagnie de René Girard et de Mikkel Borch-Jacobsen. Roustang se forme à l'hypnose, notamment avec Judith Fleiss et avec des hypnothérapeutes américains formés par Milton Erickson. En 1986 il confirme la rupture avec la psychanalyse et l'héritage de Lacan .
Ajouter des informations
Accéder aux informations relatives à l'ouvrage sur le site des éditions érès : https://www.editions-eres.com/ouvrage/5121/dans-le-fauteuil-de-lhypnose « Au cours de cet ouvrage, je vous propose de cheminer avec moi dans le processus hypnotique, dans le monde de la perception, de la sensorialité et de l'imaginaire qui nous conduit de l'induction à la transe ou ‘perceptude' pour reprendre les mots de François Roustang philosophe, psychothérapeute et hypnothérapeute qui m'a formé et éclairé pendant des années par de nombreux écrits, enseignements et rencontres.Nous resterons dans le cadre de l'hypnose médicale, que je pratique. Nous nous écarterons de l'hypnose spectacle ou de rue qui n'appartient pas à mon champ de compétences. Ce cheminement repose sur des rencontres cliniques, des lectures, des échanges de congrès, des ateliers d'enseignements qui ont alimenté ma pratique d'anesthésiste et de praticien dans des consultations d'hôpitaux universitaires et des centres de santé intégratives ou généralistes. Les différents exemples qui alimentent le texte vous permettrons je l'espère de mieux comprendre et de mieux intégrer l'exercice hypnotique dans le parcours de vie : ‘Installez-vous'. » Le livre replace l'hypnose et son processus dans une perceptive de changement des perceptions à travers de nombreux exemples cliniques. le patient est invité à s'assoir dans le « fauteuil » pour un exercice hypnotique sensoriel qui relie le corps et l'esprit et s'intègre dans une stratégie thérapeutique non médicamenteuse.
Non seulement elle n'exigeait rien des hommes qu'elle rencontrait, mais elle n'en attendait rien, c'est pourquoi elle était toujours disponible instant sur instant, pas par suffisance, mais par désespoir définitif. (...) Elle avait été prête alors à prendre les petites gouttes d'affection, de tendresse, d'amour comme quelque chose d'inattendu, de non dû, comme le rare soleil d'automne, comme l'inexplicable fraîcheur d'été dans les déserts humides du Sud."
Pourtant le refus, comme première réponse à l'événement qui provoque la souffrance, est légitime et nécessaire.
"Pour agir le corps doit faire taire la parole et l'explication consciente. Mais cela ne signifie pas que l'esprit a disparu. Il est devenu corps vivant, car le corps est esprit et c'est pour cela qu'il pense à bon escient." p. 141
"Cela lui semblait tout d'abord impossible, car il y a un abîme entre les mots compréhensibles de ce qui est à faire et le faire lui-même. On passe alors en effet à cet ordre des choses différent dans lequel les mots doivent devenir des actes. Et peu importe alors que l'on ressente ou non, il faut et il suffit de sauter le pas, de réaliser le mouvement ou de se rendre disponible au point de l'autoriser à s'effectuer. " p. 159
"L'élève qui craint de ne pouvoir écrire, l'apprenti qui appréhende de scier ou de peindre, l'enfant qui redoute de se mettre à l'eau pour nager, tous retardent le moment décisif en demandant de nouvelles explications, en ergotant sur les procédures proposées, en discutant les ordres. Il faut que le maître cesse de répondre, fasse taire et se contente de formuler un impératif : "Fais le d'abord, tes objections n'ont maintenant aucun sens". p. 160
"Pour l'élève ou l'apprenti, il y a là nécessité d'un saut. Il faut qu'il fasse confiance au maître et qu'il accomplisse la tâche, sans quoi il n'apprendra jamais rien. Abandonner le besoin incoercible de comprendre qui sert à retarder ou à éviter l'acte, ne plus tenir le savoir à distance de l'acte, mais en quelques sortes l'y perdre pour qu'il devienne intérieur à l'acte, s'incorporer le savoir du maître à qui l'on a fait confiance, en d'autres termes transformer l'hétéronomie de l'ordre reçu en autonomie, tels sont les impératifs auxquels doit se soumettre l'élève. Le renoncement à la pseudo-autonomie de la demande d'explication et de la levée des doutes ouvre seul à l'autonomie véritable. Il en est ainsi de tous les apprentissages humains." p.172

Fastes vénitiens
Alzie
45 livres
Politique et littérature
Les Romantiques français, dans leur jeunesse, étaient plutôt réactionnaires et monarchistes. Quel est celui qui a connu une évolution qui l’a conduit à être élu sénateur siégeant plutôt à gauche ?
272 lecteurs ont répondu