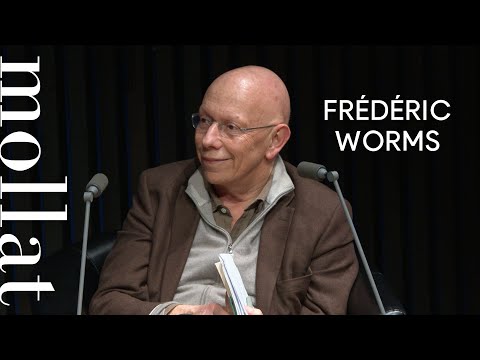Nationalité : France
Né(e) : 1964
Ajouter des informations
Né(e) : 1964
Biographie :
Frédéric Worms est un philosophe, professeur de philosophie contemporaine à l'École normale supérieure, établissement dont il est devenu directeur-adjoint en septembre 2015.
Ancien élève de l'ENS, agrégé de philosophie, il soutient en 1995 à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand une thèse consacrée à Henri Bergson : "Le problème de l'esprit : psychologie, théorie de la connaissance et métaphysique dans l’œuvre de Bergson".
Il devient ensuite en 2004 professeur des universités à Lille III puis à l'ENS, rue d'Ulm, dont il devient en 2015 le Directeur-adjoint Lettres. Durant cette même année, il devient membre du Comité consultatif national d'éthique (CCNE).
Spécialiste de l'œuvre d'Henri Bergson, il est le co-auteur avec Philippe Soulez d'une biographie faisant autorité sur le philosophe et académicien en plus d'avoir publié plusieurs ouvrages sur sa pensée. Il dirige les Annales bergsoniennes et a rédigé avec une équipe de jeunes chercheurs la première édition critique de l'oeuvre de Bergson, publiée en 2004 aux Presses universitaires de France (Puf) dans la collection « Quadrige. Grands textes ».
Frédéric Worms est par ailleurs président de la Société des amis de Bergson.
En tant qu'éditeur, il a notamment contribué à la réédition d'ouvrages du philosophe et ancien professeur à la Sorbonne Jean Wahl.
Il a publié de nombreux articles sur la Philosophie du XXème siècle en France et un ouvrage synthétique : "La Philosophie du XXème siècle en France. Moments" (Gallimard, Folio-Essais, 2009). Spécialiste en éthique et en philosophie morale, il publie en 2010 aux Puf "Le moment du soin, à quoi tenons-nous ?" un ouvrage regroupant les enseignements d'études générales sur les relations et les ruptures entre les hommes et un ensemble de chroniques qu'il a écrites durant cinq ans dans la revue Esprit .
À la suite de ces ouvrages, il a publié "Revivre, éprouver nos blessures et nos ressources" (Flammarion, collection Sens propre, 2012), "La vie qui unit et qui sépare" (éditions Payot & Rivages, collection Manuels, 2013) ainsi que "Penser à quelqu'un" (Flammarion, collection sens propre, 2014).
Son dernier ouvrage "Les maladies chroniques de la démocratie" a été édité en 2017 aux Éditions Desclée de Brouwer.
Enfin, depuis 2017 Fédéric Worms anime chaque lundi soir sur France-Culture "Matières à penser", une émission de discussion libre et philosophique avec un invité.
+ Voir plusFrédéric Worms est un philosophe, professeur de philosophie contemporaine à l'École normale supérieure, établissement dont il est devenu directeur-adjoint en septembre 2015.
Ancien élève de l'ENS, agrégé de philosophie, il soutient en 1995 à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand une thèse consacrée à Henri Bergson : "Le problème de l'esprit : psychologie, théorie de la connaissance et métaphysique dans l’œuvre de Bergson".
Il devient ensuite en 2004 professeur des universités à Lille III puis à l'ENS, rue d'Ulm, dont il devient en 2015 le Directeur-adjoint Lettres. Durant cette même année, il devient membre du Comité consultatif national d'éthique (CCNE).
Spécialiste de l'œuvre d'Henri Bergson, il est le co-auteur avec Philippe Soulez d'une biographie faisant autorité sur le philosophe et académicien en plus d'avoir publié plusieurs ouvrages sur sa pensée. Il dirige les Annales bergsoniennes et a rédigé avec une équipe de jeunes chercheurs la première édition critique de l'oeuvre de Bergson, publiée en 2004 aux Presses universitaires de France (Puf) dans la collection « Quadrige. Grands textes ».
Frédéric Worms est par ailleurs président de la Société des amis de Bergson.
En tant qu'éditeur, il a notamment contribué à la réédition d'ouvrages du philosophe et ancien professeur à la Sorbonne Jean Wahl.
Il a publié de nombreux articles sur la Philosophie du XXème siècle en France et un ouvrage synthétique : "La Philosophie du XXème siècle en France. Moments" (Gallimard, Folio-Essais, 2009). Spécialiste en éthique et en philosophie morale, il publie en 2010 aux Puf "Le moment du soin, à quoi tenons-nous ?" un ouvrage regroupant les enseignements d'études générales sur les relations et les ruptures entre les hommes et un ensemble de chroniques qu'il a écrites durant cinq ans dans la revue Esprit .
À la suite de ces ouvrages, il a publié "Revivre, éprouver nos blessures et nos ressources" (Flammarion, collection Sens propre, 2012), "La vie qui unit et qui sépare" (éditions Payot & Rivages, collection Manuels, 2013) ainsi que "Penser à quelqu'un" (Flammarion, collection sens propre, 2014).
Son dernier ouvrage "Les maladies chroniques de la démocratie" a été édité en 2017 aux Éditions Desclée de Brouwer.
Enfin, depuis 2017 Fédéric Worms anime chaque lundi soir sur France-Culture "Matières à penser", une émission de discussion libre et philosophique avec un invité.
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (32)
Voir plusAjouter une vidéo
Frédéric Worms vous présente son ouvrage "Le pourquoi du comment : philosophie pour mieux vivre" aux éditions Flammarion. Entretien avec Pierre Coutelle.
Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/2985335/frederic-worms-le-pourquoi-du-comment-philosophie-pour-mieux-vivre
Note de musique : © mollat
Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/
Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux :
Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/
Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts
Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/
Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat
Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/
Vimeo : https://vimeo.com/mollat
+ Lire la suite
Podcasts (3)
Voir tous
Citations et extraits (26)
Voir plus
Ajouter une citation
On pourrait se passer de la philosophie si il n'y avait pas la mort, la maladie et le mal.
Ce qui m'a poussé vers la philo a certainement été, entre autres, le besoin de répondre à des questions qui ne se posaient pas directement à moi, mais s'étaient posées à mes parents quand on les avait obligés à se cacher pendant la guerre. Les questions philosophiques peuvent mettre des années avant de se formuler consciemment.
La médecine scientifique contemporaine avait contribué à dévaluer la notion de soin. À l’hôpital, le personnel « soignant » – celui qui vous demande de quitter la chambre du malade pour les « soins » – apparaît clairement subordonné aux décisions des médecins et des internes, seuls porteurs de science.
Contre les excès d’un technicisme souvent jugé inhumain, au rebours d’une division des tâches qui a conduit certains à déplorer une possible « mort de la clinique », voici le soin qui s’impose maintenant à l’attention. Il ne s’agit pas seulement de l’hommage toujours rendu au dévouement du personnel et de la mention, comme en passant, des petits gestes qui allègent humblement la souffrance du patient. Ce qui est en jeu, c’est la redécouverte du socle anthropologique sur lequel la médecine – toute médecine – fonde son humanité et son efficacité.
Contre les excès d’un technicisme souvent jugé inhumain, au rebours d’une division des tâches qui a conduit certains à déplorer une possible « mort de la clinique », voici le soin qui s’impose maintenant à l’attention. Il ne s’agit pas seulement de l’hommage toujours rendu au dévouement du personnel et de la mention, comme en passant, des petits gestes qui allègent humblement la souffrance du patient. Ce qui est en jeu, c’est la redécouverte du socle anthropologique sur lequel la médecine – toute médecine – fonde son humanité et son efficacité.
Nous rejouons incessamment certaines scènes passées, certaines expériences douloureuses, et la mort ou, comme le dira Winnicott, "l'effondrement", n'est pas pour nous quelque chose à venir, mais, étrangement, quelque chose qui a déjà eu lieu. Mais nous répétons aussi quelque chose qui va avoir lieu, et qui, en étant ainsi répété, se crée, et même dont chaque répétition est déjà une création. Voyez notre orchestre intérieur. Vous ne vous contentez pas de le préparer pour le grand soir du grand concert devant le grand public. Mais déjà, entre vous, lorsque vous lui dites de se concentrer sur une mesure difficile, vous inventez quelque chose de définitif que vous reprendrez par la suite. C'est en fait le concert qui sera une répétition, l'intégrale de toutes les répétitions, ou du moins de tous les moments de surprise et de bonheur survenus dans les répétitions, avec encore quelque chose de plus, comme dans chaque répétition, qui est en fait une création.
Ce n'est pas là une métaphore.
Chaque instant de notre vie nous voit réellement répéter sur la scène du monde, avec d'autres acteurs, des drames à la fois partagés et uniques. Mais parce que l'autre répétition (destructrice) guette, ces répétitions (immédiatement créatrices) vont plus loin encore dans nos vies que celles qui sont protégées dans l'écrin des salles de spectacle, de la mise en scène et de l'art. Elles jouent d'emblée pour d evrai. Elles doivent inclure en elles un effort pour s'opposer à ce qui, d'une manière ou d'une autre, les menace.
Dès lors, ce n'est pas tant la vie et la mort qui s'opposent, faut-il même dire Éros et Thanatos, mais une destruction – qui ne vient pas seulement du dehors – et une création – qui n'est pas seulement intérieure, mais qui rayonne aussitôt, depuis nous, entre nous, et au-dehors de nous.
Ce n'est pas là une métaphore.
Chaque instant de notre vie nous voit réellement répéter sur la scène du monde, avec d'autres acteurs, des drames à la fois partagés et uniques. Mais parce que l'autre répétition (destructrice) guette, ces répétitions (immédiatement créatrices) vont plus loin encore dans nos vies que celles qui sont protégées dans l'écrin des salles de spectacle, de la mise en scène et de l'art. Elles jouent d'emblée pour d evrai. Elles doivent inclure en elles un effort pour s'opposer à ce qui, d'une manière ou d'une autre, les menace.
Dès lors, ce n'est pas tant la vie et la mort qui s'opposent, faut-il même dire Éros et Thanatos, mais une destruction – qui ne vient pas seulement du dehors – et une création – qui n'est pas seulement intérieure, mais qui rayonne aussitôt, depuis nous, entre nous, et au-dehors de nous.
Se hisser au-dessus de soi suppose que l'on "assure" chaque palier atteint, comme font les alpinistes chevronnés pour éviter la dégringolade. Image réelle du "progrès" ? Un pas, une prise, un palier, puis tout ce qu'il faut pour ramener le corps et son équipage, toute cette lourdeur, et encore planter les pitons, surveiller l'orage, préparer le bivouac, car le froid et la nuit vont venir, être sûr, enfin, que le pas est fait, celui-ci, pour aujourd'hui. Celui qui a fait aussitôt après le pas de trop, le pas de l'ange, on voit encore la trace de sa chute ; il a dévissé, non sans entraîner avec lui la fragile humanité pleine de courbatures et de vertiges qui le suivait dans sa route, cet émouvant cortège de réfugiés et de pionniers qui traverse l'histoire.
On a tellement pris La Peste d’Albert Camus pour une allégorie politique, qu’on en a presque oublié qu’une épidémie de peste poserait en elle-même un problème politique. Or c’est justement ce que vient nous rappeler aujourd’hui l’épidémie de grippe aviaire ou, plus précisément, le passage possible, par mutation du virus, de cette épidémie (ou de cette épizootie, que les vétérinaires nomment « peste aviaire ») à une pandémie, se transmettant donc directement entre les hommes, et que, pendant un temps au moins, l’on ne pourrait pas guérir. Ce passage, cette mutation, ne serait ainsi pas seulement quantitatif, mais qualitatif, et même deux fois qualitatif. Ce ne serait pas le passage d’un « risque » à un « plus grand » risque, mais plutôt, très précisément, le passage d’un risque à une catastrophe. Mais ce serait aussi (et en même temps, de manière sans doute inséparable) le passage d’une dimension « seulement » (ou principalement) sanitaire, à une dimension qui ne serait pas politique en plus ou par surcroît, mais de l’intérieur et par principe.
Qui croira que la souffrance causée par une séparation amoureuse puisse être "seulement" psychologique, sans ancrage dans le corps ?
L’expression qui donne son titre à ce livre, « le moment du soin », y sera prise entre les deux sens les plus extrêmes qu’elle puisse sans doute recevoir. Ce sera d’abord l’instant de l’urgence vitale, ou mortelle, qui nous révèle tout à coup une double dépendance vis-à-vis du monde, mais aussi d’autrui (que nous appelons alors « au secours »). Mais ce sera ensuite, en un sens tout à la fois très large et historiquement situé, le moment présent dans son ensemble, l’époque, si l’on veut, où nous vivons, comme si celle-ci pouvait se caractériser par une sorte d’extension de cette vulnérabilité, de cette urgence, des réponses à y apporter, à tous et à tout – concernant donc non seulement les individus mais les collectivités, jusqu’à l’ensemble de l’espèce, ainsi que l’instant des « catastrophes », les temps qui les précèdent ou les suivent et, finalement, le sentiment même de « l’histoire », aujourd’hui.
Ma femme à la bouche de cocarde et de bouquet d'étoiles de
dernière grandeur
Aux dents d'empreintes de souris blanche sur la terre
blanche
À la langue d'ambre et de verre frottés
Ma femme à la langue d'hostie poignardée
À la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux
À la langue de pierre incroyable
Ma femme aux cils de bâtons d'écriture d'enfant
Aux sourcils de bord de nid d'hirondelle
Splendeur du langage poétique le plus intense, qui évoque pourtant la « langue » la plus littérale, minimale et littérale. Tension entre le rythme, qui devient rite, et litanie, et la transgression qui rappelle que la langue qui est sacrement peut être aussi violence.
Rigueur de l'écriture la plus lyrique, mais qui réveille les «bâtons
d'écriture d'enfant». Le langage est toujours aussi langue, même si la langue peut être littéralement chantée dans le langage.
On aurait tort de croire que, sans le langage, toute relation serait impossible ; le langage continue, déploie, recrée ce qui est d'abord contact et distance entre des corps expressifs et fragiles, mystérieux de profondeur mais aussi de minéralité, de mouvements, non moins que de risque de pétrification et de
perte.
Mais le signe va de la dent de souris, du nid d'hirondelle et de notre bouche balbutiante, jusqu'à leur association libre et leur transfiguration pleine dans les vers du poète, qui embrasse ainsi la totalité du sens.
dernière grandeur
Aux dents d'empreintes de souris blanche sur la terre
blanche
À la langue d'ambre et de verre frottés
Ma femme à la langue d'hostie poignardée
À la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux
À la langue de pierre incroyable
Ma femme aux cils de bâtons d'écriture d'enfant
Aux sourcils de bord de nid d'hirondelle
Splendeur du langage poétique le plus intense, qui évoque pourtant la « langue » la plus littérale, minimale et littérale. Tension entre le rythme, qui devient rite, et litanie, et la transgression qui rappelle que la langue qui est sacrement peut être aussi violence.
Rigueur de l'écriture la plus lyrique, mais qui réveille les «bâtons
d'écriture d'enfant». Le langage est toujours aussi langue, même si la langue peut être littéralement chantée dans le langage.
On aurait tort de croire que, sans le langage, toute relation serait impossible ; le langage continue, déploie, recrée ce qui est d'abord contact et distance entre des corps expressifs et fragiles, mystérieux de profondeur mais aussi de minéralité, de mouvements, non moins que de risque de pétrification et de
perte.
Mais le signe va de la dent de souris, du nid d'hirondelle et de notre bouche balbutiante, jusqu'à leur association libre et leur transfiguration pleine dans les vers du poète, qui embrasse ainsi la totalité du sens.
(...) nous avons besoin pour vivre de ces deux rapports au monde, de ces deux relations à nous-même et aux autres : le travail et le jeu.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Classes préparatoires B/L
Keefitz14
17 livres
Auteurs proches de Frédéric Worms
Lecteurs de Frédéric Worms (129)Voir plus
Quiz
Voir plus
Barbus illustres
La barbe est à la mode au 19ème siècle chez les écrivains. Qui n’y succombe pas ?
Victor Hugo
Emile Zola
Gustave Flaubert
11 questions
106 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, barbe
, célébritéCréer un quiz sur cet auteur106 lecteurs ont répondu