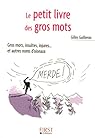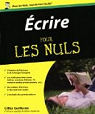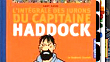Nationalité : France
Biographie :
Professeur agrégé de lettres modernes, Gilles Guilleron enseigne à l'université de Lorient.
Il est également l'auteur du Bac Français pour les Nuls, du croustillant Petit livre des gros mots, de Comment les haïkus naissent dans les choux et de A la queue leu leu parus chez First.
Professeur agrégé de lettres modernes, Gilles Guilleron enseigne à l'université de Lorient.
Il est également l'auteur du Bac Français pour les Nuls, du croustillant Petit livre des gros mots, de Comment les haïkus naissent dans les choux et de A la queue leu leu parus chez First.
Source : www.editionsfirst.fr
Ajouter des informations
étiquettes
Citations et extraits (24)
Voir plus
Ajouter une citation
Il ne faut jamais dire : "Fontaine, je ne boirai pas de ton eau"
Nul ne sachant de quoi demain sera fait, il pourrait bien arriver qu'une chose ou une personne dont on n'a que faire aujourd'hui nous devienne dans l'avenir vitale. Telle est la signification de cette apostrophe lancée directement à la fontaine, courante à partir du XIXe siècle. C'est du côté de Cervantès, dans la bouche prolixe en proverbes populaires espagnols de Sancho Pança (Don Quichotte, I, XXVII, LV), qu'on en trouvera l'origine.
Nul ne sachant de quoi demain sera fait, il pourrait bien arriver qu'une chose ou une personne dont on n'a que faire aujourd'hui nous devienne dans l'avenir vitale. Telle est la signification de cette apostrophe lancée directement à la fontaine, courante à partir du XIXe siècle. C'est du côté de Cervantès, dans la bouche prolixe en proverbes populaires espagnols de Sancho Pança (Don Quichotte, I, XXVII, LV), qu'on en trouvera l'origine.
Un coup de Jarnac
Cette expression rappelle un duel qui opposa sur la terrasse du château de Saint-Germain-en-Laye, le 10 juillet 1547, Guy Chabot, baron de Jarnac, à François de Vivonnes, seigneur de la Châtaigneraie. Durant le combat, Guy Chabot plaça un coup d'épée derrière la jambe de son adversaire et fendit le jarret de celui-ci, cette botte inattendue mai régulière donna la victoire au baron de Jarnac. L'expression a pris très rapidement un tour négatif pour désigner une action perfide, une victoire remportée par traîtrise.
Cette expression rappelle un duel qui opposa sur la terrasse du château de Saint-Germain-en-Laye, le 10 juillet 1547, Guy Chabot, baron de Jarnac, à François de Vivonnes, seigneur de la Châtaigneraie. Durant le combat, Guy Chabot plaça un coup d'épée derrière la jambe de son adversaire et fendit le jarret de celui-ci, cette botte inattendue mai régulière donna la victoire au baron de Jarnac. L'expression a pris très rapidement un tour négatif pour désigner une action perfide, une victoire remportée par traîtrise.
Verba volant, scripta manent ("Les paroles s'envolent, les écrits restent")... Facile à dire, mais pas toujours facile à écrire !
DEGONFLE : Construit à partir du verbe latin "conflare", gonfler, activer le feu en soufflant. Indéniablement un "dégonflé" se caractérise par son manque de courage et une propension à ne pas assumer la situation. L'"espèce de dégonflé" perd du volume dans les situations qui requièrent un engagement.
Variantes : trouillard, couille molle
Comment le dire en:
- registre courant : lâche, peureux, poltron
- registre soutenu : pleutre, pourfendeur de nano-dangers
Variantes : trouillard, couille molle
Comment le dire en:
- registre courant : lâche, peureux, poltron
- registre soutenu : pleutre, pourfendeur de nano-dangers
Dans le train
les voyageurs regardent
passer les vaches.
les voyageurs regardent
passer les vaches.
Frais Emoulu
Voici une curiosité! "Emoulu" participe passé du verbe latin emolere, "aiguiser", est la seule trace du verbe "émoudre", aujourd'hui disparu, qui était employé dans le domaine des armes blanches. Un combat "à fer émoulu" était dangereux car les armes venaient d'être aiguisées et n'étaient pas mouchetées. "Frais" (du francique frisk) n'a pas ici le sens de légèrement froid mais de récent : "frais émoulu" a pris un tour métaphorique au XVIe siècle pour désigner une personne récemment sortie d'une formation, donc particulièrement motivée et au fait des dernières innovations dans son domaine de compétence, en d'autres termes très affûtée!
Voici une curiosité! "Emoulu" participe passé du verbe latin emolere, "aiguiser", est la seule trace du verbe "émoudre", aujourd'hui disparu, qui était employé dans le domaine des armes blanches. Un combat "à fer émoulu" était dangereux car les armes venaient d'être aiguisées et n'étaient pas mouchetées. "Frais" (du francique frisk) n'a pas ici le sens de légèrement froid mais de récent : "frais émoulu" a pris un tour métaphorique au XVIe siècle pour désigner une personne récemment sortie d'une formation, donc particulièrement motivée et au fait des dernières innovations dans son domaine de compétence, en d'autres termes très affûtée!
Vous êtes d'excellents passeurs. Vous transmettez proverbes et expressions populaires hérités de vos parents, à vos enfants qui, passeurs non moins excellents, les transmettront à leur tour à leurs enfants. La plupart du temps ils vous sont si familiers, qu'il ne vous vient pas à l'idée de vous interroger sur leur origine, sur leur sens premier, voire sur leur orthographe.
Soyons donc modestes, surtout avec nos amis anglais ! La littérature anglaise, bien qu’elle vienne d’îles, est un véritable continent dont ces quelques pages ne pourront donner qu’un bref aperçu. Vous trouverez ici la présentation de quelques-uns de ces chefs-d’œuvre. Ils sont là pour vous inciter à entreprendre votre propre voyage de lecture.
Le « tout petit tour littéraire »
Du Moyen Âge au XVIIe siècle
Dans la littérature naissante du Moyen Âge, nous retiendrons les Contes de Canterbury (1387-1400) de Geoffrey Chaucer (1340-1400), suite de récits peignant avec humour et parfois ironie la société anglaise dans son quotidien. Au début du XVIe siècle, L’Utopie (1515) de Thomas More pose, par le biais de la fiction, une réflexion sur l’organisation du pouvoir.
Sous le règne de la reine Elisabeth Ire (au pouvoir de 1558 à 1603), le théâtre connaît un extraordinaire développement (chaque semaine, plus de 20 000 personnes allaient au théâtre à Londres) ; Christophe Marlowe développe le genre tragique avec des pièces comme Le Grand Tamberlain (1587) et La Tragique Histoire du Docteur Faust (1589) ; mais le point d’orgue, c’est l’œuvre monumentale de William Shakespeare (voir ci-après).
En poésie, John Milton inscrit sa création dans une perspective où se mêle religion et réflexion politique, comme dans son gigantesque recueil Le Paradis perdu (1667).
Du XVIIIe siècle au XIXe siècle
La poésie d’Alexander Pope (1688-1744) marque la première moitié du XVIIIe siècle en associant philosophie, critique de la société et fonction morale de la morale, notamment dans L’Essai sur l’homme (1733-1734). Sur le plan romanesque, Les Aventures de Robinson Crusoé (1719) de Daniel Defoe et Les Voyages de Gulliver (1726) de Jonathan Swift s’imposent. La langue anglaise trouve son ancrage linguistique avec la publication du Dictionnaire de la langue anglaise (1755) de Samuel Johnson.
Du XIXe siècle au XXe siècle
Trois noms dominent la poésie de la fin du XVIIIe siècle et celle du début du XIXe siècle : Samuel Taylor Coleridge, et notamment son recueil Kubla Khan (1816), où le poète met en mots le fonctionnement de l’inspiration poétique et de l’imaginaire littéraire. Lord Byron, sorte de concurrent de Coleridge, poète du paradoxe, publie en 1819 un recueil imposant de plus 16 000 vers, Don Juan, où le mythe donjuanesque est repris sur le mode ironique. John Keats, poète romantique, complète ce trio avec ses Odes (1819), où l’acte poétique est une tentative toujours renouvelée de saisir la complexité de la trajectoire humaine exprimée dans ce vers célèbre : « Beauté est vérité et vérité beauté. Voilà tout ce que l’on sait sur terre et tout ce qu’il faut savoir ».
Le genre romanesque s’épanouit dans un premier temps avec les œuvres de Mary Shelley (Frankenstein, 1818) et de Jane Austen (Orgueil et Préjugés 1813) et la vogue du roman historique, où Walter Scott s’impose (Ivanhoé, 1819) ; puis, dans un second temps, avec les œuvres de Charles Dickens (Oliver Twist, 1837-1839 ; David Copperfield, 1850) et celles des sœurs Brontë en 1847 : Jane Eyre de Charlotte ; Les Hauts de Hurlevent par Emily. Dans un troisième temps, Lewis Carroll, Oscar Wilde et Robert Louis Stevenson explorent des univers fantastiques et psychologiques qui font évoluer le genre (voir leurs œuvres présentées ci-après).
Au début du XXe siècle, George Bernard Shaw relance le théâtre d’idées avec plusieurs pièces qui revisitent des œuvres du passé (par exemple Homme et superhomme, 1901-1903, où le mythe de Don Juan est revisité). Un peu plus tard, un théâtre engagé politiquement se développe, notamment à travers l’œuvre de Sean O’ Casey (Junon et le Paon, 1922). Après la Seconde Guerre mondiale et ses terribles leçons, le théâtre de l’absurde s’impose à travers certaines œuvres d’Harold Pinter, mais surtout de Samuel Beckett.
Le roman du XXe siècle introduit de nouvelles orientations où le héros et la chronologie sont souvent déstructurés ; les romans de Joseph Conrad, James Joyce, Virginia Woolf, Doris Lessing (voir leurs œuvres présentées ci-après) illustrent cette esthétique.
Voilà, le tout petit tour s’achève. À vous maintenant d’entrer dans le cercle et de l’élargir…
Du XVIe au XVIIIe siècle : des idées, du théatre et des aventures
Philosophie, théâtre, roman d’aventures… on peut dire que la littérature anglaise commence fort ! C’est cette diversité que vous retrouvez chez More, Shakespeare, Defoe, Swift, et bien d’autres.
Le « tout petit tour littéraire »
Du Moyen Âge au XVIIe siècle
Dans la littérature naissante du Moyen Âge, nous retiendrons les Contes de Canterbury (1387-1400) de Geoffrey Chaucer (1340-1400), suite de récits peignant avec humour et parfois ironie la société anglaise dans son quotidien. Au début du XVIe siècle, L’Utopie (1515) de Thomas More pose, par le biais de la fiction, une réflexion sur l’organisation du pouvoir.
Sous le règne de la reine Elisabeth Ire (au pouvoir de 1558 à 1603), le théâtre connaît un extraordinaire développement (chaque semaine, plus de 20 000 personnes allaient au théâtre à Londres) ; Christophe Marlowe développe le genre tragique avec des pièces comme Le Grand Tamberlain (1587) et La Tragique Histoire du Docteur Faust (1589) ; mais le point d’orgue, c’est l’œuvre monumentale de William Shakespeare (voir ci-après).
En poésie, John Milton inscrit sa création dans une perspective où se mêle religion et réflexion politique, comme dans son gigantesque recueil Le Paradis perdu (1667).
Du XVIIIe siècle au XIXe siècle
La poésie d’Alexander Pope (1688-1744) marque la première moitié du XVIIIe siècle en associant philosophie, critique de la société et fonction morale de la morale, notamment dans L’Essai sur l’homme (1733-1734). Sur le plan romanesque, Les Aventures de Robinson Crusoé (1719) de Daniel Defoe et Les Voyages de Gulliver (1726) de Jonathan Swift s’imposent. La langue anglaise trouve son ancrage linguistique avec la publication du Dictionnaire de la langue anglaise (1755) de Samuel Johnson.
Du XIXe siècle au XXe siècle
Trois noms dominent la poésie de la fin du XVIIIe siècle et celle du début du XIXe siècle : Samuel Taylor Coleridge, et notamment son recueil Kubla Khan (1816), où le poète met en mots le fonctionnement de l’inspiration poétique et de l’imaginaire littéraire. Lord Byron, sorte de concurrent de Coleridge, poète du paradoxe, publie en 1819 un recueil imposant de plus 16 000 vers, Don Juan, où le mythe donjuanesque est repris sur le mode ironique. John Keats, poète romantique, complète ce trio avec ses Odes (1819), où l’acte poétique est une tentative toujours renouvelée de saisir la complexité de la trajectoire humaine exprimée dans ce vers célèbre : « Beauté est vérité et vérité beauté. Voilà tout ce que l’on sait sur terre et tout ce qu’il faut savoir ».
Le genre romanesque s’épanouit dans un premier temps avec les œuvres de Mary Shelley (Frankenstein, 1818) et de Jane Austen (Orgueil et Préjugés 1813) et la vogue du roman historique, où Walter Scott s’impose (Ivanhoé, 1819) ; puis, dans un second temps, avec les œuvres de Charles Dickens (Oliver Twist, 1837-1839 ; David Copperfield, 1850) et celles des sœurs Brontë en 1847 : Jane Eyre de Charlotte ; Les Hauts de Hurlevent par Emily. Dans un troisième temps, Lewis Carroll, Oscar Wilde et Robert Louis Stevenson explorent des univers fantastiques et psychologiques qui font évoluer le genre (voir leurs œuvres présentées ci-après).
Au début du XXe siècle, George Bernard Shaw relance le théâtre d’idées avec plusieurs pièces qui revisitent des œuvres du passé (par exemple Homme et superhomme, 1901-1903, où le mythe de Don Juan est revisité). Un peu plus tard, un théâtre engagé politiquement se développe, notamment à travers l’œuvre de Sean O’ Casey (Junon et le Paon, 1922). Après la Seconde Guerre mondiale et ses terribles leçons, le théâtre de l’absurde s’impose à travers certaines œuvres d’Harold Pinter, mais surtout de Samuel Beckett.
Le roman du XXe siècle introduit de nouvelles orientations où le héros et la chronologie sont souvent déstructurés ; les romans de Joseph Conrad, James Joyce, Virginia Woolf, Doris Lessing (voir leurs œuvres présentées ci-après) illustrent cette esthétique.
Voilà, le tout petit tour s’achève. À vous maintenant d’entrer dans le cercle et de l’élargir…
Du XVIe au XVIIIe siècle : des idées, du théatre et des aventures
Philosophie, théâtre, roman d’aventures… on peut dire que la littérature anglaise commence fort ! C’est cette diversité que vous retrouvez chez More, Shakespeare, Defoe, Swift, et bien d’autres.
Travaillez l'art de suggérer et laissez l'imaginaire du lecteur se déployer dans votre histoire pour qu'elle devienne sienne : plutôt que « Paul se sent nerveux », dites « les mains de Paul tremblent ».
GREDIN : Du néerlandais gredich. Souvent, c'est après coup que le "gredin" est identifié, démasqué et nommé comme tel et cette injure vient alors ponctuer avec fatalisme la découverte d'un comportement malveillant, malhonnête, "quel gredin !".
Variantes : escroc, fumier, ordure
Comment le dire en :
- langage courant : bandit, malfaiteur
- langage soutenu : percepteur au noir
Variantes : escroc, fumier, ordure
Comment le dire en :
- langage courant : bandit, malfaiteur
- langage soutenu : percepteur au noir
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Conseils d'écrivains
agnesmoisan84
27 livres
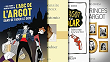
Argot à tire-larigot
Alzie
35 livres
Auteurs proches de Gilles Guilleron
Lecteurs de Gilles Guilleron (158)Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz Voyage au bout de la nuit
Comment s'appelle le héros qui raconte son expérience de la 1ère guerre mondiale
Bardamu
Bardamur
Barudamurad
Barudabadumarad
Rudaba Abarmadabudabar
9 questions
1304 lecteurs ont répondu
Thème : Voyage au bout de la nuit de
Louis-Ferdinand CélineCréer un quiz sur cet auteur1304 lecteurs ont répondu