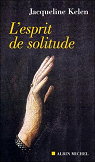Citations de Jacqueline Kelen (299)
L'amour que je ressens pour un être ne met pas fin à ma solitude mais il l'enrichit, l'enchante et la fait rayonner. L'élu , l'être aimé serait paradoxalement celui avec qui j'ai envie d'être seule.
(...) la plupart des femmes seules inquiètent ou font peur, elles posent question ; et si elles paraissent souffrir de leur isolement, elles repoussent à coup sûr les hommes, bien loin de les attirer, de les émouvoir. En vérité, les hommes ne supportent pas les femmes tristes, malades ou en détresse.
Celui qui vit en solitude n'est pas coupé de ses contemporains, il n'est pas lointain mais plutôt au cœur des choses, en intimité avec les êtres vivants - ceux qui passent aujourd'hui sur terre et ceux qui l'ont quittée. Il se sent relié en profondeur.
Nous étions dans l'éblouissement de la jeunesse lorsque nos regards se sont étreints. Dans le ravissement de l'amour. Tu n'avais pas connu cette folle émotion, ce déraisonné désir avant moi, peut-être t'étais-tu méfié des femmes. Moi, j'étais toute jeune, je n'avais pas encore enlacé un amant, mais une femme n'a pas besoin de s'allonger auprès d'un homme pour connaître l'amour : qu'elle reste vierge ou qu'elle s'offre à tous, elle est, dès sa naissance, initiée à ce mystère. Là réside certainement la souveraineté de la femme : elle naît avec la connaissance de l'amour sans en avoir eu encore l'expérience.
Viviane et Merlin
Viviane et Merlin
Qui prend en compte la souffrance de ces jeunes gens, majoritairement des filles ? Qui pense au calvaire qu'ils endurent à subir des traitements tout à fait inappropriés, qui blessent leur âme encore davantage ? Car tous les anorexiques ne cessent de le dire : leur « problème » ne réside ni dans la nourriture, ni dans la maigreur, ni dans le seul environnement familial, ni dans le psychisme… Mais sans vouloir les entendre on continue de leur prodiguer les mêmes soins routiniers et inutiles, voire nocifs.
Qu’ils soient ou non mineurs, ne peut-on enfin écouter et respecter ce qu'ils disent ? Leurs propos me semblent d’une clarté éblouissante : ils veulent devenir pur esprit, ils rêvent de beauté et d’idéal, ils ont soif de perfection, de salut, d’immensité, ils veulent échapper à l’ordinaire, à l’affligeante condition humaine… Et ils formulent tout cela simplement. Mais les spécialistes du psychisme et de la nutrition refusent catégoriquement de prêter attention à ces témoignages et de leur accorder de la valeur. Pis, ils traitent souvent ces « malades » de menteurs, de manipulateurs et autres perversités et ne font aucun cas des souffrances qu'ils éprouvent à être systématiquement niés, incompris. Il me semble pourtant que la présomption d’innocence ou de sincérité devrait être accordée aussi aux anorexiques.
Ces adolescents au corps évanescent et à l’intelligence brillante, à la volonté ferme, répètent qu'ils ne sont pas fous, qu'ils ne veulent pas mourir, que les traitements psychiatriques ou le gavage ne mènent à rien, sont hors champ ; et surtout, ils implorent qu'on cesse de leur parler de pitance et de poids : ils attendent mieux de la vie et des autres, ils veulent faire de leur existence mieux qu’un temps de dépense et de consommation…
Mais en dépit de ces propos constants, communs à tous, et en dépit d’échecs avérés depuis plus de cent ans, certains psychiatres rigides ainsi que des médecins sûrs de leur science persistent dans leur dogmatisme, déclarant que le désir d’immortalité est un fantasme, Dieu une échappatoire, les livres et l’art un dérivatif. Plus que tout, la quête de perfection et le mysticisme de ces jeunes filles les dérangent. Voici quelques phrases du psychiatre Alain Meunier à propos d’une fille anorexique, qui en disent long sur son propre univers et sa vision de l’être humain : « Elle a la dureté des gens qui savent, des croyants ; c'est une parfaite ; sa dévotion à l’absolu la ferait flirter avec le mysticisme… C'est une terroriste dans l’âme. Mue par un idéal, elle ne s’embarrasse pas de la vie. » Et il se dévoile tout à fait en avouant son « axe thérapeutique » : « Il faut casser une partie de cet univers d’anorexique, pour faire une part à la réalité de la planète Terre. »
On a vraiment affaire à un dialogue de sourds : les psychiatres n’ont qu’un monde étriqué et réaliste à proposer à des jeunes gens assoiffés d’amour et d’idéal. Il est impossible que les uns et les autres se rejoignent jamais.
Du reste, à quoi les patriciens reconnaissent-ils que l’adolescent est guéri ? Certains spécialistes l’admettent : « Les critères médicaux de la guérison ont pour particularité d’être ces modèles d’adaptation à l’ordre établi que l’anorexique récuse. »
Ces critères ne sont autres que le poids « normal », le partage des repas en famille, le cycle menstruel régulier pour les jeunes filles, plus tard le mariage et la grossesse… Il s’agit donc bien de normes sociales auxquelles tous les individus doivent se ranger. Mais les auteurs féminins de l’ouvrage sont assez lucides pour déclarer : « Celle qui ne sait comment vivre autrement qu’en refusant la nourriture n'est pas "guérie" lorsqu’elle se remet à manger. »
La conclusion est limpide : les spécialistes ne comprennent quasiment rien à l’étrange maladie qui touche en forte proportion les filles, et les traitements conventionnels échouent. À leur sortie d’hôpital, les anorexiques ont repris du poids, mais leur esprit – et c'est heureux – n'a pas changé parce que leur esprit n'est pas malade.
pp. 207-209
Qu’ils soient ou non mineurs, ne peut-on enfin écouter et respecter ce qu'ils disent ? Leurs propos me semblent d’une clarté éblouissante : ils veulent devenir pur esprit, ils rêvent de beauté et d’idéal, ils ont soif de perfection, de salut, d’immensité, ils veulent échapper à l’ordinaire, à l’affligeante condition humaine… Et ils formulent tout cela simplement. Mais les spécialistes du psychisme et de la nutrition refusent catégoriquement de prêter attention à ces témoignages et de leur accorder de la valeur. Pis, ils traitent souvent ces « malades » de menteurs, de manipulateurs et autres perversités et ne font aucun cas des souffrances qu'ils éprouvent à être systématiquement niés, incompris. Il me semble pourtant que la présomption d’innocence ou de sincérité devrait être accordée aussi aux anorexiques.
Ces adolescents au corps évanescent et à l’intelligence brillante, à la volonté ferme, répètent qu'ils ne sont pas fous, qu'ils ne veulent pas mourir, que les traitements psychiatriques ou le gavage ne mènent à rien, sont hors champ ; et surtout, ils implorent qu'on cesse de leur parler de pitance et de poids : ils attendent mieux de la vie et des autres, ils veulent faire de leur existence mieux qu’un temps de dépense et de consommation…
Mais en dépit de ces propos constants, communs à tous, et en dépit d’échecs avérés depuis plus de cent ans, certains psychiatres rigides ainsi que des médecins sûrs de leur science persistent dans leur dogmatisme, déclarant que le désir d’immortalité est un fantasme, Dieu une échappatoire, les livres et l’art un dérivatif. Plus que tout, la quête de perfection et le mysticisme de ces jeunes filles les dérangent. Voici quelques phrases du psychiatre Alain Meunier à propos d’une fille anorexique, qui en disent long sur son propre univers et sa vision de l’être humain : « Elle a la dureté des gens qui savent, des croyants ; c'est une parfaite ; sa dévotion à l’absolu la ferait flirter avec le mysticisme… C'est une terroriste dans l’âme. Mue par un idéal, elle ne s’embarrasse pas de la vie. » Et il se dévoile tout à fait en avouant son « axe thérapeutique » : « Il faut casser une partie de cet univers d’anorexique, pour faire une part à la réalité de la planète Terre. »
On a vraiment affaire à un dialogue de sourds : les psychiatres n’ont qu’un monde étriqué et réaliste à proposer à des jeunes gens assoiffés d’amour et d’idéal. Il est impossible que les uns et les autres se rejoignent jamais.
Du reste, à quoi les patriciens reconnaissent-ils que l’adolescent est guéri ? Certains spécialistes l’admettent : « Les critères médicaux de la guérison ont pour particularité d’être ces modèles d’adaptation à l’ordre établi que l’anorexique récuse. »
Ces critères ne sont autres que le poids « normal », le partage des repas en famille, le cycle menstruel régulier pour les jeunes filles, plus tard le mariage et la grossesse… Il s’agit donc bien de normes sociales auxquelles tous les individus doivent se ranger. Mais les auteurs féminins de l’ouvrage sont assez lucides pour déclarer : « Celle qui ne sait comment vivre autrement qu’en refusant la nourriture n'est pas "guérie" lorsqu’elle se remet à manger. »
La conclusion est limpide : les spécialistes ne comprennent quasiment rien à l’étrange maladie qui touche en forte proportion les filles, et les traitements conventionnels échouent. À leur sortie d’hôpital, les anorexiques ont repris du poids, mais leur esprit – et c'est heureux – n'a pas changé parce que leur esprit n'est pas malade.
pp. 207-209
À force de dépendre de leurs machines portables, de leurs écrans qui clignotent de mille jeux, les contemporains vont devenir à leur image, dénués de pensée personnelle et de sentiments profonds. Ils « fonctionnent » au lieu de vivre, ils « gèrent » leurs émotions au lieu d’aimer, et ils consomment des « produits » de beauté plutôt que de se soucier de la beauté de leur âme. Ce faisant, ils passent à côté de la vie douce et violente, de la vie toujours incontrôlable, merveilleusement imprévisible.
La différence est de taille entre savoir et connaissance. La connaissance est directement proportionnelle à la qualité spirituelle de l’être. Plus un être est purifié et élevé spirituellement, plus ample et profonde s’avère sa connaissance. Tandis qu’un homme peut disposer d’un savoir immense tout en étant immoral ou mauvais.
Un parcours philosophique ou spirituel consiste à passer de l’état d’enfance à l’esprit d’enfance. À quitter l’ignorance et la naïveté sans perdre sa fraîcheur et sa gaieté. À devenir conscient et lucide sans perdre sa faculté d’émerveillement et ses élans d’amour. Très fin équilibre qui signe la maturité, faite de juvénilité et de profondeur.
La solitude apprend à aimer. Ce n'est pas l'amour qui brise la solitude, c'est la solitude qui permet l'éclosion et la durée de l'amour. Un amour qui ne soit pas possession de l'autre ou appartenance de l'autre. Un amour qui respecte la solitude de l'autre.
Si l’amour fou, si la joie s’avèrent si précieux, c’est parce que sur eux rien ni personne n’ont de prise, parce que nulle raison, nul obstacle ne les font renoncer ; en un mot, parce qu’ils sont infiniment libres. En comparaison avec ces états proprement divins, combien chétifs paraissent nos sentiments, combien fragiles nos plaisirs, et comme les humains cherchent à se protéger de tout au lieu de se libérer de tout !
Dans un parcours spirituel, l’amour, la liberté, la joie l’emportent irréversiblement sur toute douleur, sur tout ressentiment. Etty Hillesum note, en mars 1941 : « Mille liens qui m’oppressaient sont rompus. Je respire librement, je me sens forte et je porte sur toutes choses un regard radieux. Et maintenant que je ne veux plus rien posséder, maintenant que je suis libre, tout m’appartient désormais et ma richesse intérieure est immense. »
Dans un parcours spirituel, l’amour, la liberté, la joie l’emportent irréversiblement sur toute douleur, sur tout ressentiment. Etty Hillesum note, en mars 1941 : « Mille liens qui m’oppressaient sont rompus. Je respire librement, je me sens forte et je porte sur toutes choses un regard radieux. Et maintenant que je ne veux plus rien posséder, maintenant que je suis libre, tout m’appartient désormais et ma richesse intérieure est immense. »
Qui désire accéder au royaume intérieur doit avant tout se tenir en silence et en solitude : ces conditions externes disposent l’individu à l’écoute et au recueillement. Dans la vie quotidienne, on se laisse happer par le tourbillon des événements, on se disperse, et on se retrouve harassé. La société actuelle est faite de gens pressés et débordés, qui n’ont pas une minute à eux. Mais lorsqu’on fait retour à soi, lorsqu’on renoue avec la vie intérieure, on perçoit que le temps s’ouvre tout autant que l’espace, et plus on va vers la profondeur, plus l’être se déploie.
« Court est le temps qui t’est laissé. Vis comme sur une montagne », énonce Marc Aurèle. Toute démarche philosophique, toute aventure spirituelle commencent par le retrait et le silence propices au calme et à la réflexion et s’y ressourcent régulièrement. Ainsi Socrate affirme : « La vie d’un véritable philosophe est une vie de calme, de silence intérieur, de solitude et de distance avec le monde. Oublié et oublieux du monde, il trouve la paix dans la contemplation du Bien. Cela et cela seul est la vraie vie. » Jésus lui-même, ainsi que le notent les évangiles, se tient volontiers à l’écart et après avoir enseigné les foules ou accompli un miracle, recherche la solitude.
« Court est le temps qui t’est laissé. Vis comme sur une montagne », énonce Marc Aurèle. Toute démarche philosophique, toute aventure spirituelle commencent par le retrait et le silence propices au calme et à la réflexion et s’y ressourcent régulièrement. Ainsi Socrate affirme : « La vie d’un véritable philosophe est une vie de calme, de silence intérieur, de solitude et de distance avec le monde. Oublié et oublieux du monde, il trouve la paix dans la contemplation du Bien. Cela et cela seul est la vraie vie. » Jésus lui-même, ainsi que le notent les évangiles, se tient volontiers à l’écart et après avoir enseigné les foules ou accompli un miracle, recherche la solitude.
Celui qui désire avancer sur la voie intérieure n’a pas besoin de se tourner vers un maître, comme on le fait accroire de nos jours où l’Occident, oublieux de se propres richesses, copie le modèle spirituel de l’Orient suivant lequel les disciples dépendent d’un guru, d’un swami, d’un lama. Selon la tradition occidentale – où convergent Athènes, Jérusalem et Rome –, la précellence est donnée à la liberté de la personne humaine et la démarche philosophique ou spirituelle s’apparente à un compagnonnage, à une relation d’amitié entre des personnes partageant une même quête, et non pas à un lien d’obéissance et de dépendance entre quelqu'un qui sait et les autres qui ont tout à apprendre de lui. La vision occidentale de l’être humain est celle d’une personne unique et irremplaçable, douée de libre arbitre, de mémoire et de volonté, et capable d’exercer son propre jugement. Ainsi Socrate, loin de se poser en maître, se déclare accoucheur d’âmes et converse librement avec les gens qu’il rencontre autant qu’avec ses amis. Ainsi Jésus chemine sur les routes en compagnie d’hommes et de femmes, les interroge au lieu de les embrigader, et désigne ses apôtres par le beau qualificatif d’amis.
Si la femme peut être insultée, avilie, la Dame ne peut jamais être souillée ni atteinte de blessures parce qu’elle figure l’éternelle, l’immuable dimension de l’Esprit. Et en toute créature féminine il y a, souveraine, une Dame qui surmonte et sanctifie les blessures faites à la femme. Ainsi la Dame oint et referme les plaies de la femme offensée en son corps, en son cœur ou en sa dimension sacrée.
Jamais la Dame ne peut être détruite ni endommagée, mais elle endure de terribles souffrances à se sentir si éloignée, si peu recherchée des mortels. Ainsi, Raymond Lulle met en scène, dès le prologue de L’Arbre de la Philosophie d’Amour, une belle jeune femme qu’il rencontre « dans un beau pré, au milieu duquel il y avait un grand arbre et une belle fontaine ». La dame est gracieuse et richement parée mais se répand en pleurs déchirants. S’approchant d’elle, le narrateur la salue humblement, il lui demande son nom et la raison de son chagrin. La dame se présente comme Philosophie d’Amour, dont la sœur Philosophie de Savoir reçoit tous les suffrages des hommes qui préfèrent les « sciences de l’entendement et de la vérité à celles de l’amour et de la bonté ». Ainsi parle la belle dame désolée : « Ce ne sont pas la jalousie ni l’orgueil qui me font gémir ; je pleure parce que la plupart des hommes ne savent pas aimer ; s’ils savaient aimer aussi bien qu’ils savent comprendre, grâce à moi et à ma sœur le monde entier serait dans un ordre parfait. »
Depuis le mois d’octobre 1298, date à laquelle Raymond Lulle termina, près de Paris, son magnifique ouvrage, on ne peut guère avancer que les choses aient changé dans le cœur des hommes. Philosophie d’Amour demeure inconsolée.
Voilà pourquoi toute femme au cœur libre et aimant a mal à l’Amour en ce monde, pourquoi les mystiques au cœur transpercé souffrent des blessures réitérées que les mortels portent à l’Amour en l’ignorant ou en le rabaissant à leur misérable niveau. La Dame d’Amour déroule sa longue plainte dans le silence des cœurs fermés. Didon, Héloïse, la religieuse portugaise, et toutes celles que Rilke nomme les « grandes amoureuses » parce qu’elles ouvrent à l’homme l’espace illimité de l’Amour au lieu de restreindre celui-ci au cercle clos de leurs bras.
pp. 291-292
Jamais la Dame ne peut être détruite ni endommagée, mais elle endure de terribles souffrances à se sentir si éloignée, si peu recherchée des mortels. Ainsi, Raymond Lulle met en scène, dès le prologue de L’Arbre de la Philosophie d’Amour, une belle jeune femme qu’il rencontre « dans un beau pré, au milieu duquel il y avait un grand arbre et une belle fontaine ». La dame est gracieuse et richement parée mais se répand en pleurs déchirants. S’approchant d’elle, le narrateur la salue humblement, il lui demande son nom et la raison de son chagrin. La dame se présente comme Philosophie d’Amour, dont la sœur Philosophie de Savoir reçoit tous les suffrages des hommes qui préfèrent les « sciences de l’entendement et de la vérité à celles de l’amour et de la bonté ». Ainsi parle la belle dame désolée : « Ce ne sont pas la jalousie ni l’orgueil qui me font gémir ; je pleure parce que la plupart des hommes ne savent pas aimer ; s’ils savaient aimer aussi bien qu’ils savent comprendre, grâce à moi et à ma sœur le monde entier serait dans un ordre parfait. »
Depuis le mois d’octobre 1298, date à laquelle Raymond Lulle termina, près de Paris, son magnifique ouvrage, on ne peut guère avancer que les choses aient changé dans le cœur des hommes. Philosophie d’Amour demeure inconsolée.
Voilà pourquoi toute femme au cœur libre et aimant a mal à l’Amour en ce monde, pourquoi les mystiques au cœur transpercé souffrent des blessures réitérées que les mortels portent à l’Amour en l’ignorant ou en le rabaissant à leur misérable niveau. La Dame d’Amour déroule sa longue plainte dans le silence des cœurs fermés. Didon, Héloïse, la religieuse portugaise, et toutes celles que Rilke nomme les « grandes amoureuses » parce qu’elles ouvrent à l’homme l’espace illimité de l’Amour au lieu de restreindre celui-ci au cercle clos de leurs bras.
pp. 291-292
Le précepte majeur de toute quête de sens est : « Connais-toi toi-même. » La devise inscrite au fronton du temple de Delphes que Socrate prit comme point de départ de son enseignement. Qui suis-je ? À quoi est-ce que je m’identifie, je me limite ? Ne suis-je qu’un corps, un organisme vivant et pensant ? Ne suis-je que matière destinée à disparaître ? Ne suis-je fait que de beaucoup d’inconscience et d’un peu de conscience ? N’existé-je qu’en raison d’une lignée charnelle, n’ai-je d’héritage que génétique ? Ne suis-je mû que par des besoins, des pulsions, et mes désirs ne se portent-ils que sur des choses concrètes à acquérir, à posséder ? Ne suis-je pas habité par un songe plus vaste, par un désir d’éternité ? Qu’est-ce qui de moi demeurera lorsque je mourrai ? En quels instants me sens-je vivant, véritablement vivant ?...
Et tant d’autres questions.
Des questions qui n’attendent aucune réponse immédiate et refusent les explications toutes faites. Des questions qui ont pour vertu d’ouvrir des fenêtres, de déblayer le chemin, qui font avancer. Les mots « quête » et « question » sont de parenté étroite, ne n’oublions pas.
Un individu qui se montre avide d’explications et de solutions se croit rassuré par des réponses, qui viennent le plus souvent de l’extérieur. Il a peu de chance de partir en quête. Il risque plutôt de subir toutes les modes, tous les conformismes, et de rester dans le troupeau. Un tel individu croit que les autres, les spécialistes en particulier, savent mieux que lui ce qu’il ressent, ce qui est bon pour lui, il s’en remet à eux pour aller cahin-caha dans la vie, mais ce faisant, il s’est dépossédé de son intériorité, il a abandonné à d’autres – exploiteurs sans vergogne ou experts en bâtiment – sa précieuse maison intérieure.
La connaissance de soi ne brasse pas des problèmes et ne réclame pas des solutions. Mais, ouvrant tout l’« espace du dedans » dont parle le poète Henri Michaux, elle affranchit d’abord de toute influence, de toute manipulation venant de l’extérieur, elle permet de se dégager des nombreux conditionnements auxquels chacun se trouve soumis. Un homme dépourvu d’intériorité se condamne à n’être qu’un pur produit : d’une famille, d’une époque, d’un pays, d’une mode… Il subit tous les déterminismes tout en se croyant libre et actif, et il n’a d’autre possibilité, comme produit, que de reproduire des schémas, des explications et des solutions, sans jamais inventer, créer du neuf. C’est pourquoi, n’ayant pas accès à sa singularité, il se sent à l’aise dans les groupes, la foule anonyme, et ne parle qu’en termes de généralité et de génération. Dépouillé de sa maison intérieure, il a besoin des autres pour qu’ils l’hébergent, le soutiennent, lui tiennent chaud. Comme il est incapable de vivre seul, il se raccroche au « vivre ensemble », un programme collectif.
Qui suis-je lorsque je ne me définis plus par ma filiation, par ma profession, par mes attaches sentimentales et mes liens sociaux et amicaux ? Qu’est-ce qui reste lorsque tout cela s’efface ? N’y a-t-il plus qu’un grand vide effarant, l’impression de ne pas exister, de n’avoir nul visage, ou est-ce qu’une petite lumière palpite encore, une flamme que l’extérieur n’a pas étouffée ?
Se connaître, c’est partir à la découverte de ce qui en soi est inconditionné et inaliénable. Indestructible.
[…]
La connaissance de soi, qui nécessite une démarche de retrait et de recueillement et peut au départ s’apparenter à une introspection, loin de se limiter au moi existentiel ouvre à un monde infini. « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l’univers et les dieux », tel est l’adage de sagesse en son intégralité.
pp. 66-68
Et tant d’autres questions.
Des questions qui n’attendent aucune réponse immédiate et refusent les explications toutes faites. Des questions qui ont pour vertu d’ouvrir des fenêtres, de déblayer le chemin, qui font avancer. Les mots « quête » et « question » sont de parenté étroite, ne n’oublions pas.
Un individu qui se montre avide d’explications et de solutions se croit rassuré par des réponses, qui viennent le plus souvent de l’extérieur. Il a peu de chance de partir en quête. Il risque plutôt de subir toutes les modes, tous les conformismes, et de rester dans le troupeau. Un tel individu croit que les autres, les spécialistes en particulier, savent mieux que lui ce qu’il ressent, ce qui est bon pour lui, il s’en remet à eux pour aller cahin-caha dans la vie, mais ce faisant, il s’est dépossédé de son intériorité, il a abandonné à d’autres – exploiteurs sans vergogne ou experts en bâtiment – sa précieuse maison intérieure.
La connaissance de soi ne brasse pas des problèmes et ne réclame pas des solutions. Mais, ouvrant tout l’« espace du dedans » dont parle le poète Henri Michaux, elle affranchit d’abord de toute influence, de toute manipulation venant de l’extérieur, elle permet de se dégager des nombreux conditionnements auxquels chacun se trouve soumis. Un homme dépourvu d’intériorité se condamne à n’être qu’un pur produit : d’une famille, d’une époque, d’un pays, d’une mode… Il subit tous les déterminismes tout en se croyant libre et actif, et il n’a d’autre possibilité, comme produit, que de reproduire des schémas, des explications et des solutions, sans jamais inventer, créer du neuf. C’est pourquoi, n’ayant pas accès à sa singularité, il se sent à l’aise dans les groupes, la foule anonyme, et ne parle qu’en termes de généralité et de génération. Dépouillé de sa maison intérieure, il a besoin des autres pour qu’ils l’hébergent, le soutiennent, lui tiennent chaud. Comme il est incapable de vivre seul, il se raccroche au « vivre ensemble », un programme collectif.
Qui suis-je lorsque je ne me définis plus par ma filiation, par ma profession, par mes attaches sentimentales et mes liens sociaux et amicaux ? Qu’est-ce qui reste lorsque tout cela s’efface ? N’y a-t-il plus qu’un grand vide effarant, l’impression de ne pas exister, de n’avoir nul visage, ou est-ce qu’une petite lumière palpite encore, une flamme que l’extérieur n’a pas étouffée ?
Se connaître, c’est partir à la découverte de ce qui en soi est inconditionné et inaliénable. Indestructible.
[…]
La connaissance de soi, qui nécessite une démarche de retrait et de recueillement et peut au départ s’apparenter à une introspection, loin de se limiter au moi existentiel ouvre à un monde infini. « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l’univers et les dieux », tel est l’adage de sagesse en son intégralité.
pp. 66-68
Le désir, c’est le goût de l’autre, de la vie, de l’ailleurs, du nouveau. Plus un individu, par peur, étouffe en lui le désir, et plus il devient morne et triste. Un individu narcissique est seulement désireux de lui-même et ce n’est pas par hasard si notre époque qui flatte en permanence l’égocentrisme des gens est une époque de convoitise généralisée, non pas de désir.
Il s’agit de passer de l’état de victime, consentant à son mal, à celui de sujet conscient et responsable, à l’état de vivant. Il s’agit de s’éveiller, de quitter son cocon ou sa chère prison de souffrances. L’homme nouveau, l’homme éveillé, n’est pas celui à qui il est arrivé des choses extraordinaires, mais celui qui a ressenti avec acuité, fulgurance, et de façon irréversible, l’obligation de se libérer. En jouant avec le mot grec pathos et le mot latin passio qui ont fourni à la langue française la « pathologie » et la « passion », où l’on ne retient que l’homme qui subit, qui souffre, tel un patient en attente de guérison, je dirai que la voie proposée par Sophocle [dans la pièce Philoctète], et par tout récit initiatique, consiste à tirer l’homme de son état pathologique, triste et passif, pour en faire un homme de passion – de haute, de noble passion. Et on ne peut vivre passionnément sans être passé par la blessure et sans l’avoir dépassée.
De la connaissance de soi qui affranchit des entraves temporelles et individuelles, on est tombé dans l’amour de soi qui est enfermement, indifférence à l’autre ou utilisation d’autrui.
Toutes les flatteries d’amour-propre invitent à rester à la maison, plus exactement dans la prison. Or, comme Platon l’a admirablement décrit dans le mythe de la Caverne, au septième livre de sa République, la plupart des mortels préfèrent rester entravés et captifs mais à l’abri, plutôt que de s’arracher aux reflets, aux illusions du monde, afin de contempler la source de Lumière. Voilà pourquoi ils restent des mortels.
L’éveil est un arrachement, une coupure irréversible. Le prisonnier de l’apologue platonicien qui, seul, s’est retourné vers le Réel en refusant l’emprise de l’habitude et de l’ignorance, et qui s’est détaché du groupe des captifs, sera à jamais marqué par une déchirure qui est sa noblesse et sa singularité, qui signe aussi l’accès à l’Être. Ce retournement et cet éveil de conscience le séparent du commun des mortels, de la mortifère inconscience commune. Aussi est-il traité de fou ou de malade par ceux qui le croyaient des leurs. Non, il n’est plus leur semblable, leur congénère, il ne fait plus partie de ces gens qui se croient heureux, qui s’estiment tranquilles, il est un homme libre allant vers la Source, un esseulé allant vers le Solitaire. Il est marqué à vie car vive est la blessure de l’éveil.
[…]
Celui qui s’est évadé de la prison et qui s’est coupé de la chaude communauté des mortels n’est pas à la fin de ses épreuves puisque, au contraire, la quête commence. L’homme blessé, en marche, se voit exposé à toutes les rencontres, à d’autres déchirures. Il se retrouve libre et seul, immensément fragile, à l’abri de rien parce qu’en quête de tout. Avançant sur le chemin, il aimera de plus en plus sa vulnérabilité qui n’est pas faiblesse, sa sensibilité qui est chant du cœur. C’est une fragilité qui n’a pas besoin d’être protégée, c’est une blessure qui ne réclame nulle guérison. Cette fragilité est la musique de l’être, sa nudité essentielle et indestructible.
La blessure sauve l’homme de toutes les tentatives d’asservissement que représente le besoin compulsif d’être indemne et protégé de tout, elle le sauve de tous les remèdes qui veulent euphoriser ou tranquilliser son existence et d’abord sa pensée. Elle rappelle la précieuse précarité de l’être humain, la fragilité cristalline de l’âme immortelle qui requiert tous nos soins. Et la brisure du vase n’ensevelira jamais la pureté du chant qui en jaillit.
Toutes les flatteries d’amour-propre invitent à rester à la maison, plus exactement dans la prison. Or, comme Platon l’a admirablement décrit dans le mythe de la Caverne, au septième livre de sa République, la plupart des mortels préfèrent rester entravés et captifs mais à l’abri, plutôt que de s’arracher aux reflets, aux illusions du monde, afin de contempler la source de Lumière. Voilà pourquoi ils restent des mortels.
L’éveil est un arrachement, une coupure irréversible. Le prisonnier de l’apologue platonicien qui, seul, s’est retourné vers le Réel en refusant l’emprise de l’habitude et de l’ignorance, et qui s’est détaché du groupe des captifs, sera à jamais marqué par une déchirure qui est sa noblesse et sa singularité, qui signe aussi l’accès à l’Être. Ce retournement et cet éveil de conscience le séparent du commun des mortels, de la mortifère inconscience commune. Aussi est-il traité de fou ou de malade par ceux qui le croyaient des leurs. Non, il n’est plus leur semblable, leur congénère, il ne fait plus partie de ces gens qui se croient heureux, qui s’estiment tranquilles, il est un homme libre allant vers la Source, un esseulé allant vers le Solitaire. Il est marqué à vie car vive est la blessure de l’éveil.
[…]
Celui qui s’est évadé de la prison et qui s’est coupé de la chaude communauté des mortels n’est pas à la fin de ses épreuves puisque, au contraire, la quête commence. L’homme blessé, en marche, se voit exposé à toutes les rencontres, à d’autres déchirures. Il se retrouve libre et seul, immensément fragile, à l’abri de rien parce qu’en quête de tout. Avançant sur le chemin, il aimera de plus en plus sa vulnérabilité qui n’est pas faiblesse, sa sensibilité qui est chant du cœur. C’est une fragilité qui n’a pas besoin d’être protégée, c’est une blessure qui ne réclame nulle guérison. Cette fragilité est la musique de l’être, sa nudité essentielle et indestructible.
La blessure sauve l’homme de toutes les tentatives d’asservissement que représente le besoin compulsif d’être indemne et protégé de tout, elle le sauve de tous les remèdes qui veulent euphoriser ou tranquilliser son existence et d’abord sa pensée. Elle rappelle la précieuse précarité de l’être humain, la fragilité cristalline de l’âme immortelle qui requiert tous nos soins. Et la brisure du vase n’ensevelira jamais la pureté du chant qui en jaillit.
Marcher
Dès que l’on marche quelque temps, sans but précis et à son rythme, on se surprend à chanter ou bien à siffloter. Le marcheur est joyeux sans raison particulière mais du simple fait qu’il respire largement, qu’il renoue avec son corps et qu’il accorde de l’attention au monde qui l’entoure. Plus il avance et plus il devient poreux. Ses plantes de pied lui font reprendre contact avec la terre mère et le grand air nettoie ses pensées et ses ruminations diverses. Il se retrouve à la fois enraciné et vacant. Il peut dès lors entrer en relation avec l’arbre, la pierre, le vent, la lumière, jusqu’à se fondre en eux.
L’homme qui au lieu d’utiliser un véhicule se déplace sur ses deux pieds ne se contente pas de découvrir la nature : il ressent qu’il fait partie d’elle et cette sensation est apaisante. Autant dire qu’il accepte sa mesure humaine, sa juste place et sa vulnérabilité : il n’est pas plus fort ni plus important que le rocher, le buisson, l’oiseau.
À force d’arpenter la forêt, le désert ou la campagne, on finit par ressembler au paysage. L’homme de passage qu’est le marcheur porte une part du monde mais sans forfanterie, sans laisser de trace. Les individus qui se croient puissants et civilisés caparaçonnent leur ego dans une clinquante automobile. Mais la liberté est du côté de la marche : aller à pied, c’est s’oublier pour s’élargir peu à peu aux dimensions de l’univers.
Aristote donnait ses leçons en se promenant avec ses disciples sous les portiques du Lycée : aussi qualifia-t-on sa philosophie de péripatéticienne. Socrate arpentait les rues d’Athènes, Diogène refusait d’avoir un domicile fixe et bon nombre de philosophes grecs préféraient se déplacer ici et là plutôt que de s’enfermer dans une tour d’ivoire. En marchant, ils réfléchissaient ou conversaient avec leurs disciples. Ils avaient compris que la véritable intelligence demande la participation de tout le corps, de l’espace même, et qu’elle ne saurait se réduire à la pensée. Une philosophie en marche congédie tout système, elle est ouverte au possible et au questionnement, elle appelle à se transformer incessamment et à se volatiliser, ce qui est le comble de l’harmonie. Voilà pourquoi Socrate n’a pas plus écrit que Jésus.
Tchouang-Tseu, quant à lui, nous livre une évidence salutaire : si l’homme peut marcher sur la terre immense, ce n’est pas tant à cause de ses pieds que grâce à tout l’espace qu’il n’occupe pas.
Dès que l’on marche quelque temps, sans but précis et à son rythme, on se surprend à chanter ou bien à siffloter. Le marcheur est joyeux sans raison particulière mais du simple fait qu’il respire largement, qu’il renoue avec son corps et qu’il accorde de l’attention au monde qui l’entoure. Plus il avance et plus il devient poreux. Ses plantes de pied lui font reprendre contact avec la terre mère et le grand air nettoie ses pensées et ses ruminations diverses. Il se retrouve à la fois enraciné et vacant. Il peut dès lors entrer en relation avec l’arbre, la pierre, le vent, la lumière, jusqu’à se fondre en eux.
L’homme qui au lieu d’utiliser un véhicule se déplace sur ses deux pieds ne se contente pas de découvrir la nature : il ressent qu’il fait partie d’elle et cette sensation est apaisante. Autant dire qu’il accepte sa mesure humaine, sa juste place et sa vulnérabilité : il n’est pas plus fort ni plus important que le rocher, le buisson, l’oiseau.
À force d’arpenter la forêt, le désert ou la campagne, on finit par ressembler au paysage. L’homme de passage qu’est le marcheur porte une part du monde mais sans forfanterie, sans laisser de trace. Les individus qui se croient puissants et civilisés caparaçonnent leur ego dans une clinquante automobile. Mais la liberté est du côté de la marche : aller à pied, c’est s’oublier pour s’élargir peu à peu aux dimensions de l’univers.
Aristote donnait ses leçons en se promenant avec ses disciples sous les portiques du Lycée : aussi qualifia-t-on sa philosophie de péripatéticienne. Socrate arpentait les rues d’Athènes, Diogène refusait d’avoir un domicile fixe et bon nombre de philosophes grecs préféraient se déplacer ici et là plutôt que de s’enfermer dans une tour d’ivoire. En marchant, ils réfléchissaient ou conversaient avec leurs disciples. Ils avaient compris que la véritable intelligence demande la participation de tout le corps, de l’espace même, et qu’elle ne saurait se réduire à la pensée. Une philosophie en marche congédie tout système, elle est ouverte au possible et au questionnement, elle appelle à se transformer incessamment et à se volatiliser, ce qui est le comble de l’harmonie. Voilà pourquoi Socrate n’a pas plus écrit que Jésus.
Tchouang-Tseu, quant à lui, nous livre une évidence salutaire : si l’homme peut marcher sur la terre immense, ce n’est pas tant à cause de ses pieds que grâce à tout l’espace qu’il n’occupe pas.
Île
Dans une île on est bien parce qu’on se sent loin. À l’abri des agitations du siècle, des vanités humaines. Je parle bien sûr des îles que ne peuvent atteindre l’avion ni le téléphone et qui, bien avant de devenir une destination touristique, furent une image du Paradis.
C’est la plus belle des cellules monastiques et il convient de s’y rendre seul. De se suffire à soi-même à la façon dont l’île vit en autarcie. « Tout est en toi », c’est la première leçon prodiguée par ce séjour.
Demeurant dans une île, on se sent paisible et centré. On se fait oublier des contemporains, on échappe aux injonctions de la mode, de la croissance économique. On prend donc de la distance, une distance heureuse. Mais cette terre située entre l’eau et le ciel rappelle aussi à l’être humain sa position médiane, entre les eaux d’en haut et celles d’en bas, entre les deux insondables, et elle invite ainsi à une dimension de profondeur. De là, plusieurs attitudes s’ensuivent : l’homme peut s’aventurer tout au fond, il peut aussi bondir vers les cimes célestes, ou encore faire le compte de ses propres forces, se recueillir. Le recours ne vient pas d’ailleurs, il est ici et en soi.
Lorsque les flots s’agitent et que le ciel est parcouru d’orages, l’île demeure stable et ferme, elle évoque une paix intérieure que rien ne saurait troubler.
Celui qui se retire dans une île manifeste son indépendance autant qu’une soif d’immensité. Il y est parti en se posant une seule question : qui est mon semblable ?
Dans les villes, dans les pays habités, on ne parle que de communiquer, de vivre ensemble, de tolérance et de solidarité. C’est épuisant et illusoire. Sur une île, l’homme n’a pas de semblable, mais, face à l’infini du ciel, à l’insondable de l’eau, il se sent empli d’égards et de révérence, frère du caillou et de l’étoile.
Dans une île on est bien parce qu’on se sent loin. À l’abri des agitations du siècle, des vanités humaines. Je parle bien sûr des îles que ne peuvent atteindre l’avion ni le téléphone et qui, bien avant de devenir une destination touristique, furent une image du Paradis.
C’est la plus belle des cellules monastiques et il convient de s’y rendre seul. De se suffire à soi-même à la façon dont l’île vit en autarcie. « Tout est en toi », c’est la première leçon prodiguée par ce séjour.
Demeurant dans une île, on se sent paisible et centré. On se fait oublier des contemporains, on échappe aux injonctions de la mode, de la croissance économique. On prend donc de la distance, une distance heureuse. Mais cette terre située entre l’eau et le ciel rappelle aussi à l’être humain sa position médiane, entre les eaux d’en haut et celles d’en bas, entre les deux insondables, et elle invite ainsi à une dimension de profondeur. De là, plusieurs attitudes s’ensuivent : l’homme peut s’aventurer tout au fond, il peut aussi bondir vers les cimes célestes, ou encore faire le compte de ses propres forces, se recueillir. Le recours ne vient pas d’ailleurs, il est ici et en soi.
Lorsque les flots s’agitent et que le ciel est parcouru d’orages, l’île demeure stable et ferme, elle évoque une paix intérieure que rien ne saurait troubler.
Celui qui se retire dans une île manifeste son indépendance autant qu’une soif d’immensité. Il y est parti en se posant une seule question : qui est mon semblable ?
Dans les villes, dans les pays habités, on ne parle que de communiquer, de vivre ensemble, de tolérance et de solidarité. C’est épuisant et illusoire. Sur une île, l’homme n’a pas de semblable, mais, face à l’infini du ciel, à l’insondable de l’eau, il se sent empli d’égards et de révérence, frère du caillou et de l’étoile.
Nous sommes entourés, assaillis, par des gens qui à longueur de temps broient du noir – soit en ressassant leurs misères personnelles, soit en colportant des nouvelles affreuses.
L’être spirituel est celui qui, en toutes circonstances et face au plus grand péril, broie de la lumière.
L’être spirituel est celui qui, en toutes circonstances et face au plus grand péril, broie de la lumière.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Jacqueline Kelen
Lecteurs de Jacqueline Kelen (377)Voir plus
Quiz
Voir plus
Oyez le parler médiéval !
Un destrier...
une catapulte
un cheval de bataille
un étendard
10 questions
1583 lecteurs ont répondu
Thèmes :
moyen-âge
, vocabulaire
, littérature
, culture générale
, challenge
, définitions
, histoireCréer un quiz sur cet auteur1583 lecteurs ont répondu