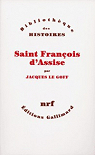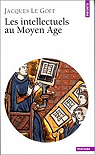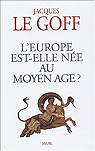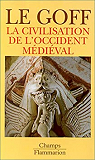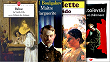Citations de Jacques Le Goff (214)
Jésus a-t-il ri ?
L’Histoire, n° 158, septembre 1992
L’Histoire, n° 158, septembre 1992
« Son modèle est évidemment l’humilité de Jésus. C’est la sœur de la pauvreté. » (p. 219)
« François n’a pas été un écrivain, il a été un missionnaire complétant par quelques écrits un message dont il avait exprimé l’essentiel par la parole et par l’exemple. » (p. 94)
« Son succès va venir de ce qu’il répond à l’attente d’une grande partie de ses contemporains, à la fois dans ce qu’ils accueillent et dans ce qu’ils refusent. » (p. 35)
Dans les âpres discussions entre protestants et catholiques au XVIe siècle, les réformés reprochaient vivement à leurs adversaires la croyance au Purgatoire, à ce que Luther appelait « le troisième lieu ».
Autres conciliations difficiles à réaliser : celle entre la raison et l’expérience, celle entre la théorie et la pratique.
C’est l’école anglaise avec le grand savant que fut Robert Grosseteste, chancelier d’Oxford et évêque de Lincoln, puis avec un groupe de franciscains d’Oxford d’où émerge Roger Bacon, qui tente la première.
C’est l’école anglaise avec le grand savant que fut Robert Grosseteste, chancelier d’Oxford et évêque de Lincoln, puis avec un groupe de franciscains d’Oxford d’où émerge Roger Bacon, qui tente la première.
L’Europe se construit. C’est une grande espérance. Elle ne se réalisera que si elle tient compte de l’histoire: une Europe sans histoire serait orpheline et malheureuse. Car aujourd’hui vient d’hier, et demain sort du passé. Un passé qui ne doit pas paralyser le présent, mais l’aider à être différent dans la fidélité et nouveau dans le progrès.
En proposant pour programme un idéal positif, ouvert à l'amour de toutes les créatures et de toute la création, ancré dans la joie et non plus dans l'accedia morose (...), il (saint François d'Assise) bouleversait la sensibilité médiévale et chrétienne et retrouvait une jubilation première, vite étouffée par un christianisme masochiste.
Quand il était plein de l'ardeur du Saint-Esprit, il parlait à haute voix en français.
C est bien comme un artisan, comme un homme de métier comparable aux autres citadins que se sent l intellectuel urbain du XII siècle. Sa fonction c est l étude et l enseignement des arts libéraux. Mais qu 'est ce qu un art? Ce n est pas une science , c est une technique. Ars c est la spécialité du professeur comme celle du forgeron ou du charpentier. (...) un artc est toute une activité rationnelle et juste de l esprit appliqué à la fabrication des instruments tant matériels qu intellectuels: c est une technique intelligente du faire.
Ars est recta ratio factibiliul. Ainsi l intellectuel est un artisan; parmi toutes les sciences sont appelés arts cat ils n impliquent pas seulement la connaissance mais aussi la production qui découle immédiatement de la raison , telles que la fonction de la construction, des syllogismes, du discours, des nombres, des mesures, des mélodies, des calculs du cours des astres
Ars est recta ratio factibiliul. Ainsi l intellectuel est un artisan; parmi toutes les sciences sont appelés arts cat ils n impliquent pas seulement la connaissance mais aussi la production qui découle immédiatement de la raison , telles que la fonction de la construction, des syllogismes, du discours, des nombres, des mesures, des mélodies, des calculs du cours des astres
Abelard souffre de n avoir plus d adversaire à sa taille. Logicien il s irrite d ailleurs de voir passer au dessus de tous les théologiens. Il en fait serment: il sera théologien aussi. Il redevient étudiant et se précipite à Laon aux leçons du plus illustre théologien du temps: Anselme.(...)
" Je m approchai donc de ce vieillard qui devait sa réputation plus à son grand âge qu'à son talent ou à sa culture. Tous ceux qui l abordaient sur un sujet dont ils étaient incertains repartaient plus incertains encore. Si l on se contentait de l écouter, il était admirable mais si on le questionnait il se révélait nul. Pour le verbiage il était admirable, pour l intelligence méprisable, pour la raison vide. Sa flamme enfumait la maison au lieu de l éclairer. De loin son arbre tout feuillu attirait les yeux, mais quand on le regardait de plus pret et au plus de soin, on s apercevait qu il n y avait point de fruit. Lorsque je m approchai de lui pour cueillir son fruit, je vis qu il ressemblait au figuier qui maudit le seigneur ou à ce chêne à quoi Lucain compare Pompée
Il se tient de l ombre d un grand nom.
Tel un chêne superbe au milieu des champs.
Edifié, je ne perdus pas mon temps à son école "
" Je m approchai donc de ce vieillard qui devait sa réputation plus à son grand âge qu'à son talent ou à sa culture. Tous ceux qui l abordaient sur un sujet dont ils étaient incertains repartaient plus incertains encore. Si l on se contentait de l écouter, il était admirable mais si on le questionnait il se révélait nul. Pour le verbiage il était admirable, pour l intelligence méprisable, pour la raison vide. Sa flamme enfumait la maison au lieu de l éclairer. De loin son arbre tout feuillu attirait les yeux, mais quand on le regardait de plus pret et au plus de soin, on s apercevait qu il n y avait point de fruit. Lorsque je m approchai de lui pour cueillir son fruit, je vis qu il ressemblait au figuier qui maudit le seigneur ou à ce chêne à quoi Lucain compare Pompée
Il se tient de l ombre d un grand nom.
Tel un chêne superbe au milieu des champs.
Edifié, je ne perdus pas mon temps à son école "
Je suis chose légère
Telle la feuille dont l ouragan joué
...
Tel l essuie voguant sans pilote,
Comme un oiseau errant par les chemins d air,
Je ne suis fixé ni par l ancre, ni par les cordes.
....
La beauté des filles a blessé ma poitrine.
Celles que je ne puis toucher, je les possède de coeur.
...
On me reproche en second lieu le jeu. Mais sitôt que le jeu
M a laissé nu et le corps froid, mon esprit s'échauffe.
C est alors que ma muse composé ses meilleurs chansons.
En troisième lieu parlons du cabaret.
...
Je veux mourir à la taverne
Là où les vins seront proches de la bouche du mourant,
Après les choeurs des Anges descendront en chantant :" a ce bon buveur que Dieu soit clément".
Telle la feuille dont l ouragan joué
...
Tel l essuie voguant sans pilote,
Comme un oiseau errant par les chemins d air,
Je ne suis fixé ni par l ancre, ni par les cordes.
....
La beauté des filles a blessé ma poitrine.
Celles que je ne puis toucher, je les possède de coeur.
...
On me reproche en second lieu le jeu. Mais sitôt que le jeu
M a laissé nu et le corps froid, mon esprit s'échauffe.
C est alors que ma muse composé ses meilleurs chansons.
En troisième lieu parlons du cabaret.
...
Je veux mourir à la taverne
Là où les vins seront proches de la bouche du mourant,
Après les choeurs des Anges descendront en chantant :" a ce bon buveur que Dieu soit clément".
Tel est le sens de la fameuse phrase de Bernard de Chartres qui a eu un tel retentissement au Moyen Âge
"Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Nous voyons ainsi davantage et plus loin qu eux, non parce notre vue est plus aiguë ou notre taille plus haute, mais parce qu ils nous portent en l air et nous élèvent de toute leur hauteur gigantesque..."
"Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Nous voyons ainsi davantage et plus loin qu eux, non parce notre vue est plus aiguë ou notre taille plus haute, mais parce qu ils nous portent en l air et nous élèvent de toute leur hauteur gigantesque..."
… l'empereur [Valentinien III] a établi un nouveau peuple dans l'Empire : les Burgondes, un moment installés à Worms d'où ils ont essayé d'envahir la Gaule, mais qui ont subi une sanglante défaite des mains d'Aetius et de ses mercenaires huns. L'épisode de 436, où leur roi Gunther trouva la mort sera le point de départ des Nibelungen. En 443 les Romains leur concèdent l'occupation de la Savoie.
3075 – [Arthaud, p. 46]
3075 – [Arthaud, p. 46]
Tout est dit dans ces phrases : la connivence entre le Barbare et le révolté, le Goth et le Bagaude, et l’évolution des masses populaires romaines qui les barbarise avant que les Barbares soient arrivés.
3007 - [Éditions Arthaud, 1972, p. 36]
3007 - [Éditions Arthaud, 1972, p. 36]
La vérité c'est que les Barbares ont bénéficié de la complicité active ou passive de la masse de la population romaine. La structure sociale de l'Empire romain où les couches populaires étaient de plus en plus écrasées par une minorité de riches et de puissants explique le succès des invasions barbares. Écoutons Salvien : « Les pauvres sont dépouillés, les veuves gémissent, les orphelins sont foulés aux pieds, à tel point que beaucoup d'entre eux, y compris des gens de bonne naissance et ayant reçu une éducation supérieure, se réfugient chez les ennemis. Pour ne pas périr sous les Romains, parce qu'ils ne peuvent plus supporter, parmi les Romains, l’inhumanité des Barbares. »
3005 - [Éditions Arthaud, 1972, p. 36]
3005 - [Éditions Arthaud, 1972, p. 36]
Le degré d’assimilation, de métamorphose, de dénaturation varie d’un auteur à l’autre et souvent un même auteur oscille entre ces deux pôles qui marquent les limites de la culture médiévale : la fuite horrifiée devant la littérature païenne et l’admiration passionnée conduisant à de larges emprunts. Saint Jérôme définit le même compromis que saint Augustin : que l’auteur chrétien en use avec ses modèles païens comme les Juifs du Deutéronome avec les prisonnières de guerre à qui ils rasent la tête, coupent les ongles et donnent de nouveaux vêtements avant de les épouser.
Dans la pratique, les clercs médiévaux trouveront bien des moyens d’utiliser les livres « païens » en satisfaisant leur conscience à peu de frais. Ainsi à Cluny, le moine qui consultait à la bibliothèque un manuscrit d’auteur antique devait se gratter l’oreille avec un doigt, à la manière d’un chien se grattant avec sa patte, « car c’est à bon droit que l’infidèle est comparé à cet animal ».
Il reste que si ce compromis a sauvegardé une certaine continuité de la tradition antique, il a suffisamment trahi cette tradition pour que l’élite intellectuelle, à diverses reprises, ait éprouvé le besoin d’un vrai retour aux sources anciennes. Ce sont les renaissances qui scandent le Moyen Âge : à l’époque carolingienne, au XIIe siècle, à l’aube de la grande Renaissance enfin.
Il reste surtout que la double nécessité pour les auteurs du Haut Moyen Âge occidental d’utiliser l’irremplaçable outillage intellectuel du monde gréco-romain et de le couler dans les moules chrétiens a favorisé sinon créé des habitudes intellectuelles très fâcheuses : la déformation systématique de la pensée des auteurs, l’anachronisme perpétuel, la pensée par citations détachées de leur contexte. La pensée antique n’a survécu au Moyen Âge qu’atomisée, déformée, humiliée par la pensée chrétienne. Obligé d’avoir recours aux services de son ennemi vaincu, le christianisme se vit contraint d’ôter la mémoire à son esclave prisonnier et de le faire travailler pour lui en oubliant ses traditions. Mais il fut du même coup entraîné dans cette a-temporalité de la pensée. Toutes les vérités ne purent être qu’éternelles. Saint Thomas d’Aquin encore au XIIIe siècle dira que ce qu’ont voulu dire les auteurs importe peu, l’essentiel étant ce qu’ils ont dit qu’on peut utiliser à sa guise. (pp. 92-93)
Dans la pratique, les clercs médiévaux trouveront bien des moyens d’utiliser les livres « païens » en satisfaisant leur conscience à peu de frais. Ainsi à Cluny, le moine qui consultait à la bibliothèque un manuscrit d’auteur antique devait se gratter l’oreille avec un doigt, à la manière d’un chien se grattant avec sa patte, « car c’est à bon droit que l’infidèle est comparé à cet animal ».
Il reste que si ce compromis a sauvegardé une certaine continuité de la tradition antique, il a suffisamment trahi cette tradition pour que l’élite intellectuelle, à diverses reprises, ait éprouvé le besoin d’un vrai retour aux sources anciennes. Ce sont les renaissances qui scandent le Moyen Âge : à l’époque carolingienne, au XIIe siècle, à l’aube de la grande Renaissance enfin.
Il reste surtout que la double nécessité pour les auteurs du Haut Moyen Âge occidental d’utiliser l’irremplaçable outillage intellectuel du monde gréco-romain et de le couler dans les moules chrétiens a favorisé sinon créé des habitudes intellectuelles très fâcheuses : la déformation systématique de la pensée des auteurs, l’anachronisme perpétuel, la pensée par citations détachées de leur contexte. La pensée antique n’a survécu au Moyen Âge qu’atomisée, déformée, humiliée par la pensée chrétienne. Obligé d’avoir recours aux services de son ennemi vaincu, le christianisme se vit contraint d’ôter la mémoire à son esclave prisonnier et de le faire travailler pour lui en oubliant ses traditions. Mais il fut du même coup entraîné dans cette a-temporalité de la pensée. Toutes les vérités ne purent être qu’éternelles. Saint Thomas d’Aquin encore au XIIIe siècle dira que ce qu’ont voulu dire les auteurs importe peu, l’essentiel étant ce qu’ils ont dit qu’on peut utiliser à sa guise. (pp. 92-93)
Les croisades n’ont apporté à la Chrétienté ni l’essor commercial né de rapports antérieurs avec le monde musulman et du développement interne de l’économie occidentale, ni les techniques et les produits venus par d’autres voies, ni l’outillage intellectuel fourni par les centres de traduction et les bibliothèques de Grèce, d’Italie (de Sicile avant tout) et d’Espagne où les contacts étaient autrement étroits et féconds qu’en Palestine, ni même ce goût du luxe et ces habitudes molles que des moralistes moroses d’Occident croient être l’apanage de l’Orient et le cadeau empoisonné des infidèles aux croisés naïfs et sans défense devant les charmes et charmeuses de l’Orient.
Sans doute les bénéfices tirés surtout, non du commerce, mais de la location des bateaux et des prêts consentis aux croisés ont-ils permis à certaines villes italiennes – Gênes et Venise surtout – de s’enrichir rapidement, mais que les croisades aient suscité l’éveil et l’essor du commerce de la Chrétienté médiévale, aucun historien sérieux ne le croit plus. Qu’elles aient au contraire contribué à l’appauvrissement de l’Occident, en particulier de la classe chevaleresque, que loin de créer l’unité morale de la Chrétienté elles aient fortement poussé à envenimer des oppositions nationales naissantes (il suffit, entre maintes témoignages, de lire le récit de la IIe Croisade par Eudes de Deuil, moine de Saint-Denis et chapelain du Capétien Louis VII, où la haine entre Allemands et Français s’exaspère à chaque épisode), qu’elles aient creusé un fossé définitif entre Occidentaux et Byzantins (de croisade en croisade s’accentue l’hostilité entre Latins et Grecs qui aboutira à la IVe Croisade et à la prise de Constantinople par les croisés en 1204), que loin d’adoucir les mœurs, la rage de la guerre sainte ait conduit les croisés aux pires excès, depuis les pogroms perpétrés sur leur route jusqu’aux massages et pillages (de Jérusalem par exemple en 1099, et de Constantinople en 1204 qu’on peut lire dans les récits des chroniqueurs chrétiens aussi bien que musulmans ou byzantins), que le financement de la croisade ait été le motif ou le prétexte de l’alourdissement de la fiscalité pontificale, à la pratique inconsidérée des indulgences, et que finalement les ordres militaires impuissant à défendre et à conserver la Terre sainte se soient repliés sur l’Occident pour s’y livrer à toutes sortes d’exactions financières ou militaires, voilà en fait le lourd passif de ces expéditions. Je ne vois guère que l’abricot comme fruit possible ramené des croisades par les chrétiens.
Il reste que l’établissement éphémère des croisés en Palestine a été le premier exemple de colonialisme européen, et qu’à titre de précédent il est plein d’enseignement pour l’historien. (pp. 54-55)
Sans doute les bénéfices tirés surtout, non du commerce, mais de la location des bateaux et des prêts consentis aux croisés ont-ils permis à certaines villes italiennes – Gênes et Venise surtout – de s’enrichir rapidement, mais que les croisades aient suscité l’éveil et l’essor du commerce de la Chrétienté médiévale, aucun historien sérieux ne le croit plus. Qu’elles aient au contraire contribué à l’appauvrissement de l’Occident, en particulier de la classe chevaleresque, que loin de créer l’unité morale de la Chrétienté elles aient fortement poussé à envenimer des oppositions nationales naissantes (il suffit, entre maintes témoignages, de lire le récit de la IIe Croisade par Eudes de Deuil, moine de Saint-Denis et chapelain du Capétien Louis VII, où la haine entre Allemands et Français s’exaspère à chaque épisode), qu’elles aient creusé un fossé définitif entre Occidentaux et Byzantins (de croisade en croisade s’accentue l’hostilité entre Latins et Grecs qui aboutira à la IVe Croisade et à la prise de Constantinople par les croisés en 1204), que loin d’adoucir les mœurs, la rage de la guerre sainte ait conduit les croisés aux pires excès, depuis les pogroms perpétrés sur leur route jusqu’aux massages et pillages (de Jérusalem par exemple en 1099, et de Constantinople en 1204 qu’on peut lire dans les récits des chroniqueurs chrétiens aussi bien que musulmans ou byzantins), que le financement de la croisade ait été le motif ou le prétexte de l’alourdissement de la fiscalité pontificale, à la pratique inconsidérée des indulgences, et que finalement les ordres militaires impuissant à défendre et à conserver la Terre sainte se soient repliés sur l’Occident pour s’y livrer à toutes sortes d’exactions financières ou militaires, voilà en fait le lourd passif de ces expéditions. Je ne vois guère que l’abricot comme fruit possible ramené des croisades par les chrétiens.
Il reste que l’établissement éphémère des croisés en Palestine a été le premier exemple de colonialisme européen, et qu’à titre de précédent il est plein d’enseignement pour l’historien. (pp. 54-55)
Les pénitentiels du Haut Moyen Age – tarifs de châtiments applicables à chaque espèce de péché – pourraient figurer dans les « enfers » des bibliothèques. Non seulement ressort le vieux fonds de superstitions paysannes, mais se débrident toutes les aberrations sexuelles, s’exaspèrent les violences : coups et blessures, gloutonnerie et ivrognerie. Un livre célèbre, qui n’a ajouté à la fidélité aux documents qu’une habile mise en scène littéraire, les Récits des temps mérovingiens d’Augustin Thierry, puisés aux meilleures sources et d’abord à Grégoire de Tours, nous a familiarisés depuis plus d’un siècle avec le déchaînement de la violence barbare, d’autant plus sauvage que le rang supérieur de ses protagonistes leur assure une relative impunité. Seuls l’emprisonnement et le meurtre mettent un frein au débordement de ces princes et princesses franques dont le gouvernement a été défini par Fustel de Coulanges en une expression célèbre : « un despotisme tempéré par l’assassinat ».
« Il se commit en ce temps-là beaucoup de crimes… chacun voyait la justice dans sa propre volonté », écrit Grégoire de Tours.
Le raffinement des supplices inspirera longtemps l’iconographie médiévale. Ce que les Romains païens n’avaient pas fait subir aux martyrs chrétiens, les Francs catholiques l’infligèrent aux leurs. « On coupe couramment les mains et les pieds, l’extrémité des narines, on arrache les yeux, on mutile le visage au moyen de fers ardents, on enfance des bâtons pointus sous les ongles des mains et des pieds… Lorsque les plaies, après l’écoulement du pus, commencent à se fermer, on les renouvelle. Au besoin on fait appel à un médecin afin que, guéri, le malheureux puisse être torturé par un plus long supplice. » Saint Léger, évêque d’Autun, tombe aux mains de son ennemi, le maire du palais de Neustrie Ebroïn en 677. On lui coupe la langue, on lui taillade les joues et les lèvres, on l’oblige à marcher nu-pieds à travers une piscine semée de pierres aiguës et perçantes comme des clous, on lui crève enfin les yeux. C’est aussi la mort de Brunehaut, torturée pendant trois jours et finalement attachée à la queue d’un cheval vicieux qui fut fouetté jusqu’à ce qu’il s’emballât…
Le langage sans émotion des codes est le plus impressionnant. Extrait de la loi salique : « Avoir arraché à autrui une main, ou un pied, un œil, le nez : 100 sous ; mais seulement 63 si la main reste pendante ; avoir arraché le pouce : 50 sous, mais seulement 30 s’il reste pendant ; avoir arraché l’index (le doigt qui sert à tirer à l’arc) : 32 sous ; un autre doigt 30 sous ; deux doigts ensemble : 35 sous ; trois doigts ensemble : 50 sous. » (pp. 29-30)
« Il se commit en ce temps-là beaucoup de crimes… chacun voyait la justice dans sa propre volonté », écrit Grégoire de Tours.
Le raffinement des supplices inspirera longtemps l’iconographie médiévale. Ce que les Romains païens n’avaient pas fait subir aux martyrs chrétiens, les Francs catholiques l’infligèrent aux leurs. « On coupe couramment les mains et les pieds, l’extrémité des narines, on arrache les yeux, on mutile le visage au moyen de fers ardents, on enfance des bâtons pointus sous les ongles des mains et des pieds… Lorsque les plaies, après l’écoulement du pus, commencent à se fermer, on les renouvelle. Au besoin on fait appel à un médecin afin que, guéri, le malheureux puisse être torturé par un plus long supplice. » Saint Léger, évêque d’Autun, tombe aux mains de son ennemi, le maire du palais de Neustrie Ebroïn en 677. On lui coupe la langue, on lui taillade les joues et les lèvres, on l’oblige à marcher nu-pieds à travers une piscine semée de pierres aiguës et perçantes comme des clous, on lui crève enfin les yeux. C’est aussi la mort de Brunehaut, torturée pendant trois jours et finalement attachée à la queue d’un cheval vicieux qui fut fouetté jusqu’à ce qu’il s’emballât…
Le langage sans émotion des codes est le plus impressionnant. Extrait de la loi salique : « Avoir arraché à autrui une main, ou un pied, un œil, le nez : 100 sous ; mais seulement 63 si la main reste pendante ; avoir arraché le pouce : 50 sous, mais seulement 30 s’il reste pendant ; avoir arraché l’index (le doigt qui sert à tirer à l’arc) : 32 sous ; un autre doigt 30 sous ; deux doigts ensemble : 35 sous ; trois doigts ensemble : 50 sous. » (pp. 29-30)
Mais on voit aussi peu de mouvements qui semblent si propres à exprimer et à éclairer tout moment de l'humanité. S'ouvrir et résister à la fois au monde, c'est un modèle, un programme d'hier et d'aujourd'hui, de demain sans doute.
Et en notre époque où nos regards, nos efforts doivent avant tout se porter vers les tragiques pays du tiers monde et y prendre pour modèle les petits, les pauvres, les opprimés, car là reste, malgré les échecs, les dérapages, les trahisons, la leçon du franciscanisme dans son grand mouvement vers les laïcs, c'est encore, tant que la faim, la misère, l'oppression ne seront pas vaincus, une leçon valable pour notre temps.
p. 112
---------------
« Saint François d'Assise », Le Goff, éd. Gallimard © - 1999
Et en notre époque où nos regards, nos efforts doivent avant tout se porter vers les tragiques pays du tiers monde et y prendre pour modèle les petits, les pauvres, les opprimés, car là reste, malgré les échecs, les dérapages, les trahisons, la leçon du franciscanisme dans son grand mouvement vers les laïcs, c'est encore, tant que la faim, la misère, l'oppression ne seront pas vaincus, une leçon valable pour notre temps.
p. 112
---------------
« Saint François d'Assise », Le Goff, éd. Gallimard © - 1999
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Jacques Le Goff
Quiz
Voir plus
Voyage au Centre de la Terre
Comment se nomme le neveu du professeur Lidenbrock ?
Hans
Robert
Axel
Julien
10 questions
465 lecteurs ont répondu
Thème : Voyage au centre de la Terre de
Jules VerneCréer un quiz sur cet auteur465 lecteurs ont répondu