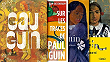Nationalité : France
Ajouter des informations
Biographie :
Laurence Madeline est une conservatrice et commissaire d'exposition.
Elle a été conservatrice au Musée Picasso, au Musée Léon-Dierx et au Musée d'Orsay.
De 2011 à 2015, elle est responsable du pôle Beaux-Arts du Musée d'art et d'histoire de Genève.
Spécialiste des avant-gardes de la fin du xixe et du début du XXe siècle, Laurence Madeline a publié plusieurs monographies sur Van Gogh, Gauguin et Picasso.
Elle est l'auteur de Picasso Van Gogh (2006, La Martinière), Ultra sauvage. Gauguin sculpteur (Adam Biro, 2000) et a publié les correspondances de Gertrude Stein et Picasso (Gallimard, 2005) et les lettres de Dali à Picasso (Le Promeneur, 2005) ainsi que Picasso devant la télé (Les Presses du réel, 2013).
Elle a été commissaire générale de l’exposition Picasso à l’œuvre. Dans l’objectif de David Douglas Duncan (Genève, 2011) et commissaire de Picasso devant la télé (Consortium de Dijon, Genève, 2013 ; musée Picasso à Münster et musée Picasso à Malaga, 2014).
En novembre 2013, elle a fait partie du comité de soutien à l'entrée de Gustave Courbet au Panthéon
+ Voir plusLaurence Madeline est une conservatrice et commissaire d'exposition.
Elle a été conservatrice au Musée Picasso, au Musée Léon-Dierx et au Musée d'Orsay.
De 2011 à 2015, elle est responsable du pôle Beaux-Arts du Musée d'art et d'histoire de Genève.
Spécialiste des avant-gardes de la fin du xixe et du début du XXe siècle, Laurence Madeline a publié plusieurs monographies sur Van Gogh, Gauguin et Picasso.
Elle est l'auteur de Picasso Van Gogh (2006, La Martinière), Ultra sauvage. Gauguin sculpteur (Adam Biro, 2000) et a publié les correspondances de Gertrude Stein et Picasso (Gallimard, 2005) et les lettres de Dali à Picasso (Le Promeneur, 2005) ainsi que Picasso devant la télé (Les Presses du réel, 2013).
Elle a été commissaire générale de l’exposition Picasso à l’œuvre. Dans l’objectif de David Douglas Duncan (Genève, 2011) et commissaire de Picasso devant la télé (Consortium de Dijon, Genève, 2013 ; musée Picasso à Münster et musée Picasso à Malaga, 2014).
En novembre 2013, elle a fait partie du comité de soutien à l'entrée de Gustave Courbet au Panthéon
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (4)
Voir plusAjouter une vidéo
Payot - Marque Page - Laurence Madeline - Picasso. 8 femmes
Citations et extraits (20)
Voir plus
Ajouter une citation
Avec les bords de Seine, les côtes de la Manche constituent un grand pôle géographique de l'impressionnisme. Desservie très tôt par le train, urbanisée par les promoteurs du second Empire, l'embouchure de la Seine devient le rendez-vous des Parisiens pour leurs loisirs.
Les bains se font encore sur prescription médicale, mais déjà la mer n'est plus ce terrain aventureux des pêcheurs et des marins. Les peintres suivent les vacanciers se promenant sur les plages, et également les peintres de la génération précédente, Courbet, Daubigny, Jongkind qui arpentaient la côte, carnet à la main.
Les bains se font encore sur prescription médicale, mais déjà la mer n'est plus ce terrain aventureux des pêcheurs et des marins. Les peintres suivent les vacanciers se promenant sur les plages, et également les peintres de la génération précédente, Courbet, Daubigny, Jongkind qui arpentaient la côte, carnet à la main.
En 1874, une république désenchantée et prudence, la troisième, a remplacé l'optimisme criard et aveugle de l'Empire qui a sombré en 1870. On peut penser que l'avènement d'un nouveau régime politique aurait favorisé le libéralisme dans les arts. Il n'en est rien. Profondément choquée par les événements de 1870 et 1871, la société française attend de l'art qu'il remplisse une mission moralisatrice et édificatrice. Il faudra attendre les années 1880 pour que l'Etat desserre sa mainmise sur les arts, sous la pression, entre autres, des artistes indépendants ou réfractaires au Salon.
L'affaire Dreyfus, révélée au grand public en 1898 par le "J'accuse" de Zola, soulève et exacerbe les sentiments nationalistes, revanchards, antisémites qui traversent la société depuis 1871. A la recherche de la justice et de la vérité, la société se divise profondément et durablement sur l'image des valeurs fondatrices de la France. Cette ultime crise du siècle finissant touchera également les impressionnistes, eux aussi divisés en dreyfusards et anti-dreyfusards.
Ainsi ce qui les sépare essentiellement de leurs prédécesseurs, c'est une question de plus ou de moins dans le fini. L'objet de l'art ne change pas, le moyen de traduction seul est modifié, d'autres diraient altéré. Telle est, en soi, la tentative, toute la tentative des impressionnistes.
(extrait d'un article du critique Jules Castagnary dans "Le Siècle" en 1860)
(extrait d'un article du critique Jules Castagnary dans "Le Siècle" en 1860)
Zola écrit au sujet du jeune peintre (Monet) : "Celui-ci a sucé le lait de notre âge, celui-là a grandi et grandira encore dans l'adoration de ce qui l'entoure.."
Le dessin au pastel, n'est-ce pas la plus jolie chose qu'on puisse imaginer ?
Sa surface ressemble à du velours, la fraîcheur et le modelage obtenus ne se retrouvent dans aucune autre technique.
Paul Helleu ( 1859- 1927 )
Sa surface ressemble à du velours, la fraîcheur et le modelage obtenus ne se retrouvent dans aucune autre technique.
Paul Helleu ( 1859- 1927 )
Lucien Lévy- Dhurmer, mystères symbolistes.
Toujours en 1896, Lévy-Dhurmer fait un portrait songeur de son nouvel ami, le poète symboliste Georges Rodenbach: au pastel, il immortalise la douceur de son expression, de ses yeux gris- bleu et de sa moustache blonde, avec la ville de Bruges en arrière-plan, en hommage à son roman " Bruges-la-Morte".
(...) Apprécié de Gustave Moreau et d'Émile Bernard, Lévy-Dhurmer devient l'ami du compositeur Debussy, dont les rêveries cristallines l'inspirent.
( p.47)
Toujours en 1896, Lévy-Dhurmer fait un portrait songeur de son nouvel ami, le poète symboliste Georges Rodenbach: au pastel, il immortalise la douceur de son expression, de ses yeux gris- bleu et de sa moustache blonde, avec la ville de Bruges en arrière-plan, en hommage à son roman " Bruges-la-Morte".
(...) Apprécié de Gustave Moreau et d'Émile Bernard, Lévy-Dhurmer devient l'ami du compositeur Debussy, dont les rêveries cristallines l'inspirent.
( p.47)
« Au fond, tout ne tient qu’à soi. C’est un soleil dans le ventre aux mille rayons. Le reste n’est rien. »
Pour le peintre qui, à l'occasion d'une exposition, voit, comme moi aujourd'hui, revenir quelques-unes de ses toiles de très loin, il semble qu'il s'agit là d'enfants prodiges mais qui retournent à la maison en chemise d'or.
L'autoportrait dans l'histoire de l'art : De Rembrandt à Warhol, l'intimité révélée de 50 artistes
Laurence Madeline
Laurence Madeline
A partir de la Renaissance, apprendre le métier de peintre consiste à maîtriser un savoir-faire non plus seulement dans le souci quasi exclusif d'exprimer la puissance divine, mais aussi en vue d'accéder à une meilleure connaissance du monde. Ainsi, dans son autoportrait, Léonard de Vinci prend-il le masque d'un philosophe. Car à ses yeux, l'artiste doit pénétrer les lois physiques de l'univers sensible, les observer avec subtilité et finesse puis, par la qualité de son génie, les faire agir dans ses productions artistiques.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
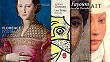
Regards de portraits
Alzie
53 livres

abécédaire
camilleetmile
26 livres
Auteurs proches de Laurence Madeline
Quiz
Voir plus
Qui a écrit ça ? [3]
QUEL ROMANCIER A ECRIT CES PHRASES: « Nous disons bien que l’heure de la mort est incertaine, mais quand nous disons cela, nous nous représentons cette heure comme située dans un espace vague et lointain, nous ne pensons pas qu’elle ait un rapport quelconque avec la journée déjà commencée et puisse signifier que la mort — ou sa première prise de possession partielle de nous, après laquelle elle ne nous lâchera plus — pourra se produire dans cet après-midi même, si peu incertain, cet après-midi où l’emploi de toutes les heures est réglé d’avance » ?
Marcel Proust
Virginie Despentes
Guy de Maupassant
Louis Aragon
10 questions
31 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature françaiseCréer un quiz sur cet auteur31 lecteurs ont répondu