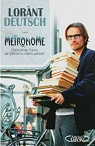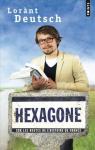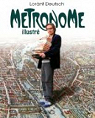Nationalité : France
Né(e) à : Alençon , le 27/10/1975
Ajouter des informations
Né(e) à : Alençon , le 27/10/1975
Biographie :
Lorànt Deutsch est un acteur de cinéma français et écrivain.
Né dans l'Orne à Alençon d'un père hongrois et d'une mère parisienne, il grandit à Sablé-sur-Sarthe. Il découvre la comédie au centre culturel de cette ville mais se passionne d'abord pour le football. À 12 ans, il est recruté par le F.C. Nantes dans le cadre "Sport-études". Deux ans plus tard, il abandonne et part chez ses grands-parents à Paris. C'est dans une MJC qu'il prend goût au théâtre. Plus tard, sa sœur l'inscrit au théâtre Mouffetard dans le Ve arrondissement.
En 1990, il se présente pour la première fois aux auditions d'une série de télévision franco-québécoise. Premier contrat ; pendant cinq ans il tient le rôle de Tom, un garçon français jouant les détectives avec une copine québécoise, dans Les Intrépides.
Il met ensuite sa carrière artistique entre parenthèses en faveur de ses études, sans toutefois renoncer aux cours de théâtre qu'il continue à fréquenter. Ni aux plateaux, d'ailleurs, puisque pendant cette période, il est présent dans de nombreuses publicités.
Après avoir achevé en 1998 ses études de philosophie et de civilisation hongroise, il entame sa carrière avec la sortie du film "Le Ciel, les oiseaux et... ta mère !" de Djamel Bensalah.
En 2003, il est récompensé par l'Étoile d'or de la révélation masculine, pour son interprétation dans les films "Le Raid", de Djamel Bensalah et "3 zéros", de Fabien Onteniente. Il obtient le prix Jean-Gabin en 2004.
À l'automne 2009, il joue le rôle principal de la pièce "Le roman d'un trader", où son personnage s'inspire de Jérôme Kerviel. Il se marie avec la comédienne Marie-Julie Baup le 3 octobre 2009. Ils ont deux filles.
Lorànt Deutsch est également connu pour avoir publié plusieurs ouvrages de vulgarisation sur l'histoire de France, dont "Métronome : l'histoire de France au rythme du métro parisien" ( 2009 ), ou "Hexagone" (2013), vendu à plus de 50.000 d'exemplaires.
+ Voir plusLorànt Deutsch est un acteur de cinéma français et écrivain.
Né dans l'Orne à Alençon d'un père hongrois et d'une mère parisienne, il grandit à Sablé-sur-Sarthe. Il découvre la comédie au centre culturel de cette ville mais se passionne d'abord pour le football. À 12 ans, il est recruté par le F.C. Nantes dans le cadre "Sport-études". Deux ans plus tard, il abandonne et part chez ses grands-parents à Paris. C'est dans une MJC qu'il prend goût au théâtre. Plus tard, sa sœur l'inscrit au théâtre Mouffetard dans le Ve arrondissement.
En 1990, il se présente pour la première fois aux auditions d'une série de télévision franco-québécoise. Premier contrat ; pendant cinq ans il tient le rôle de Tom, un garçon français jouant les détectives avec une copine québécoise, dans Les Intrépides.
Il met ensuite sa carrière artistique entre parenthèses en faveur de ses études, sans toutefois renoncer aux cours de théâtre qu'il continue à fréquenter. Ni aux plateaux, d'ailleurs, puisque pendant cette période, il est présent dans de nombreuses publicités.
Après avoir achevé en 1998 ses études de philosophie et de civilisation hongroise, il entame sa carrière avec la sortie du film "Le Ciel, les oiseaux et... ta mère !" de Djamel Bensalah.
En 2003, il est récompensé par l'Étoile d'or de la révélation masculine, pour son interprétation dans les films "Le Raid", de Djamel Bensalah et "3 zéros", de Fabien Onteniente. Il obtient le prix Jean-Gabin en 2004.
À l'automne 2009, il joue le rôle principal de la pièce "Le roman d'un trader", où son personnage s'inspire de Jérôme Kerviel. Il se marie avec la comédienne Marie-Julie Baup le 3 octobre 2009. Ils ont deux filles.
Lorànt Deutsch est également connu pour avoir publié plusieurs ouvrages de vulgarisation sur l'histoire de France, dont "Métronome : l'histoire de France au rythme du métro parisien" ( 2009 ), ou "Hexagone" (2013), vendu à plus de 50.000 d'exemplaires.
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (11)
Voir plusAjouter une vidéo
Citations et extraits (126)
Voir plus
Ajouter une citation
Au bord de la Charente, parmi les magnifiques vestiges du XVIIème siècle, comment ne pas être impressionné par la Corderie Royale ?
Ce fut l'un des plus anciens et des plus vastes bâtiments de l'arsenal, le plus long monument d'Europe à l'époque (trois cent soixante-quinze mètres).
La manufacture de cordes a fourni la marine jusqu'en 1867, puis l'apparition des câbles en acier amena la suppression de la corderie, devenue inutile.
Les bâtiments furent réhabilités pour héberger une école d'officiers et d'apprentis armuriers mais, en 1926, la Corderie, désaffectée, fut laissée à l'abandon.
Cinquante ans plus tard, une rénovation lui a rendu la vie.
Aujourd'hui, on visite ce lieu historique pour découvrir ce qu'était un chantier naval il y a plus de trois cents ans (rue Jean-Baptiste-Audebert) ...
Ce fut l'un des plus anciens et des plus vastes bâtiments de l'arsenal, le plus long monument d'Europe à l'époque (trois cent soixante-quinze mètres).
La manufacture de cordes a fourni la marine jusqu'en 1867, puis l'apparition des câbles en acier amena la suppression de la corderie, devenue inutile.
Les bâtiments furent réhabilités pour héberger une école d'officiers et d'apprentis armuriers mais, en 1926, la Corderie, désaffectée, fut laissée à l'abandon.
Cinquante ans plus tard, une rénovation lui a rendu la vie.
Aujourd'hui, on visite ce lieu historique pour découvrir ce qu'était un chantier naval il y a plus de trois cents ans (rue Jean-Baptiste-Audebert) ...
Nous voici enfin sur la rive droite. A la station Louvre, nous quittons le monde romain pour entrer dans l’ère des Francs. Venus du Sud, les romains avaient colonisés le sud de Paris, c’est-à-dire la rive gauche. Les Francs venus du Nord vont tout naturellement développer l’axe nord de la ville la rive droite.
Le musée du Louvre jadis palais jadis encore château voire place forte, recèle les vestiges d’un donjon et des tours de l’ancienne forteresse :
Sous Philippe Auguste, cette forteresse était encore un ouvrage militaire, voire une prison. Il faudra attendre Charles V, vers 1370, pour parler de résidence royale, avec de nombreux embellissements. Puis la guerre de Cent Ans éloigna les rois de France de Paris. Ce ne fut qu’avec François Ier que le Louvre, devenu un palais, accueillit de nouveau les souverains.
Le musée du Louvre jadis palais jadis encore château voire place forte, recèle les vestiges d’un donjon et des tours de l’ancienne forteresse :
Sous Philippe Auguste, cette forteresse était encore un ouvrage militaire, voire une prison. Il faudra attendre Charles V, vers 1370, pour parler de résidence royale, avec de nombreux embellissements. Puis la guerre de Cent Ans éloigna les rois de France de Paris. Ce ne fut qu’avec François Ier que le Louvre, devenu un palais, accueillit de nouveau les souverains.
Lutèce, ville impériale, va devenir, en cette même année 360, ville ecclésiale. Les évêques gaulois décident de convoquer à Paris un important concile dont le but essentiel est de réunir les ouailles pour condamner les hérésies chrétiennes, particulièrement l’arianisme, qui ne reconnaît ni la divinité du Christ ni l’autorité du pape. Paris devient ainsi, momentanément, le lieu de l’expression la plus dogmatique du catholicisme romain.
Dans sa géographie, la ville moderne n’a pas effacé le souvenir du saint… La voie romaine du nord, où il a guéri jadis le lépreux, est aujourd’hui la rue Saint-Martin.
Dans sa géographie, la ville moderne n’a pas effacé le souvenir du saint… La voie romaine du nord, où il a guéri jadis le lépreux, est aujourd’hui la rue Saint-Martin.
En s’arrêtant à la station Saint - Germain - des - Prés, le promeneur pense à l’existentiolisme, aux caves de jazz, aux écrivains attablés près du poêle des Deux -Magots, aux amants du Flore dont les ombres, jamais , n’ont déserté les lieux... Illusion, car Jean-Paul Sartre , Simone de Beauvoir, tout comme Boris Vian, Jacques Prévert et les autres ont disparu depuis longtemps. Dans sa quête, le badaud ne trouve qu’ une plaque dérisoire fixée sur un piquet en bord de trottoir : « Place Sartre -Beauvoir »...
Là encore, Léonard va mettre le paquet.
Il n'est pas du genre à se contenter de quelques cotillons et d'une queue-leu-leu pour amuser la galerie.
Oh que non ! ...
Il n'est pas du genre à se contenter de quelques cotillons et d'une queue-leu-leu pour amuser la galerie.
Oh que non ! ...
Je vous l'ai dit : l'Histoire n'est pas terminée. Nous la prolongeons en filant sur l'asphalte, en bifurquant sur des voies de traverse, en faisant rouler des pierres sur le sentier.
Accompagnés d'ombres invisibles, celles des gaulois et des romains, celles des pèlerins du moyen-âge et des seigneurs féodaux, celles des postillons et des cantonniers, nous nous dirigeons tous vers des routes inconnues ...
Quelles surprises nous réservent-elles, ces routes du troisième millénaire ? ...
Accompagnés d'ombres invisibles, celles des gaulois et des romains, celles des pèlerins du moyen-âge et des seigneurs féodaux, celles des postillons et des cantonniers, nous nous dirigeons tous vers des routes inconnues ...
Quelles surprises nous réservent-elles, ces routes du troisième millénaire ? ...
En regardant vers l’Arc de Triomphe, vous verrez, au bout du parvis, un peu perdue parmi les constructions nouvelles, l’ancienne statue de la Défense, érigée en 1883 en hommage à la résistance des Parisiens lors de l’invasion prussienne de 1970. Le quartier lui doit son nom.
Quoi qu’il en soit, pour Paris, notre siècle sera celui d’une expansion vertigineuse. Ce sera le siècle du Grand Paris, le triomphe d’une agglomération tentaculaire, qui franchira le Périphérique pour avaler tout ou partie de sa banlieue, supprimant quelques départements au passage.
[…] Et en se développant vers l’ouest, Paris, le Grand Paris de demain, aura fait de ce quartier d’affaires aux tours agressives une partie de lui-même, un témoin de son passé, une fenêtre ouverte vers son avenir. Et la capitale continuera naturellement de se prolonger vers l’ouest pour englober Nanterre, juste derrière la Défense.
Ainsi la ville remonte lentement à sa source… On s’en souvient, la Lutèce gauloise se situait au bord de la Seine, à l’emplacement de l’actuelle Nanterre.
Quoi qu’il en soit, pour Paris, notre siècle sera celui d’une expansion vertigineuse. Ce sera le siècle du Grand Paris, le triomphe d’une agglomération tentaculaire, qui franchira le Périphérique pour avaler tout ou partie de sa banlieue, supprimant quelques départements au passage.
[…] Et en se développant vers l’ouest, Paris, le Grand Paris de demain, aura fait de ce quartier d’affaires aux tours agressives une partie de lui-même, un témoin de son passé, une fenêtre ouverte vers son avenir. Et la capitale continuera naturellement de se prolonger vers l’ouest pour englober Nanterre, juste derrière la Défense.
Ainsi la ville remonte lentement à sa source… On s’en souvient, la Lutèce gauloise se situait au bord de la Seine, à l’emplacement de l’actuelle Nanterre.
Un an plus tard, en novembre 887, le mécontentement est général dans l’empire. Pour apaiser la noblesse, Charles le Gros se voit contraint de convoquer une diète à Trebur, près de Mayence.
[…] Au mois de février suivant, les seigneurs francs réunis à Compiègne acclament Eudes : le comte de Paris est nommé roi de Francie occidentale.
[…] L’ennemi a définitivement renoncé à Paris, mais la ville panse ses plaies. Les invasions vikings ont ruinés ses édifices : de la Basilique Saint-Germain-des-Prés, il ne reste que la partie inférieure d’une tour carrée ; Sainte-Geneviève, Saint-Julien-le-Pauvre, Saint Marcel, Saint-Germain-l’Auxerrois et de nombreuses autres églises ont été mises à sac et incendiées.
[…] Par leur défense obstinée, les Parisiens se sont imposés au reste du royaume, et même si, à sa mort, le comte de Paris Eudes redonnera la couronne de Francie occidentale aux descendants directs de Charlemagne, ce sont eux, les Parisiens, qui désormais font l’Histoire, ce sont eux qui font les rois.
[…] Au mois de février suivant, les seigneurs francs réunis à Compiègne acclament Eudes : le comte de Paris est nommé roi de Francie occidentale.
[…] L’ennemi a définitivement renoncé à Paris, mais la ville panse ses plaies. Les invasions vikings ont ruinés ses édifices : de la Basilique Saint-Germain-des-Prés, il ne reste que la partie inférieure d’une tour carrée ; Sainte-Geneviève, Saint-Julien-le-Pauvre, Saint Marcel, Saint-Germain-l’Auxerrois et de nombreuses autres églises ont été mises à sac et incendiées.
[…] Par leur défense obstinée, les Parisiens se sont imposés au reste du royaume, et même si, à sa mort, le comte de Paris Eudes redonnera la couronne de Francie occidentale aux descendants directs de Charlemagne, ce sont eux, les Parisiens, qui désormais font l’Histoire, ce sont eux qui font les rois.
Childéric, le roi franc qui règne à Tournai, dans le Nord, se soumet à Odoacre, roi en Italie.
[…] Childéric, fils du roi Mérovée, voit dans cet enchevêtrement d’intérêts et de fricotages l’occasion d’assurer sa lignée, celle des Mérovingiens.
Clovis, jeune homme de seize ans, soudain promu roi des Francs, est bien décidé à perpétuer avec une belle piété filiale la politique paternelle. Il poursuit le combat contre Syagrius et continue d’assiéger Paris.
Paris, le bourg gallo-romain, la ville-citadelle, devient capitale du royaume des Francs en 508
Sainte Geneviève mourut en 502, neuf ans avant son roi chrétien qui fut inhumé à son côté dans cette église Saint-Pierre-et-Saint-Paul sur le mont Lucotitius (la montagne Sainte-Geneviève)
[…] L’église, devenue abbaye au XIIe siècle, fut remplacée en 1744 par l’église Sainte-Geneviève voulue par le roi Louis XV. C’est aujourd’hui le Panthéon, mausolée des grands personnages de l’Histoire de France.
[…] Childéric, fils du roi Mérovée, voit dans cet enchevêtrement d’intérêts et de fricotages l’occasion d’assurer sa lignée, celle des Mérovingiens.
Clovis, jeune homme de seize ans, soudain promu roi des Francs, est bien décidé à perpétuer avec une belle piété filiale la politique paternelle. Il poursuit le combat contre Syagrius et continue d’assiéger Paris.
Paris, le bourg gallo-romain, la ville-citadelle, devient capitale du royaume des Francs en 508
Sainte Geneviève mourut en 502, neuf ans avant son roi chrétien qui fut inhumé à son côté dans cette église Saint-Pierre-et-Saint-Paul sur le mont Lucotitius (la montagne Sainte-Geneviève)
[…] L’église, devenue abbaye au XIIe siècle, fut remplacée en 1744 par l’église Sainte-Geneviève voulue par le roi Louis XV. C’est aujourd’hui le Panthéon, mausolée des grands personnages de l’Histoire de France.
L'écrivain normand Guernes de Pont-Sainte-Maxence conseille en 1174 de "bien écrire afin que nul ne puisse en rire" ...
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Lorànt Deutsch
Quiz
Voir plus
«Métronome» de Lorànt Deutsch
Dans son ouvrage "Métronome", au rythme de quoi, Lorànt Deutsch fait-il découvrir l'histoire de France ?
du métro parisien
des routes nationales
des sentiers de grandes randonnées
10 questions
59 lecteurs ont répondu
Thème : Métronome : L'histoire de France au rythme du métro parisien de
Lorànt DeutschCréer un quiz sur cet auteur59 lecteurs ont répondu