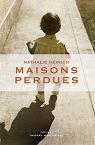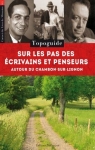Critiques de Nathalie Heinich (81)
Se souvenir des êtres chers, d'une époque, de soi comme un effet miroir dont le réceptacle est une maison "je devais avoir cinq ou six ans, et je lisais un livre d'images où il était question d'un groupe d'enfants qui jouaient et vivaient dans un livre - chaque double page était une pièce de leur maison. Vivre dans un livre, tous ensemble : une image du bonheur total qui m'a emplie de la certitude, soudain que c'était à cela que devait ressembler la vraie vie".
10 maisons de la lignée maternelle et paternelle fréquentées par l'auteure qui disparaîtront un jour du giron familial , 10 chapitres d'une géographie du coeur par les chemins de la Provence, du Massif central, d'Ile de France et de Bretagne pour un retour en Provence.
Pour y parvenir, Nathale Heinich convoque une image ou son inconscient pour faire revivre le temps de ces bâtisses qui sont d'avantage "qu'un toit, deux fenêtres et une porte" et nous les faire aimer.
Comme la physionomie d'une personne, la maison quelle soit rurale, urbaine ou de résidence secondaire a sa particularité propre : type d'architecture locale, agencement intérieur (les pièces de vie, teinte des tissus, nappes, motifs du carrelage..) sans oublier le jardin, prolongement indispensable de lieu de vie en harmonie avec la nature ; La maison est là devant nous tant la description est dans le moindre détail, tant elle est vraie.
A l'intérieur de la maison comme les bras d'une personne, l'auteure selon son état intérieur vit et ressent soit des moments de bonheur intense soit parfois de triste solitude, seul cas où elle sera soulagée de laisser une part d'elle même.
Pour l'auteure, le pur bonheur est la ferme du Monteillet, où enfant elle séjournait en vacances et s'emplissait d'émotions et de sensations : courir libre dans la campagne, chanter, écouter l'aboiements des chiens, sentir le café du matin, goûter la saveur des fruits, respirer l'air, s'enivrer de lumière. Adulte, ces sons et ces goûts lui rappelleront toujours Monteillet mais sans plus ressentir leur extrême jouissance parce que "la petite fille a cessé d'exister".
Aide à la construction de la personnalité au temps de l'enfance et de l'adolescence, "maison médicament" où l'on aime se réfugier en cas de blessure, la maison porte aussi l'état d'épanouissement intellectuel, l'amour des livres, l'inspiration qui sera pour l'auteure Montmachoux.
De fait, le récit fourmille de références littéraires classiques où est rattachée avec émotion une maison à une histoire lue à l'enfance ou à l'adolescence .
Adulte, il s'agit pour l'auteure de trouver ou "constuire une maison avec l'homme de sa vie" correspondant à leur projet de vie en commun.
Chacun de nous a son "Monteillet, lire ces lignes fait ressurgir dans notre mémoire avec bonheur et douce mélancolie ce que l'on a connu et....perdu. Perdu pour non possession, par la vente à un tiers, dégradation, démolition ou impossibilité de reconnaître LA maison dans le cadre d'une restructuration urbaine : "mais ne pas même savoir si ce qu'on a connu existe encore, et où, alors même qu'on y est - comment l'accepter ?".
La grande réussite de cet essai qui était une gageure de Nathalie Heinich est, en le lisant, de partager le deuil que l'on fait un jour d'une maison qui nous a vu grandir et de surmonter la douleur de la perte en se consolant de ces mots qui touchent profondément.
10 maisons de la lignée maternelle et paternelle fréquentées par l'auteure qui disparaîtront un jour du giron familial , 10 chapitres d'une géographie du coeur par les chemins de la Provence, du Massif central, d'Ile de France et de Bretagne pour un retour en Provence.
Pour y parvenir, Nathale Heinich convoque une image ou son inconscient pour faire revivre le temps de ces bâtisses qui sont d'avantage "qu'un toit, deux fenêtres et une porte" et nous les faire aimer.
Comme la physionomie d'une personne, la maison quelle soit rurale, urbaine ou de résidence secondaire a sa particularité propre : type d'architecture locale, agencement intérieur (les pièces de vie, teinte des tissus, nappes, motifs du carrelage..) sans oublier le jardin, prolongement indispensable de lieu de vie en harmonie avec la nature ; La maison est là devant nous tant la description est dans le moindre détail, tant elle est vraie.
A l'intérieur de la maison comme les bras d'une personne, l'auteure selon son état intérieur vit et ressent soit des moments de bonheur intense soit parfois de triste solitude, seul cas où elle sera soulagée de laisser une part d'elle même.
Pour l'auteure, le pur bonheur est la ferme du Monteillet, où enfant elle séjournait en vacances et s'emplissait d'émotions et de sensations : courir libre dans la campagne, chanter, écouter l'aboiements des chiens, sentir le café du matin, goûter la saveur des fruits, respirer l'air, s'enivrer de lumière. Adulte, ces sons et ces goûts lui rappelleront toujours Monteillet mais sans plus ressentir leur extrême jouissance parce que "la petite fille a cessé d'exister".
Aide à la construction de la personnalité au temps de l'enfance et de l'adolescence, "maison médicament" où l'on aime se réfugier en cas de blessure, la maison porte aussi l'état d'épanouissement intellectuel, l'amour des livres, l'inspiration qui sera pour l'auteure Montmachoux.
De fait, le récit fourmille de références littéraires classiques où est rattachée avec émotion une maison à une histoire lue à l'enfance ou à l'adolescence .
Adulte, il s'agit pour l'auteure de trouver ou "constuire une maison avec l'homme de sa vie" correspondant à leur projet de vie en commun.
Chacun de nous a son "Monteillet, lire ces lignes fait ressurgir dans notre mémoire avec bonheur et douce mélancolie ce que l'on a connu et....perdu. Perdu pour non possession, par la vente à un tiers, dégradation, démolition ou impossibilité de reconnaître LA maison dans le cadre d'une restructuration urbaine : "mais ne pas même savoir si ce qu'on a connu existe encore, et où, alors même qu'on y est - comment l'accepter ?".
La grande réussite de cet essai qui était une gageure de Nathalie Heinich est, en le lisant, de partager le deuil que l'on fait un jour d'une maison qui nous a vu grandir et de surmonter la douleur de la perte en se consolant de ces mots qui touchent profondément.
Les maisons que nous avons connues, où nous avons vêcu depuis notre enfance sont dans notre mémoire, et nous évoquent plus qu'un lieu : une époque, les personnes qui y vivaient avec nous, une atmosphère, des senteurs, des sensations... elles sont en nous. Je partage les sentiments de N. Heinich, et son livre m'a beaucoup touchée
Sociologue de formation, Nathalie Heinrich a choisi la fome plus intime du récit pour égrener, au fil de dix chapitres, Les maisons perdues., celles qu'elle a aimées, où elle a té heureuse .En filigrane, de 1950 à nos jours, se lit l'histoire d'une famille, l'évolution de la narratrice-auteure quant à sa volonté de trouver sa maison.
C'est aussi l'occasion de brosser des portraits tendres et chaleureux de ceux qui ont habité au sens fort du terme ces demeures et ont accompagné la narratrice dans son chemin de vie. Une écriture précise et sensible , une réflexion intéressante mais quelques longueurs dans les descriptions de ces maisons.
C'est aussi l'occasion de brosser des portraits tendres et chaleureux de ceux qui ont habité au sens fort du terme ces demeures et ont accompagné la narratrice dans son chemin de vie. Une écriture précise et sensible , une réflexion intéressante mais quelques longueurs dans les descriptions de ces maisons.
Pousser de nouveau la porte des maisons de sa jeunesse, celles auxquelles elle n’a plus accès, celles qui n’existent plus, un peu comme l’on évoque « des gens qu’on a aimés », tel est l’objet de Maisons perdues de Nathalie Heinich. Retrouver par l’écriture ces lieux de l’enfance qui l’ont façonnée. A travers les maisons, c’est elle-même finalement qu’évoque la sociologue, dans ce qu’elle qualifie d’ « autobiographie par les toits ».
L’on y découvre une enfance marseillaise auprès de la bâtisse des grands-parents. La petite fille y fait ses premiers pas, cherchant l’équilibre, comme en témoigne de vieilles photos. C’est l’une d’entre elle qui est choisie pour la couverture du livre. L’enfant qui trottine ignore encore le mariage forcé de ses grands-parents, la grand-mère aînée de trois filles que, par l’entremise du pasteur, on a marié dans l’urgence, alors même qu’elle en aimait un autre, à un jeune homme bien inconsistant à côté de l’élu de son coeur. Elle ne perçoit pas pour le moment que ses parents ont allié une famille protestante austère, un brin pétainiste, à des Juifs soudés par la disparition de beaucoup trop d’entre eux, par les fuites incessantes devant l’occupant. Pour l’instant l’enfant profite des confitures et des gâteaux de son aïeule. D’autres maisons façonnent la jeunesse de Nathalie Heinich dans le sud-est, maisons des oncles et tantes, qui reçoivent régulièrement pour le plus grand bonheur des cousins qui ont ainsi de beaux terrains de jeu.
Et puis il y a les maisons de vacances, celles des bonheurs d’été, les paradis de l’Ardèche et du Massif central. Des grandes fermes typiques de ces régions, aux pièces nombreuses. Autour, des jardins immenses, puis la nature, sauvage, où gambader. Plus tard, les maisons de l’adolescence, celle des amies plus mûres qui sont autant de mentors pour la narratrice. En Ile-de-France, puis en Bretagne. Ces derniers lieux sont indissociables de leurs propriétaires qui en sont les fées autant que les gardiennes.
Enfin ce sont les maisons de l’adulte avec l’un ou l’autre des « hommes-de-ma-vie ». Difficile pour l’adolescente d’imaginer qu’il pourrait y en avoir plusieurs, et pourtant. Eux aussi sont attachés à des gîtes accueillants. Dans le sud-est, à l’aplomb de la Méditerranée, puis de nouveau dans le Massif central.
Ces lieux enchanteurs, il faut les quitter pourtant. Les aléas d’un divorce, de disputes parfois entre les hôtes et les invités. Des décès trop souvent. Les maisons perdues vivent dans la mémoire et s’invitent parfois dans les rêves, comme une douleur si douce au souvenir. C’est l’écriture qui permet de les faire revivre tout en apaisant leur perte.
L’on y découvre une enfance marseillaise auprès de la bâtisse des grands-parents. La petite fille y fait ses premiers pas, cherchant l’équilibre, comme en témoigne de vieilles photos. C’est l’une d’entre elle qui est choisie pour la couverture du livre. L’enfant qui trottine ignore encore le mariage forcé de ses grands-parents, la grand-mère aînée de trois filles que, par l’entremise du pasteur, on a marié dans l’urgence, alors même qu’elle en aimait un autre, à un jeune homme bien inconsistant à côté de l’élu de son coeur. Elle ne perçoit pas pour le moment que ses parents ont allié une famille protestante austère, un brin pétainiste, à des Juifs soudés par la disparition de beaucoup trop d’entre eux, par les fuites incessantes devant l’occupant. Pour l’instant l’enfant profite des confitures et des gâteaux de son aïeule. D’autres maisons façonnent la jeunesse de Nathalie Heinich dans le sud-est, maisons des oncles et tantes, qui reçoivent régulièrement pour le plus grand bonheur des cousins qui ont ainsi de beaux terrains de jeu.
Et puis il y a les maisons de vacances, celles des bonheurs d’été, les paradis de l’Ardèche et du Massif central. Des grandes fermes typiques de ces régions, aux pièces nombreuses. Autour, des jardins immenses, puis la nature, sauvage, où gambader. Plus tard, les maisons de l’adolescence, celle des amies plus mûres qui sont autant de mentors pour la narratrice. En Ile-de-France, puis en Bretagne. Ces derniers lieux sont indissociables de leurs propriétaires qui en sont les fées autant que les gardiennes.
Enfin ce sont les maisons de l’adulte avec l’un ou l’autre des « hommes-de-ma-vie ». Difficile pour l’adolescente d’imaginer qu’il pourrait y en avoir plusieurs, et pourtant. Eux aussi sont attachés à des gîtes accueillants. Dans le sud-est, à l’aplomb de la Méditerranée, puis de nouveau dans le Massif central.
Ces lieux enchanteurs, il faut les quitter pourtant. Les aléas d’un divorce, de disputes parfois entre les hôtes et les invités. Des décès trop souvent. Les maisons perdues vivent dans la mémoire et s’invitent parfois dans les rêves, comme une douleur si douce au souvenir. C’est l’écriture qui permet de les faire revivre tout en apaisant leur perte.
Un remarquable ouvrage dont je m’étonne qu’il n’y ait aucun commentaire à ce jour, sur un site destiné à la lecture !
Tout lecteur ne peut ignorer la déferlante de folie apportée par les néo féministes ou autres ultra qui veulent abattre les règles de notre intelligible grammaire et prônent et imposeraient volontiers comme impératrice l’´écriture inclusive au risque de rendre incompréhensible et stupide notre langue extrêmement précise et séculaire.
La Cancel Culture ou wokisme ici sont décortiqués et expliqués de même que les différentes évolutions de la langue au cours des siècles, les raisons de tel ou tel choix, le point de vue des plus grands linguistes et grammairiens.
Un panel de grands noms ont participé à ce parfait ouvrage pour expliquer à ceux qui en doutent encore que la langue n’est pas politique qu’elle n’a pas de SEXE, mais qu’elle est neutre. et que les questions ou problèmes, extravagances et exigences d’extrémistes dangereux et stupides doivent être relégués aux oubliettes et définitivement.
Où va la France ?
Tout lecteur ne peut ignorer la déferlante de folie apportée par les néo féministes ou autres ultra qui veulent abattre les règles de notre intelligible grammaire et prônent et imposeraient volontiers comme impératrice l’´écriture inclusive au risque de rendre incompréhensible et stupide notre langue extrêmement précise et séculaire.
La Cancel Culture ou wokisme ici sont décortiqués et expliqués de même que les différentes évolutions de la langue au cours des siècles, les raisons de tel ou tel choix, le point de vue des plus grands linguistes et grammairiens.
Un panel de grands noms ont participé à ce parfait ouvrage pour expliquer à ceux qui en doutent encore que la langue n’est pas politique qu’elle n’a pas de SEXE, mais qu’elle est neutre. et que les questions ou problèmes, extravagances et exigences d’extrémistes dangereux et stupides doivent être relégués aux oubliettes et définitivement.
Où va la France ?
Un percutant recueil de textes consacrés aux ravages de l'écriture inclusive
Lien : https://www.marianne.net/cul..
Lien : https://www.marianne.net/cul..
c'est une analyse des rapports entre mère et fille illustrée par des personnages de la littérature ou de films de cinéma (la leçon de piano, la pianiste, l'amant...). Ce livre permet vraiment de décoder la complexité de la relation entre une mère et sa fille ( comme lors d'une psychanalyse) et l'illustration par des romans donne envie de lire ces romans pour approfondir la thématique.
Bref, ça m'a beaucoup plu surtout à l'heure où je me pose des questions par rapport à ma propre mère , à devenir femme et à l'heure où peut être j'ai envie de devenir mère à mon tour.... Trés intéressant
Bref, ça m'a beaucoup plu surtout à l'heure où je me pose des questions par rapport à ma propre mère , à devenir femme et à l'heure où peut être j'ai envie de devenir mère à mon tour.... Trés intéressant
Il est assez difficile de comprendre tout ce qui se joue entre mère et fille. Ce livre se propose de nous guider pour mieux comprendre ce qui se joue. Un peu ardu parfois mais il mérite d'être lu.
Très intéressant par la richesse des références aux œuvres littéraires ou cinématographiques.
je me suis retrouvée complètement dans le rôle de mère que je suis et de fille...
Une analyse pertinente et peut être vulgarisée sur le rapport entre mère fille pour appréhender la complexité de cette relation : à l'amour à la haine...
Ce petit livre expose et développe les raisons qu’on peut avoir de résister à un certain esprit du temps qui disperse et enferme les hommes, au sens de l’humanité, dans des catégories figées. Il est constitué d’articles divers parfois déjà publiés ailleurs. Il est du côté de la rationalité de l’universel, de ce qui constitue notre commune humanité. C’est ce choix qui fonde le mot « universalisme » : une aspiration, qui n’est pas (encore) une réalité, et qu’il faut conserver et développer. À cet universalisme, s’oppose le communautarisme qui met en priorité les groupes auxquels chacun appartient. L’universalisme ne peut céder devant le fait que l’égalité n’est pas parfaitement réalisée.
Le mode de pensée des communautaristes est binaire : des dominants et des dominés, des bourreaux et des victimes.
Trois domaines de la vie sociétale sont affectés par ce retournement des valeurs : l’identité, la différence sexuelle, le peu de valeur de la parole de l’autre. Cela donne trois parties au livre. Ces retournements viennent des USA, ce qui est reprochable en soi, les USA ayant toujours fonctionné sur ces distinctions préalables à toutes autres considérations, et à la considération de l’unité de l’homme dans toutes ces « identités ». Quel que soit l’avis qu’on peut porter sur ce phénomène, sa dimension d’intrusion caractérisée est en soi un reproche qui pourrait suffire à l’invalider, à le rejeter. Mais ce n’est pas l’essentiel.
L’identitarisme découpe la société en communautés. L’appartenance à une identité collective n’est pas le fait d’une décision, ce qui la placerait dans l’ordre de la volonté, elle est donnée comme « un fait », une essence. Or, tout groupe, par construction, est exclusif. L’appartenance en peut exister sans son contraire : l’exclusion (de ceux qui ne sont pas du groupe). C’est là que l’unité de l’universel se brise. L’appartenance comme l’exclusion peuvent être douces et tranquilles. Ce n’est guère le cas dans cette optique : les groupes communautaires entrent en concurrence les uns avec les autres. A été inventée ainsi l’intersectionnalité : « dès lors que les individus sont appréhendés comme appartenant à un collectif assigné, il faut trouver des solutions pour rendre compte de l’évidente pluralité des identités… créer une nouvelle identité » (p90)
Le néo-féminisme est un autre domaine du communautarisme. Du point de vue de l’universalisme, la différence sexuelle ne doit être mise en avant que lorsqu’elle joue un rôle dans ce que l’on a à dire, le reste du temps, l’humanité des femmes et des hommes ne nécessite pas de spécification et n’a pas à être mentionnée. L’écriture dite-inclusive ne cesse de vouloir rappeler l’existence des femmes et des hommes, ce que l’on sait bien. Il y a une double injonction impossible à, d’une part ne pas considérer les sexes (par souci d’égalité) et, d’autre part de les spécifier sans cesse dans la détermination dominant-dominé. Comme il va de même de la race, on trouve un « féminisme décolonial », les femmes noirs subiraient plus de discrimination, selon leur appartenance à deux catégories victimisées. Le bourreau désigné identitairement est le « mâle blanc », convergence de toutes ces catégories de plaignants.
Car, dernier point, tout ce système se fait sur un mode accusatoire, ou l’élimination du discours de l’autre et même de sa personne est érigé en méthode et idéal (cela s’appelle woke ou cancel culture). Des conférences sont interdites, des statues déboulonnées, des livres brûlés… dans une culture de la censure, où certains se sentent tellement assurés d’être du côté du bien qu’ils se sentent en droit de faire du mal aux autres, à leur parole, à leurs créations… Cette idéologie gagne l’université, les syndicats…
Le meilleur remède aux inégalités du monde est encore la considération de ce qui unifie les hommes, ce qui rassemble, ce qui les rend semblables les uns aux autres, dans un combat permanent pour réaliser, rendre réel, l’égalité qui découle de cette unité humaine : chaque humain, membre de la collectivité nationale, ses appartenances à des « communautés » ne lui conférant aucun droit, ne conférant aucune légitimité spéciales à ses opinions.
Le mode de pensée des communautaristes est binaire : des dominants et des dominés, des bourreaux et des victimes.
Trois domaines de la vie sociétale sont affectés par ce retournement des valeurs : l’identité, la différence sexuelle, le peu de valeur de la parole de l’autre. Cela donne trois parties au livre. Ces retournements viennent des USA, ce qui est reprochable en soi, les USA ayant toujours fonctionné sur ces distinctions préalables à toutes autres considérations, et à la considération de l’unité de l’homme dans toutes ces « identités ». Quel que soit l’avis qu’on peut porter sur ce phénomène, sa dimension d’intrusion caractérisée est en soi un reproche qui pourrait suffire à l’invalider, à le rejeter. Mais ce n’est pas l’essentiel.
L’identitarisme découpe la société en communautés. L’appartenance à une identité collective n’est pas le fait d’une décision, ce qui la placerait dans l’ordre de la volonté, elle est donnée comme « un fait », une essence. Or, tout groupe, par construction, est exclusif. L’appartenance en peut exister sans son contraire : l’exclusion (de ceux qui ne sont pas du groupe). C’est là que l’unité de l’universel se brise. L’appartenance comme l’exclusion peuvent être douces et tranquilles. Ce n’est guère le cas dans cette optique : les groupes communautaires entrent en concurrence les uns avec les autres. A été inventée ainsi l’intersectionnalité : « dès lors que les individus sont appréhendés comme appartenant à un collectif assigné, il faut trouver des solutions pour rendre compte de l’évidente pluralité des identités… créer une nouvelle identité » (p90)
Le néo-féminisme est un autre domaine du communautarisme. Du point de vue de l’universalisme, la différence sexuelle ne doit être mise en avant que lorsqu’elle joue un rôle dans ce que l’on a à dire, le reste du temps, l’humanité des femmes et des hommes ne nécessite pas de spécification et n’a pas à être mentionnée. L’écriture dite-inclusive ne cesse de vouloir rappeler l’existence des femmes et des hommes, ce que l’on sait bien. Il y a une double injonction impossible à, d’une part ne pas considérer les sexes (par souci d’égalité) et, d’autre part de les spécifier sans cesse dans la détermination dominant-dominé. Comme il va de même de la race, on trouve un « féminisme décolonial », les femmes noirs subiraient plus de discrimination, selon leur appartenance à deux catégories victimisées. Le bourreau désigné identitairement est le « mâle blanc », convergence de toutes ces catégories de plaignants.
Car, dernier point, tout ce système se fait sur un mode accusatoire, ou l’élimination du discours de l’autre et même de sa personne est érigé en méthode et idéal (cela s’appelle woke ou cancel culture). Des conférences sont interdites, des statues déboulonnées, des livres brûlés… dans une culture de la censure, où certains se sentent tellement assurés d’être du côté du bien qu’ils se sentent en droit de faire du mal aux autres, à leur parole, à leurs créations… Cette idéologie gagne l’université, les syndicats…
Le meilleur remède aux inégalités du monde est encore la considération de ce qui unifie les hommes, ce qui rassemble, ce qui les rend semblables les uns aux autres, dans un combat permanent pour réaliser, rendre réel, l’égalité qui découle de cette unité humaine : chaque humain, membre de la collectivité nationale, ses appartenances à des « communautés » ne lui conférant aucun droit, ne conférant aucune légitimité spéciales à ses opinions.
LIvre très intéressant -- comme tout ce fait Mme Heinich -- sur une problématique très actuelle : celle de l'intrusion massive des problématiques de genre et de communauté dans un monde qui avait jusqu'ici privilégié la notion d'universalité et d'Homme citoyen plutôt que Homme membre d'une communauté particulière dotée de droits particuliers. Cette réflexion est particulièrement urgente et utile pour comprendre ce qui se joue et ce vers quoi mènent ces forces à l'oeuvre dans nos sociétés. Lecture un peu difficile par moment, mais fort utile.
Je dois avouer qu'en lisant Heinich parlant de Bourdieu, je me suis senti moins seul. Car chez Bourdieu, j'aime autant son souci de chercher là où le regard n'avait pas encore porté, sa manière de faire parler les chiffres, que je me désole de son côté paranoïaque (Heinich dit « agonistique », j'ai dû prendre mon dictionnaire, et j'ai appris un mot utile) et d'un style « ni-ni » qui me rappelle le lutteur qui s'enduit d'huile pour ne pas pouvoir être attrapé. Lire Heinich m'a donc permis de mettre en forme des idées que la lecture des écrits de Bourdieu m'inspirait souvent de manière fragmentaire.
Par ailleurs, la forme de Heinich me convient particulièrement : elle s'attaque à des sujets relativement complexes, de manière compréhensible (même s'il faut tout à fait normalement s'y reprendre à plusieurs fois sur certaines pages), sans nous prendre non plus pour des benêts.
Je n'ai pas été choqué, à l'instar de certains critiques du livre, par l'utilisation de son histoire personnelle auprès de Bourdieu. Au contraire il me semble qu'elle la met à sa place exacte, sans laisser paraître de rancoeur. Plutôt un regret que Bourdieu lui-même n'ait jamais laissé la place, lui qui aimait tant la réflexivité, à l'étude de sa propre paranoïa. D'autant qu'elle lit, comme une évidence (à laquelle j'adhère), l'alternative que Bourdieu a refusée : (p.147) "alors qu'il suffirait pour les clore de considérer que ces deux options ne sont que les pôles extrêmes d'un continuum sur lequel se déploie la réalité de l'expérience, mixte de décisions relativement autonomes et de déterminations relativement hétéronomes".
Je ne peux m'empêcher d'être surpris par le nombre de similitudes que je trouve entre Lordon et Bourdieu. A creuser… Merci aussi à Heinich de m'avoir fait découvrir « Un destin si funeste » de François Roustang… le processus de mutation du leader intellectuel en gourou, basé sur le cas de Freud, éclaire aussi Lacan et tant d'autres.
Après tout ces éloges sur cet ouvrage, une surprise : celle de voir Heinich décrire Bourdieu, implicitement, sans avoir l'air d'y toucher, et à de multiples reprises, comme un produit dans le cadre du « star system ». Elle utilise ainsi les mots « succès », « réussite », « concurrent ». Or la moindre des choses aurait été de creuser cette dimension. A-t-elle réellement échappé à son autrice ? J'ai du mal à le croire…
Par ailleurs, la forme de Heinich me convient particulièrement : elle s'attaque à des sujets relativement complexes, de manière compréhensible (même s'il faut tout à fait normalement s'y reprendre à plusieurs fois sur certaines pages), sans nous prendre non plus pour des benêts.
Je n'ai pas été choqué, à l'instar de certains critiques du livre, par l'utilisation de son histoire personnelle auprès de Bourdieu. Au contraire il me semble qu'elle la met à sa place exacte, sans laisser paraître de rancoeur. Plutôt un regret que Bourdieu lui-même n'ait jamais laissé la place, lui qui aimait tant la réflexivité, à l'étude de sa propre paranoïa. D'autant qu'elle lit, comme une évidence (à laquelle j'adhère), l'alternative que Bourdieu a refusée : (p.147) "alors qu'il suffirait pour les clore de considérer que ces deux options ne sont que les pôles extrêmes d'un continuum sur lequel se déploie la réalité de l'expérience, mixte de décisions relativement autonomes et de déterminations relativement hétéronomes".
Je ne peux m'empêcher d'être surpris par le nombre de similitudes que je trouve entre Lordon et Bourdieu. A creuser… Merci aussi à Heinich de m'avoir fait découvrir « Un destin si funeste » de François Roustang… le processus de mutation du leader intellectuel en gourou, basé sur le cas de Freud, éclaire aussi Lacan et tant d'autres.
Après tout ces éloges sur cet ouvrage, une surprise : celle de voir Heinich décrire Bourdieu, implicitement, sans avoir l'air d'y toucher, et à de multiples reprises, comme un produit dans le cadre du « star system ». Elle utilise ainsi les mots « succès », « réussite », « concurrent ». Or la moindre des choses aurait été de creuser cette dimension. A-t-elle réellement échappé à son autrice ? J'ai du mal à le croire…
La commune du Chambon-sur-Lignon, sur le « Haut-Plateau », est mondialement connue pour avoir accueilli et caché de nombreux réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale : émigrés français, espagnols, Juifs, résistants… Pour commémorer cette histoire, un Lieu de mémoire a été inauguré en 2013, face au temple du Chambon.
Nathalie Heinich, dont l'histoire familiale recoupe celle de ce village, a choisi de s’intéresser aux intellectuels qui ont effectué un séjour marquant pour leur vie, ou leur œuvre, sur ce petit territoire .
Les motifs du séjour au Chambon de ces écrivains, et penseurs sont très divers : villégiature (Louis Comte, Charles Gide) raisons de santé ( Albert Camus), recherche d'un refuge ( Georges Vajda, André Chouraqui, Jules Isaac) , lieu pour exercer une activité de résistance, tradition familiale protestante (Francis Ponge) .
Un nombre important d’œuvres majeures furent écrites en ces lieux : La Peste de Camus, La Fabrique du pré et Le Carnet du bois de pin de Francis Ponge, Jésus et Israël de Jules Isaac, l’Introduction à la pensée juive du Moyen Âge de Georges Vajda…
Nathalie Heinich associée à Sophie Ott, brocanteuse et bouquiniste au Chambon, ont rédigé ce topoguide, joliment illustré, qui permet de partir, à notre tour, à la rencontre de ces personnalités , à pied, à bicyclette, en voiture entre Saint-Jeures, Le Chambon-sur-Lignon, Le Mazet-Saint-Voy, Saint-Agrève et Tence.
J’ai eu le privilège et le grand bonheur , très récemment, de participer à une de ces balades champêtres , accompagnée par Nathalie Heinich pour aller à la rencontre d’Albert Camus, à Panelier.
Nathalie Heinich, dont l'histoire familiale recoupe celle de ce village, a choisi de s’intéresser aux intellectuels qui ont effectué un séjour marquant pour leur vie, ou leur œuvre, sur ce petit territoire .
Les motifs du séjour au Chambon de ces écrivains, et penseurs sont très divers : villégiature (Louis Comte, Charles Gide) raisons de santé ( Albert Camus), recherche d'un refuge ( Georges Vajda, André Chouraqui, Jules Isaac) , lieu pour exercer une activité de résistance, tradition familiale protestante (Francis Ponge) .
Un nombre important d’œuvres majeures furent écrites en ces lieux : La Peste de Camus, La Fabrique du pré et Le Carnet du bois de pin de Francis Ponge, Jésus et Israël de Jules Isaac, l’Introduction à la pensée juive du Moyen Âge de Georges Vajda…
Nathalie Heinich associée à Sophie Ott, brocanteuse et bouquiniste au Chambon, ont rédigé ce topoguide, joliment illustré, qui permet de partir, à notre tour, à la rencontre de ces personnalités , à pied, à bicyclette, en voiture entre Saint-Jeures, Le Chambon-sur-Lignon, Le Mazet-Saint-Voy, Saint-Agrève et Tence.
J’ai eu le privilège et le grand bonheur , très récemment, de participer à une de ces balades champêtres , accompagnée par Nathalie Heinich pour aller à la rencontre d’Albert Camus, à Panelier.
Une généalogie vivante de deux familles, l'une juive, l'autre protestante, l'une et l'autre convergeant, en devenant et/ou en restant français.
Une histoire France est un livre sur la famille maternelle et paternelle de l'auteure Nathalie Heinich. Le livre est très documenté avec de nombreuses photos et actes de naissances, extraits...
La première partie sur l'immigration de sa famille paternelle est très poignante et intéressante. On a tous entendu des témoignages de la guerre et du destin des juifs mais ici nous avons un cas concret et la lecture en est parfois difficile. Très touchant, on ne peut rester insensible au destin de ses ancêtres.
En revanche je mes suis par moment perdu dans la généalogie, il y a de nombreux enfants et on s'y perd parfois.
Ce livre traite de la condition des hommes mais surtout de la condition des femmes au fil des époques.
La première partie sur l'immigration de sa famille paternelle est très poignante et intéressante. On a tous entendu des témoignages de la guerre et du destin des juifs mais ici nous avons un cas concret et la lecture en est parfois difficile. Très touchant, on ne peut rester insensible au destin de ses ancêtres.
En revanche je mes suis par moment perdu dans la généalogie, il y a de nombreux enfants et on s'y perd parfois.
Ce livre traite de la condition des hommes mais surtout de la condition des femmes au fil des époques.
Dans cet ouvrage l'auteure Nathalie Heinich, fille de Lionel Heinich et de Geneviève Creuzet, nous raconte ses origines familiales paternelle et maternelle.
A la fin du 19eme siècle, son arrière-grand-père Jacob Benyoumoff, juif originaire d'Ukraine, chassé par les pogroms, émigre avec sa famille. Après un séjour d'environ 6 ans à Oran, ils arrivent à Marseille. Jacob est désigné comme "casquettier" (fabriquant de casquettes). C'est le début de la saga des Benyoumoff. A la veille de la deuxième guerre mondiale, la famille a fait fortune dans le "schmattès" (la confection). Certains membres de cette familles seront victimes de la déportation des juifs, notamment les grands-parents de l'auteure Bentzi et Jeanne.
Au lendemain de la guerre, Lionel, après s'être rêvé journaliste, devient directeur de l'usine familiale. Il a vingt-deux ans lorsqu'il rencontre Geneviève.
Si la famille paternelle a eu sur le plan social une trajectoire ascendante, celle de la famille maternelle a plutôt vécu une trajectoire en déclin.
Au lendemain de la guerre de 1870, la famille Lambs émigre vers Paris : Alsacienne et protestante, elle quitte l'Alsace après son annexion par l'Allemagne. Fin des années 1930 Serge et Madeleine s’installent à Marseille. Serge exerce alors le métier de représentant en cravates et chemises.
Lionel (juif) et Geneviève (protestante) se marient le 4 août 1950 à la mairie de Marseille, en l'absence des parents opposés au mariage mixte, et sans contrat de mariage pour la plus grande fureur de Lazare, père du marié.
Si j'ai apprécié le travail de recherche effectué par Nathalie Heinich pour reconstituer sa généalogie (assez compliquée, je me suis parfois perdue entre toutes les générations, les frères, sœurs et cousins ...) j'ai fermé ce livre avec sentiment de tristesse particulièrement devant le destin des femmes de ces familles. Pour certaines d'entre elles l'amour n'a joué aucun rôle dans leur mariage, les conjoints étant choisis par les parents, et pour d'autres la maladie et la mort en ont bouleversé le cours normal. Seuls Bentzi et Jeanne semblent avoir connus une vie conjugale heureuse, malheureusement terminée tragiquement.
Le texte de l'auteure est complété par une très nombreuse documentation (photos, schémas, cartes, copie de correspondance et autres pièces) particulièrement intéressante.
Ce livre est également intéressant compte tenu du contexte actuel sur l'émigration. La famille Benyoumoff notamment est exemplaire sur une intégration réussie. Deux des fils de Jacob sont mort "pour la France" au cours de la première guerre mondiale.
Merci à Babélio et aux éditions Les Impressions Nouvelles de m'avoir adressé ce livre.
A la fin du 19eme siècle, son arrière-grand-père Jacob Benyoumoff, juif originaire d'Ukraine, chassé par les pogroms, émigre avec sa famille. Après un séjour d'environ 6 ans à Oran, ils arrivent à Marseille. Jacob est désigné comme "casquettier" (fabriquant de casquettes). C'est le début de la saga des Benyoumoff. A la veille de la deuxième guerre mondiale, la famille a fait fortune dans le "schmattès" (la confection). Certains membres de cette familles seront victimes de la déportation des juifs, notamment les grands-parents de l'auteure Bentzi et Jeanne.
Au lendemain de la guerre, Lionel, après s'être rêvé journaliste, devient directeur de l'usine familiale. Il a vingt-deux ans lorsqu'il rencontre Geneviève.
Si la famille paternelle a eu sur le plan social une trajectoire ascendante, celle de la famille maternelle a plutôt vécu une trajectoire en déclin.
Au lendemain de la guerre de 1870, la famille Lambs émigre vers Paris : Alsacienne et protestante, elle quitte l'Alsace après son annexion par l'Allemagne. Fin des années 1930 Serge et Madeleine s’installent à Marseille. Serge exerce alors le métier de représentant en cravates et chemises.
Lionel (juif) et Geneviève (protestante) se marient le 4 août 1950 à la mairie de Marseille, en l'absence des parents opposés au mariage mixte, et sans contrat de mariage pour la plus grande fureur de Lazare, père du marié.
Si j'ai apprécié le travail de recherche effectué par Nathalie Heinich pour reconstituer sa généalogie (assez compliquée, je me suis parfois perdue entre toutes les générations, les frères, sœurs et cousins ...) j'ai fermé ce livre avec sentiment de tristesse particulièrement devant le destin des femmes de ces familles. Pour certaines d'entre elles l'amour n'a joué aucun rôle dans leur mariage, les conjoints étant choisis par les parents, et pour d'autres la maladie et la mort en ont bouleversé le cours normal. Seuls Bentzi et Jeanne semblent avoir connus une vie conjugale heureuse, malheureusement terminée tragiquement.
Le texte de l'auteure est complété par une très nombreuse documentation (photos, schémas, cartes, copie de correspondance et autres pièces) particulièrement intéressante.
Ce livre est également intéressant compte tenu du contexte actuel sur l'émigration. La famille Benyoumoff notamment est exemplaire sur une intégration réussie. Deux des fils de Jacob sont mort "pour la France" au cours de la première guerre mondiale.
Merci à Babélio et aux éditions Les Impressions Nouvelles de m'avoir adressé ce livre.
Livre qui relate l'histoire familiale de l'auteure, au travers de plusieurs personnages. Il s'agit de Juifs immigrés, qui arrivent à Marseille et qui subiront la répression nazie. C'est évidemment poignant de pouvoir entrer comme ça dans l'intimité d'une famille ayant vécue l'extermination des Juifs de très près. Encore récente, cette lecture mériterait d'être mieux digérée pour pouvoir vous en faire un commentaire plus constructif. En tout cas, c'est un livre que je conseil sans hésiter. Cela donne matière à réfléchir sur ce qu'est la France, sur ce que peuvent vivre les migrants actuels, qui n'ont pas la même culture, ni même la même religion, et qui arrive dans une société dans laquelle ils vont devoir se faire une place.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Nathalie Heinich
Lecteurs de Nathalie Heinich (484)Voir plus
Quiz
Voir plus
Couples de l'Antiquité
Antigone et ...
Thisbé
Andromaque
Didon
Eurydice
Clytemnestre
Baucis
Marc-Antoine
Hémon
Pénélope
Andromède
10 questions
44 lecteurs ont répondu
Thèmes :
couple
, antiquitéCréer un quiz sur cet auteur44 lecteurs ont répondu