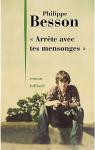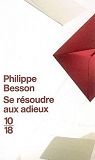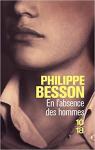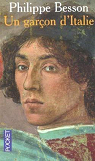Nationalité : France
Né(e) à : Barbezieux-Saint-Hilaire , le 29/01/1967
Né(e) à : Barbezieux-Saint-Hilaire , le 29/01/1967
Biographie :
Philippe Besson est auteur, dramaturge et scénariste français. Il a été également critique littéraire et animateur de télévision.
Il est diplômé de l'École supérieure de commerce de Rouen et titulaire d'un DESS de droit. En 1989, il s'installe à Paris où il exerce une profession de juriste et enseigne le droit social. Pendant près de 6 ans, il sera le bras droit de Laurence Parisot, en tant que DRH puis secrétaire-général de l'Institut français d'opinion publique. Par la suite, il sera DRH de T-Online France - Club Internet.
En 1999, il publie "En l'absence des hommes", récompensé par le prix Emmanuel-Roblès. En 2001, il publie "Son frère" qui sera retenu pour la sélection du Prix Femina. L'adaptation cinématographique avec Bruno Todeschini et Eric Caravaca dans les rôles principaux qu'en fera Patrice Chéreau en 2003, recevra l'Ours d'argent au festival de Berlin.
"L'Arrière-saison", roman publié en 2002, est récompensé par le Grand Prix RTL-Lire 2003, année où paraît "Un garçon d'Italie" qui se voit sélectionné pour les Prix Goncourt et Médicis.
Édité en 2004, son cinquième roman, "Les Jours fragiles" (centré sur les derniers jours d'Arthur Rimbaud), retient l'attention du cinéaste François Dupeyron. En 2006, "L' Enfant d'octobre" suscite une polémique dès sa sortie. Ce roman raconte l'affaire Grégory sous une forme romancée, alors que les différents acteurs de ce drame sont encore vivants.
Changement de registre en 2007 avec le très mélancolique "Se résoudre aux adieux". En 2009, il publie "Un homme accidentel", dont l'intrigue se déroule à Beverly Hills et il participe avec d'autres auteurs à "Huit", un recueil de nouvelles sur les objectifs pour le développement. La même année, il s'intéresse encore une fois aux États-Unis dans "La trahison de Thomas Spencer", qui raconte la vie de deux amis nés le même jour.
En 2011, il soutient l'action de l'association Isota qui milite pour le mariage et l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Il réalise en 2014 le documentaire "Homos, la haine" sur France 2. "Vivre vite", consacré à James Dean, paraît en janvier 2015, année anniversaire de sa mort.
Il relate sa première histoire d'amour alors qu'il était adolescent dans son roman, "Arrête avec tes mensonges" (2017), qui devient une trilogie. Le roman est adapté au cinéma, réalisé en 2023 par Olivier Peyon et interprété par Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo.
+ Voir plusPhilippe Besson est auteur, dramaturge et scénariste français. Il a été également critique littéraire et animateur de télévision.
Il est diplômé de l'École supérieure de commerce de Rouen et titulaire d'un DESS de droit. En 1989, il s'installe à Paris où il exerce une profession de juriste et enseigne le droit social. Pendant près de 6 ans, il sera le bras droit de Laurence Parisot, en tant que DRH puis secrétaire-général de l'Institut français d'opinion publique. Par la suite, il sera DRH de T-Online France - Club Internet.
En 1999, il publie "En l'absence des hommes", récompensé par le prix Emmanuel-Roblès. En 2001, il publie "Son frère" qui sera retenu pour la sélection du Prix Femina. L'adaptation cinématographique avec Bruno Todeschini et Eric Caravaca dans les rôles principaux qu'en fera Patrice Chéreau en 2003, recevra l'Ours d'argent au festival de Berlin.
"L'Arrière-saison", roman publié en 2002, est récompensé par le Grand Prix RTL-Lire 2003, année où paraît "Un garçon d'Italie" qui se voit sélectionné pour les Prix Goncourt et Médicis.
Édité en 2004, son cinquième roman, "Les Jours fragiles" (centré sur les derniers jours d'Arthur Rimbaud), retient l'attention du cinéaste François Dupeyron. En 2006, "L' Enfant d'octobre" suscite une polémique dès sa sortie. Ce roman raconte l'affaire Grégory sous une forme romancée, alors que les différents acteurs de ce drame sont encore vivants.
Changement de registre en 2007 avec le très mélancolique "Se résoudre aux adieux". En 2009, il publie "Un homme accidentel", dont l'intrigue se déroule à Beverly Hills et il participe avec d'autres auteurs à "Huit", un recueil de nouvelles sur les objectifs pour le développement. La même année, il s'intéresse encore une fois aux États-Unis dans "La trahison de Thomas Spencer", qui raconte la vie de deux amis nés le même jour.
En 2011, il soutient l'action de l'association Isota qui milite pour le mariage et l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Il réalise en 2014 le documentaire "Homos, la haine" sur France 2. "Vivre vite", consacré à James Dean, paraît en janvier 2015, année anniversaire de sa mort.
Il relate sa première histoire d'amour alors qu'il était adolescent dans son roman, "Arrête avec tes mensonges" (2017), qui devient une trilogie. Le roman est adapté au cinéma, réalisé en 2023 par Olivier Peyon et interprété par Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Besson
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (135)
Voir plusAjouter une vidéo
Podcasts (3)
Voir tous
Citations et extraits (3422)
Voir plus
Ajouter une citation
Ça fait mal d'apprendre à quitter ceux qui nous quittent, d'apprendre à les aimer en silence, le dos tourné, les yeux baissés. De devoir apprendre à son coeur la force de se vider tout en demeurant habité. Apprendre à pleurer en souriant, à s'en aller en aimant . . .
Avez-vous remarqué comme les paysages les plus beaux perdent leur éclat dès que nos pensées nous empêchent de les regarder comme il faudrait ?
Je t'écris parce que t'écrire, c'est être avec toi.
[Incipit.]
Clément,
J'ai décidé de t'écrire, plutôt que rien.
Plutôt que rester là, comme ça, dans le silence.
Que je te dise : je me suis honnêtement, sérieusement essayée au silence, je l'ai endossé comme on se glisse dans un vêtement, je m'y suis livrée comme on accepte une astreinte. Je l'ai fait d'abord pour moi, ne t'y trompe pas, c'était un choix égoïste, même s'il m'a coûté. En fait, j'ai pensé que cela me sauverait. Mais le rien-dire ne sauve pas, enfin disons que, moi, il ne m'a pas sauvée. Je crois même qu'il m'a enfoncée un peu plus dans la tristesse, le chagrin. Pour être tout à fait honnête, il m'a dévastée parce qu'il est peuplé d'images, le silence, de souvenirs impossibles à chasser, telles ces mouches importunes qui tournent autour du visage, qu'on tente d'éloigner avec de grands mouvements des bras, et qui toujours reviennent. Et puis, dans le silence, on est sans défense : les assauts n'en sont que plus blessants.
Alors maintenant, j'essaie les mots, ça ne pourra pas être pire. Qui sait si, en parlant, je ne vais pas me délester de la douleur entassée ? Un peu.
Pourquoi t'écrire à toi, me diras-tu ? Mais parce que des paroles sans destinataire ne sont pas vraiment des paroles. Sans écho, elles se perdent. C'est comme si elles n'avaient jamais existé. C'est écrire au vent, au désert, à l'abîme. Si personne ne m'écoute, autant continuer à me taire. Quelqu'un doit m'écouter. Et qui mieux que toi ?
Oui, qui mieux que toi ?
Je vais t'appeler par ton prénom.
Clément.
Je ne peux plus dire : «mon amour», ou des choses approchantes, toutes ces expressions niaises qu'on emploie sans en percevoir le ridicule et qu'on répète à l'envi au point de leur ôter leur signification. Tu serais embarrassé si je disais : «mon amour», de toute façon. Tu prétendrais que je ne suis pas guérie.
Un aveu : je ne suis pas guérie. Mais les malades doivent avoir l'élégance de ne pas indisposer les bien-portants, on leur sait gré de dissimuler leur mal.
Clément,
J'ai décidé de t'écrire, plutôt que rien.
Plutôt que rester là, comme ça, dans le silence.
Que je te dise : je me suis honnêtement, sérieusement essayée au silence, je l'ai endossé comme on se glisse dans un vêtement, je m'y suis livrée comme on accepte une astreinte. Je l'ai fait d'abord pour moi, ne t'y trompe pas, c'était un choix égoïste, même s'il m'a coûté. En fait, j'ai pensé que cela me sauverait. Mais le rien-dire ne sauve pas, enfin disons que, moi, il ne m'a pas sauvée. Je crois même qu'il m'a enfoncée un peu plus dans la tristesse, le chagrin. Pour être tout à fait honnête, il m'a dévastée parce qu'il est peuplé d'images, le silence, de souvenirs impossibles à chasser, telles ces mouches importunes qui tournent autour du visage, qu'on tente d'éloigner avec de grands mouvements des bras, et qui toujours reviennent. Et puis, dans le silence, on est sans défense : les assauts n'en sont que plus blessants.
Alors maintenant, j'essaie les mots, ça ne pourra pas être pire. Qui sait si, en parlant, je ne vais pas me délester de la douleur entassée ? Un peu.
Pourquoi t'écrire à toi, me diras-tu ? Mais parce que des paroles sans destinataire ne sont pas vraiment des paroles. Sans écho, elles se perdent. C'est comme si elles n'avaient jamais existé. C'est écrire au vent, au désert, à l'abîme. Si personne ne m'écoute, autant continuer à me taire. Quelqu'un doit m'écouter. Et qui mieux que toi ?
Oui, qui mieux que toi ?
Je vais t'appeler par ton prénom.
Clément.
Je ne peux plus dire : «mon amour», ou des choses approchantes, toutes ces expressions niaises qu'on emploie sans en percevoir le ridicule et qu'on répète à l'envi au point de leur ôter leur signification. Tu serais embarrassé si je disais : «mon amour», de toute façon. Tu prétendrais que je ne suis pas guérie.
Un aveu : je ne suis pas guérie. Mais les malades doivent avoir l'élégance de ne pas indisposer les bien-portants, on leur sait gré de dissimuler leur mal.
Je crois qu'on survit à tout. Je crois que la vie est plus forte. Je crois que le temps est assassin et balaye les visages du passé en emportant avec lui les épreuves qu'on pensait ne pas pouvoir surmonter.
Mais aimer, ce n'est pas s'installer une fois pour toutes au sommet de ses certitudes. C'est douter toujours, trembler toujours. Et puis, demeurer vigilant pour éviter que le poison mortel de l'habitude ne s'insinve et nous tue, ou pire : nous anésthésie. Ne pas croire que plus rien ne reste à faire mais au contraire séduire, séduire encore.
Aimer, ce n'est pas gagner à tous les coups. C'est prendre des risques, faire des partis incertains, connaitre la frayeur de perdre sa mise pour mieux savourer le frisson de la douleur.
Aimer, ce n'est pas emprunter des routes toutes tracées et balises. C'est avancer en funambule au-dessus de précipices et savoir qu'il y a quelqu'un au bout qui dit d'une voix douce et calme : avance, continue d'avancer, n'aie pas peur, tu vas y arriver, je suis là.
Aimer, ce n'est pas gagner à tous les coups. C'est prendre des risques, faire des partis incertains, connaitre la frayeur de perdre sa mise pour mieux savourer le frisson de la douleur.
Aimer, ce n'est pas emprunter des routes toutes tracées et balises. C'est avancer en funambule au-dessus de précipices et savoir qu'il y a quelqu'un au bout qui dit d'une voix douce et calme : avance, continue d'avancer, n'aie pas peur, tu vas y arriver, je suis là.
C'est à ce moment-là qu'on s'est perdus de vue, lui et moi. J'articule ces derniers mots sans y mettre le moindre affect, comme si la vie, c'était ça, simplement ça, se fréquenter et se perdre de vue et continuer à vivre, comme s'il n'y avait pas des déchirements, des séparations qui laissent exsangues, des ruptures dont on peine à se remettre, des regrets qui vous poursuivent longtemps après.
Les pires douleurs sont celles qu'on s'inflige.
Les deux garçons sur ce cliché ancien, c'est Paul et moi.
Je reconnais ses cheveux bruns, ses lourdes boucles brunes qui s'envolent avec le vent, et son regard sombre, ses joues creusées, la peau claire, immaculée. Il baisse un peu la tête, il a les mains enfoncées dans les poches d'un caban de marin. Moi, je suis plus petit que lui, la différence de taille se voit. Les verres de mes lunettes sont embués à cause de la pluie. En arrière-plan, le clocher d'une église, un clocher distinctif, un cône noir surmontant un édifice blanc, celui d'Ars-en-Ré. Je présume que c'était cela, l'effet recherché, montrer que nous nous trouvions à Ars, et faire que la singularité du lieu apparaisse.
Paul a vingt-quatre ans, moi vingt et un.
Pages 11-12, Julliard, 2019.
Je reconnais ses cheveux bruns, ses lourdes boucles brunes qui s'envolent avec le vent, et son regard sombre, ses joues creusées, la peau claire, immaculée. Il baisse un peu la tête, il a les mains enfoncées dans les poches d'un caban de marin. Moi, je suis plus petit que lui, la différence de taille se voit. Les verres de mes lunettes sont embués à cause de la pluie. En arrière-plan, le clocher d'une église, un clocher distinctif, un cône noir surmontant un édifice blanc, celui d'Ars-en-Ré. Je présume que c'était cela, l'effet recherché, montrer que nous nous trouvions à Ars, et faire que la singularité du lieu apparaisse.
Paul a vingt-quatre ans, moi vingt et un.
Pages 11-12, Julliard, 2019.
Et il faut rentrer. Puisqu'il faut toujours rentrer. Puisque toujours les étés se terminent. Et chaque fois, c'est une sensation déchirante. Quand j'étais enfant, le signal, c'était la mort des tournesols, le moment où leur tête jaune virait au noir et s'inclinait vers la terre sèche, je comprenais que la rentrée des classes appro chait, que c'en était fini du soleil et du désœuvrement, ça me plongeait dans des abîmes de mélancolie. J'ai écrit souvent, après, sur les arrière-saisons, sur la disparition de l'été ; ça vient de là.
Page 28, Julliard, 2019.
Page 28, Julliard, 2019.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Les romans les mieux notés
heros_pitch
195 livres

Les fins qui tuent
iris29
127 livres
Auteurs proches de Philippe Besson
Lecteurs de Philippe Besson Voir plus
Quiz
Voir plus
Philippe BESSON
Quel est son tout premier roman ?
Un instant d'abandon
Se résoudre aux adieux
Un homme accidentel
En l'absence des hommes
12 questions
146 lecteurs ont répondu
Thème :
Philippe BessonCréer un quiz sur cet auteur146 lecteurs ont répondu