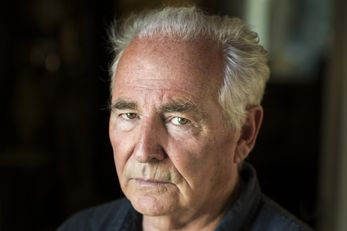Citations de Régis Franc (36)
(Les premières pages du livre)
C’est arrivé d’un seul coup. Comme une apparition. Il se peut que, sidéré, je me sois exclamé à voix haute : « Oh mon Dieu… » J’eus l’impression de traverser le miroir. Oui, il était là, dans le reflet de l’imposante vitrine du magasin vers lequel je me hâtais comme tous, au passage piéton, dans la foule de Brompton Road. Il venait, j’allais vers lui. Un léger effroi m’a saisi. « Eh bien, nous y sommes », ai-je murmuré. Car ce mirage dans la vitrine, cet homme engoncé dans mon pardessus, mon cher vieux manteau usé de Muji, fabricant japonais, n’était plus moi. Ou l’idée que j’avais de moi, je veux dire ce type qui habitait mon corps et que, vaille que vaille, toujours un peu agacé, je m’étais, avec le temps, habitué à côtoyer. Désormais je marcherais, je le voyais bien, de ce pas chaloupé. Mains calées au fond des poches. Regardant sans rien voir, confit dans une sorte de méditation hasardeuse puisque ainsi il chemina tout au long de sa vie. À mon tour, j’irais de ce pas. Un pas dansant. Même taille, même tête, j’étais devenu lui. Lui, « Bataillé »… Je n’ai pas trouvé là une nouvelle qui puisse me réjouir. Jamais, oh je le jure, je n’ai voulu ressembler à mon père. Si bien que, face au miroir, pris dans le flux des Londoners, je me suis rappelé ce commentaire trouvé je ne sais où à propos de tribus primitives, de leurs rituels. Pourquoi enterraient-elles leurs morts sous un tas de pierres ? La réponse m’avait fait sourire : Pour qu’ils ne se relèvent pas. Mort en paix, et depuis enfoui sous la terre, mon père relevé était là, il habiterait désormais mon manteau. Bon. Il me faudrait faire avec…
Tout alla de travers durant le mois de décembre. Depuis l’automne son corps avait commencé à l’abandonner et si sa tête, sa volonté restaient intactes, ses jambes maintenant refusaient de le porter. Il était épuisé. Il tombait. Il avait honte, il se sentait humilié. La dignité lui commandait de rester debout. Un genou à terre, il s’excusait, grommelait que ça n’était rien, interdisait qu’on l’aide, se redressait tant bien que mal. Exigeant d’une voix qui ne supportait pas de réplique qu’on lui foute la paix. « Il n’y a rien à voir », disait-il, tamponnant son visage en sang avec un torchon trouvé là, et son médecin accouru me rapportait qu’il était furieux.
À son arrivée au « chenil » – il appela ainsi la maison de retraite où il avait choisi de terminer sa longue course –, il ne s’émut pas. Sans se retourner, il venait de quitter sa chère maison, sa vie d’avant, toute sa vie, emportant dans un sac plastique à 20 centimes, spécialité de Carrefour, un de ces pauvres pyjamas rayés dont les vieillards ont si souvent le goût. Il avait ajouté quelques chemises repassées.
« Au cas où le soir, il y aurait dancing », précisa-t-il.
J’ai toujours aimé chez lui cette fausse tranquillité. Son humour. Ceci par exemple :
« Bon, puisque me voilà dans un nouveau quadrille parfumé à la soupe aux choux, n’y aurait-il pas ici quelque raison de se réjouir ? Salue-t-on ceux qui sortent les pieds devant par des salves d’applaudissements, une haie d’honneur ? Il faudra y penser… Nous créerons le comité Adieu à la Vie. »
Afin qu’il se sente un peu à la maison dans cette chambre si commune, où, avant lui, étaient venus s’éteindre d’autres de son âge, j’avais couvert les murs de photos, témoignages de ce qu’il avait été. On l’y voyait jeune et « vaillant ». Joyeux. Vivant.
Ainsi s’écoula cette année où il vécut au « chenil », s’asseyant le soir au réfectoire pour manger la purée de pois cassés sans sel parmi ses nouveaux camarades, arrivés pour la plupart sans bien savoir comment, eux que leurs familles n’avaient pas pris la peine de secourir au seuil de la pause éternelle et qui recréaient ici, vaille que vaille, une sorte de société. Un pittoresque club de cabossés. De sourds. De béquillards. Mme Lucette Fabre-Petit ne quittait pas sa chambre sans ses boucles d’oreilles en plaqué or 18 carats, serties de brillants. Patiente, Lucette la dorée attendait un silence pour entamer un épisode glorieux, déjà dix fois répété, de sa vie mignonnette « quand elle habitait Toulon ». À sa droite, M. Martinelli Gregorio, « son fiancé », ancien garde-chasse. Et aussi Mme Bonnet, considérablement tordue, abîmée, tremblante, montrait un petit museau où se devinait une réelle bonté, un vrai grand cœur, une âme claire, paisible. Tous, doux, perdus, déjà éloignés du monde, gardant un bon sourire. Dans cette ménagerie sans barreaux vécut mon père. Un an où, parmi tous ceux-là, il peaufina sa légende.
Quand vint l’automne, il était pensionnaire depuis janvier, glissant sans illusions vers l’ombre, curieux, il ne quittait presque plus son lit, souffle court, protégeant son front d’une main tachée de fleurs de cimetière et moi, maladroit venu le visiter, je baissais la tête, perclus de culpabilité. Il voyait que je voyais tout ça, « la tôle rouillée, usée », haussait les épaules et me lançait, ironique :
« Pas mal, non ? »
J’avais le cœur serré. Il m’arrivait de m’éloigner de sa chambre pour me réfugier dans le couloir, incapable de supporter longtemps la vue d’un vieil homme à la peine.
J’aurais dû être doux et compatissant, je restais sans voix, sans chaleur, incapable de trouver le bon tempo. Submergé par de lourdes envies de fuite, je résistais, adossé au mur de la loggia où trottaient les employées poussant des fauteuils dans lesquels gémissaient de pauvres choses accablées. Je tâchais de faire bonne figure face aux autres grands vieillards passant par là, des au-bout-du-rouleau, des ex-êtres humains qui nous connaissaient depuis toujours et se fendaient d’un sourire édenté en me parlant naturellement dans la langue d’oc, celle d’ici :
« Eh bien ? Ton père ? Comment va-t-il aujourd’hui ? Ne t’en fais pas. Il s’en sortira, vaï. On le connaît. C’est un Bataillé, non ? Un combattant. »
Le soir venu, je quittais sa chambre avec l’impression d’avoir accompli un devoir majeur comme un minable. Et j’allais de l’autre côté de la ville pour dormir dans sa maison, cet ancien rêve parfait de sa femme. Ma mère. Maison d’ouvrier qu’il avait, pour elle, bâtie de ses mains. Et qui n’avait pas bougé. Dessinée dans l’esprit des années 1960, telle que de malins architectes l’avaient inventée quand les Français sortant des troubles du siècle avaient découvert la modernité, salle de bains et frigo compris. Des « villas » (on les appela ainsi) avec pierres taillées apparentes sur la façade, rampes en fer forgé et de larges ouvertures pour rôtir au soleil, contresens d’experts du Nord à l’usage des gens du Sud. Maison où jamais, hélas, hélas, hélas, ma mère qui en avait tant rêvé n’était entrée, malgré les efforts que lui, le maçon, avait déployés, travaillant quinze heures par jour afin de finir ce palais dédié à celle qu’il aimait de tout son cœur. Et morte une semaine avant la fin des travaux, à 39 ans, comme c’est triste. À quelques jours près, ça aurait pu aller, oh, quelques jours, ça n’était pas grand-chose.
Mais non.
Ma mère s’éteignit le 24 juillet 1960, on l’enterra le 27, la maison fut terminée le 1er août et nous déménageâmes. Ce contretemps signa nos vies. Voilà comment nous entrâmes épuisés et vaincus dans une maison moderne, si moderne et si désirée par elle. Sans elle. Ni mon père, ni ma petite sœur, ni moi-même ne devions nous en remettre. Nous apprîmes alors la mélancolie, sentiment si inapproprié au caractère des gens du peuple. On note ça sur les photos. Si tous les trois nous affichons un demi-sourire, c’est que la joie s’était pour moitié glissée dans la tombe : elle ne remonterait plus. Il se pourrait qu’ici, je finisse par ce court récit un si long deuil.
Mon père, Roger Alphonse Franc, était maçon. Il avait les mains courtes, dures. Et militant, il avait le verbe haut, ne laissait personne parler à sa place. Et poète, il écrivait des vers interminables dans la langue du Sud, cette merveille oubliée qui m’embrumera toujours les yeux.
Des poèmes de félibre à la gloire du Languedoc. Des hymnes à la fraternité ouvrière. Il aimait Marcel Pagnol d’Aubagne, la Catinou du Grenier de Toulouse, Charles Trenet de Narbonne, notre capitale, Gruissan Plage au bord de la mer, ses chalets sur pilotis, Lézignan-Corbières, sa « ville » de 3 500 habitants et, comme tous ceux de son âge, il connaissait et respectait Victor Hugo, le grand Français. Mon père lisait, il écrivait. Les femmes assuraient qu’il avait une belle voix, il chantait « du Tino ». Quand il plâtrait une pièce vide, il chantait « … et je vous dis que je vous aime, mon amour… ». Dans la pièce à côté, le carreleur aussi chantait. Et plus loin, le plombier chantait. L’électricien ne chantait pas, impossible pour lui qui avait toujours une vis dans le bec et des doigts trop gros pour de si petits écrous.
Là était le charme de la classe ouvrière.
Celle aperçue dans Jean Renoir, Duvivier ou Grémillon. Carné, bien sûr. Tous ceux-là, « la belle équipe », étaient « rouges ». Ils n’en faisaient pas une histoire. Ils lisaient en diagonale L’Humanité, un point c’est tout. Demande-t-on aux gens des beaux quartiers de qualifier leur allure, de justifier leurs souliers vernis ? Qui oserait ? Ces rouges-là étaient frères, ils avaient « fait la jeunesse » ensemble, connu des grappes de filles au bal, à la rivière, des qui gloussaient déjà en les voyant venir. Des filles d’ici, sœurs, voisines, cousines en pique-nique, assises sur le bord de la nappe blanche, des filles qui leur criaient :
« Eh, dis donc ! Elle te plaît ma cousine ? Attention là ! Tiens-toi donc tranquille ! Je t’ai repéré, tu es un rouge !
— Eh bé, c’est-à-dire que…
— Vas-y ! Tu la fais danser, tu as le béguin, ne mens pas, tié tout rouge le rouge… »
On avait bu du panaché, de la grenadine, du Picon, les couples s’étaient trouvés. Comme la guerre avait brisé le cours des choses, on avait attendu en faisant pénitence et puis, la guerre finie, on avait rattrapé le temps. On eut des enfants. L
C’est arrivé d’un seul coup. Comme une apparition. Il se peut que, sidéré, je me sois exclamé à voix haute : « Oh mon Dieu… » J’eus l’impression de traverser le miroir. Oui, il était là, dans le reflet de l’imposante vitrine du magasin vers lequel je me hâtais comme tous, au passage piéton, dans la foule de Brompton Road. Il venait, j’allais vers lui. Un léger effroi m’a saisi. « Eh bien, nous y sommes », ai-je murmuré. Car ce mirage dans la vitrine, cet homme engoncé dans mon pardessus, mon cher vieux manteau usé de Muji, fabricant japonais, n’était plus moi. Ou l’idée que j’avais de moi, je veux dire ce type qui habitait mon corps et que, vaille que vaille, toujours un peu agacé, je m’étais, avec le temps, habitué à côtoyer. Désormais je marcherais, je le voyais bien, de ce pas chaloupé. Mains calées au fond des poches. Regardant sans rien voir, confit dans une sorte de méditation hasardeuse puisque ainsi il chemina tout au long de sa vie. À mon tour, j’irais de ce pas. Un pas dansant. Même taille, même tête, j’étais devenu lui. Lui, « Bataillé »… Je n’ai pas trouvé là une nouvelle qui puisse me réjouir. Jamais, oh je le jure, je n’ai voulu ressembler à mon père. Si bien que, face au miroir, pris dans le flux des Londoners, je me suis rappelé ce commentaire trouvé je ne sais où à propos de tribus primitives, de leurs rituels. Pourquoi enterraient-elles leurs morts sous un tas de pierres ? La réponse m’avait fait sourire : Pour qu’ils ne se relèvent pas. Mort en paix, et depuis enfoui sous la terre, mon père relevé était là, il habiterait désormais mon manteau. Bon. Il me faudrait faire avec…
Tout alla de travers durant le mois de décembre. Depuis l’automne son corps avait commencé à l’abandonner et si sa tête, sa volonté restaient intactes, ses jambes maintenant refusaient de le porter. Il était épuisé. Il tombait. Il avait honte, il se sentait humilié. La dignité lui commandait de rester debout. Un genou à terre, il s’excusait, grommelait que ça n’était rien, interdisait qu’on l’aide, se redressait tant bien que mal. Exigeant d’une voix qui ne supportait pas de réplique qu’on lui foute la paix. « Il n’y a rien à voir », disait-il, tamponnant son visage en sang avec un torchon trouvé là, et son médecin accouru me rapportait qu’il était furieux.
À son arrivée au « chenil » – il appela ainsi la maison de retraite où il avait choisi de terminer sa longue course –, il ne s’émut pas. Sans se retourner, il venait de quitter sa chère maison, sa vie d’avant, toute sa vie, emportant dans un sac plastique à 20 centimes, spécialité de Carrefour, un de ces pauvres pyjamas rayés dont les vieillards ont si souvent le goût. Il avait ajouté quelques chemises repassées.
« Au cas où le soir, il y aurait dancing », précisa-t-il.
J’ai toujours aimé chez lui cette fausse tranquillité. Son humour. Ceci par exemple :
« Bon, puisque me voilà dans un nouveau quadrille parfumé à la soupe aux choux, n’y aurait-il pas ici quelque raison de se réjouir ? Salue-t-on ceux qui sortent les pieds devant par des salves d’applaudissements, une haie d’honneur ? Il faudra y penser… Nous créerons le comité Adieu à la Vie. »
Afin qu’il se sente un peu à la maison dans cette chambre si commune, où, avant lui, étaient venus s’éteindre d’autres de son âge, j’avais couvert les murs de photos, témoignages de ce qu’il avait été. On l’y voyait jeune et « vaillant ». Joyeux. Vivant.
Ainsi s’écoula cette année où il vécut au « chenil », s’asseyant le soir au réfectoire pour manger la purée de pois cassés sans sel parmi ses nouveaux camarades, arrivés pour la plupart sans bien savoir comment, eux que leurs familles n’avaient pas pris la peine de secourir au seuil de la pause éternelle et qui recréaient ici, vaille que vaille, une sorte de société. Un pittoresque club de cabossés. De sourds. De béquillards. Mme Lucette Fabre-Petit ne quittait pas sa chambre sans ses boucles d’oreilles en plaqué or 18 carats, serties de brillants. Patiente, Lucette la dorée attendait un silence pour entamer un épisode glorieux, déjà dix fois répété, de sa vie mignonnette « quand elle habitait Toulon ». À sa droite, M. Martinelli Gregorio, « son fiancé », ancien garde-chasse. Et aussi Mme Bonnet, considérablement tordue, abîmée, tremblante, montrait un petit museau où se devinait une réelle bonté, un vrai grand cœur, une âme claire, paisible. Tous, doux, perdus, déjà éloignés du monde, gardant un bon sourire. Dans cette ménagerie sans barreaux vécut mon père. Un an où, parmi tous ceux-là, il peaufina sa légende.
Quand vint l’automne, il était pensionnaire depuis janvier, glissant sans illusions vers l’ombre, curieux, il ne quittait presque plus son lit, souffle court, protégeant son front d’une main tachée de fleurs de cimetière et moi, maladroit venu le visiter, je baissais la tête, perclus de culpabilité. Il voyait que je voyais tout ça, « la tôle rouillée, usée », haussait les épaules et me lançait, ironique :
« Pas mal, non ? »
J’avais le cœur serré. Il m’arrivait de m’éloigner de sa chambre pour me réfugier dans le couloir, incapable de supporter longtemps la vue d’un vieil homme à la peine.
J’aurais dû être doux et compatissant, je restais sans voix, sans chaleur, incapable de trouver le bon tempo. Submergé par de lourdes envies de fuite, je résistais, adossé au mur de la loggia où trottaient les employées poussant des fauteuils dans lesquels gémissaient de pauvres choses accablées. Je tâchais de faire bonne figure face aux autres grands vieillards passant par là, des au-bout-du-rouleau, des ex-êtres humains qui nous connaissaient depuis toujours et se fendaient d’un sourire édenté en me parlant naturellement dans la langue d’oc, celle d’ici :
« Eh bien ? Ton père ? Comment va-t-il aujourd’hui ? Ne t’en fais pas. Il s’en sortira, vaï. On le connaît. C’est un Bataillé, non ? Un combattant. »
Le soir venu, je quittais sa chambre avec l’impression d’avoir accompli un devoir majeur comme un minable. Et j’allais de l’autre côté de la ville pour dormir dans sa maison, cet ancien rêve parfait de sa femme. Ma mère. Maison d’ouvrier qu’il avait, pour elle, bâtie de ses mains. Et qui n’avait pas bougé. Dessinée dans l’esprit des années 1960, telle que de malins architectes l’avaient inventée quand les Français sortant des troubles du siècle avaient découvert la modernité, salle de bains et frigo compris. Des « villas » (on les appela ainsi) avec pierres taillées apparentes sur la façade, rampes en fer forgé et de larges ouvertures pour rôtir au soleil, contresens d’experts du Nord à l’usage des gens du Sud. Maison où jamais, hélas, hélas, hélas, ma mère qui en avait tant rêvé n’était entrée, malgré les efforts que lui, le maçon, avait déployés, travaillant quinze heures par jour afin de finir ce palais dédié à celle qu’il aimait de tout son cœur. Et morte une semaine avant la fin des travaux, à 39 ans, comme c’est triste. À quelques jours près, ça aurait pu aller, oh, quelques jours, ça n’était pas grand-chose.
Mais non.
Ma mère s’éteignit le 24 juillet 1960, on l’enterra le 27, la maison fut terminée le 1er août et nous déménageâmes. Ce contretemps signa nos vies. Voilà comment nous entrâmes épuisés et vaincus dans une maison moderne, si moderne et si désirée par elle. Sans elle. Ni mon père, ni ma petite sœur, ni moi-même ne devions nous en remettre. Nous apprîmes alors la mélancolie, sentiment si inapproprié au caractère des gens du peuple. On note ça sur les photos. Si tous les trois nous affichons un demi-sourire, c’est que la joie s’était pour moitié glissée dans la tombe : elle ne remonterait plus. Il se pourrait qu’ici, je finisse par ce court récit un si long deuil.
Mon père, Roger Alphonse Franc, était maçon. Il avait les mains courtes, dures. Et militant, il avait le verbe haut, ne laissait personne parler à sa place. Et poète, il écrivait des vers interminables dans la langue du Sud, cette merveille oubliée qui m’embrumera toujours les yeux.
Des poèmes de félibre à la gloire du Languedoc. Des hymnes à la fraternité ouvrière. Il aimait Marcel Pagnol d’Aubagne, la Catinou du Grenier de Toulouse, Charles Trenet de Narbonne, notre capitale, Gruissan Plage au bord de la mer, ses chalets sur pilotis, Lézignan-Corbières, sa « ville » de 3 500 habitants et, comme tous ceux de son âge, il connaissait et respectait Victor Hugo, le grand Français. Mon père lisait, il écrivait. Les femmes assuraient qu’il avait une belle voix, il chantait « du Tino ». Quand il plâtrait une pièce vide, il chantait « … et je vous dis que je vous aime, mon amour… ». Dans la pièce à côté, le carreleur aussi chantait. Et plus loin, le plombier chantait. L’électricien ne chantait pas, impossible pour lui qui avait toujours une vis dans le bec et des doigts trop gros pour de si petits écrous.
Là était le charme de la classe ouvrière.
Celle aperçue dans Jean Renoir, Duvivier ou Grémillon. Carné, bien sûr. Tous ceux-là, « la belle équipe », étaient « rouges ». Ils n’en faisaient pas une histoire. Ils lisaient en diagonale L’Humanité, un point c’est tout. Demande-t-on aux gens des beaux quartiers de qualifier leur allure, de justifier leurs souliers vernis ? Qui oserait ? Ces rouges-là étaient frères, ils avaient « fait la jeunesse » ensemble, connu des grappes de filles au bal, à la rivière, des qui gloussaient déjà en les voyant venir. Des filles d’ici, sœurs, voisines, cousines en pique-nique, assises sur le bord de la nappe blanche, des filles qui leur criaient :
« Eh, dis donc ! Elle te plaît ma cousine ? Attention là ! Tiens-toi donc tranquille ! Je t’ai repéré, tu es un rouge !
— Eh bé, c’est-à-dire que…
— Vas-y ! Tu la fais danser, tu as le béguin, ne mens pas, tié tout rouge le rouge… »
On avait bu du panaché, de la grenadine, du Picon, les couples s’étaient trouvés. Comme la guerre avait brisé le cours des choses, on avait attendu en faisant pénitence et puis, la guerre finie, on avait rattrapé le temps. On eut des enfants. L
(Monologue de Jacques Chirac)
J'aurais jamais dû accepter d'être premier ministre !
Voilà,...la vérité c'est ça, voilà.
AUX PRESIDENTIELLES JE VAIS ETRE JUGE SUR MES CONNERIES !
ET LE GROS BARRE, LUI !! RIEN !
LUI IL VA NOUS FAIRE CROIRE QU'IL EST COMME L'AGNEAU QUI VIENT DE NAÎTRE !
Merde !
IL FAUT QUE JE ME DISSOCIE DE MON GOUVERNEMENT !!
C'est le seul moyen.
SEGUIN NOUS MET LA SECU AU TAPIS
Un.
CHALANDON SE DEBALLONNE SUR LE CODE DE LA NATIONALITE
Deux
BALLADUR NE VEUT PAS DEMENAGER A BERCY !!
Pas assez chic pour lui...
J'aurais jamais dû accepter d'être premier ministre !
Voilà,...la vérité c'est ça, voilà.
AUX PRESIDENTIELLES JE VAIS ETRE JUGE SUR MES CONNERIES !
ET LE GROS BARRE, LUI !! RIEN !
LUI IL VA NOUS FAIRE CROIRE QU'IL EST COMME L'AGNEAU QUI VIENT DE NAÎTRE !
Merde !
IL FAUT QUE JE ME DISSOCIE DE MON GOUVERNEMENT !!
C'est le seul moyen.
SEGUIN NOUS MET LA SECU AU TAPIS
Un.
CHALANDON SE DEBALLONNE SUR LE CODE DE LA NATIONALITE
Deux
BALLADUR NE VEUT PAS DEMENAGER A BERCY !!
Pas assez chic pour lui...
- Mmmm !... Vous sentez Maman ! Quelle bonne odeur de grillade... Ça vient de chez Monsieur Landru, chaque fois qu'il a une nouvelle amie, ils mangent des grillades... Quand je serai grande, je serai une bonne amie de Monsieur Landru moi aussi...
- Tais-toi, Louise. Mange ta soupe.
- Tais-toi, Louise. Mange ta soupe.
On enterrait un ouvrier dans la fraternité des pauvres.
C'était très classe.
Classe ouvrière, bien sûr.
C'était très classe.
Classe ouvrière, bien sûr.
A son arrivée au "chenil"-
il appela ainsi la maison de retraite
où il avait choisi de finir sa longue course,
il ne s'émut pas.
il appela ainsi la maison de retraite
où il avait choisi de finir sa longue course,
il ne s'émut pas.
Regis Franc signe là un beau récit familial, un livre sur la condition ouvrière , un texte sur le deuil et le manque.C’est un livre empli de sincérité, particulièrement touchant .
L’auteur a la nostalgie de cet « Éden ouvrier »des années 1950 où ses parents, sa sœur et lui vivaient modestement à Lézignan corbières mais vivaient ...
Le père c’est Roger Alphonse Franc, ouvrier maçon et militant, il écrit de longs poèmes en patois languedocien .D’ouvrier, il devient patron, il construit des maisons pour les autres et pour sa famille il bâtit « L’ensouleiado ».
La mère c’est Renee Angely. Roger et elle se marient en 1941.Elle décède d’un cancer à 39 ans , 6 jours avant d’emménager dans la maison neuve.Sa disparition plonge son fils et sa fille dans un profond abîme qui les habitera toute leur vie, la sœur cadette de l’auteur ne s’en remettra jamais .
L’auteur quant à lui trahit, il quitte le sud à 20 ans pour trouver sa voie dans le dessin.Comment le père et le fils vont-ils communiquer ?
L’auteur a la nostalgie de cet « Éden ouvrier »des années 1950 où ses parents, sa sœur et lui vivaient modestement à Lézignan corbières mais vivaient ...
Le père c’est Roger Alphonse Franc, ouvrier maçon et militant, il écrit de longs poèmes en patois languedocien .D’ouvrier, il devient patron, il construit des maisons pour les autres et pour sa famille il bâtit « L’ensouleiado ».
La mère c’est Renee Angely. Roger et elle se marient en 1941.Elle décède d’un cancer à 39 ans , 6 jours avant d’emménager dans la maison neuve.Sa disparition plonge son fils et sa fille dans un profond abîme qui les habitera toute leur vie, la sœur cadette de l’auteur ne s’en remettra jamais .
L’auteur quant à lui trahit, il quitte le sud à 20 ans pour trouver sa voie dans le dessin.Comment le père et le fils vont-ils communiquer ?
Les lieux n'ont pas d'âme. C'est nous qui leur en donnons.
Nous apprimes la mélancolie,
sentiment, si inapproprié
au caractère des gens du peuple.
sentiment, si inapproprié
au caractère des gens du peuple.
A vingt ans on fait comme tout le monde, convaincu de ne rien faire comme personne.
Je ne sais pas parler avec lui.
C’est ainsi.
Trop de silences ont sédimenté entre nous.
C’est ainsi.
Trop de silences ont sédimenté entre nous.
À quel moment s'éclipsent en douce nos vies, faites d'instants magiques, aventureux, où l'inattendu, l'émerveillement, l'effroi, le cœur qui bat nous bousculent ou nous débarquent à vive allure ? Serait-ce quand une photo abandonnée dans une boîte à chaussures indique, à la coupe d'un chandail trop porté, à la terrasse du café d'une ignoble banalité, aux sourires d'amis dont on a oublié le nom, que rien n'avance plus, que demain sera aussi bête qu'aujourd'hui, que c'est fini ? Vieillir.
-Il est tout seul le gros rat?
-Oui le gros rat était tout seul ,mais il comprit (reniflant sans se retourner le parfum trop lourd) qu'il n'allait plus longtemps rester ainsi.
-Oui le gros rat était tout seul ,mais il comprit (reniflant sans se retourner le parfum trop lourd) qu'il n'allait plus longtemps rester ainsi.
Ma vie a été bâtie sur trois choses : le travail, le travail, le travail...
Demandez à mes ouvriers !
Ils bossent...
Hin ! Hin !
Demandez à mes ouvriers !
Ils bossent...
Hin ! Hin !
London est plein de jolies filles des balkans à l'avenir incertain
On note ça sur les photos. Si tous les trois nous affichons
un demi-sourire, c’est que la joie s’était pour moitié glissée
dans la tombe : elle ne remonterait plus.
un demi-sourire, c’est que la joie s’était pour moitié glissée
dans la tombe : elle ne remonterait plus.
Affectueux ? Je ne l'avais été ni dans mon jeune âge, ni plus tard. Toujours, j'ai déçu les miens, comme c'est triste.
Mais quels espoirs bâtissent donc père et mère, scrutant les premiers pas de leurs enfants ? Qui sait reconnatre l'instant où nos destins, une fois venu ce « plus beau jour de la vie », basculent vers l'ombre, l'oubli.
Mais quels espoirs bâtissent donc père et mère, scrutant les premiers pas de leurs enfants ? Qui sait reconnatre l'instant où nos destins, une fois venu ce « plus beau jour de la vie », basculent vers l'ombre, l'oubli.
Va-t-en, glapissaient les enfants, on te veut pas. Tu es moche. Ton chapeau est nul. Un immense chagrin donc. Mais comme elle avait 11 ans, que l'on ne meurt pas de tristesse à 11 ans, elle avait survécu. Comment dire ? Elle s' était promis en ce jour affreux d'avoir, plus tard, une belle vie.
Grâce à ces garçons anglais, les adolescents devinrent « les jeunes ». Avant ça, les jeunes et vieux fraternisaient, réunis au café autour du saint pastis. La hiérarchie restait bon enfant. Jamais les jeunes bourrés ne manquaient de respect aux vieux ivrognes. Et puis, sous l’influence affreuse des Beatles ou pis encore, des Rolling Stones, les jeunes décrétèrent que l’alcool était une saloperie, qu’ils préféraient le haschisch. Le hippie déjanté apparut sous Sergeant Pepper. Une calamité, un tsunami dans un pays où de tout temps avait régné le dieu Pernot.
Incipit :
C’est arrivé d’un seul coup. Comme une apparition. Il se peut que, sidéré, je me sois exclamé à voix haute : « Oh mon Dieu… » J’eus l’impression de traverser le miroir. Oui, il était là, dans le reflet de l’imposante vitrine du magasin vers lequel je me hâtais comme tous, au passage piéton, dans la foule de Brompton Road. Il venait, j’allais vers lui. Un léger effroi m’a saisi. « Eh bien, nous y sommes », ai-je murmuré. Car ce mirage dans la vitrine, cet homme engoncé dans mon pardessus, mon cher vieux manteau usé de Muji, fabricant japonais, n’était plus moi. Ou l’idée que j’avais de moi, je veux dire ce type qui habitait mon corps et que, vaille que vaille, toujours un peu agacé, je m’étais, avec le temps, habitué à côtoyer. Désormais je marcherais, je le voyais bien, de ce pas chaloupé. Mains calées au fond des poches ? Regardant sans rien voir, confit dans une sorte de méditation hasardeuse puisque ainsi il chemina tout au long de sa vie. A mon tour, j’irai de ce pas. Un pas dansant. Même taille, même tête, j’étais devenu lui. Lui, « Bataillé »… Je n’ai pas trouvé là une nouvelle qui puisse me réjouir. Jamais, oh je le jure, je n’ai voulu ressembler à mon père. Si bien que, face au miroir, pris dans le flux des Londoners, je me suis rappelé ce commentaire trouvé je ne sais où à propos de tribus primitives, de leurs rituels. Pourquoi enterraient-elles leurs morts sous un tas de pierres ? La réponse m’avait fait sourire : Pour qu’ils ne se relève pas. Mort en paix, et depuis enfoui sous la terre, mon père relevé était là, il habiterait désormais mon manteau. Bon. Il me faudrait faire avec…
C’est arrivé d’un seul coup. Comme une apparition. Il se peut que, sidéré, je me sois exclamé à voix haute : « Oh mon Dieu… » J’eus l’impression de traverser le miroir. Oui, il était là, dans le reflet de l’imposante vitrine du magasin vers lequel je me hâtais comme tous, au passage piéton, dans la foule de Brompton Road. Il venait, j’allais vers lui. Un léger effroi m’a saisi. « Eh bien, nous y sommes », ai-je murmuré. Car ce mirage dans la vitrine, cet homme engoncé dans mon pardessus, mon cher vieux manteau usé de Muji, fabricant japonais, n’était plus moi. Ou l’idée que j’avais de moi, je veux dire ce type qui habitait mon corps et que, vaille que vaille, toujours un peu agacé, je m’étais, avec le temps, habitué à côtoyer. Désormais je marcherais, je le voyais bien, de ce pas chaloupé. Mains calées au fond des poches ? Regardant sans rien voir, confit dans une sorte de méditation hasardeuse puisque ainsi il chemina tout au long de sa vie. A mon tour, j’irai de ce pas. Un pas dansant. Même taille, même tête, j’étais devenu lui. Lui, « Bataillé »… Je n’ai pas trouvé là une nouvelle qui puisse me réjouir. Jamais, oh je le jure, je n’ai voulu ressembler à mon père. Si bien que, face au miroir, pris dans le flux des Londoners, je me suis rappelé ce commentaire trouvé je ne sais où à propos de tribus primitives, de leurs rituels. Pourquoi enterraient-elles leurs morts sous un tas de pierres ? La réponse m’avait fait sourire : Pour qu’ils ne se relève pas. Mort en paix, et depuis enfoui sous la terre, mon père relevé était là, il habiterait désormais mon manteau. Bon. Il me faudrait faire avec…
3 mois que je suis à son service et tous les soirs le même cirque:le film puis la pipe...le seul film qu'elle ait fait où elle apparaît plus d'une minute et demi ...et je sais toujours pas comment ça se termine...
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Régis Franc
Lecteurs de Régis Franc (158)Voir plus
Quiz
Voir plus
Quand les aliments portent des noms insolites ou pas...
Les cheveux d'ange se mangent-ils ?
Oui
Non
10 questions
184 lecteurs ont répondu
Thèmes :
nourriture
, fruits et légumes
, fromages
, manger
, bizarreCréer un quiz sur cet auteur184 lecteurs ont répondu