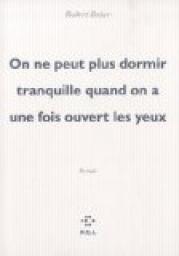Critiques de Robert Bober (74)
Ellis Island est un court texte de Georges Perec prévu à l’origine pour accompagner un film documentaire, réalisé en 1980 par Robert Bober, sur une idée originale de l’INA et diffusé par TF1 les 25 et 26 novembre de la même année. Les éditions du Sorbier et l’INA firent paraître ce texte (avec des photographies prises pendant le tournage). En 1994, les éditions P.O.L. rééditèrent cet opuscule en l’enrichissant de documents annexes. L’édition que j’ai choisie est la dernière édition, conçue par Madame Ela Bienenfeld, qui se concentre uniquement sur le texte de Perec pour en souligner la « confrontation avec le lieu même de la dispersion, de la clôture, de l’errance et de l’espoir ».
J’aime l’idée que les auteurs soient saisis, hantés par des lieux. C’est le cas de Marguerite Duras pour laquelle ma fascination m’a longuement occupé par le passé : unité et obsession du lieu, que ce soit dans un square, dans un terrain vague, un hôtel au bord de la mer… C’est aussi ce que j’aime chez Pierre Cendors : le lieu n’est pas seulement chargé de symboles ou d’histoires (ou d’Histoire avec une grande Hache comme le soulignait Perec dans W ou le souvenir d’enfance) censés ajouter des couches sémantiques, sensorielles, émotionnelles avec l’intrigue, non ! il fait corps avec le personnage ou le narrateur et entre en résonance avec le lecteur qui l’associe comme un personnage à part entière dans la narration qu’il perçoit.
Perec développe déjà cette vision du lieu dans La vie, mode d’emploi, dans lequel le lieu, le 11 rue Simon-Crubellier, est la matrice même de l’histoire. C’est à partir du lieu que se construit, tel un puzzle, la narration, selon une logique oulipienne définie à l’avance. Dans W ou le souvenir d’enfance, l’île W est le lieu où converge le récit. Tous ces lieux sont inexistants, ce sont des non-lieux, des lieux imaginaires, utopiques/dystopiques dans lesquels Perec puise ou dissémine une partie de sa mémoire, de son histoire ou perd son lecteur.
Avec Ellis Island Perec entreprend le chemin inverse : partir d’un lieu réel, d’un lieu documenté pour aller, finalement et peut-être sans véritablement le vouloir, vers le lieu imaginaire, intérieur, biographique.
Ellis Island, surnommée L’île des larmes, devint à partir de 1892 le point de passage obligé pour rentrer en Amérique. Perec décrit l’histoire de ce lieu qui met progressivement en place une gestion rationalisée des flux migratoires de masse.
« Seize millions d’immigrés passeront à Ellis Island, à raison de cinq à dix mille par jour. La plupart n’y séjourneront que quelques heures ; deux à trois pour cent seulement seront refoulés. En somme, Ellis Island ne sera rien d’autre qu’une usine à fabriquer des Américains. » p. 15
A partir de 1924, les conditions d’immigrations deviennent plus restrictives (2%) et Ellis Island devient « un centre de détention pour les émigrés en situation irrégulières » puis un musée à partir des années 70. Fidèle à sa manière quasi obsessionnelle de procéder, Georges Perec dresse des inventaires dans lesquelles se côtoient des listes interminables de chiffres (les migrants classés par pays d’origine, etc.) et de noms (ceux des bateaux qui acheminaient les immigrés, les ports d’où ils provenaient…).
«Cela ne veut rien dire, de vouloir
faire parler les images, de les
forcer à dire ce qu’elles ne
sauraient dire.
Au début, on ne peut qu’essayer
de nommer les choses, une
à une, platement,
les énumérer, les dénombrer,
de la manière la plus
banale possible,
de la manière la plus précise
possible,
en essayant de ne rien oublier. »
p. 43
Ce qui frappe Perec en découvrant le site, c’est le caractère résolument banal de ces lieux chargés d’histoires ; « rien ne ressemble plus à un lieu abandonné | qu’un autre lieu abandonné. ». Puis le discours se transforme peu à peu : de la simple description des lieux Perec en arrive à une question beaucoup plus subjective, à savoir pourquoi, lui, Perec, est venu dans cette île et pour y chercher quoi ? Pourquoi Robert Bober en a-t-il fait de même et quelles sont ses raisons ? Et quelles traces, ou quelle absence de traces viennent quotidiennement chercher tous ces touristes de la mémoire, en rangs serrés, à Ellis Island ?
Cette interrogation soudaine marque une rupture dans le documentaire : l’observateur devient l’observé dans le contexte du documentaire. Ce n’est plus tant un film sur Ellis Island qu’un film qui s’interroge sur la raison même de sa production. Cette irruption de l’observateur dans sa propre production a de quoi déstabiliser le zappeur du XXIe siècle dont je suis, trop accoutumé qu’il est aux besoins impérieux d’une objectivation journalistique devenue la norme télévisuelle actuelle. Cette norme qui veut que le reporter s’efface derrière la caméra pour y substituer le spectateur, pour superposer et fusionner les deux regards, pour son immersion, pour sa concentration sur l’objet exploré, et in fine pour obtenir sa totale adhésion au discours. Ce qui m’interpelle dans ce documentaire, c’est l’infinie poésie de la monstration qui cache et dévoile, dans le même élan, son aporie originelle, les limites de sa surface physique auxquelles ne peut s’ajouter les dimensions historiques, émotionnelles, subjectives…
— Tu n’as rien vu à Ellis Island semble répéter Georges Perec.
« …ce que moi, Georges Perec, je suis venu questionner ici, c’est l’errance, la dispersion, la diaspora.
Ellis Island est pour moi le lieu même de l’exil,
c’est-à-dire
le lieu de l’absence de lieu, le non-lieu, le nulle part.
C’est en ce sens que ces images me concernent, me fascinent, m’impliquent,
comme si la recherche de mon identité
passait par l’appropriation de ce lieu-dépotoir
où des fonctionnaires harassés baptisaient des
Américains à la pelle.
Ce qui pour moi se trouve ici
ce ne sont en rien des repères, des racines ou des traces,
mais le contraire : quelque chose d’informe, à la limite du dicible,
quelque chose que je peux nommer clôture, ou scission, ou coupure,
et qui est pour moi très intimement et très confusément lié au fait même d’être juif. »
pp. 57 – 58
Et l’erreur serait de penser que Perec, par une superposition photographique de lieux abandonnés, de lieux hantés par un traitement industriel de masses humaines, ait l’idée, la tentation de construire un parallèle entre Ellis Island et les camps de concentration. Ce n’est pas son propos. La plupart des gens passés par cet endroit l’ont fait pour fuir une situation — précaire, dangereuse, désespérée — et en trouver une autre, meilleure. C’est le lieu de cette métamorphose, de cette « scission » sociale, psychologique, linguistique qui fascine Perec. C’est ce maillon manquant de sa propre condition, lui qui ne connaît ni ses aïeuls, ni sa langue d’origine, qui ne partage aucun souvenir, aucun rite de ses ancêtres. « Quelque part, écrit-il, je suis étranger par rapport à quelque chose de moi-même ; quelque part, je suis “différent“, mais non pas différent des autres, différent des “miens“… »
Lien : http://www.labyrinthiques.fr..
J’aime l’idée que les auteurs soient saisis, hantés par des lieux. C’est le cas de Marguerite Duras pour laquelle ma fascination m’a longuement occupé par le passé : unité et obsession du lieu, que ce soit dans un square, dans un terrain vague, un hôtel au bord de la mer… C’est aussi ce que j’aime chez Pierre Cendors : le lieu n’est pas seulement chargé de symboles ou d’histoires (ou d’Histoire avec une grande Hache comme le soulignait Perec dans W ou le souvenir d’enfance) censés ajouter des couches sémantiques, sensorielles, émotionnelles avec l’intrigue, non ! il fait corps avec le personnage ou le narrateur et entre en résonance avec le lecteur qui l’associe comme un personnage à part entière dans la narration qu’il perçoit.
Perec développe déjà cette vision du lieu dans La vie, mode d’emploi, dans lequel le lieu, le 11 rue Simon-Crubellier, est la matrice même de l’histoire. C’est à partir du lieu que se construit, tel un puzzle, la narration, selon une logique oulipienne définie à l’avance. Dans W ou le souvenir d’enfance, l’île W est le lieu où converge le récit. Tous ces lieux sont inexistants, ce sont des non-lieux, des lieux imaginaires, utopiques/dystopiques dans lesquels Perec puise ou dissémine une partie de sa mémoire, de son histoire ou perd son lecteur.
Avec Ellis Island Perec entreprend le chemin inverse : partir d’un lieu réel, d’un lieu documenté pour aller, finalement et peut-être sans véritablement le vouloir, vers le lieu imaginaire, intérieur, biographique.
Ellis Island, surnommée L’île des larmes, devint à partir de 1892 le point de passage obligé pour rentrer en Amérique. Perec décrit l’histoire de ce lieu qui met progressivement en place une gestion rationalisée des flux migratoires de masse.
« Seize millions d’immigrés passeront à Ellis Island, à raison de cinq à dix mille par jour. La plupart n’y séjourneront que quelques heures ; deux à trois pour cent seulement seront refoulés. En somme, Ellis Island ne sera rien d’autre qu’une usine à fabriquer des Américains. » p. 15
A partir de 1924, les conditions d’immigrations deviennent plus restrictives (2%) et Ellis Island devient « un centre de détention pour les émigrés en situation irrégulières » puis un musée à partir des années 70. Fidèle à sa manière quasi obsessionnelle de procéder, Georges Perec dresse des inventaires dans lesquelles se côtoient des listes interminables de chiffres (les migrants classés par pays d’origine, etc.) et de noms (ceux des bateaux qui acheminaient les immigrés, les ports d’où ils provenaient…).
«Cela ne veut rien dire, de vouloir
faire parler les images, de les
forcer à dire ce qu’elles ne
sauraient dire.
Au début, on ne peut qu’essayer
de nommer les choses, une
à une, platement,
les énumérer, les dénombrer,
de la manière la plus
banale possible,
de la manière la plus précise
possible,
en essayant de ne rien oublier. »
p. 43
Ce qui frappe Perec en découvrant le site, c’est le caractère résolument banal de ces lieux chargés d’histoires ; « rien ne ressemble plus à un lieu abandonné | qu’un autre lieu abandonné. ». Puis le discours se transforme peu à peu : de la simple description des lieux Perec en arrive à une question beaucoup plus subjective, à savoir pourquoi, lui, Perec, est venu dans cette île et pour y chercher quoi ? Pourquoi Robert Bober en a-t-il fait de même et quelles sont ses raisons ? Et quelles traces, ou quelle absence de traces viennent quotidiennement chercher tous ces touristes de la mémoire, en rangs serrés, à Ellis Island ?
Cette interrogation soudaine marque une rupture dans le documentaire : l’observateur devient l’observé dans le contexte du documentaire. Ce n’est plus tant un film sur Ellis Island qu’un film qui s’interroge sur la raison même de sa production. Cette irruption de l’observateur dans sa propre production a de quoi déstabiliser le zappeur du XXIe siècle dont je suis, trop accoutumé qu’il est aux besoins impérieux d’une objectivation journalistique devenue la norme télévisuelle actuelle. Cette norme qui veut que le reporter s’efface derrière la caméra pour y substituer le spectateur, pour superposer et fusionner les deux regards, pour son immersion, pour sa concentration sur l’objet exploré, et in fine pour obtenir sa totale adhésion au discours. Ce qui m’interpelle dans ce documentaire, c’est l’infinie poésie de la monstration qui cache et dévoile, dans le même élan, son aporie originelle, les limites de sa surface physique auxquelles ne peut s’ajouter les dimensions historiques, émotionnelles, subjectives…
— Tu n’as rien vu à Ellis Island semble répéter Georges Perec.
« …ce que moi, Georges Perec, je suis venu questionner ici, c’est l’errance, la dispersion, la diaspora.
Ellis Island est pour moi le lieu même de l’exil,
c’est-à-dire
le lieu de l’absence de lieu, le non-lieu, le nulle part.
C’est en ce sens que ces images me concernent, me fascinent, m’impliquent,
comme si la recherche de mon identité
passait par l’appropriation de ce lieu-dépotoir
où des fonctionnaires harassés baptisaient des
Américains à la pelle.
Ce qui pour moi se trouve ici
ce ne sont en rien des repères, des racines ou des traces,
mais le contraire : quelque chose d’informe, à la limite du dicible,
quelque chose que je peux nommer clôture, ou scission, ou coupure,
et qui est pour moi très intimement et très confusément lié au fait même d’être juif. »
pp. 57 – 58
Et l’erreur serait de penser que Perec, par une superposition photographique de lieux abandonnés, de lieux hantés par un traitement industriel de masses humaines, ait l’idée, la tentation de construire un parallèle entre Ellis Island et les camps de concentration. Ce n’est pas son propos. La plupart des gens passés par cet endroit l’ont fait pour fuir une situation — précaire, dangereuse, désespérée — et en trouver une autre, meilleure. C’est le lieu de cette métamorphose, de cette « scission » sociale, psychologique, linguistique qui fascine Perec. C’est ce maillon manquant de sa propre condition, lui qui ne connaît ni ses aïeuls, ni sa langue d’origine, qui ne partage aucun souvenir, aucun rite de ses ancêtres. « Quelque part, écrit-il, je suis étranger par rapport à quelque chose de moi-même ; quelque part, je suis “différent“, mais non pas différent des autres, différent des “miens“… »
Lien : http://www.labyrinthiques.fr..
Je suis allée à Ellis Island, il y a vingt ans, dans un but bien précis. J'ai relaté cette visite dans la liste créée par Fanfanouche, je n'ai pas envie d'en reparler. Lorsque les immigrants ont transité par là, le bâtiment était un ancien fort militaire resté en l'état, sans électricité .... Aujourd'hui c'est un superbe "Musée de l'Immigration"... Difficile de s'imaginer ce que pouvaient ressentir ces pauvres gens en arrivant après tous les rêves qu'ils avaient en tête avant leur départ. Les trottoirs recouverts d'or !
Je me sens "toute, toute petite" pour écrire quoi que ce soit sur ce texte incroyable, après avoir lu, très émotionnée et admirative la chronique de PetiteBijou !!!
Je vais tenter toutefois... car je ressens le besoin et l'élan d'offrir ma reconnaissance et ma gratitude à Gaëlle Josse. Grâce à son texte « Le dernier gardien d’Ellis Island », qui m’a littéralement « tourneboulée »… j’ai éprouvé l’intense besoin d’aller plus loin , dans ce « non-lieu », et passage qui a transformé, amélioré , abîmé, transformé des millions de familles, qui ont abandonné leurs racines, pour TOUT reconstruire ailleurs, dans un autre pays.
A ma grande honte, Gaëlle Josse m’a mené au texte de Georges Perec (dont je ne connaissais pas même l’existence). je viens de l'achever; c'est un autre coup de poing. Lorsque nous nous plaignons de nos quotidiens, soucis, préoccupations diverses, De grâce !... songeons à toutes ces personnes, à nos « frères » de tous les pays , ayant tout perdu , tout laissé dans l’espoir d’une autre vie meilleure, pour eux et leurs enfants, sur une terre étrangère.
Le texte de Georges Perec, est d’autant plus percutant et dérangeant, qu’il écrit les dénuements extrêmes du déracinement, sans affect… de façon distante, et étrangement, pour ma part, cela prend une dimension universelle, d’autant plus cinglante et dérangeante…
Je me permets d’établir un bref rappel des circonstances de ce texte. En 1978, L’Institut National de l’Audiovisuel confia à Georges Perec et à Robert Bober, sur une idée de celui-ci, le soin de réaliser un film sur Ellis Island. Ceux-ci allèrent sur place, à New-York, une première fois procéder aux repérages, puis y retournèrent en 1979 effectuer le tournage de ce qui devait devenir « Récits d’Ellis Island, Histoires d’errance et d’espoir », film en deux parties : « L’ile des larmes » et « Mémoires », dont la première diffusion eut lieu sur TF les 25 et 26 novembre 1980.
La présente édition présente exclusivement le texte brut de Georges Perec, sans les interviews.
Georges Perec, parle d’Ellis Island, de tous les arrachements à sa terre ; mais aussi de ses propres racines, juives...
« Etre juif, pour lui (Robert Bober), c’est avoir reçu, pour le transmettre à son tour, tout un ensemble de coutumes, de manières de manger, de danser, de chanter, des mots, des goûts, des habitudes,
Et c’est surtout avoir le sentiment de partager ces geste et ces rites avec d’autres , au-delà des frontières et des nationalités, partager ces choses devenues racines, tout en sachant qu’elles sont en même temps fragiles et essentielles, menacées par le temps et par les hommes (…) (p.60)
Georges Perec, parle aussi des descendants de ces migrants, qui viennent à Ellis Island, chercher les éléments manquants de leur histoire , rassembler le « puzzle » des chemins courageux de leurs aïeux.
Ce texte est court mais d’une densité sans comparaison !
Il est un peu déplacé ou inutile de commenter, je préfère redonner la parole à l’auteur lui-même !
« Quelles sommes d’espoirs, d’attentes, de risques,
D’enthousiasmes, d’énergies étaient ici rassemblées
Ne pas dire seulement : seize millions d’émigrants
Sont passés en trente ans par Ellis Island
Mais tenter de se représenter
Ce que furent ces seize millions d’histoires individuelles,
Ces seize millions d’histoires identiques et différentes
De ces hommes, de ces femmes et de ces enfants chassés
De leur terre natale par la famine ou la misère,
L’oppression politique, raciale ou religieuse,
Et quittant tout, leur village, leur famille, leurs
Amis, mettant des mois et des années à rassembler
L’argent nécessaire au voyage (…)
Il ne s’agit pas de s’apitoyer mais de comprendre
quatre émigrants sur cinq n’ont passé sur Ellis
Island que quelques heures
Ce n’était, tout compte fait, qu’une formalité anodine,
Le temps de transformer l’émigrant en immigrant,
Celui qui était parti en celui qui était arrivé
Mais chacun de ceux qui défilaient
Devant les docteurs et les officiers d’état civil,
Ce qui était en jeu était vital :
Ils avaient renoncé à leur passé et à leur histoire,
Ils avaient tout abandonné pour tenter de venir vivre
Ici une vie qu’on ne leur avait pas donné le droit de
vivre dans leur pays natal
Et ils étaient désormais en face de l’inexorable » (p.52-53)
On ne ressort pas indemne d’un texte comme celui-ci, comme celui, fictionnel de Gaëlle Josse . Un hommage au courage extrême, à la détermination de
ces millions de migrants. De quoi effacer à jamais de son vocabulaire, le
terme d’ »étranger » !!!
Je vais tenter toutefois... car je ressens le besoin et l'élan d'offrir ma reconnaissance et ma gratitude à Gaëlle Josse. Grâce à son texte « Le dernier gardien d’Ellis Island », qui m’a littéralement « tourneboulée »… j’ai éprouvé l’intense besoin d’aller plus loin , dans ce « non-lieu », et passage qui a transformé, amélioré , abîmé, transformé des millions de familles, qui ont abandonné leurs racines, pour TOUT reconstruire ailleurs, dans un autre pays.
A ma grande honte, Gaëlle Josse m’a mené au texte de Georges Perec (dont je ne connaissais pas même l’existence). je viens de l'achever; c'est un autre coup de poing. Lorsque nous nous plaignons de nos quotidiens, soucis, préoccupations diverses, De grâce !... songeons à toutes ces personnes, à nos « frères » de tous les pays , ayant tout perdu , tout laissé dans l’espoir d’une autre vie meilleure, pour eux et leurs enfants, sur une terre étrangère.
Le texte de Georges Perec, est d’autant plus percutant et dérangeant, qu’il écrit les dénuements extrêmes du déracinement, sans affect… de façon distante, et étrangement, pour ma part, cela prend une dimension universelle, d’autant plus cinglante et dérangeante…
Je me permets d’établir un bref rappel des circonstances de ce texte. En 1978, L’Institut National de l’Audiovisuel confia à Georges Perec et à Robert Bober, sur une idée de celui-ci, le soin de réaliser un film sur Ellis Island. Ceux-ci allèrent sur place, à New-York, une première fois procéder aux repérages, puis y retournèrent en 1979 effectuer le tournage de ce qui devait devenir « Récits d’Ellis Island, Histoires d’errance et d’espoir », film en deux parties : « L’ile des larmes » et « Mémoires », dont la première diffusion eut lieu sur TF les 25 et 26 novembre 1980.
La présente édition présente exclusivement le texte brut de Georges Perec, sans les interviews.
Georges Perec, parle d’Ellis Island, de tous les arrachements à sa terre ; mais aussi de ses propres racines, juives...
« Etre juif, pour lui (Robert Bober), c’est avoir reçu, pour le transmettre à son tour, tout un ensemble de coutumes, de manières de manger, de danser, de chanter, des mots, des goûts, des habitudes,
Et c’est surtout avoir le sentiment de partager ces geste et ces rites avec d’autres , au-delà des frontières et des nationalités, partager ces choses devenues racines, tout en sachant qu’elles sont en même temps fragiles et essentielles, menacées par le temps et par les hommes (…) (p.60)
Georges Perec, parle aussi des descendants de ces migrants, qui viennent à Ellis Island, chercher les éléments manquants de leur histoire , rassembler le « puzzle » des chemins courageux de leurs aïeux.
Ce texte est court mais d’une densité sans comparaison !
Il est un peu déplacé ou inutile de commenter, je préfère redonner la parole à l’auteur lui-même !
« Quelles sommes d’espoirs, d’attentes, de risques,
D’enthousiasmes, d’énergies étaient ici rassemblées
Ne pas dire seulement : seize millions d’émigrants
Sont passés en trente ans par Ellis Island
Mais tenter de se représenter
Ce que furent ces seize millions d’histoires individuelles,
Ces seize millions d’histoires identiques et différentes
De ces hommes, de ces femmes et de ces enfants chassés
De leur terre natale par la famine ou la misère,
L’oppression politique, raciale ou religieuse,
Et quittant tout, leur village, leur famille, leurs
Amis, mettant des mois et des années à rassembler
L’argent nécessaire au voyage (…)
Il ne s’agit pas de s’apitoyer mais de comprendre
quatre émigrants sur cinq n’ont passé sur Ellis
Island que quelques heures
Ce n’était, tout compte fait, qu’une formalité anodine,
Le temps de transformer l’émigrant en immigrant,
Celui qui était parti en celui qui était arrivé
Mais chacun de ceux qui défilaient
Devant les docteurs et les officiers d’état civil,
Ce qui était en jeu était vital :
Ils avaient renoncé à leur passé et à leur histoire,
Ils avaient tout abandonné pour tenter de venir vivre
Ici une vie qu’on ne leur avait pas donné le droit de
vivre dans leur pays natal
Et ils étaient désormais en face de l’inexorable » (p.52-53)
On ne ressort pas indemne d’un texte comme celui-ci, comme celui, fictionnel de Gaëlle Josse . Un hommage au courage extrême, à la détermination de
ces millions de migrants. De quoi effacer à jamais de son vocabulaire, le
terme d’ »étranger » !!!
Ce petit livre, simple et généreux à l'image de son auteur, est un morceau de musique klezmer. Ça vibre, s'emballe, rythme joyeux et un peu dissonant et soudain la phrase musicale s'allonge, devient un peu plaintive, vibrante comme une larme, plonge, s'adoucit, ralentit.... Puis le tempo s'accélère, la gaité revient, pour un peu on risquerait des vitsns. Robert Bober a sa manière s'y risque lui, avec tendresse et dérision. L'histoire d'un atelier après la guerre rue de Turenne, le patron Albert, la patronne Léa, leurs jeunes enfants Raphael et Betty. Les employés Maurice, Charles, Léon, Mme Andrée, Mme Paulette, et les autres. Juifs et non juifs. L'histoire de chacun vu par le petit bout de la lorgnette. Le quotidien dans l'atmosphère légèrement chauffée par les machines et les fers à repasser, la poussière de tissu, les peluches, les bouts de fils qui s'accrochent un peu partout ou en pelote par terre, la craie pour dessiner le patron d'un vêtement, un petit microcosme en somme. On n'y parle jamais de la guerre, elle est finie depuis un an ou deux. On lui tourne le dos, parce qu'il faut vivre et pour certains reconstruire. Raphael le fils du patron, écrit son journal, ses séjours à la CCE avec son copain Georges qui a déjà la manie des listes, des classements, des énumérations, passionné de cinéma. Robert Bober connait son sujet, il a été tailleur pendant 7 ans dans sa jeunesse. Il y a surement de lui dans le personnage de Joseph, plus doué pour l'écriture et le reste que pour coudre des boutonnières au bon endroit.
Quelques mots de Georges Perec pour finir :
"Mes espaces sont fragiles : le temps va les user, va les détruire : rien ne ressemblera plus à ce qui était, mes souvenirs me trahiront, l'oubli s'infiltrera dans ma mémoire, je regarderai sans les reconnaître quelques photos jaunies aux bords tout cassés"
Quelques mots de Georges Perec pour finir :
"Mes espaces sont fragiles : le temps va les user, va les détruire : rien ne ressemblera plus à ce qui était, mes souvenirs me trahiront, l'oubli s'infiltrera dans ma mémoire, je regarderai sans les reconnaître quelques photos jaunies aux bords tout cassés"
Ellis Island… un îlot minuscule où ont transité les rêves et les espoirs de millions d’émigrants en provenance d’Europe, de 1892 à 1954, porte d’entrée pour les uns, seuil de retour à l’envoyeur pour les autres. Un tampon sur un document, noir sur blanc, pareil au jugement dernier, manichéen. Je t’octroie une nouvelle vie, noir, je te renvoie à ta vie de misère, ta non-vie, blanc. La main du jugement est celle d’un employé anonyme, fonctionnaire obéissant, kafkaïen. Tu ne pourras qu’en vouloir à ton Dieu, ou à ton destin. A ma gauche, peut-être la fortune et la gloire. A ma droite, le retour au néant, le meurtre de l’espoir, noyé dans les eaux de l’Hudson.
Comme Georges Perec, cette porte d’entrée sur New York a hanté mes pensées, dès mon adolescence. Elle fait partie de l’histoire de ma famille, la branche italienne dont ma mère est issue. Ni celle-ci, ni mon père ou mon frère, n’ont jamais à ma connaissance manifesté de curiosité pour Ellis Island. Pour moi, l’intérêt pour cette histoire et ce lieu n’ont fait que croître dès l’âge de 15 ans, l’année de mon entrée dans un internat d’un lycée à Aix-en-Provence. J’imagine que me sentir en prison avait exacerbé le besoin de trouver mes propres îlots de liberté, réels ou imaginaires. « Ellis Island » de Georges Perec, ce sont des « récits d’errance et d’espoir ». Cette union d’«Errance et espoir » pourrait sous-titrer mes années d’adolescence, et je vois dans ce raccourci un peu facile une explication possible à cette promesse que je me fis d’aller un jour à New York, rencontrer ce qui restait de ma famille, et surtout éprouver physiquement ces lieux de ma mythologie personnelle.
Voici donc l’histoire : mon arrière-grand-mère et sa sœur ont quitté la région de Venise dans les années 1910 pour Marseille, mon arrière-grand-mère avec ses quatre fils nés pour le premier (mon grand-père) en 1911 et le dernier en 1914 (son mari, resté en Italie, n’éprouvera jamais le besoin de les suivre), et sa sœur avec son mari et ses deux enfants. Ils ne possédaient rien. Le beau-frère de mon arrière-grand-mère, Giovanni, eut envie, quitte à ne rien posséder, de tenter sa chance à New York. Pour quelle raison ? Je l’ignore à ce jour. Il partit donc, dans les années 20, laissant en France ses enfants encore petits et sa femme. Très vite, installé à Brooklyn, il devint cuisinier, se trouva un petit appartement. Au fil des mois, il écrivait régulièrement à sa famille, racontant sa vie en détail, tout ce qu’il achetait, ses acquisitions à crédit. De rien, il eut un peu, et d’un peu, encore un peu plus. Il joignait des photos à ses lettres enthousiastes. Il était heureux. Son fils aîné, Léon, regardant inlassablement les photos dans son lit marseillais, se mit à rêver d’Amérique, et pendant des années tanna sa mère pour qu’à leur tour ils fassent le voyage. Celle-ci refusait, voulant demeurer auprès de sa sœur. Quand Léon eut 17 ans, en 1938, il était devenu le chef de famille. Il ordonna à sa mère et sa sœur de le suivre en terre promise. Le père envoya l’argent, et tous trois prirent le bateau. Les femmes, y compris mon arrière-grand-mère, pleurèrent énormément. Arrivés à Ellis Island, Léon et sa sœur obtinrent leur visa d’entrée sur le territoire américain du Bureau Fédéral d’Immigration. On découvrit à leur mère un foyer infectieux pulmonaire : elle fut refoulée. Les enfants retrouvèrent leur père, et firent leur vie d’italo-américains dignes des films de Coppola. La mère rentra à Marseille, auprès de sa sœur. Elle ne revit jamais son mari et ses enfants. Son fils considéra toute sa vie l’exil américain comme une bénédiction. Sa fille vécut la sienne dans le ressentiment envers son père et son frère et la nostalgie de son enfance italienne et française. Il y aurait là matière à roman.
Dans « Ellis Island », Georges Perec liste, collecte, catalogue, recueille, comme il l’a fait dans toute son œuvre. Démarche rationnelle, précise, sans affect apparent. Il questionne les témoins avant que ceux-ci ne disparaissent. Il interroge l’exil, le déplacement, le déménagement des âmes et des corps. Il décrit les espaces confinés, les files d’attente, détaille les bagages, les vêtements, les objets.
Ce point dans l’eau est le point de départ de l’infini des cercles concentriques d’une mémoire démultipliée. Ces histoires ne sont pas sienne, ni celle des siens, mais, au fond, Perec explore le rêve d’un ailleurs possible, d’une nouvelle existence, l’éventualité d’un pied de nez au destin d’une identité rendue fantomatique qui reprendrait corps dans les bras accueillants de la statue de la liberté. Les listes égrenées avec une minutie maniaque rappellent les listes des déportés : ceux qui sont de retours, ceux qui ont disparu, comme pour Ellis Island ceux qui auront la chance d’un présent vierge où planter les jeunes pousses de futures racines et ceux qui seront condamnés à leur condition d’errance. Bien sûr, on peut trouver dans « Ellis Island » tous les thèmes de la judéité, de l’exil intérieur à la promesse messianique, du questionnement identitaire comme de la condition de l’être « élu ». Mais, par sa volonté de ne céder à aucun sentimentalisme, son absence de commentaire personnel, Perec, comme dans « Je suis né » ou « W ou le souvenir d’enfance » rend davantage encore l’histoire universelle. Le lecteur attentif ou déjà familier de l’auteur comprendra que celui-ci habille les silences de sa prose avec les oripeaux de sa mémoire amputée. Georges Perec ne parle pas de lui mais il est partout, dans chaque lettre, chaque espace, chaque signe de ponctuation. Il est ce qu’il tait. J’imagine Lady Liberty, ancrée dans l’Hudson, se penchant maternellement pour révéler par la flamme de sa torche les mots secrets de l’enfant Georges écrits à l’encre sympathique.
Je ne connaissais pas Perec lors de mon voyage à New York en 1986. C’est un avion qui me fit traverser l’océan atlantique. J’ai rencontré la sœur de Léon en Floride, où elle avait suivi son mari ancien GI, installée dans la plus vieille ville des Etats-Unis : quelle ironie pour celle qui a toujours détesté ce pays ! Puis je remontai à New York, et rencontrai le désormais vieux et fatigué Léon. Il n’était jamais revenu en France, et fut le premier de ma famille à reconnaître dans mes traits une parenté indiscutable. Il vit l’Italienne en moi, et cela le fit pleurer. Pendant plus d’un mois il me fit visiter sa ville, les lieux de sa mémoire. Malgré notre grande différence d’âge, j’ai trouvé en lui une intuition de ce que j’étais incroyablement perspicace et affectueuse. Nous discutions, passant de l’anglais au français, sans oublier l’italien. Abandonné des siens, il s’est reconnu en moi. Un matin, nous nous rendîmes sur Liberty Island, alors en travaux. Il me raconta Ellis Island, ses rêves d’enfant puis de jeune homme, son égoïsme monstrueux envers sa mère et sa sœur. Il me parla de sa légende américaine, sa propre gloire puis sa chute. Le jour de mon départ, en larmes, il me fit promettre de ne jamais renoncer à mes rêves. « Quel qu’en soit le prix, ça vaut le coup (ou le coût ?) ». Je le revois me faisant un signe d’adieu alors que je m’engouffrais dans le taxi jaune qui allait me conduire à JFK. Je ne l’ai plus jamais revu, happée à mon tour par ma vie, mes rêves, mon égoïsme.
Aujourd’hui, pensant à lui, victime collatérale du 11 septembre 2001, j’imagine l’adolescent brun exalté débarquant à Ellis Island et tenant le nouveau monde dans sa main vigoureuse.
N’ayant pas de photo, c’est dans le livre de Georges Perec que je vois les traces du visage et de la silhouette trapue de Léon. Sa sœur et sa mère s’y trouvent aussi, ainsi que Giovanni, et donc un morceau de moi.
Ma bibliothèque entière est promise à un frère de cœur. Cet ami, comme moi, entretient avec New York une relation intime et un peu secrète. Je sais qu’il aurait pu être un émigrant échoué sur Ellis Island. Je sais qu’une partie de lui est là-bas. Je sais qu’il aime à trouver ses mots pour raconter cette ville qu’il aime.
Ce n’est pas un bateau, mais le train de la poste qui a amené mon exemplaire de « Ellis Island » de Georges Perec sur le lieu catalan où il possède actuellement ses ancrages. C’était une date importante, j’ai écrit quelques mots sur la première page, moi qui ne le fais que rarement.
Par ces mots, j’ai semé quelques traces, tendu le fil invisible de Léon à mon frère, de mon frère à Georges Perec. Quand je n’aurai plus de mémoire demeureront mes rêves comme autant de voyages à faire ou de mots à écrire. L’écriture sera enfin devenue une terre d’asile pour les récits d’errance et d’espoir.
Lien : http://parures-de-petitebijo..
Comme Georges Perec, cette porte d’entrée sur New York a hanté mes pensées, dès mon adolescence. Elle fait partie de l’histoire de ma famille, la branche italienne dont ma mère est issue. Ni celle-ci, ni mon père ou mon frère, n’ont jamais à ma connaissance manifesté de curiosité pour Ellis Island. Pour moi, l’intérêt pour cette histoire et ce lieu n’ont fait que croître dès l’âge de 15 ans, l’année de mon entrée dans un internat d’un lycée à Aix-en-Provence. J’imagine que me sentir en prison avait exacerbé le besoin de trouver mes propres îlots de liberté, réels ou imaginaires. « Ellis Island » de Georges Perec, ce sont des « récits d’errance et d’espoir ». Cette union d’«Errance et espoir » pourrait sous-titrer mes années d’adolescence, et je vois dans ce raccourci un peu facile une explication possible à cette promesse que je me fis d’aller un jour à New York, rencontrer ce qui restait de ma famille, et surtout éprouver physiquement ces lieux de ma mythologie personnelle.
Voici donc l’histoire : mon arrière-grand-mère et sa sœur ont quitté la région de Venise dans les années 1910 pour Marseille, mon arrière-grand-mère avec ses quatre fils nés pour le premier (mon grand-père) en 1911 et le dernier en 1914 (son mari, resté en Italie, n’éprouvera jamais le besoin de les suivre), et sa sœur avec son mari et ses deux enfants. Ils ne possédaient rien. Le beau-frère de mon arrière-grand-mère, Giovanni, eut envie, quitte à ne rien posséder, de tenter sa chance à New York. Pour quelle raison ? Je l’ignore à ce jour. Il partit donc, dans les années 20, laissant en France ses enfants encore petits et sa femme. Très vite, installé à Brooklyn, il devint cuisinier, se trouva un petit appartement. Au fil des mois, il écrivait régulièrement à sa famille, racontant sa vie en détail, tout ce qu’il achetait, ses acquisitions à crédit. De rien, il eut un peu, et d’un peu, encore un peu plus. Il joignait des photos à ses lettres enthousiastes. Il était heureux. Son fils aîné, Léon, regardant inlassablement les photos dans son lit marseillais, se mit à rêver d’Amérique, et pendant des années tanna sa mère pour qu’à leur tour ils fassent le voyage. Celle-ci refusait, voulant demeurer auprès de sa sœur. Quand Léon eut 17 ans, en 1938, il était devenu le chef de famille. Il ordonna à sa mère et sa sœur de le suivre en terre promise. Le père envoya l’argent, et tous trois prirent le bateau. Les femmes, y compris mon arrière-grand-mère, pleurèrent énormément. Arrivés à Ellis Island, Léon et sa sœur obtinrent leur visa d’entrée sur le territoire américain du Bureau Fédéral d’Immigration. On découvrit à leur mère un foyer infectieux pulmonaire : elle fut refoulée. Les enfants retrouvèrent leur père, et firent leur vie d’italo-américains dignes des films de Coppola. La mère rentra à Marseille, auprès de sa sœur. Elle ne revit jamais son mari et ses enfants. Son fils considéra toute sa vie l’exil américain comme une bénédiction. Sa fille vécut la sienne dans le ressentiment envers son père et son frère et la nostalgie de son enfance italienne et française. Il y aurait là matière à roman.
Dans « Ellis Island », Georges Perec liste, collecte, catalogue, recueille, comme il l’a fait dans toute son œuvre. Démarche rationnelle, précise, sans affect apparent. Il questionne les témoins avant que ceux-ci ne disparaissent. Il interroge l’exil, le déplacement, le déménagement des âmes et des corps. Il décrit les espaces confinés, les files d’attente, détaille les bagages, les vêtements, les objets.
Ce point dans l’eau est le point de départ de l’infini des cercles concentriques d’une mémoire démultipliée. Ces histoires ne sont pas sienne, ni celle des siens, mais, au fond, Perec explore le rêve d’un ailleurs possible, d’une nouvelle existence, l’éventualité d’un pied de nez au destin d’une identité rendue fantomatique qui reprendrait corps dans les bras accueillants de la statue de la liberté. Les listes égrenées avec une minutie maniaque rappellent les listes des déportés : ceux qui sont de retours, ceux qui ont disparu, comme pour Ellis Island ceux qui auront la chance d’un présent vierge où planter les jeunes pousses de futures racines et ceux qui seront condamnés à leur condition d’errance. Bien sûr, on peut trouver dans « Ellis Island » tous les thèmes de la judéité, de l’exil intérieur à la promesse messianique, du questionnement identitaire comme de la condition de l’être « élu ». Mais, par sa volonté de ne céder à aucun sentimentalisme, son absence de commentaire personnel, Perec, comme dans « Je suis né » ou « W ou le souvenir d’enfance » rend davantage encore l’histoire universelle. Le lecteur attentif ou déjà familier de l’auteur comprendra que celui-ci habille les silences de sa prose avec les oripeaux de sa mémoire amputée. Georges Perec ne parle pas de lui mais il est partout, dans chaque lettre, chaque espace, chaque signe de ponctuation. Il est ce qu’il tait. J’imagine Lady Liberty, ancrée dans l’Hudson, se penchant maternellement pour révéler par la flamme de sa torche les mots secrets de l’enfant Georges écrits à l’encre sympathique.
Je ne connaissais pas Perec lors de mon voyage à New York en 1986. C’est un avion qui me fit traverser l’océan atlantique. J’ai rencontré la sœur de Léon en Floride, où elle avait suivi son mari ancien GI, installée dans la plus vieille ville des Etats-Unis : quelle ironie pour celle qui a toujours détesté ce pays ! Puis je remontai à New York, et rencontrai le désormais vieux et fatigué Léon. Il n’était jamais revenu en France, et fut le premier de ma famille à reconnaître dans mes traits une parenté indiscutable. Il vit l’Italienne en moi, et cela le fit pleurer. Pendant plus d’un mois il me fit visiter sa ville, les lieux de sa mémoire. Malgré notre grande différence d’âge, j’ai trouvé en lui une intuition de ce que j’étais incroyablement perspicace et affectueuse. Nous discutions, passant de l’anglais au français, sans oublier l’italien. Abandonné des siens, il s’est reconnu en moi. Un matin, nous nous rendîmes sur Liberty Island, alors en travaux. Il me raconta Ellis Island, ses rêves d’enfant puis de jeune homme, son égoïsme monstrueux envers sa mère et sa sœur. Il me parla de sa légende américaine, sa propre gloire puis sa chute. Le jour de mon départ, en larmes, il me fit promettre de ne jamais renoncer à mes rêves. « Quel qu’en soit le prix, ça vaut le coup (ou le coût ?) ». Je le revois me faisant un signe d’adieu alors que je m’engouffrais dans le taxi jaune qui allait me conduire à JFK. Je ne l’ai plus jamais revu, happée à mon tour par ma vie, mes rêves, mon égoïsme.
Aujourd’hui, pensant à lui, victime collatérale du 11 septembre 2001, j’imagine l’adolescent brun exalté débarquant à Ellis Island et tenant le nouveau monde dans sa main vigoureuse.
N’ayant pas de photo, c’est dans le livre de Georges Perec que je vois les traces du visage et de la silhouette trapue de Léon. Sa sœur et sa mère s’y trouvent aussi, ainsi que Giovanni, et donc un morceau de moi.
Ma bibliothèque entière est promise à un frère de cœur. Cet ami, comme moi, entretient avec New York une relation intime et un peu secrète. Je sais qu’il aurait pu être un émigrant échoué sur Ellis Island. Je sais qu’une partie de lui est là-bas. Je sais qu’il aime à trouver ses mots pour raconter cette ville qu’il aime.
Ce n’est pas un bateau, mais le train de la poste qui a amené mon exemplaire de « Ellis Island » de Georges Perec sur le lieu catalan où il possède actuellement ses ancrages. C’était une date importante, j’ai écrit quelques mots sur la première page, moi qui ne le fais que rarement.
Par ces mots, j’ai semé quelques traces, tendu le fil invisible de Léon à mon frère, de mon frère à Georges Perec. Quand je n’aurai plus de mémoire demeureront mes rêves comme autant de voyages à faire ou de mots à écrire. L’écriture sera enfin devenue une terre d’asile pour les récits d’errance et d’espoir.
Lien : http://parures-de-petitebijo..
Ecriture simple mais profonde.
J'ai rencontré Robert Bober récemment et cela restera une rencontre magique . Ses mots, ses attitudes , sa vision sur le monde m'ont fait réfléchir sur le partage des souvenirs .
J'ai rencontré Robert Bober récemment et cela restera une rencontre magique . Ses mots, ses attitudes , sa vision sur le monde m'ont fait réfléchir sur le partage des souvenirs .
De bonnes intentions mais une écriture on ne peut plus plate.
Ce livre m'a enchanté, on a une impression de réalité comme dans "Quoi de neuf sur la guerre?" du même auteur.
Le narrateur évoque son quotidien au sein d'une maison d'enfants après guerre. Les enfants sont gardés dans ces maisons parce qu'ils n'ont plus de parents, morts en déportation.
Le quotidien n'est pas tout rose, certains sont violents, il y a dans ces pages de la peine, de la pudeur, de la retenue, des souvenirs...
Le narrateur évoque son quotidien au sein d'une maison d'enfants après guerre. Les enfants sont gardés dans ces maisons parce qu'ils n'ont plus de parents, morts en déportation.
Le quotidien n'est pas tout rose, certains sont violents, il y a dans ces pages de la peine, de la pudeur, de la retenue, des souvenirs...
"On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux" titre tiré de «plupart de temps» de Pierre Reverdy.
Tout commence le mardi 2 Mai 1961, au café Victor de l’impasse Compans à Belleville. Truffaut tourne une scène de Jules et Jim où le personnage principal, Bernard, a décroché un petit rôle grâce à Robert ... Bober qui passera en invité de temps en temps comme une silhouette à la Hitchcock ou comme la coccinelle de Gotlib, au choix.
Quand le film sort sur les écrans, Bernard demande à sa mère de l’accompagner. Fier de lui montrer son apparition sur le grand écran. Ils vont en ressortir bouleversés : Bernard parce que ses scènes ont été coupées au montage, sa mère parce le film est un écho de sa propre vie. Sur le chemin du retour à la maison, et pour la première fois, Bernard va apprendre ce qui «précédait sa naissance».
Va se mettre en place une mosaïque de petites histoires, qui mises en résonances, conduiront le personnage jusqu’au bout de sa quête d’identité.
Voilà pour l’histoire principale.
Mais c’est loin d’être tout !
Le livre de Robert nous entraîne dans une longue flânerie à la Modiano dans le Paris des années 60. Paris qui devient à lui seul un personnage. Nous allons de rue en rue, de café en café et accoudés au zinc nous écoutons, attentifs, les personnages parler des films de Max Ophuls, de la ronde de Schnilzer, de Harpo des Marx Brothers, de Casque d’or, des 400 coups. Nous tapons du pied au son du jazz manouche, et parfois même il nous arrive de pousser la chansonnette. Entre deux verres, nous courrons assister au cours sur le temps de Jankélévitch «c’est toujours le bon, le temps qui est passé». Et nous hâtons le pas, pour ne pas manquer notre rendez-vous avec Robert Giraud auteur «du vin des rues» et ami de Doisneau.
"ll n’y a pas de meilleur endroit pour un solitaire que le bistrot m’a dit Giraud, commandant deux rouges d’autorité. A cause des oreilles qui entendent toujours quelque chose dans quoi on peut intervenir et reprendre contact. Mais après, il faut y revenir. Parce que, boire un coup, c'est mieux de le faire dans un endroit où on connaît votre nom. On y est plus à l'aise. Mais il y a aussi ceux qu'on retrouve jamais. Ils sont là, un temps, à la même place, et puis un jour plus rien. Emportés on ne sait où. Effacés. On se souvient juste du nom qu'on leur donnait."
Sous le charme et l’émotion.
Pour les amoureux de cinéma, de Paris, de belles histoires, c’est à dire à peu près tout le monde, il serait dommage de passer à côté de ce très beau livre, car le peu que je viens d’en dire, est encore loin d’être tout.
Tout commence le mardi 2 Mai 1961, au café Victor de l’impasse Compans à Belleville. Truffaut tourne une scène de Jules et Jim où le personnage principal, Bernard, a décroché un petit rôle grâce à Robert ... Bober qui passera en invité de temps en temps comme une silhouette à la Hitchcock ou comme la coccinelle de Gotlib, au choix.
Quand le film sort sur les écrans, Bernard demande à sa mère de l’accompagner. Fier de lui montrer son apparition sur le grand écran. Ils vont en ressortir bouleversés : Bernard parce que ses scènes ont été coupées au montage, sa mère parce le film est un écho de sa propre vie. Sur le chemin du retour à la maison, et pour la première fois, Bernard va apprendre ce qui «précédait sa naissance».
Va se mettre en place une mosaïque de petites histoires, qui mises en résonances, conduiront le personnage jusqu’au bout de sa quête d’identité.
Voilà pour l’histoire principale.
Mais c’est loin d’être tout !
Le livre de Robert nous entraîne dans une longue flânerie à la Modiano dans le Paris des années 60. Paris qui devient à lui seul un personnage. Nous allons de rue en rue, de café en café et accoudés au zinc nous écoutons, attentifs, les personnages parler des films de Max Ophuls, de la ronde de Schnilzer, de Harpo des Marx Brothers, de Casque d’or, des 400 coups. Nous tapons du pied au son du jazz manouche, et parfois même il nous arrive de pousser la chansonnette. Entre deux verres, nous courrons assister au cours sur le temps de Jankélévitch «c’est toujours le bon, le temps qui est passé». Et nous hâtons le pas, pour ne pas manquer notre rendez-vous avec Robert Giraud auteur «du vin des rues» et ami de Doisneau.
"ll n’y a pas de meilleur endroit pour un solitaire que le bistrot m’a dit Giraud, commandant deux rouges d’autorité. A cause des oreilles qui entendent toujours quelque chose dans quoi on peut intervenir et reprendre contact. Mais après, il faut y revenir. Parce que, boire un coup, c'est mieux de le faire dans un endroit où on connaît votre nom. On y est plus à l'aise. Mais il y a aussi ceux qu'on retrouve jamais. Ils sont là, un temps, à la même place, et puis un jour plus rien. Emportés on ne sait où. Effacés. On se souvient juste du nom qu'on leur donnait."
Sous le charme et l’émotion.
Pour les amoureux de cinéma, de Paris, de belles histoires, c’est à dire à peu près tout le monde, il serait dommage de passer à côté de ce très beau livre, car le peu que je viens d’en dire, est encore loin d’être tout.
Puzzle ou fin tissage, cette œuvre poétique multiplie les voix et les temps, dans un Paris qui ressemble aux photos de Doisneau.
Lien : http://www.telerama.fr/criti..
Lien : http://www.telerama.fr/criti..
J'ai lu ce livre jusqu'au bout, mais je ne peux pas dire qu'il m'ait laissé une impression formidable. Il était agréable, nostalgique, mais sans plus.
Pour les amoureux d'un Paris bien oublié ?
Pour les amoureux d'un Paris bien oublié ?
Livre –mémoire.
Mémoire de Paris ou plutôt d’un certain quartier juif autour de la République, délimité par la Rue Oberkampf, le Boulevard Saint Martin, Belleville, et Le père Lachaise. Quartier que je connaissais bien, où habitaient Noémie, Aviva, Tal, mes copines et copains du Mouvement, où leurs mère parlaient avec l’accent Yiddish qui berce la lecture de ces pages… Habituellement, je m’évade par la lecture, curieuse d’apprendre sur le monde et je laisse peu de place au retour sur les lieux de mon adolescence.
Il faut bien dire que la promenade nostalgique est douce lorsqu’en plus elle se double des réminiscences cinéphiles
Lien : http://miriampanigel.blog.le..
Mémoire de Paris ou plutôt d’un certain quartier juif autour de la République, délimité par la Rue Oberkampf, le Boulevard Saint Martin, Belleville, et Le père Lachaise. Quartier que je connaissais bien, où habitaient Noémie, Aviva, Tal, mes copines et copains du Mouvement, où leurs mère parlaient avec l’accent Yiddish qui berce la lecture de ces pages… Habituellement, je m’évade par la lecture, curieuse d’apprendre sur le monde et je laisse peu de place au retour sur les lieux de mon adolescence.
Il faut bien dire que la promenade nostalgique est douce lorsqu’en plus elle se double des réminiscences cinéphiles
Lien : http://miriampanigel.blog.le..
Ce quatrième roman de R. Bober plonge le lecteur dans le Paris des années 1960. A travers l'histoire de Bernard Appelbaum, Bober peint par touches tel un impressionniste le portrait d'un Paris atypique et révolu. Mais loin de grandes descriptions, la narration prend toute la place dans ce récit. Comme un fil rouge, l'histoire de "Jules et Jim', ce pur amour à trois comme le décrivait Truffaut, sera le moteur de la recherche du passé pour Bernard.
Les personnages prennent dans ce roman tout l'espace. Attachants pour les uns, curieux pour les autres, grotesques ou tragiques, mais toujours vrais, tout y est terriblement vivant.
Sous le signe de la nostalgie,du romantisme parisien d'autrefois, à la fois romanesque et empreint de l'Histoire dans tout son drame, ce roman à la fois émouvant et drôle est un passage obligatoire pour ceux qui sourient devant les photos de Robert Doisneau ou de Willy Ronis, qui lisent avec plaisir Robert Giraud (ce qui commence à faire beaucoup de Robert!) ou qui ne se lassent pas du jazz de Django Reinhardt. L'une des plus belles lectures de la rentrée littéraire 2010.
Les personnages prennent dans ce roman tout l'espace. Attachants pour les uns, curieux pour les autres, grotesques ou tragiques, mais toujours vrais, tout y est terriblement vivant.
Sous le signe de la nostalgie,du romantisme parisien d'autrefois, à la fois romanesque et empreint de l'Histoire dans tout son drame, ce roman à la fois émouvant et drôle est un passage obligatoire pour ceux qui sourient devant les photos de Robert Doisneau ou de Willy Ronis, qui lisent avec plaisir Robert Giraud (ce qui commence à faire beaucoup de Robert!) ou qui ne se lassent pas du jazz de Django Reinhardt. L'une des plus belles lectures de la rentrée littéraire 2010.
Une révélation...
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Robert Bober
Lecteurs de Robert Bober (608)Voir plus
Quiz
Voir plus
Qui suis-je ? Les auteurs en A
J'ai écrit Le grand Meaulnes. Je suis mort au Sud de Verdun durant la première guerre mondiale. Qui suis-je ?
Jean Anouilh
Alain-Fournier (de son vrai nom Henri-Alban Fournier)
Guillaume Apollinaire
Marguerite Audoux
7 questions
21 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur21 lecteurs ont répondu