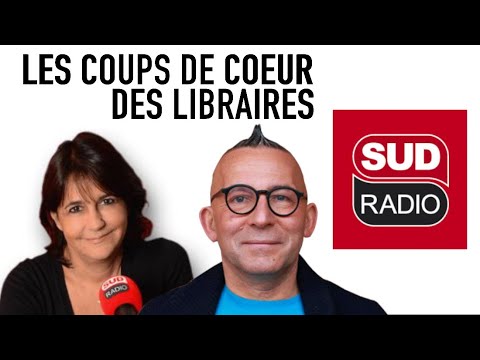Né(e) à : Aurillac , le 01/10/1962
Marie-Hélène Lafon est une professeure agrégée et écrivaine française.
Née dans une famille de paysans, elle est élève à l'Institution Saint-Joseph (collège) puis à La Présentation Notre-Dame (lycée) deux pensionnats religieux de Saint-Flour.
Elle part ensuite étudier à Paris, à la Sorbonne, où elle obtient une maîtrise de latin et le CAPES de lettres modernes. Elle obtient également un Diplôme d'études approfondies (DEA) à l'Université Paris III-Sorbonne Nouvelle puis un doctorat de littérature à l'Université Paris VII-Denis Diderot.
Elle devient agrégée de grammaire en 1987. Elle enseigne le français, le latin et le grec dans le collège Saint-Exupéry, Paris 14e, en banlieue parisienne, dans un collège situé en Zone d’Éducation Prioritaire, puis à Paris, où elle vit.
Elle commence à écrire en 1996, à 34 ans. Son premier roman "Le soir du chien" (2001) est récompensé par le prix Renaudot des lycéens en 2001.
Elle avait précédemment écrit des nouvelles - pour lesquelles elle ne trouvait pas d'éditeur - dont "Liturgie", "Alphonse et Jeanne", qui seront publiées l'année suivante dans le recueil "Liturgie" (2002), récompensé par le prix Renaissance de la Nouvelle en 2003. Elle préside le prix littéraire des lycéens de Compiègne en 2003-2004. En 2015, le téléfilm "L'Annonce" est adapté de son roman éponyme de 2009, réalisé par Julie Lopes-Curval, avec Alice Taglioni et Éric Caravaca, produit par Arte.
Lauréate de nombreux prix, Marie-Hélène Lafon obtient le Prix du Style 2012 pour "Les Pays" et le Prix Goncourt de la nouvelle en 2016 pour "Histoires". Elle reçoit le Prix Renaudot 2020, pour son roman "Histoire du fils".
Célibataire et sans enfant, son département d'origine, le Cantal, et sa rivière, la Santoire, sont le décor de la majorité de ses romans.
Ajouter des informations
Attention !!! Nouvel horaire pour l'émission "Le coup de coeur des libraires" sur les Ondes de Sud Radio. Valérie Expert et Gérard Collard vous donne rendez-vous chaque samedi à 13h30 pour vous faire découvrir leurs passions du moment ! • Retrouvez leurs dernières sélections de livres ici ! • • Mémoires de Raymond Aron, Nicolas Baverez aux éditions Bouquins 9782221114025 • Patience dans l'azur : L'évolution cosmique de Hubert Reeves aux éditions Points 9782757841105 • Poussières d'étoiles de Hubert Reeves aux éditions Points https://www.lagriffenoire.com/poussieres-d-etoiles-reedition.html • Car un jour de vengeance de Alexandra Julhiet aux éditions Calmann-Lévy https://www.lagriffenoire.com/car-un-jour-de-vengeance-1.html • Une Fille de Province de Johanne Rigoulot aux éditions Les Avrils https://www.lagriffenoire.com/une-fille-de-province.html • Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bondoux et Coline Peyrony aux éditions Gallimard Jeunesse https://www.lagriffenoire.com/nous-traverserons-des-orages.html • La Vie selon Chaval - Dessins choisis et présentés par Philippe Geluck de Chaval et Philippe Geluck aux éditions du Cherche Midi https://www.lagriffenoire.com/la-vie-selon-chaval.html • Les Gardiens du phare de Emma Stonex aux éditions Livre de Poche https://www.lagriffenoire.com/les-gardiens-du-phare-1.html • Autobiographie d'une Courgette de Gilles Paris, Marie-Luce Raillard aux éditions Flammarion https://www.lagriffenoire.com/autobiographie-d-une-courgette-2.html • Les 7 vies de Mlle Belle Kaplan de Gilles Paris aux éditions Plon https://www.lagriffenoire.com/les-7-vies-de-mlle-belle-kaplan.html • La boîte à Berk de Julien Béziat aux éditions École des Loisirs https://www.lagriffenoire.com/la-boite-a-berk.html • Les crayons fêtent Halloween de Drew Daywalt, Oliver Jeffers aux éditions Kaléidoscope https://www.lagriffenoire.com/les-crayons-fetent-halloween.html • Gare aux fantômes, Palomino de Michaël Escoffier et Matthieu Maudet aux éditions École des Loisirs https://www.lagriffenoire.com/gare-aux-fantomes-palomino.html • À pied d'oeuvre de Franck Courtès aux éditions Gallimard https://www.lagriffenoire.com/a-pied-d-oeuvre.html • Harry Potter - le Guide Ultime de Collectif, Jean-François Ménard aux éditions Gallimard Jeunesse https://www.lagriffenoire.com/harry-potter-le-gu
(pages 23-24)
Histoire du fils
Qu’a entraîné la mort d’Armand Lachalme en avril 1908 ?
14 lecteurs ont répondu