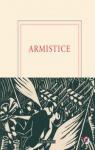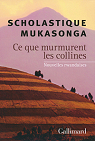Critiques de Scholastique Mukasonga (326)
A l'occasion du centenaire de l'armistice, Gallimard a proposé à différents écrivains un hommage aux poilus. Le résultat est sublime. Trente et un auteurs contemporains se livrent à l'exercice difficile. Daeninckx, Hatzfeld, Jourde, Moï, Rufin, pour n'en citer qu'une poignée ont accepté cette écriture mémoire.
Chaque texte est illustré par une peinture, une gravure, un dessin. C'est ainsi que j'ai découvert l'histoire de vie et les peintures de Rik Wouters.
Cet ouvrage collectif fait écho aux chefs d'œuvre qui ont eu pour sujet la 1ere guerre mondiale: Voyage au bout de nuit, Les sentiers de la gloire, Au revoir là haut, capitaine Conan...
Chaque texte est illustré par une peinture, une gravure, un dessin. C'est ainsi que j'ai découvert l'histoire de vie et les peintures de Rik Wouters.
Cet ouvrage collectif fait écho aux chefs d'œuvre qui ont eu pour sujet la 1ere guerre mondiale: Voyage au bout de nuit, Les sentiers de la gloire, Au revoir là haut, capitaine Conan...
A travers cette suite de nouvelles (6 en tout), Scholastique Mukasonga nous parle du Rwanda : ce pays déchiré, à l'histoire douloureuse, qui n'en est pas moins porteur de beauté et d'espoir.
Ce livre est un pur plaisir de lecture, et le talent de conteuse de Scholastique Mukasonga fait des merveilles. Ces nouvelles en partie autobiographiques nous entraînent au coeur d'une Afrique méconnue, entre mythologie, faits historiques et difficultés du quotidien.
Ce livre est un pur plaisir de lecture, et le talent de conteuse de Scholastique Mukasonga fait des merveilles. Ces nouvelles en partie autobiographiques nous entraînent au coeur d'une Afrique méconnue, entre mythologie, faits historiques et difficultés du quotidien.
L'auteur de "Notre-Dame du Nil", prix Renaudot 2012, propose dans ce recueil 6 nouvelles sur le Rwanda de son enfance. C'est un voyage plein de beauté, un mélange de faits et de croyances, où l'on découvre les rites, les coutumes, les principes des peuples qui composent le pays.
On frôle le documentaire sur certaines (notamment au début) avec une somme d'informations et une énumération de noms....à tel point qu'on pourrait facilement décrocher...mais il faut poursuivre et aller jusqu'au bout du recueil pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. De belles histoires nous attendent avec des personnages attachants.
On frôle le documentaire sur certaines (notamment au début) avec une somme d'informations et une énumération de noms....à tel point qu'on pourrait facilement décrocher...mais il faut poursuivre et aller jusqu'au bout du recueil pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. De belles histoires nous attendent avec des personnages attachants.
Du relativisme ethnologique...
C’est sur les rives de la Rukarara qu’est née Scholastique Mukasonga.
A partir d’une première nouvelle consacrée à cette rivière sacrée pour sa famille, l’auteur rwandaise se fait conteuse. Elle, dont les précédents écrits évoquaient le destin tragique de sa famille et des Tutsi les années précédents le génocide, renoue cette fois-ci avec la tradition orale des contes que lui murmurait sa mère Stéfania. Elle nous entraîne dans Afrique méconnue, entre rituels magiques, faits historiques et difficultés du quotidien.
La Rukarara, c’est cette rivière aux vertus magiques dont l’eau soigna sa blessure au crâne alors qu’elle n’était encore qu’une enfant. Titicarabi, c’est ce chien mystérieux à la parole envoûtante. «La Vache du roi Musinga» témoigne de l’amour des Tutsi pour leur bétail, et les rapports compliqués entre les potentats locaux et les colonisateurs belges. Toujours en sobriété, l’auteur sait également nous décrire un monde fait de contrastes : les leçons de catéchisme dispensées par les « bons pères » mêlées aux pratiques des rituels magiques ou bien encore des petits élèves Tutsi exilés par les Hutu et qui eux-mêmes rejettent Cyprien le petit Pygmée, « car on ne peut pas être tout à fait sûr qu’ils [les Batwa] soient vraiment des humains ».
Voici six contes qui nous présentent la vie d’autrefois au Rwanda, celle d’avant le génocide. De ses souvenirs d’enfance, Scholastique Mukasonga nous révèle une société rwandaise qui, malgré l’influence et le pouvoir des missionnaires, garde ses pratiques traditionnelles et reste méfiante vis-à-vis des colonisateurs. Le tout dans un style poétique, simple et touchant.
A partir d’une première nouvelle consacrée à cette rivière sacrée pour sa famille, l’auteur rwandaise se fait conteuse. Elle, dont les précédents écrits évoquaient le destin tragique de sa famille et des Tutsi les années précédents le génocide, renoue cette fois-ci avec la tradition orale des contes que lui murmurait sa mère Stéfania. Elle nous entraîne dans Afrique méconnue, entre rituels magiques, faits historiques et difficultés du quotidien.
La Rukarara, c’est cette rivière aux vertus magiques dont l’eau soigna sa blessure au crâne alors qu’elle n’était encore qu’une enfant. Titicarabi, c’est ce chien mystérieux à la parole envoûtante. «La Vache du roi Musinga» témoigne de l’amour des Tutsi pour leur bétail, et les rapports compliqués entre les potentats locaux et les colonisateurs belges. Toujours en sobriété, l’auteur sait également nous décrire un monde fait de contrastes : les leçons de catéchisme dispensées par les « bons pères » mêlées aux pratiques des rituels magiques ou bien encore des petits élèves Tutsi exilés par les Hutu et qui eux-mêmes rejettent Cyprien le petit Pygmée, « car on ne peut pas être tout à fait sûr qu’ils [les Batwa] soient vraiment des humains ».
Voici six contes qui nous présentent la vie d’autrefois au Rwanda, celle d’avant le génocide. De ses souvenirs d’enfance, Scholastique Mukasonga nous révèle une société rwandaise qui, malgré l’influence et le pouvoir des missionnaires, garde ses pratiques traditionnelles et reste méfiante vis-à-vis des colonisateurs. Le tout dans un style poétique, simple et touchant.
Ce que j’ai préféré dans ce bouquin, c’est l’introduction. Alors que Scholastique Mukosonga n’a pas encore pris la plume du conteur, elle nous raconte son enfance, nous explique finalement les origines de ces nouvelles. Elle met ainsi le doigt sur les événements tragiques qui ont marqués son pays, dont je dois avouer je n’étais pas très au fait. A vrai dire, je n’aurais pas même su placer le Rwanda sur une carte avant de démarrer cette lecture. Si mes lacunes restent grandes, j’ai maintenant un peu moins honte de mon ignorance.
Lire la suite : http://www.bizzetmiel.com/2016/05/scholastique-mukasonga-ce-que-murmurent.html
Lien : http://www.bizzetmiel.com/20..
Lire la suite : http://www.bizzetmiel.com/2016/05/scholastique-mukasonga-ce-que-murmurent.html
Lien : http://www.bizzetmiel.com/20..
Le Rwanda. Le pays aux mille collines. La source du Nil. Le pays d'Afrique continentale le plus densément peuplé. Avril 1994 : plus de 800 000 humains exterminés. Le 4e génocide du 20e siècle.
L'apocalypse de c'est pas abattu tout à coup, par hasard sur ce peuple. Le mal s'est infiltré peu à peu. Un mal ancien a gangréné, infecté son équilibre social. Pays colonisé . 1885, le traité de Berlin, l'Afrique est, découpée en morceaux, mettant en charpies nombre de cultures, d'alliances, de relations communautaires. L'église catholique va « missionner » sa parole lézardant, sapant l'édifice spirituel de ces populations. Le Rwanda deviendra colonie allemande, puis belge, jusqu’à son indépendance le 1er juillet 1962.
Les colons vont inventer un concept totalement inconnu pour cette population : La notion d'ethnie, de race.
La société rwandaise était établie sur des critères sociaux économiques qui architecturaient le rapport de ses pouvoirs politiques, religieux et militaires. Le clan des éleveurs, les Hutu, le clan des cultivateurs les Ttusi, le clan des cueilleurs , les Twa ( peuple premier du Rwanda) . une répartition donc par clans, par castes. Une répartition mouvante, flexible.
Puisque les mariages permettaient à la femme originaire d'un des clans d'intégrer le clan auquel était originaire son époux. Le rattachement au clan était donc établi par naissance pour l'homme, par alliance pour la femme. Mais n'était pas pour la communauté immuable. Plusieurs clans, mais une même langue, un même dieu l'Imana.
L'administration coloniale sans aucune connaissance de cette culture, de son histoire, de ses croyances, de toutes les bases de sa spiritualité a procédé un classement pseudo ethnique ahurissant de la population en se basant sur des critères aberrants de nuances de pigmentation de la peau, de taille, de considération pseudo anthropologique, échafaudant ainsi une fausse théorie des races rwandaises aboutissant ainsi à une classification « qualitative » de la population Selon les besoins politiques , économiques , les colonisateurs ont fait évoluer leurs appuis politiques vers l'une ou l'autre de ces deux pseudo ethnies qu'ils avaient artificiellement et arbitrairement ordonnées, hiérarchisées, classifiées, établies. Et ceci durant la période coloniale mais également post coloniale. La politique « africaine » de la France venant elle même peu à peu surenchérir le désordre politique et social du pays.
S'en suivra la guerre civile de 1957, les massacres de 1963, de 1972, les livraisons régulières à partir de 1987 d’équipements militaires vers le Rwanda par la France, pour en arriver à un génocide qui débuta le 07 avril 1994 et qui prit fin en juillet 1994, provocant la mort de 800 000 à un million de personnes, Tutsi et Hutu opposants au régime gouvernemental en place.
Ce que murmurent les collines, recueil de nouvelles de l'écrivaine rwandaise, Scholastique Mukasonga, nous fait entendre l'âme rwandaise. La réalité de ses couleurs qui sont celles de sa terre, de ses collines, de son ciel, de ses légendes, de ses rivières, de ses traditions, de sa mémoire. Les couleurs incroyables de sa musique. Il nous fait comprendre la méconnaissance totale et souvent absurde d'une culture coloniale occidentale, qui a piétiné, utilisé, instrumentalisé, malmené, déformé, d' une population entière pour assouvir ses propre besoins, selon ses propres critères, ses lois, l'échelle de ses valeurs, faisant table rase de la complexité, de la pluralité d'un continent entier. Ce que murmurent les collines est un magnifique recueil.
Je ne peux que nous conseiller également de voir le film « Quelques jours en avril » ( sometimes in April) de Raoul Peck, afin de nous apprendre ou de mieux nous faire comprendre, ou nous rappeler ce qu'une effrayante et terrifiante notion de race, et plus largement toute notion de classification identitaire ; peut engendrer comme immense péril pour toute l'humanité, et cela quelque soit la colline où elle voit le jour.
A lire également « Congo » d'Eric Vuillard qui témoigne d'un holocauste oublié qui fit 10 millions de morts en vingt ans, sous le règne de de Leopold II, « le coupeur de mains », roi des Belges.
Astrid Shriqui Garain
L'apocalypse de c'est pas abattu tout à coup, par hasard sur ce peuple. Le mal s'est infiltré peu à peu. Un mal ancien a gangréné, infecté son équilibre social. Pays colonisé . 1885, le traité de Berlin, l'Afrique est, découpée en morceaux, mettant en charpies nombre de cultures, d'alliances, de relations communautaires. L'église catholique va « missionner » sa parole lézardant, sapant l'édifice spirituel de ces populations. Le Rwanda deviendra colonie allemande, puis belge, jusqu’à son indépendance le 1er juillet 1962.
Les colons vont inventer un concept totalement inconnu pour cette population : La notion d'ethnie, de race.
La société rwandaise était établie sur des critères sociaux économiques qui architecturaient le rapport de ses pouvoirs politiques, religieux et militaires. Le clan des éleveurs, les Hutu, le clan des cultivateurs les Ttusi, le clan des cueilleurs , les Twa ( peuple premier du Rwanda) . une répartition donc par clans, par castes. Une répartition mouvante, flexible.
Puisque les mariages permettaient à la femme originaire d'un des clans d'intégrer le clan auquel était originaire son époux. Le rattachement au clan était donc établi par naissance pour l'homme, par alliance pour la femme. Mais n'était pas pour la communauté immuable. Plusieurs clans, mais une même langue, un même dieu l'Imana.
L'administration coloniale sans aucune connaissance de cette culture, de son histoire, de ses croyances, de toutes les bases de sa spiritualité a procédé un classement pseudo ethnique ahurissant de la population en se basant sur des critères aberrants de nuances de pigmentation de la peau, de taille, de considération pseudo anthropologique, échafaudant ainsi une fausse théorie des races rwandaises aboutissant ainsi à une classification « qualitative » de la population Selon les besoins politiques , économiques , les colonisateurs ont fait évoluer leurs appuis politiques vers l'une ou l'autre de ces deux pseudo ethnies qu'ils avaient artificiellement et arbitrairement ordonnées, hiérarchisées, classifiées, établies. Et ceci durant la période coloniale mais également post coloniale. La politique « africaine » de la France venant elle même peu à peu surenchérir le désordre politique et social du pays.
S'en suivra la guerre civile de 1957, les massacres de 1963, de 1972, les livraisons régulières à partir de 1987 d’équipements militaires vers le Rwanda par la France, pour en arriver à un génocide qui débuta le 07 avril 1994 et qui prit fin en juillet 1994, provocant la mort de 800 000 à un million de personnes, Tutsi et Hutu opposants au régime gouvernemental en place.
Ce que murmurent les collines, recueil de nouvelles de l'écrivaine rwandaise, Scholastique Mukasonga, nous fait entendre l'âme rwandaise. La réalité de ses couleurs qui sont celles de sa terre, de ses collines, de son ciel, de ses légendes, de ses rivières, de ses traditions, de sa mémoire. Les couleurs incroyables de sa musique. Il nous fait comprendre la méconnaissance totale et souvent absurde d'une culture coloniale occidentale, qui a piétiné, utilisé, instrumentalisé, malmené, déformé, d' une population entière pour assouvir ses propre besoins, selon ses propres critères, ses lois, l'échelle de ses valeurs, faisant table rase de la complexité, de la pluralité d'un continent entier. Ce que murmurent les collines est un magnifique recueil.
Je ne peux que nous conseiller également de voir le film « Quelques jours en avril » ( sometimes in April) de Raoul Peck, afin de nous apprendre ou de mieux nous faire comprendre, ou nous rappeler ce qu'une effrayante et terrifiante notion de race, et plus largement toute notion de classification identitaire ; peut engendrer comme immense péril pour toute l'humanité, et cela quelque soit la colline où elle voit le jour.
A lire également « Congo » d'Eric Vuillard qui témoigne d'un holocauste oublié qui fit 10 millions de morts en vingt ans, sous le règne de de Leopold II, « le coupeur de mains », roi des Belges.
Astrid Shriqui Garain
Nous sommes chez notre fille au Rwanda et je trouve ce bouquin qu'elle me conseille. Belle découverte ces nouvelles qui racontent un vécu colonisé....
Et lire ça en étant dans ce magnifique pays, un plaisir.
Et lire ça en étant dans ce magnifique pays, un plaisir.
L'auteur a écrit je crois 4 livres sur le génocide avant de revenir sur l'histoire de l'ancien Rwanda. Entre histoire, fiction et poésie, l'auteur revient sur la colonisation, les légendes locales, et les anecdotes de son enfance .Je suis restée fascinée en lisant la première nouvelle au bord de la rivière, la source du Nil. La nature est foisonnante, omniprésente. Les mots simples de l'auteur rendent presque palpable le mode de vie posé des rwandais de cet époque. Les différentes nouvelles s’enchaînent vite au rythme des récit comme celui de la vache qui m'a fait sourire.L'auteur emboîte des histoires dans ces histoires, comme des matriochka. J'ai passé un très joli moment . La tristesse du génocide était d'autant plus présente dans mais pensée que l'auteur décrivait une période où il n'avait pas encore eu lieu. Un brin mélancolique, j'ai terminé ce livre avec des envies de voyage.
Un recueil de nouvelles très agréable à lire, une certaine poésie dans l'écriture.
L'histoire d'un pays, le Rwanda, pris dans la colonisation des "Blancs" qui s'interroge sur des pratiques pour lui exotique. Un regard d'enfant sur les changements de la société et les légendes qui se perdent en même temps que la perte des racines avec l'exil, la quasi-obligation de se convertir au christianisme en laissant de côté les croyances ancestrales.
Tout en délicatesse sans jugement ni reproche de très beaux textes.
Je me suis parfois un peu perdue avec les noms africains mais dans l'ensemble un très belle lecture.
L'histoire d'un pays, le Rwanda, pris dans la colonisation des "Blancs" qui s'interroge sur des pratiques pour lui exotique. Un regard d'enfant sur les changements de la société et les légendes qui se perdent en même temps que la perte des racines avec l'exil, la quasi-obligation de se convertir au christianisme en laissant de côté les croyances ancestrales.
Tout en délicatesse sans jugement ni reproche de très beaux textes.
Je me suis parfois un peu perdue avec les noms africains mais dans l'ensemble un très belle lecture.
Ces nouvelles très intéressantes évoquent l’histoire du Rwanda (que ce soit au début de la colonisation ou pendant l’enfance de l’autrice), sa nature, ses croyances et ses modes de vie.
Voici mes deux nouvelles préférées: "Le Malheur", "Un Pygmée à l’école".
Voici mes deux nouvelles préférées: "Le Malheur", "Un Pygmée à l’école".
D'habitude, je n'aime pas trop le format nouvelles. Parce que je suis souvent frustrée par un goût de trop peu, le sentiment de ne pas avoir pris le temps d'aller au fond d'un sujet.
Ce ne fut pas le cas ici.
Entre souvenirs d'enfance et légendes rwandaises, chaque nouvelle est une histoire complète en soi. Il faut dire que l'autrice excelle dans le genre, ce qui lui a d'ailleurs valu un prix pour cet ouvrage. Le revers de la médaille étant que dans son roman Notre Dame du Nil, j'avais parfois l'impression que les chapitres étaient accolés les uns aux autres sans réel fil conducteur fort. Et ma lecture de ce recueil me donne un éclairage sur ce sentiment: Scholastique Mukasonga est vraiment forte pour conter avec densité, en peu de pages, toute une intrigue, y apportant couleurs et émotions.
La plupart des nouvelles murmurées par la colline se déroule dans l'enfance de l'autrice, une période durant laquelle les missionnaires blancs occupaient la place, où les Hutus et les Tutsis se haïssaient déjà (existe-t-il un temps où ce ne fut pas le cas?), où les congolais, bras armés des belges, semaient la crainte dans les collines. A travers ses récits, Scholastique Mukasonga fait revivre certaines croyances, leur redonnant parfois du sens, et teinte le tout d'une couche de nostalgie sans amertume.
J'ai particulièrement bien appréciée la nouvelle Malheur qui donne la voix à plusieurs femmes sur l'origine supposé de la malchance qui semble poursuivre l'une d'entre elle. Et à travers la dernière nouvelle, un pygmée à l'école, nous découvrons que le racisme a toujours été tapi au cœur de toute les civilisations et qu'il s'exprime toujours par les même voies.
Le personnage principal reste le Rwanda, cette terre maudite, aux portes d'un Burundi qui effraie, dans une Afrique qui manque de luxuriance.
Un recueil de nouvelles bien intéressant pour entrer dans la culture rwandaise, sans démagogie, juste par le bout des sentiments.
Style particulier, les histoires sont belles, mais c'est un peu du Kirikou, même si l'histoire de l'Afrique se trouve dans ces croyances ancestrales, un peu léger, je trouve
6 nouvelles, partiellement autobiographique,Mukasonga nous enchante avec les contes de sa mère, l'histoire de Cyprien le Pygmee rejeté de presque tous, l'histoire d'Anonciata qui porte malheur....et tant d'autres belles histoires à découvrir ...
Si dans "Notre-Dame du Nil", elle racontait l’histoire d’un lycée de jeunes filles de la bonne société rwandaise au début des années 1970, ce récit annonçait surtout de manière dramatique, le génocide qui viendra vingt ans plus tard. Et comme on connaît la suite, la tension entre ces élèves n’en est que plus horrible.
Lien : http://www.lalibre.be/cultur..
Lien : http://www.lalibre.be/cultur..
Rarement autant ému par une histoire d'amour!
L'amour de l'auteure, Rwandaise exilée, pour son pays, son peuple, sa culture, son histoire avant l'arrivée des blancs, des belges, elle l'exprime à travers des petits contes issus d'histoires racontées par sa mère, son grand père ou simplement vécues à l'école ou au catéchisme.
Si simple et si fort!
L'amour de l'auteure, Rwandaise exilée, pour son pays, son peuple, sa culture, son histoire avant l'arrivée des blancs, des belges, elle l'exprime à travers des petits contes issus d'histoires racontées par sa mère, son grand père ou simplement vécues à l'école ou au catéchisme.
Si simple et si fort!
Ce recueil de nouvelles nous permet de découvrir les légendes et les traditions rwandaises. Scholastique Mukasonga nous conte le quotidien de son enfance et quelques autres histoires.
A travers ces nouvelles, nous découvrons un pays, le Rwanda, avant le génocide et au moment où les européens avaient établis leurs colonies ce qui a entraîné une cohabitation entre les cultures païennes et la domination chrétienne.
Cela a été pour moi une excellente découverte, d'autant que j'avais apprécié moyennement son roman : "Notre Dame du Nil". A travers de courts récits, j'ai pu mieux appréhender le quotidien du peuple rwandais. L'auteur a d'ailleurs consacré à chaque fin des nouvelles un petit passage intitulé "Notes à l'attention d'un lecteur curieux".
A travers ces nouvelles, nous découvrons un pays, le Rwanda, avant le génocide et au moment où les européens avaient établis leurs colonies ce qui a entraîné une cohabitation entre les cultures païennes et la domination chrétienne.
Cela a été pour moi une excellente découverte, d'autant que j'avais apprécié moyennement son roman : "Notre Dame du Nil". A travers de courts récits, j'ai pu mieux appréhender le quotidien du peuple rwandais. L'auteur a d'ailleurs consacré à chaque fin des nouvelles un petit passage intitulé "Notes à l'attention d'un lecteur curieux".
De très belles nouvelles qui nous font découvrir un pays largement méconnu: le Rwanda, pays d'origine de l'auteure, Scholastique Mukasonga.
Ma préférée est la première nouvelle "La Rivière Rukarara" qui nous permet de découvrir les rivières de ce pays et la partie limitrophe avec le Burundi et le chemin emprunté par les réfugiés Tutsi.
Une rivière témoin des massacres de 1963 et qui a été franchie par les membres de la famille de l'auteure dans des conditions dramatiques.
Bien après, Scholastique se souvient de la rivière de sa jeunesse. une rivière qui prend sa source dans la forêt vierge et qui se joint à la rivière Mwogo pour devenir la Nyabarongo qui enserre le coeur du Rwanda.
Cette rivière serait la source du Nil, selon les découvertes d'explorateurs en 2006.
La source de la Rukarara a été proclamée "la source la plus lointaine du Nil".
Un Allemand, Richard Kandt, était arrivé aux mêmes conclusions en 1898.
Cette nouvelle reprend la trajectoire de ce découvreur.
C'est passionnant et cela nous donne une nouvelle approche de ce pays tellement meurtri au cours des dernières années.
Ma préférée est la première nouvelle "La Rivière Rukarara" qui nous permet de découvrir les rivières de ce pays et la partie limitrophe avec le Burundi et le chemin emprunté par les réfugiés Tutsi.
Une rivière témoin des massacres de 1963 et qui a été franchie par les membres de la famille de l'auteure dans des conditions dramatiques.
Bien après, Scholastique se souvient de la rivière de sa jeunesse. une rivière qui prend sa source dans la forêt vierge et qui se joint à la rivière Mwogo pour devenir la Nyabarongo qui enserre le coeur du Rwanda.
Cette rivière serait la source du Nil, selon les découvertes d'explorateurs en 2006.
La source de la Rukarara a été proclamée "la source la plus lointaine du Nil".
Un Allemand, Richard Kandt, était arrivé aux mêmes conclusions en 1898.
Cette nouvelle reprend la trajectoire de ce découvreur.
C'est passionnant et cela nous donne une nouvelle approche de ce pays tellement meurtri au cours des dernières années.
Voici six nouvelles quelque peu surprenantes au départ car elles nous font entrer par une petite porte, bien agréable je trouve, dans une culture qui nous est totalement étrangère. L'Afrique, et le Rwanda en particulier, ont une longue Histoire, les colonisateurs blancs n’ont pas écrit sur une feuille vierge, c'est ce qui est dit ici très simplement. Ces récits nous font découvrir un monde poétique, riche d’imaginaire et de lien social, dont la lecture apaise.
Les noms sonnent curieusement mais racontent l'histoire par leur musique particulière. Il faut s'attarder un peu sur eux, sur leur sonorité, au départ c'est un effort puis on s'en fait vite des amis et des complices de lecture… Il y a là le dieu Mwami… la rivière Rukarara… La famille de Scolastique a été exilée comme tant d'autres tutsis (et hutus opposants) à Nyamata au Bugesera en franchissant la rivière Nyabarongo : « J'allais avec les autres filles chercher de l'eau au lac Cyohoha ou, pour des occasions solennelles, à la source de Rwakibirizi dont le flot abondant et intarissable semblait jaillir par la grâce d'un improbable miracle au milieu de ce pays de sécheresse qu'est le Bugasera. »
Scholastique Mukasonga est née au Rwanda et fait partie de ces exilés qui ont dû chercher refuge après avoir vécu des persécutions _ et dans son cas, un génocide des plus terribles de toute l’histoire humaine. L’identité de cette écrivaine ayant reçu de multiples prix est en soit intéressant et porte la marque de l'Europe par le prénom, la scolastique c'est l'école mais dans un sens philosophique, alors que son nom, Mukasonga, est tout à fait rwandais. Et dans ce prénom a été ajouté le h du latin schola _l’école_ comme une marque du destin particulier de la petite fille exilée.
Dans la nouvelle « Le Malheur » on apprend que MUKA est un préfixe marqueur des noms féminins, propre au Rwanda, pouvant se traduire par « Femme de… » ou « Celle de … ». Ce qui signifiait que la femme avait réellement un statut en se mariant ou en étant mère. C'est une des histoires qui m'a vraiment plu, les six femmes qui sont présentées dans ce conte sont très intéressantes, elles ont une interprétation forte et personnelle de l'origine des malheurs touchant leur colline.
J'ai aussi beaucoup aimé la nouvelle « Un pygmée à l’école ». Cette histoire de Cyprien, enfant admis exceptionnellement à l’école et ensuite mis à l'écart des autres enfants de la classe car originaire d’une autre ethnie, est édifiante. On retrouve là toute la puissance des contes, marquant fortement les esprits, ils plongent dans le passé par la transmission orale d’avant le livre. Il convoque à la fois le récit mémoriel, l'histoire et à travers le dénouement, une sorte de morale que le lecteur peut, s'il a été touché par les arguments ou/et par l'habileté du conteur/de la conteuse, faire sien.
On peut lire ces nouvelles dans l'ordre prévu par l'auteure ou pas… Pour ma part je conseille de commencer par ces deux-là : « Le Malheur » et « Un pygmée à l’école » et de poursuivre par « la rivière Rukarara », cri d'amour pour son pays natal perdu et une nature magnifique qui porte la vie.
« La vache du roi Musinga » est un beau récit historique du pouvoir en place avant l'arrivée des colonisateurs allemands puis belges. Là où un animal est à la fois richesse, transmission, relation d'un roi à son peuple.
Le remplacement des valeurs est bien décrit dans la nouvelle « Le bois de la croix ». Le culte à la nature, l'arbre géant et les gris-gris sont remplacés par l'eau bénite des pères blancs. Le bois de la croix est celui de l'arbre géant et les arbres de la forêt qui sont « comme les enfants de l'arbre géant » vénérés par les différentes ethnies sans distinctions, le sorcier est hutu…
Dans « Titicarabi », on rentre dans le quotidien d’un enfant rwandais qui en classe accédait aux connaissances par le livre « Matins d'Afrique », avec des histoires « ... qui se passaient dans une Afrique étrange qui n'était pas le Rwanda, dans des pays encore plus bizarres qui devaient être les pays des Blancs. »
À travers cette mosaïque, Scholastique Mukasonga nous permet de comprendre réellement son enfance, de là d’où elle vient. Elle aborde avec retenue les conflits entre hutus et tutsis… Elle a écrit là-dessus dans ses précédents livres et peut-être, le temps passant et les phrases s’accumulant, peut-elle s'évader un peu de l'enfer qu'elle a connu dans son enfance. Elle avait 4 ans quand elle et sa famille tutsi ont été déportés en 1960, et où elle a dû s’exiler d’abord au Burundi puis en France (le génocide des tutsis _ mais aussi des hutus et tous ceux qui ont voulu s'interposer _ aura lieu en 1994).
Ces petites histoires nous racontent la grande Histoire. Difficile pour moi de comprendre pourquoi un tel malheur s'est abattu sur ce petit pays en écoutant seulement des infos trop souvent désincarnées, voire rejetant l’autre, l’étranger. Là, je pense approcher au plus près du vécu de ce peuple (il semble que les tutsis et les hutus vivaient en paix avant la colonisation et le marquage ethnique qui a été institué alors). Les mots de Scolastique nous parlent de l'ancien temps d'avant la colonisation par les allemands puis les belges, du mépris des Blancs pour la culture ancienne qu’ils vont alors détruire méthodiquement et du pillage des richesses. Dans les petits faits du quotidien d’alors apparaît ce qui va advenir. La graine de la haine a été plantée et elle va éclore à partir de 1959, jusqu’à cette année 1994, terrible période du 7 avril au 17 juillet, ou de nombreux membres de sa famille ont été assassinés.
Ce beau petit livre des éditions folio m’apparaissait plutôt difficile à aborder. Après lecture il m'est précieux par sa douce musique qui sait raconter la mémoire et les espoirs de tout un peuple. Et j’aime beaucoup le titre très doux : « ce que murmurent les collines »…
Pour compléter il est intéressant d’aller voir l'excellent site officiel de Scholastique Mukasonga, notamment sa biographie faite de drames et d’exil avant de déployer ces phrases magnifiques. C’est quand même curieux d’avoir entendu aussi peu parler des rescapés et de ceux qui, comme Scholastique, ont été contraints à l’exil.
https://www.scholastiquemukasonga.net/home/
J’ai aussi apprécié le site de « vision du monde » qui donne des explications abordables et sérieuses concernant la survenue de cet évènement de l’ordre de l’impensable absolu. Des quatre grands génocides, celui-ci a été le plus rapide car il s’est déroulé sur seulement 100 jours et fait 800 000 morts.
https://www.visiondumonde.fr/actualites/vision-du-monde-commemore-le-genocide-rwandais
Ces nouvelles m’ont donné l’opportunité de découvrir « une belle plume » et de prolonger cette lecture en tentant de comprendre le passé douloureux de ce peuple martyr. Au-delà de ces contes, on doit parler des responsabilités, dont celles de la France et des pays colonisateurs, qui ont conduit à ces situations. Comprendre afin de tout faire pour que cela ne se reproduise plus c’est déjà, au départ, ne pas détourner le regard !
Lien : https://clesbibliofeel.home...
Les noms sonnent curieusement mais racontent l'histoire par leur musique particulière. Il faut s'attarder un peu sur eux, sur leur sonorité, au départ c'est un effort puis on s'en fait vite des amis et des complices de lecture… Il y a là le dieu Mwami… la rivière Rukarara… La famille de Scolastique a été exilée comme tant d'autres tutsis (et hutus opposants) à Nyamata au Bugesera en franchissant la rivière Nyabarongo : « J'allais avec les autres filles chercher de l'eau au lac Cyohoha ou, pour des occasions solennelles, à la source de Rwakibirizi dont le flot abondant et intarissable semblait jaillir par la grâce d'un improbable miracle au milieu de ce pays de sécheresse qu'est le Bugasera. »
Scholastique Mukasonga est née au Rwanda et fait partie de ces exilés qui ont dû chercher refuge après avoir vécu des persécutions _ et dans son cas, un génocide des plus terribles de toute l’histoire humaine. L’identité de cette écrivaine ayant reçu de multiples prix est en soit intéressant et porte la marque de l'Europe par le prénom, la scolastique c'est l'école mais dans un sens philosophique, alors que son nom, Mukasonga, est tout à fait rwandais. Et dans ce prénom a été ajouté le h du latin schola _l’école_ comme une marque du destin particulier de la petite fille exilée.
Dans la nouvelle « Le Malheur » on apprend que MUKA est un préfixe marqueur des noms féminins, propre au Rwanda, pouvant se traduire par « Femme de… » ou « Celle de … ». Ce qui signifiait que la femme avait réellement un statut en se mariant ou en étant mère. C'est une des histoires qui m'a vraiment plu, les six femmes qui sont présentées dans ce conte sont très intéressantes, elles ont une interprétation forte et personnelle de l'origine des malheurs touchant leur colline.
J'ai aussi beaucoup aimé la nouvelle « Un pygmée à l’école ». Cette histoire de Cyprien, enfant admis exceptionnellement à l’école et ensuite mis à l'écart des autres enfants de la classe car originaire d’une autre ethnie, est édifiante. On retrouve là toute la puissance des contes, marquant fortement les esprits, ils plongent dans le passé par la transmission orale d’avant le livre. Il convoque à la fois le récit mémoriel, l'histoire et à travers le dénouement, une sorte de morale que le lecteur peut, s'il a été touché par les arguments ou/et par l'habileté du conteur/de la conteuse, faire sien.
On peut lire ces nouvelles dans l'ordre prévu par l'auteure ou pas… Pour ma part je conseille de commencer par ces deux-là : « Le Malheur » et « Un pygmée à l’école » et de poursuivre par « la rivière Rukarara », cri d'amour pour son pays natal perdu et une nature magnifique qui porte la vie.
« La vache du roi Musinga » est un beau récit historique du pouvoir en place avant l'arrivée des colonisateurs allemands puis belges. Là où un animal est à la fois richesse, transmission, relation d'un roi à son peuple.
Le remplacement des valeurs est bien décrit dans la nouvelle « Le bois de la croix ». Le culte à la nature, l'arbre géant et les gris-gris sont remplacés par l'eau bénite des pères blancs. Le bois de la croix est celui de l'arbre géant et les arbres de la forêt qui sont « comme les enfants de l'arbre géant » vénérés par les différentes ethnies sans distinctions, le sorcier est hutu…
Dans « Titicarabi », on rentre dans le quotidien d’un enfant rwandais qui en classe accédait aux connaissances par le livre « Matins d'Afrique », avec des histoires « ... qui se passaient dans une Afrique étrange qui n'était pas le Rwanda, dans des pays encore plus bizarres qui devaient être les pays des Blancs. »
À travers cette mosaïque, Scholastique Mukasonga nous permet de comprendre réellement son enfance, de là d’où elle vient. Elle aborde avec retenue les conflits entre hutus et tutsis… Elle a écrit là-dessus dans ses précédents livres et peut-être, le temps passant et les phrases s’accumulant, peut-elle s'évader un peu de l'enfer qu'elle a connu dans son enfance. Elle avait 4 ans quand elle et sa famille tutsi ont été déportés en 1960, et où elle a dû s’exiler d’abord au Burundi puis en France (le génocide des tutsis _ mais aussi des hutus et tous ceux qui ont voulu s'interposer _ aura lieu en 1994).
Ces petites histoires nous racontent la grande Histoire. Difficile pour moi de comprendre pourquoi un tel malheur s'est abattu sur ce petit pays en écoutant seulement des infos trop souvent désincarnées, voire rejetant l’autre, l’étranger. Là, je pense approcher au plus près du vécu de ce peuple (il semble que les tutsis et les hutus vivaient en paix avant la colonisation et le marquage ethnique qui a été institué alors). Les mots de Scolastique nous parlent de l'ancien temps d'avant la colonisation par les allemands puis les belges, du mépris des Blancs pour la culture ancienne qu’ils vont alors détruire méthodiquement et du pillage des richesses. Dans les petits faits du quotidien d’alors apparaît ce qui va advenir. La graine de la haine a été plantée et elle va éclore à partir de 1959, jusqu’à cette année 1994, terrible période du 7 avril au 17 juillet, ou de nombreux membres de sa famille ont été assassinés.
Ce beau petit livre des éditions folio m’apparaissait plutôt difficile à aborder. Après lecture il m'est précieux par sa douce musique qui sait raconter la mémoire et les espoirs de tout un peuple. Et j’aime beaucoup le titre très doux : « ce que murmurent les collines »…
Pour compléter il est intéressant d’aller voir l'excellent site officiel de Scholastique Mukasonga, notamment sa biographie faite de drames et d’exil avant de déployer ces phrases magnifiques. C’est quand même curieux d’avoir entendu aussi peu parler des rescapés et de ceux qui, comme Scholastique, ont été contraints à l’exil.
https://www.scholastiquemukasonga.net/home/
J’ai aussi apprécié le site de « vision du monde » qui donne des explications abordables et sérieuses concernant la survenue de cet évènement de l’ordre de l’impensable absolu. Des quatre grands génocides, celui-ci a été le plus rapide car il s’est déroulé sur seulement 100 jours et fait 800 000 morts.
https://www.visiondumonde.fr/actualites/vision-du-monde-commemore-le-genocide-rwandais
Ces nouvelles m’ont donné l’opportunité de découvrir « une belle plume » et de prolonger cette lecture en tentant de comprendre le passé douloureux de ce peuple martyr. Au-delà de ces contes, on doit parler des responsabilités, dont celles de la France et des pays colonisateurs, qui ont conduit à ces situations. Comprendre afin de tout faire pour que cela ne se reproduise plus c’est déjà, au départ, ne pas détourner le regard !
Lien : https://clesbibliofeel.home...
A travers ces nouvelles, l'auteure nous fait découvrir l'Afrique coloniale. Plus précisément le Rwanda, ce petit pays enclavé entre l'Afrique centrale et orientale, d'abord occupé par l'Allemagne, puis par la Belgique après 1918. De son point de vue d'enfant, à l'écoute des récits des Anciens, elle se souvient de la vie au village, les histoires entre le roi déchu et le pouvoir colonial, les habitudes de la vie quotidienne, l'école...
On apprend beaucoup de choses dans un style simple, presque enfantin - c'est toujours le point de vue de l'enfant. le pouvoir colonial et l'acculturation qui s'en suit sont décrits avec légèreté, presque naïvement. C'est ce qui, à mon avis, donne de la force à ces récits. Mais c'est peut-être aussi le point négatif car j'aurais souhaité plus d'implication, de dénonciation. Mais ce n'était pas le propos de l'auteur.
On apprend beaucoup de choses dans un style simple, presque enfantin - c'est toujours le point de vue de l'enfant. le pouvoir colonial et l'acculturation qui s'en suit sont décrits avec légèreté, presque naïvement. C'est ce qui, à mon avis, donne de la force à ces récits. Mais c'est peut-être aussi le point négatif car j'aurais souhaité plus d'implication, de dénonciation. Mais ce n'était pas le propos de l'auteur.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Scholastique Mukasonga
Lecteurs de Scholastique Mukasonga (1439)Voir plus
Quiz
Voir plus
Les couples célèbres
Qui étaient "les amants du Flore" ?
Anaïs Nin et Henri Miller
Elsa Triolet et Aragon
Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre
Paul Verlaine et Arthur Rimbaud
9 questions
9458 lecteurs ont répondu
Thèmes :
couple
, roman d'amourCréer un quiz sur cet auteur9458 lecteurs ont répondu