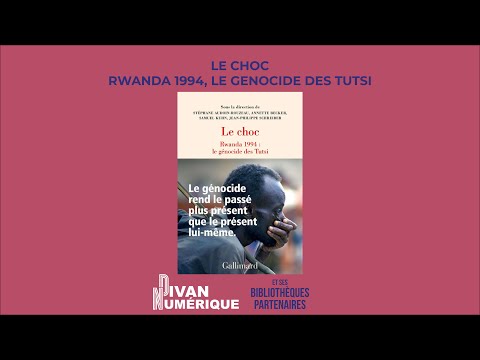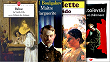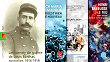Nationalité : France
Né(e) à : Paris , le 25/02/1955
Né(e) à : Paris , le 25/02/1955
Biographie :
Stéphane Audoin-Rouzeau est un historien français.
Il est le fils de Philippe Audoin (1924-1985), écrivain surréaliste proche d'André Breton et le frère de Frédérique Audoin-Rouzeau alias Fred Vargas (1957), archéozoologue et romancière, ainsi que de l'artiste peintre Joëlle Audoin-Rouzeau alias Jo Vargas (1957).
En 1984, il soutint sa thèse de doctorat sur "Les Soldats français pendant la Guerre de 1914-1918 d'après les journaux de tranchées : une étude des mentalités".
Il enseigna l'histoire contemporaine à l'Université de Clermont-Ferrand puis à l'Université de Picardie Jules-Verne (UPJV) à Amiens. Depuis 2004, il est directeur d’études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il est président du Centre international de recherche de l'Historial de la Grande Guerre de Péronne, dans la Somme.
Depuis 2007, Stéphane Audoin-Rouzeau a développé ses recherches principalement selon quatre axes. Il a prolongé un travail entrepris de longue date sur la Première Guerre mondiale en centrant celui-ci sur les objets de guerre, dans une perspective nettement anthropologique, et a tiré de cette recherche un ouvrage paru chez Armand Colin en 2009.
Parallèlement, ses recherches se sont orientées en direction d’une anthropologie du combat dans la guerre moderne, sujet qui est l’objet de son séminaire principal à l’EHESS et dont il a tiré un ouvrage paru au Seuil en 2008.
Ses recherches se sont également centrées sur la question du génocide des Tutsi au Rwanda (1994) à partir de deux terrains effectués sur place en 2008 et 2009 : de ce travail, il a tiré plusieurs articles et la direction d’un numéro de la revue Esprit paru en 2010.
Enfin, dans le cadre de son séminaire principal, son travail s’est orienté plus particulièrement sur la question du "corps guerrier" dans la conflictualité contemporaine.
Il a inspiré le personnage de Lucien Devernois à sa sœur romancière dans "Debout les morts" (1995).
+ Voir plusStéphane Audoin-Rouzeau est un historien français.
Il est le fils de Philippe Audoin (1924-1985), écrivain surréaliste proche d'André Breton et le frère de Frédérique Audoin-Rouzeau alias Fred Vargas (1957), archéozoologue et romancière, ainsi que de l'artiste peintre Joëlle Audoin-Rouzeau alias Jo Vargas (1957).
En 1984, il soutint sa thèse de doctorat sur "Les Soldats français pendant la Guerre de 1914-1918 d'après les journaux de tranchées : une étude des mentalités".
Il enseigna l'histoire contemporaine à l'Université de Clermont-Ferrand puis à l'Université de Picardie Jules-Verne (UPJV) à Amiens. Depuis 2004, il est directeur d’études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il est président du Centre international de recherche de l'Historial de la Grande Guerre de Péronne, dans la Somme.
Depuis 2007, Stéphane Audoin-Rouzeau a développé ses recherches principalement selon quatre axes. Il a prolongé un travail entrepris de longue date sur la Première Guerre mondiale en centrant celui-ci sur les objets de guerre, dans une perspective nettement anthropologique, et a tiré de cette recherche un ouvrage paru chez Armand Colin en 2009.
Parallèlement, ses recherches se sont orientées en direction d’une anthropologie du combat dans la guerre moderne, sujet qui est l’objet de son séminaire principal à l’EHESS et dont il a tiré un ouvrage paru au Seuil en 2008.
Ses recherches se sont également centrées sur la question du génocide des Tutsi au Rwanda (1994) à partir de deux terrains effectués sur place en 2008 et 2009 : de ce travail, il a tiré plusieurs articles et la direction d’un numéro de la revue Esprit paru en 2010.
Enfin, dans le cadre de son séminaire principal, son travail s’est orienté plus particulièrement sur la question du "corps guerrier" dans la conflictualité contemporaine.
Il a inspiré le personnage de Lucien Devernois à sa sœur romancière dans "Debout les morts" (1995).
Source : Wikipedia
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (18)
Voir plusAjouter une vidéo
Thomas de la librairie le Divan partage ses lectures : "Ne passez surtout pas à côté de cet ouvrage, tout aussi important et éclairant que nécessaire." Notre mot sur , 1994 : , écrit sous la direction de Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Samuel Kuhn, Jean-Philippe Schreiber et publié aux éditions Gallimard : https://www.librairie-ledivan.com/livre/9782073056764 Tous nos conseils de lecture : https://www.librairie-ledivan.com/
Citations et extraits (36)
Voir plus
Ajouter une citation
Les blessures, les soufrances, les séquelles marginalisent les mutilés en les privant de travail mais plus encore par le regard qui est portés sur eux. Ils ne sont plus les héros virils aux corps puissants -- ceux-ci, les meilleurs, sont morts--mais de pauvres hères qui sont les signes vivants de la défaite (dans le cas de l'Allemagne) et plus généralement de la honte d'avoir consenti à une guerre ayant produit de telles conséquences.
Les mutilés, "fétés comme héros" pendant la guerre, sont "oubliés comme estropiés".
Les mutilés, "fétés comme héros" pendant la guerre, sont "oubliés comme estropiés".
Bien avant 1914, le sentiment national se colore à la fois d'un ressentiment nationaliste et d'une sensiblerie patriotique ou chauvine qui ne sont pas de bon aloi pour la stabilité de l'Europe.
Comment de telles vérités ont-elles pu s'imposer chez des savants qui, justement, admiraient la culture allemande au point de la jalouser si peu de temps auparavant ? Comment n'ont-ils pas été envahis par les doutes et le sentiment de la contradiction ? La certitude de la supériorité de la « race » a balayé tout scrupule et autorisé le manichéisme. Il y avait désormais l'Allemand et les autres, le barbare et les civilisés.
En France, la guerre devient dès 1914, par directive ministérielle, le substrat de tout l'enseignement.
La guerre fournit ainsi le sujet des dissertations, des rédactions, des problèmes de mathématiques, des exercices de grammaire et de conjugaison.Le contenu des enseignements est donc relu à l'aune du conflit et l'école relaie le double discours d'exaltation de la nation et de condamnation de l'ennemi.
La guerre fournit ainsi le sujet des dissertations, des rédactions, des problèmes de mathématiques, des exercices de grammaire et de conjugaison.Le contenu des enseignements est donc relu à l'aune du conflit et l'école relaie le double discours d'exaltation de la nation et de condamnation de l'ennemi.
En france, la censure a été maintenue jusqu'en octobre 1919, afin d'éviter la contagion révolutionnaire russe puis allemande, de limiter les revendications des minorités nationales trop bruyantes au moment de la conférence de la paix, de préparer enfin les élections au sortir de la guerre, sans verser dans des troubles sociaux.
Le rationnement eut un effet imprévu : un transfert des riches vers les pauvres.En effet, les couches les plus pauvres de la population en 1914 découvrirent qu'elles avaient droit, du fait de leur citoyennetéé, à un niveau de consommation plus élevé que celui qu'elles avaient connu avant-guerre.
Les pertes dans l'armée aérienne furent très élevées.
Les parachutes étaient connus mais proscrits par l'état-major, qui craignait que leur emploi nuise à la combativité des pilotes.
Les parachutes étaient connus mais proscrits par l'état-major, qui craignait que leur emploi nuise à la combativité des pilotes.
Un grand psychiatre n'aimait pas l'expression "stress post-traumatique" parce qu'elle mélange cette réaction adaptative face au danger qu'est le stress avec le trauma authentique dans lequel il voyait un phénomène tout différent : il s'agissait pour lui d'une effraction brutale dans la psyché, à partir de laquelle cessait pour le sujet cette "illusion d'immortalité" sans laquelle nous ne pouvons tout simplement pas vivre. Le sujet, en effet, "s"est vu mort" et de cette initiation il ne peut se remettre. 98.
Les conditions si particulières du combat ont en effet multiplié, dans tous les camps, le nombre des disparus et le chiffre de ceux dont les corps n'étaient pas identifiables : les uns et les autres représentent, dans le cas français, près d'un cadavre sur deux.
On estime ainsi qu'un tiers des vingt mille morts de la Somme, le 1er juillet 1916, eussent pu être sauvés si les pratiques d’assistance aux blessées encore en usage un demi-siècle plus tôt avaient été mises en œuvres.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Stéphane Audoin-Rouzeau
Quiz
Voir plus
Auteur Mystère cher à mon Petit Coeur
Une pincée d'anticipation sociale:
Outrage et rébellion
Copyright
8 questions
17 lecteurs ont répondu
Thèmes :
polar noir
, romans policiers et polars
, noir
, littératureCréer un quiz sur cet auteur17 lecteurs ont répondu