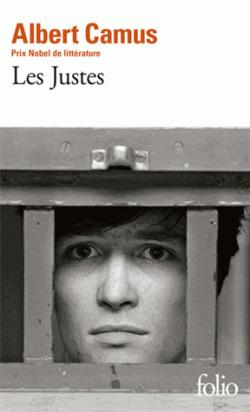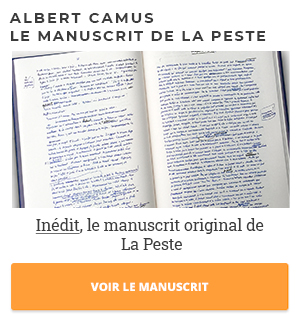Pour cette pièce de théâtre, Albert Camus a mis en scène un "fait divers" historique qu'il a voulu rendre vraisemblable, tangible, moins factuel que dans un livre d'histoire. Il s'agit d'un groupe de jeunes russes socialistes révolutionnaires qui planifient l'assassinat d'un grand-duc. , incarnant l'injustice sociale de la société russe et toute la colère qu'elle suscite chez les prolétaires. Alors, au bord du désespoir, quand il semble que la vie nous amène dans un engrenage sans fin, pour être un vrai révolutionnaire : faut-il prendre la parole ou prendre les armes ? Et une révolution/révolte peut-elle être qualifiée de "juste" si elle doit assassiner des personnes que l'on pense ou perçoit comme innocents ? Que ce soit les enfants du grand-duc ou le grand-duc lui-même qui est l'incarnation d'un système dont il bénéficie mais jamais aucun acte condamnable de sa part n'est mentionné.
Même avec des idées bien tranchées/ arrêtées, pour beaucoup, se dire que l'on met fin à une vie n'est pas chose aisée - si ceux qui le décide s'en lavent les mains, les exécutants eux peuvent être assaillis d'un questionnement moral (tout à fait légitime)
C'est une lecture que je n'avais pas prévu de faire, mais l'adaptation d'Abd al Malik diffusée sur France 5 m'y a poussée. On retrouve beaucoup de thèmes chers à Camus comme l'idéal de justice, la mort, la liberté, la nécessité d'être vrai à soi et à ses opinions. Et en prime, on sent bien la touche existentialiste, ce qui fait que cette lecture peut s'avérer ardue si l'on manque de clés pour la déchiffrer. Et même avec quelques unes, on sent bien que certains aspects de l'oeuvre nous échappent !
Le discours est lapidaire et minimaliste, et malgré les quelques moments où la passion révolutionnaire et la soif de justice émergent du texte, la plupart du temps le décalage entre ces phrases minimalistes et la gravité de la situation créent un tel contraste que l'atmosphère est des plus tendues.
On parle des riches despotes, mais aussi du risque de voir les révolutionnaires trop zélés instaurer une nouvelle forme de despotisme, notamment de par leur attachement fanatique à leur cause plus qu'aux individus.
En cela, cette pièce relevant pourtant de l'existentialisme a des résonances toutes particulières en ce début de 21ème siècle, une époque où les individus sont blasés par la violence à grande échelle avec les actes terroristes, l'avènement de Daech et le manque de lien social t de solidarité tant le monde s'est polarisé entre "nous versus les autres" (que ce soit en termes de nationalités, d'opinions politiques, d'ethnies, ou en termes économiques et sociaux).
Une chose est certaine : c'est une pièce qui noue la gorge.
Challenge Solidarité 2020
Challenge multi-défis 2020
Défi XXème siècle
Challenge Théâtre 2020
Même avec des idées bien tranchées/ arrêtées, pour beaucoup, se dire que l'on met fin à une vie n'est pas chose aisée - si ceux qui le décide s'en lavent les mains, les exécutants eux peuvent être assaillis d'un questionnement moral (tout à fait légitime)
C'est une lecture que je n'avais pas prévu de faire, mais l'adaptation d'Abd al Malik diffusée sur France 5 m'y a poussée. On retrouve beaucoup de thèmes chers à Camus comme l'idéal de justice, la mort, la liberté, la nécessité d'être vrai à soi et à ses opinions. Et en prime, on sent bien la touche existentialiste, ce qui fait que cette lecture peut s'avérer ardue si l'on manque de clés pour la déchiffrer. Et même avec quelques unes, on sent bien que certains aspects de l'oeuvre nous échappent !
Le discours est lapidaire et minimaliste, et malgré les quelques moments où la passion révolutionnaire et la soif de justice émergent du texte, la plupart du temps le décalage entre ces phrases minimalistes et la gravité de la situation créent un tel contraste que l'atmosphère est des plus tendues.
On parle des riches despotes, mais aussi du risque de voir les révolutionnaires trop zélés instaurer une nouvelle forme de despotisme, notamment de par leur attachement fanatique à leur cause plus qu'aux individus.
En cela, cette pièce relevant pourtant de l'existentialisme a des résonances toutes particulières en ce début de 21ème siècle, une époque où les individus sont blasés par la violence à grande échelle avec les actes terroristes, l'avènement de Daech et le manque de lien social t de solidarité tant le monde s'est polarisé entre "nous versus les autres" (que ce soit en termes de nationalités, d'opinions politiques, d'ethnies, ou en termes économiques et sociaux).
Une chose est certaine : c'est une pièce qui noue la gorge.
Challenge Solidarité 2020
Challenge multi-défis 2020
Défi XXème siècle
Challenge Théâtre 2020
Des terroristes membres du parti des combattants socialistes révolutionnaires avaient prévu d'attenter à la vie du grand-duc Serge de Russie le 15 février 1905. Ce dernier assistait ce jour-là à un concert au théâtre Bolchoï. Toutefois, l'un des terroristes s'est rendu compte qu'il était accompagné de ses deux enfants et n'acceptant pas l'idée de les tuer, ne donna pas le signal à ses camarades. le grand-duc sera finalement assassiné deux jours plus tard.
Dans sa pièce de théâtre « les justes » Albert Camus relate cet évènement, de la préparation de l'attentat du 15 février aux conséquences de celui du 17 février en imaginant les pensées, les discours et les actes de cinq terroristes. Il en ressort une analyse psychologique des cinq révolutionnaires qui se voient attribuer chacun une personnalité différente. Les réflexions sont nombreuses : Est-il juste de sacrifier deux enfants pour en sauver des milliers ? Est-il juste de mourir pour mettre en oeuvre ses idéaux afin que d'autres puissent vivre libres ? Est-il nécessaire de se sacrifier ? Est-il nécessaire de passer par la haine ? de manière plus générale, jusqu'où peut-on aller pour défendre ses idéaux, son engagement politique ?
C'est prenant, ça sonne juste, mais c'est court et j'aurais aimé rester davantage avec ce petit groupe pour avoir une réflexion peut-être plus profonde sur le sujet.
Dans sa pièce de théâtre « les justes » Albert Camus relate cet évènement, de la préparation de l'attentat du 15 février aux conséquences de celui du 17 février en imaginant les pensées, les discours et les actes de cinq terroristes. Il en ressort une analyse psychologique des cinq révolutionnaires qui se voient attribuer chacun une personnalité différente. Les réflexions sont nombreuses : Est-il juste de sacrifier deux enfants pour en sauver des milliers ? Est-il juste de mourir pour mettre en oeuvre ses idéaux afin que d'autres puissent vivre libres ? Est-il nécessaire de se sacrifier ? Est-il nécessaire de passer par la haine ? de manière plus générale, jusqu'où peut-on aller pour défendre ses idéaux, son engagement politique ?
C'est prenant, ça sonne juste, mais c'est court et j'aurais aimé rester davantage avec ce petit groupe pour avoir une réflexion peut-être plus profonde sur le sujet.
En février 1905, à Moscou, un petit groupe de socialistes révolutionnaires prépare l'assassinat du grand-duc Serge (Сергей Александрович Романов, Sergueï Aleksandrovitch Romanov, 1857-1905), cinquième fils de l'empereur Alexandre II de Russie (lui-même assassiné en 1881).
Ce cadre historique sert de support à la pièce de Camus.
Les membres du groupe terroriste sont a priori motivés par la même cause : mettre fin à l'exploitation du peuple russe. Les discussions entre eux sont cependant animées.
Camus nous invite à réfléchir sur la notion de justice, et sur la légitimité de l'action terroriste. Le sacrifice d'Ivan Kaliaïev semble magnifié par son propre discours, mais on y perçoit des failles soulignées par son intransigeance. Dora, portée par la même logique, mettra sur un piédestal l'acte de Kaliaïev…
La suite des évènements en Russie nous amène à porter un regard critique et lucide sur l'engagement d'hommes comme Kalaïev.
Ce cadre historique sert de support à la pièce de Camus.
Les membres du groupe terroriste sont a priori motivés par la même cause : mettre fin à l'exploitation du peuple russe. Les discussions entre eux sont cependant animées.
Camus nous invite à réfléchir sur la notion de justice, et sur la légitimité de l'action terroriste. Le sacrifice d'Ivan Kaliaïev semble magnifié par son propre discours, mais on y perçoit des failles soulignées par son intransigeance. Dora, portée par la même logique, mettra sur un piédestal l'acte de Kaliaïev…
La suite des évènements en Russie nous amène à porter un regard critique et lucide sur l'engagement d'hommes comme Kalaïev.
Poursuite de ma découverte de l'univers de Camus avec ma co-lectrice Srafina. On s'attèle cette fois-ci à sa pièce de théâtre Les Justes, qu'un ami babeliote m'avait recommandée.
Je retrouve ici le plaisir d'une lecture simple, dans le sens épurée, et directe. Je m'étonne d'utiliser le terme « plaisir » car je ne peux pas dire que le sujet ou la plume m'aient enthousiasmés. Mais je réalise cependant que je l'ai lu avec avidité : les pages se tournent très vite, on a envie de savoir et de comprendre.
Et c'est une fois de plus une lecture qui questionne et interpelle sur un sujet plutôt sombre et malheureusement intemporel.
Car ici, Camus met en scène un évènement réel qui s'est produit par le passé, en 1905 en Russie, à savoir l'assassinat du Grand-Duc Serge par des terroristes du parti socialiste révolutionnaire. Une situation qui peut aisément être transposée à d'autres évènements similaires et plus contemporains.
La question qui se pose dans cette pièce est de savoir si une cause, aussi juste soit-elle, justifie-t-elle de passer par le meurtre ?
Il présente pour cela des protagonistes très différents qui s'appuient pour certains sur la haine, pour d'autres sur l'espoir et même l'amour pour légitimer leurs actes.
Tous n'ont pas cependant la même réaction lorsqu'ils sont confrontés au choix de condamner ou pas des enfants dans cet attentat. Suivant leurs vécus, et sans doute aussi leur part d'humanité non détruite, les points de vue divergent sur les limites à prendre.
C'est une chose d'être un Juste, de se livrer corps et âme à une cause au dépend de sa vie, il en est une autre d'être aussi despotique que le despote combattu.
Le lecteur est ainsi balloté tout au long de la lecture, entre des moments d'empathie envers ces personnages qui souffrent et qui veulent défendre une cause juste, et des moments de révolte et d'antipathie face aux décisions prises et aux discours menant à ces actes graves et irréversibles. Que la nature humaine est complexe…
Je ne dirai pas que j'ai passé un bon moment de lecture avec Camus, mais je suis contente de l'avoir lu. Je reconnais avoir apprécié les réflexions que cette lecture a suscité. Les échanges et discussions avec Srafina y sont pour beaucoup, un grand merci à elle.
Je retrouve ici le plaisir d'une lecture simple, dans le sens épurée, et directe. Je m'étonne d'utiliser le terme « plaisir » car je ne peux pas dire que le sujet ou la plume m'aient enthousiasmés. Mais je réalise cependant que je l'ai lu avec avidité : les pages se tournent très vite, on a envie de savoir et de comprendre.
Et c'est une fois de plus une lecture qui questionne et interpelle sur un sujet plutôt sombre et malheureusement intemporel.
Car ici, Camus met en scène un évènement réel qui s'est produit par le passé, en 1905 en Russie, à savoir l'assassinat du Grand-Duc Serge par des terroristes du parti socialiste révolutionnaire. Une situation qui peut aisément être transposée à d'autres évènements similaires et plus contemporains.
La question qui se pose dans cette pièce est de savoir si une cause, aussi juste soit-elle, justifie-t-elle de passer par le meurtre ?
Il présente pour cela des protagonistes très différents qui s'appuient pour certains sur la haine, pour d'autres sur l'espoir et même l'amour pour légitimer leurs actes.
Tous n'ont pas cependant la même réaction lorsqu'ils sont confrontés au choix de condamner ou pas des enfants dans cet attentat. Suivant leurs vécus, et sans doute aussi leur part d'humanité non détruite, les points de vue divergent sur les limites à prendre.
C'est une chose d'être un Juste, de se livrer corps et âme à une cause au dépend de sa vie, il en est une autre d'être aussi despotique que le despote combattu.
Le lecteur est ainsi balloté tout au long de la lecture, entre des moments d'empathie envers ces personnages qui souffrent et qui veulent défendre une cause juste, et des moments de révolte et d'antipathie face aux décisions prises et aux discours menant à ces actes graves et irréversibles. Que la nature humaine est complexe…
Je ne dirai pas que j'ai passé un bon moment de lecture avec Camus, mais je suis contente de l'avoir lu. Je reconnais avoir apprécié les réflexions que cette lecture a suscité. Les échanges et discussions avec Srafina y sont pour beaucoup, un grand merci à elle.
En 1905, en Russie, deux terroristes préparent un attentat contre le grand duc. Stepan incarne le révolutionnaire froid, sans états d'âme, qui n'aime pas la vie et est prêt à tout sacrifier à un idéal théorique (l'avenir selon Camus ?). Il méprise Kaliayev, un poète idéaliste aimé de Dora qui croit en "la révolution pour la vie".
Le jour prévu de l'attentat, Kalyev ne peut lancer la bombe car deux enfants se trouvent avec le grand duc, il se veut "justicier" mais non "assassin". Stepan ne comprend pas car pour lui, la Révolution permettra se sauver l'humanité, alors que représentent deux enfants ? Il faut sauver l'humanité malgré elle, lui imposer la Révolution. Kaliayev jette la bombe deux jours plus tard, il est arrêté et refuse de dénoncer ses complices. Dora, sa fiancée a des doutes. L'idéal politique vaut-il le sacrifice du bonheur ? Donner la mort permettra-il d'accoucher d'un monde meilleur ?
Le jour prévu de l'attentat, Kalyev ne peut lancer la bombe car deux enfants se trouvent avec le grand duc, il se veut "justicier" mais non "assassin". Stepan ne comprend pas car pour lui, la Révolution permettra se sauver l'humanité, alors que représentent deux enfants ? Il faut sauver l'humanité malgré elle, lui imposer la Révolution. Kaliayev jette la bombe deux jours plus tard, il est arrêté et refuse de dénoncer ses complices. Dora, sa fiancée a des doutes. L'idéal politique vaut-il le sacrifice du bonheur ? Donner la mort permettra-il d'accoucher d'un monde meilleur ?
Les justes raconte l'histoire d'un groupe de Russes qui ont décidé de commettre un attentat à la bombe contre le grand-duc afin de libérer la Russie de l'oppression. Il s'agit d'une pièce de théâtre basée sur un fait historique. Elle se lit très vite, il y a à peine 150 pages et sous forme de pièce, ça se lit toujours rapidement. Les dialogues sont savoureux, pleins de fougue, d'émotion. On a toujours envie de la lire à voix haute. Les textes sont superbes, ce sont de belles diatribes sur l'honneur, la justice, la liberté, l'amour, la mort, etc. Ce sont de ces textes qui font un peu enfler le coeur et gonfler le torse. Et la fin... une fin bien savoureuse dans le genre du théâtre, et conséquente au reste du texte. J'aurais adoré voir cette pièce jouée sur scène, et c'est bien là qu'on voit la richesse du théâtre, c'est quand on a envie de voir la pièce.
C'est une pièce de théâtre que j'ai lu lorsque j'étais au lycée il me semble, donc ça commence à faire un bout. J'en ai très peu de souvenirs précis mais je me rappelle que j'avais beaucoup aimé et que je l'avais lu très rapidement. le théâtre est un genre que j'aime beaucoup lire et cette pièce-ci m'avait pas mal marquée parmi celles que j'avais pu lire à l'école. Je me rappelle que ce livre m'avait plus fait l'effet d'un roman structurée comme une pièce de théâtre, c'était très moderne.
C'est une pièce que je conseillerais à toute personne désireuse de lire du théâtre sans en avoir jamais fait l'expérience.
C'est une pièce que je conseillerais à toute personne désireuse de lire du théâtre sans en avoir jamais fait l'expérience.
A lire les Justes, dans la collection FolioPlus classiques (2010), ce qui m'a vraiment intéressée, outre la pièce, c'est le rapprochement qu'Agnès Verlet établit, après la présentation du texte intégral, entre un petit tableau peint par Fautrier en 1944, Tête d'otage, et la pièce de Camus, travaillée entre 1946 et 1949 et présentée la première fois au théâtre Hébertot. La figure de l'otage, sujet de l'oeuvre de Fautrier qui orne la couverture de l'opuscule et qui fait l'objet de l'analyse, prend un relief saisissant après la lecture de la pièce, comme la pièce de Camus se trouve éclairée d'une lumière plus crue par ce rapprochement. La genèse du tableau et celle de la pièce renvoient l'une et l'autre à un contexte identique : la Résistance.
Jean Fautrier (1898-1964) peint pendant la guerre à Châtenay-Malabry (La Vallée-aux-Loups, où Chateaubriand s'était fixé au début du XIXe siècle), lieu de résistance et de répression. De cette époque naît sa mutation artistique. A côté de "Tête d'otage" il produit des tableaux tels que : "Corps d'otage", "Fusillé", "Ecorché", "Otage aux mains", "Oradour" etc. Camus a perdu de nombreux amis pendant cette période. Les deux oeuvres, à peu de distance, se font l'écho d'une seule et unique tragédie dont les visions déchirantes ont hanté leurs auteurs. Elles continuent d'ailleurs peut-être d'habiter les temps présents. Jusqu'où peut-ont suivre un idéal politique ? Résistants ou terroristes, où se situe la frontière ? La fin justifie-t-elle tous les moyens ? Telles sont, entre autres questions, quelques unes de celles soulevées par Camus dans cette pièce, où la certitude (Stepan) toise le doute (Kaliayev), et qui sont approfondies par Sophie Doudet dans le dossier très complet joint à cette édition.
La figure isolée et anonyme de l'otage dont le regard abîmé a disparu dans la pâte épaisse brutalisée par le couteau de Fautrier pose avec une acuité douloureuse la question de la justification de la terreur aveugle qui fait des victimes et des otages innocents ; le doute de l'anarchiste lui fait écho. Il traverse avec force le texte court, dense et limpide de Camus, dont l'intrigue se noue autour de la préparation d'un attentat contre le grand duc de Russie, et est assumé particulièrement courageusement par le personnage de Kaliayev. Son geste de "terroriste", retenu par le regard d'un enfant est la réponse au "cri de peinture" de Fautrier. Par-delà la révolution russe de 1905 qui sert de toile de fond à la pièce et le souvenir brûlant des années de guerre, le regard détruit de l'otage de Fautrier et celui de l'enfant qui a ému Kaliayev dans la pièce de Camus, s'unissent aujourd'hui en une humanité vibrante toujours capable de questionner l'actualité.
Jean Fautrier (1898-1964) peint pendant la guerre à Châtenay-Malabry (La Vallée-aux-Loups, où Chateaubriand s'était fixé au début du XIXe siècle), lieu de résistance et de répression. De cette époque naît sa mutation artistique. A côté de "Tête d'otage" il produit des tableaux tels que : "Corps d'otage", "Fusillé", "Ecorché", "Otage aux mains", "Oradour" etc. Camus a perdu de nombreux amis pendant cette période. Les deux oeuvres, à peu de distance, se font l'écho d'une seule et unique tragédie dont les visions déchirantes ont hanté leurs auteurs. Elles continuent d'ailleurs peut-être d'habiter les temps présents. Jusqu'où peut-ont suivre un idéal politique ? Résistants ou terroristes, où se situe la frontière ? La fin justifie-t-elle tous les moyens ? Telles sont, entre autres questions, quelques unes de celles soulevées par Camus dans cette pièce, où la certitude (Stepan) toise le doute (Kaliayev), et qui sont approfondies par Sophie Doudet dans le dossier très complet joint à cette édition.
La figure isolée et anonyme de l'otage dont le regard abîmé a disparu dans la pâte épaisse brutalisée par le couteau de Fautrier pose avec une acuité douloureuse la question de la justification de la terreur aveugle qui fait des victimes et des otages innocents ; le doute de l'anarchiste lui fait écho. Il traverse avec force le texte court, dense et limpide de Camus, dont l'intrigue se noue autour de la préparation d'un attentat contre le grand duc de Russie, et est assumé particulièrement courageusement par le personnage de Kaliayev. Son geste de "terroriste", retenu par le regard d'un enfant est la réponse au "cri de peinture" de Fautrier. Par-delà la révolution russe de 1905 qui sert de toile de fond à la pièce et le souvenir brûlant des années de guerre, le regard détruit de l'otage de Fautrier et celui de l'enfant qui a ému Kaliayev dans la pièce de Camus, s'unissent aujourd'hui en une humanité vibrante toujours capable de questionner l'actualité.
Mourir pour ses idées… Mourir pour la liberté. Ne plus supporter l'injustice, vouloir d'un monde meilleur. Voilà ce que nous raconte Camus dans cette pièce de théâtre, nous faisant rentrer dans la tête de ces socialistes Russes.
Un groupe de révolutionnaires russes prépare un attentat à l'encontre du grand Duc. Cela fait des mois qu'ils attendent le bon moment, mais le jour fatidique les évènements ne se dérouleront pas comme prévus. Tuer pour sauver la nation, oui, mais pour cela nécessite-t-il d'ôter la vie à des êtres innocents au risque de passer pour des criminels et non pour des libérateurs de ce joug tyrannique ?
Les personnages sont des rêveurs, des idéalistes, mais aussi des révoltés face à ce régime oppressant. En optant pour la mise à mort de ce dictateur, ils sont convaincus que cela soulagera la Russie de ce despotisme ambiant. C'est d'une Russie en paix qu'ils souhaitent tous, une nouvelle nation où le peuple vit enfin en paix, délivré de la misère et de la mort de leurs enfants.
Un groupe de révolutionnaires russes prépare un attentat à l'encontre du grand Duc. Cela fait des mois qu'ils attendent le bon moment, mais le jour fatidique les évènements ne se dérouleront pas comme prévus. Tuer pour sauver la nation, oui, mais pour cela nécessite-t-il d'ôter la vie à des êtres innocents au risque de passer pour des criminels et non pour des libérateurs de ce joug tyrannique ?
Les personnages sont des rêveurs, des idéalistes, mais aussi des révoltés face à ce régime oppressant. En optant pour la mise à mort de ce dictateur, ils sont convaincus que cela soulagera la Russie de ce despotisme ambiant. C'est d'une Russie en paix qu'ils souhaitent tous, une nouvelle nation où le peuple vit enfin en paix, délivré de la misère et de la mort de leurs enfants.
Après les livres forêts de mots où un lecteur même aguerri se perd cent fois, voici un texte bien sec, bien élagué, mais sans pour autant être moins fort.
Ces Justes sont à mettre dans les mains de tout élève-étudiant-apprenti de la vie, un livre qui ouvre aux discussions, aux réflexions, aux confrontations, bref qui fait grandir.
La violence et la mort, la terreur et la résistance, sont et resteront encore longtemps des sujets actuels. Ce livre est et sera encore longtemps actuel.
Id est.
Ces Justes sont à mettre dans les mains de tout élève-étudiant-apprenti de la vie, un livre qui ouvre aux discussions, aux réflexions, aux confrontations, bref qui fait grandir.
La violence et la mort, la terreur et la résistance, sont et resteront encore longtemps des sujets actuels. Ce livre est et sera encore longtemps actuel.
Id est.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Albert Camus (102)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz sur l´Etranger par Albert Camus
L´Etranger s´ouvre sur cet incipit célèbre : "Aujourd´hui maman est morte...
Et je n´ai pas versé de larmes
Un testament sans héritage
Tant pis
Ou peut-être hier je ne sais pas
9 questions
4802 lecteurs ont répondu
Thème : L'étranger de
Albert CamusCréer un quiz sur ce livre4802 lecteurs ont répondu