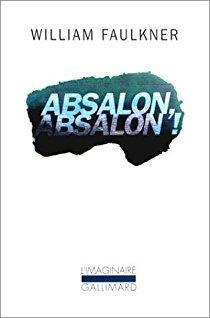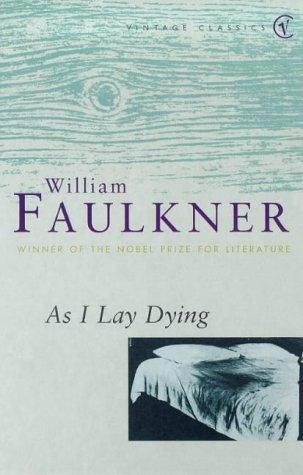Dès la première phrase, on comprend que l'on vient d'ouvrir la porte d'un monument littéraire. Autant en emporte le vent pou les grands. La guerre de sécession comme on ne l'a jamais dite, le racisme qui coule dans le sang des petits blancs, leur monde qui s'effondre sans qu'ils vascillent, prêts à renaître après l'incendie. On entend derrière les mots grommeler un Faulkner groggy de désespérance, un auteur qui comme d'habitude n'aide pas son lecteur en choisissant la narration indirecte par les voix entrecroisées, auxquelles il semble mêler la sienne, de tante Rosa et d'un descendant pour raconter la terrible histoire du non moins terrible Stupen, sa détermination clinique à braver son destin et construire un empire dans le sud, sa relation complexe à l'autre et à la race, ses chutes et résurrections.
Au-delà de cette folle histoire, c'est réellement par l'écriture fascinante, lourde, hypnotique que Faulkner nous plonge avec lui dans l'ADN d'une certaine Amérique toujours bien vivante, elle.
Au-delà de cette folle histoire, c'est réellement par l'écriture fascinante, lourde, hypnotique que Faulkner nous plonge avec lui dans l'ADN d'une certaine Amérique toujours bien vivante, elle.
Que c'est alambiqué et compliqué inutilement. Pourquoi une telle torture intellectuelle pour finalement raconter une histoire prévisible dès les premières pages? Et ces phrases interminables qui n'en finissent pas, un peu comme si l'auteur avait pris le parti de rendre complexe et incompréhensible des événements presque cousus de fil blanc.. le style ampoulé et exagérément mystérieux finit par nuire à l'ensemble. Trop scabreux pour moi. Et je ne vois pas franchement l'intérêt de m'accrocher jusqu'au bout par orgueil ou par fierté de pouvoir dire que cette lecture fut pénible mais géniale. Ce n'est malheureusement pas le cas.
Absalom ! Absalom ! c'est un livre d'une beauté extraordinaire, un roman grandiose qui respire la haine, la douleur et la tragédie. On le comprend au bout de quelques pages et celui qui connait Absalom, le sait avant même de commencer, car le titre est une référence biblique : Absalom était le fils préféré du roi David.
Sud des États-Unis au temps de la Guerre de Sécession à laquelle l'écrivain nous a habitués et qui encadre les événements de la famille Sutpen, de l'ascension de l'ancêtre Thomas à sa ruine complète et celle de ses descendants, (enfants légitimes et d'enfants répudiés). L'histoire s'étend sur une période de près de cent ans, au cours de laquelle plusieurs générations se déplacent dans une multitude de plans temporels décalés, confus et difficiles à comprendre, que seul un maître comme Faulkner pourrait créer et dominer avec une maîtrise audacieuse.
Une palette de personnages inoubliables, blancs, noirs, métis, enfants légitimes, enfants bâtards et une infinité de sujets comme l'inceste, le racisme, l'esclavage infâme, l'humiliation, la perdition, la vengeance. Au-dessus de tout se dresse la haine couvée pendant des années, jusqu'à l'explosion, jusqu'au drame. Et la confusion qui nous prend de ne pas pouvoir comprendre qui parle et de quoi nous parlons, typique de Faulkner, ne nous inquiète pas parce que nous avons confiance en l'écrivain, nous sommes sûrs qu'il finira par tirer sur chaque fil de l'écheveau et tout nous paraîtra clair.
Avec ce roman, Faulkner montre au monde ce qu'on peut faire de l'écrit, nous submerge d'un courant de conscience sans règle lexicale, se sert d'incisions très longues, d'incisions dans les incisions, d'accolades qui se nichent et de si longues périodes que pour trouver un point il faut tourner la page.
Ce n'est pas de l'exhibitionnisme lexical - d'accord il est passé maître là-dedans aussi – mais, je le répète, ce n'est pas un exercice d'écriture, car derrière ses mots il y a des personnages en chair et en os, perdus, désespérés, trompés, meurtriers, victimes et bourreaux à la fois.
Toute la grandeur de Faulkner est dans ce roman...
Lien : http://holophernes.over-blog..
Sud des États-Unis au temps de la Guerre de Sécession à laquelle l'écrivain nous a habitués et qui encadre les événements de la famille Sutpen, de l'ascension de l'ancêtre Thomas à sa ruine complète et celle de ses descendants, (enfants légitimes et d'enfants répudiés). L'histoire s'étend sur une période de près de cent ans, au cours de laquelle plusieurs générations se déplacent dans une multitude de plans temporels décalés, confus et difficiles à comprendre, que seul un maître comme Faulkner pourrait créer et dominer avec une maîtrise audacieuse.
Une palette de personnages inoubliables, blancs, noirs, métis, enfants légitimes, enfants bâtards et une infinité de sujets comme l'inceste, le racisme, l'esclavage infâme, l'humiliation, la perdition, la vengeance. Au-dessus de tout se dresse la haine couvée pendant des années, jusqu'à l'explosion, jusqu'au drame. Et la confusion qui nous prend de ne pas pouvoir comprendre qui parle et de quoi nous parlons, typique de Faulkner, ne nous inquiète pas parce que nous avons confiance en l'écrivain, nous sommes sûrs qu'il finira par tirer sur chaque fil de l'écheveau et tout nous paraîtra clair.
Avec ce roman, Faulkner montre au monde ce qu'on peut faire de l'écrit, nous submerge d'un courant de conscience sans règle lexicale, se sert d'incisions très longues, d'incisions dans les incisions, d'accolades qui se nichent et de si longues périodes que pour trouver un point il faut tourner la page.
Ce n'est pas de l'exhibitionnisme lexical - d'accord il est passé maître là-dedans aussi – mais, je le répète, ce n'est pas un exercice d'écriture, car derrière ses mots il y a des personnages en chair et en os, perdus, désespérés, trompés, meurtriers, victimes et bourreaux à la fois.
Toute la grandeur de Faulkner est dans ce roman...
Lien : http://holophernes.over-blog..
ABSALON ABSALON de WILLIAM FAULKNER
Un récit à plusieurs voix qui, au fil de la lecture, dévoile l'histoire de Sutpen, arrivé de nulle part, qui achète de la terre et construit une maison. C'est le sud avec sa violence, ses obsessions, sa noirceur, dépeint par un Faulkner au sommet de son art. Un récit hypnotique, une plongée en apnée dont on ressort épuisé. Difficile de lire un autre livre après du Faulkner.
Un récit à plusieurs voix qui, au fil de la lecture, dévoile l'histoire de Sutpen, arrivé de nulle part, qui achète de la terre et construit une maison. C'est le sud avec sa violence, ses obsessions, sa noirceur, dépeint par un Faulkner au sommet de son art. Un récit hypnotique, une plongée en apnée dont on ressort épuisé. Difficile de lire un autre livre après du Faulkner.
Quelque chose ne va pas dans (ce) Faulkner, et cette critique s'efforcera, sans le savoir d'avance, d'exprimer ce dont il s'agit.
On ne peut pas reprocher à un roman, je pense, la singulière littérarité qui en fait une oeuvre, c'est-à-dire une pièce d'art, au style distinct et ouvragé, élaborée : c'est un livre d'auteur véritable et original, que caractérise une fluence particulière et reconnaissable, un pléthorisme plutôt mathématique de la syntaxe, où les incises variées se juxtaposent sans souci de priorité thématique, où surabondent des détails de circonstances, où des développements de théorème s'encastrent selon des lois pratiques de comptables, où le travail des insertions et encastrements implique un calcul de binarités, où la complémentation de phrase devient une habitude qui tend à soustraire la simplicité de la beauté, où les inclusions, intégrations et accumulations servent un goût d'allongement où la loquacité presque complaisante frôle la verbosité superflue. Toutes ces exacerbations, chez le lecteur philologue, créent perplexité et soupçon, car elles confinent au déploiement d'épate, au point qu'il n'est pas douteux que l'auteur lui-même se soit contraint à reporter, ici ou là, comme une retenue, la proposition principale. Ces périodes arrêtées, dont la fixation traduit comme un arbitraire de pseudo-audace et de caractérisation, bien qu'assez fines pour ne jamais confiner à l'asphyxie (si Faulkner à un génie, c'est celui de la dose-limite ; il a la science de la posologie où le lecteur s'estime instruit et élevé de sa patience sans pour autant se trouver épuisé de multiplications circonstancielles – c'est très malin, cette façon d'aller à la rencontre d'un public de culture qui ne soit pas encore un public de niche, pas aussi rare), constituent, par le dessin de leurs arabesques et la densité qu'elles suggèrent, pour le lecteur un additif typique à la sensation de profondeur, et pour l'auteur sans doute un repère idéal de haut style. Or, c'est également, comme tout effet qu'un écrivain a trouvé et dont il ne se sépare plus, une sorte de tic ou de méthode, un procédé traduisant une image personnelle à rendre (peut-être l'image de sagesse que confère la réalisation d'une certaine complication vaine) ou un système déterminé à ne pas déroger (c'est une expérience commune, quand on s'est reconnu une patte en des figures récurrentes, de craindre d'en changer et d'attribuer le principal de sa confiance à la perpétuation de procédés identiques) plutôt qu'un moyen de vérité ou de transmission, et ce mécanisme de complémentation figure en maints endroits une technique manifestement inutile et probablement forcée, sans autre apport qu'un maniérisme et qu'une démonstration, et même une entrave au message, trop ostentatoire, un leurre peut-être, une illusion de bravoure en ce que ces amples rebonds, ces phrases perpétuellement relancées, renvoient un peu facilement à une représentation de profondeur comme les euphuismes de Shakespeare, confortant l'auteur lui-même, que je soupçonne d'avoir été au moins aussi finaud que fin, dans une posture d'artiste novateur, tandis qu'à bien y regarder ces longues prothèses syntaxiques, qui ne sont pas si ardues à produire et nécessitent plus de science et de patience que de sensibilité et de poésie, ne servent guère au sens, sinon, d'artifice ou d'autorité, en induisant une sensation d'épanchement intarissable, un sentiment d'irrépressible humanité, une conception de ductilité fatidique de la parole, sans parler de la théorie absolument fausse d'une transcription de l'oralité, théorie que, dans notre monde d'universitariens artificiels et appesantis, il est impossible qu'un microcosme aussi savant qu'artificieux n'ait pas reconnue. Il est d'usage, particulièrement chez les auteurs que des usages ont salués et installés dans le respect inconditionnel de la postérité, parmi ceux où l'on traque les valeurs bien davantage que la réalité des vices et des vertus, de confondre le haut style avec une syntaxe simplement allongée, de fabriquer de la profondeur spirituelle sur un fonds d'emphases et d'hypotaxes, d'indissocier définitivement l'envol supposé des pensées avec les excès de l'expression – où le génie ne devrait pas nécessairement appartenir à celui qui épate et qui enfle, à mon avis, mais je ne veux, à ce stade de mon article, rien présumer de Faulkner lui-même. Seulement, je remarque que l'indéniable méticulosité de son style et de son vocabulaire, qualité irréfragable de l'écrivain qui compose et élabore, s'accompagne malgré tout de superfétations caractérisées qui ne semblent souvent servir qu'à marquer l'idiosyncrasie à la façon des impressionnistes ou des pointillistes, qu'à insister sur la singularité à la façon des nouveaux-romanciers, qu'à induire l'idée d'une rupture à la façon des conceptualistes, mais sans nets apports expressifs ou spirituels – comme on trouva moderne et opportun de procéder dès la fin du XIXe siècle et en tous arts après avoir constaté les triomphes de la publicité dans une florissante et superficielle société de consommation où lançage et tapage attiraient bien plus l'attention que la qualité et l'effort. Et, en l'occurrence, j'affirme qu'il n'est pas vraisemblable qu'un esprit ait développé le style de ce Faulkner à l'imitation d'un sentiment intime et d'une nécessité impérieuse, il s'y mêle trop de factice, d'abruption, d'incohérence, d'inconséquence, en un mot appliqué ici à l'esprit de « solution de continuité », en décalage avec les ressorts (psycho)logiques de l'imagination et du langage, et que d'ailleurs c'est régulièrement qu'on peut percevoir, examiner et démontrer la façon dont l'écrivain, arrivant au bout de son période mental, s'efforce d'y adjoindre par contrainte une multitude de propositions circonstancielles sans qu'elles y apportent plus, à cet endroit d'essoufflement précis, qu'une parure relative et qu'une unifiante référence – comme, disais-je, une tentative de style qui aurait finalement bien pris, stratagème d'entre-deux ou d'après-guerre valorisé par une époque entichée de mode et dont le clinquant relatif faisait les engouements et les succès populaires ou critiques – ; Faulkner me paraît en cela aussi un poseur, « aussi » c'est-à-dire : sans exclusion de talent.
Quant à la composition, Absalon, Absalon ! relève sans conteste d'une intrigue fouillée et intelligemment mise en scène, difficile et subtile, délicate, abondante d'intentions et de défis, avec sa succession de narrateurs parvenant à compléter par révélations successives et insérées astucieusement, la relation d'une vie, celle de Thomas Sutpen, dont la brutale irruption dans un village du sud des États-Unis évoque les entités sombres et inhumaines, instables et torturées, de créatures des Brontë ou de Conrad, je pense à Heathcliff et à Kurtz, à Lord Jim ou à James Durie chez Stevenson. La progression, extrêmement soignée et planifiée, livre de façon comme involontaire et fortuite, les secrets du protagoniste, ses motifs profonds, ses recels d'expériences et de frustration, ses excuses l'ayant mené aux entreprises hardies et a priori incompréhensibles qu'on constate au début du roman, en un récit achronologique qui établit les causes principales et de plus en plus intimes de son caractère, et qui explique une partie de ses bizarreries et de ses violences, mais, exactement à l'instar des personnages que j'ai cités, sans éclaircir foncièrement toutes ses réactions et la tournure étrangère, imprévisible et démoniaque, de son esprit intrus. C'est alors par besoin d'auteur et probablement encore par astuce que se mêle au portrait de ces sombreurs que l'intégralité de leur histoire ne suffit à circonvenir un ingrédient supplémentaire, en l'espèce d'une destinée, d'une force maudite, d'une tension de paria, qui est malgré tout un instrument trop commode et devrait censément excuser les développements peu crédibles d'une personnalité. Car, en somme, ni Sutpen, ni Heatcliff, ni Kurtz, ni Lord Jim et ni James Durie ne sont ni ne seront véritablement ou même profondément expliqués ; ce que leur relation apprend au lecteur ne justifie pas ce qu'ils sont devenus ni comment ils se comportent, leur intrinsèque inhumanité, leur altérité ou leur aliénité (si l'on me pardonne cette création), tandis que le roman s'était initialement proposé leur peinture éclairante, incapable in fine de tenir sa promesse : on prétendra que le personnage « déborde la fiction » et qu'il a pris telle consistance et telle densité qu'il échappe à l'emprise de son auteur et du récit, qu'il a surgi dans le monde des hommes en quittant celui des personnages circonscrits à force de vraisemblance, et ce sera alors un joli mot de piètre critique, dans une analyse favorablement prévenue, que d'affirmer la preuve que le personnage est supérieurement développé puisqu'il devient alors un être qu'il est impossible « comme dans la réalité » (à ce qu'on veut croire) de définir tout à fait par le récit et la somme de ses expériences, belle vantardise littéraire ! Mais d'autres plus profonds et plus justes auront des scrupules à soutenir de pareilles naïvetés, voyant que pas davantage Fitzgerald n'explique Gatsby, et que la manière dont l'écrivain achoppe à tenir la cohérence d'un protagoniste dont l'oeuvre repose a priori sur l'intérêt d'un mystère progressivement dévoilé et d'une explicitation complète d'un individu constitue une inaptitude et une déception, un aveu d'échec ou plutôt une dissimulation d'échec, en somme que l'auteur a failli à son propre but que rien ni personne ne l'obligeait à fixer : ce n'est pas, au contraire de ce qu'on vante, que le personnage fut si finement tracé qu'il est devenu plus vrai que nature et ainsi ne peut plus trouver d'explication dans le cadre même du récit et de la conscience de son propre créateur (parce qu'il aurait, en quelque sorte, évolué par lui-même et acquis une réalité autonome en-dehors de la conception du démiurge) – cette vision romantique n'a rien de technique ou de critique, elle considère par défaut que le personnage est une conscience, c'est une vision poétique, symboliste et puérile qui fait fit de toute notion narratologique et créative –, mais c'est que l'auteur n'a pas tenu les rênes de son projet en se cantonnant aux règles de vraisemblance, car en vérité cet être de papier n'existe pas davantage à dépasser les normes de la psychologie et de la cohérence humaines, bien au contraire il existe moins, il est moins un individu et plus une convention, il devient une représentation et un acteur puisqu'il n'a pas de causalité à la différence d'une personne véritable (car au monde, foin des mièvreries ! il n'existe pas de mentalité sans étroite cohérence c'est-à-dire de psychologie inexplicable), il est surtout un rôle que le dramaturge n'est pas parvenu à rendre plausible, dont il a oublié ou abandonné la peinture de pans si vastes et nécessaires que le portrait est demeuré inachevé par bien des morceaux auxquels il accorde in extremis le nom de « mystères » pour se rattraper : et par quelle complaisance se satisfaire que le tableau expose la trame blanche de la toile non peinte au prétexte qu'ainsi on ignore davantage le sujet présenté, qu'on le perçoit moins net, ce qui correspondrait, pour les gens ignorants ou incurieux de la vie, au caractère de tout sujet réel ? Si l'on se propose à composer une mélodie comme on dresse avec art une méticuleuse et exacte description, ce n'est sans doute pas pour finir par indiquer qu'on ne sait pas à quoi sert telle mesure ou telle note, que la symphonie est essentiellement un hasard, et que c'est d'ailleurs une preuve de perfection qu'on ne puisse pas expliquer comment elle est construite et se justifie puisque « dans la nature » rien ne précise l'origine des sons. C'est une question de cohérence et de fidélité à un projet : si en particulier un romancier propose principalement le dévoilement de l'énigme d'un caractère, je n'aurais pas mon compte à ce qu'il arguât que son personnage, dont je ne suis pas dupe qu'il l'a inventé de (presque) toutes pièces, est « à ce point humain et crédible qu'il ne se décèle pas en son entier » car ce n'est rien qu'un personnage, contrairement à l'illusion que l'auteur veut en donner d'une personne réelle dont la compréhension, pour le siècle ordinaire des apparences, ne saurait être absolue, quelles que soient les analogies de vérités qu'il sert dans son livre pour entretenir une semblable illusion d'authenticité. Ici, on lit, page 127 : « Oui, Judith, Bon, Henry, Sutpen, tous autant qu'ils sont. Les voilà tous, mais il manque quelque chose : on dirait une formule chimique exhumée en même temps que les lettres de ce coffre oublié, avec précaution, le papier ancien et passé tombant en morceaux, l'écriture passée, presque indéchiffrable, mais significative, familière dans sa forme et son sens, disant le nom et la présence de forces instables et vivantes ; on les mélange dans les proportions requises, mais rien ne se produit ; on relit la formule, lentement, attentivement, pour s'y absorber et s'assurer qu'on n'a rien oublié, qu'on ne s'est pas trompé dans ses calculs ; on mélange de nouveau et, de nouveau, rien ne se produit ; rien que les mots, les symboles, les formes elles-mêmes, indistinctes, énigmatiques et sereines, sur cette toile de fond déclamatoire d'une atroce et sanglante mésaventure humaine. » ; et je pardonne cette insistance à entretenir l'illusion, il n'y a même rien à pardonner puisque la citation s'inscrit elle-même dans l'illusion de la fiction, prêtant aux personnages du roman une indubitable réalité comme s'ils avaient existé et comme s'ils étaient patiemment reconstitués par leurs témoins et successeurs (ce qui est un procédé dont a priori nul n'est dupe), mais, quand il l'écrit, Faulkner sait pertinemment que la seule vérité de cette citation c'est sa généralisation à toute autre chose qu'au roman même qu'il rédige, que le seul univers auquel il est certain que cette citation ne peut pas s'appliquer est précisément celui qu'il a fabriqué pour Absalon, Absalon !, et l'on peut l'imaginer sans mal s'amuser de ce mensonge et se dire : « Mais Judith, Bon, Henry et Sutpen tous autant qu'ils ne sont pas, justement ! Hé ! La bonne trouvaille que d'en faire sortir des lettres d'une malle : leurs papiers, ce ne sont que les mots que j'ai, moi, inventés et que j'arbore comme des pièces certifiées, tous ces faux en écriture ! » Ainsi, son personnage est bel et bien création et composition et non transposition ou témoignage, et si son dessein est de ramener au domaine de la vraisemblance un être de fiction dont les attitudes sont d'emblée inexplicables, alors il est logique de considérer que toute l'oeuvre doit être, du point de vue des motivations, une démonstration de rigueur et de contrôle, au même titre que Les quatre saisons de Vivaldi ne peut se permettre d'inclure un nombre essentiel de sonorités qui n'empruntent rien à la nature que son projet consiste à imiter. Dès lors, l'excuse du personnage qui serait « devenu si réel qu'il ne trouve pas d'explication » trompe et entourloupe, c'est une façon de jouer sur plusieurs plans et d'abuser ensuite de la confusion du lecteur et de son oubli de l'intention initiale, car ou bien l'auteur proposait autre chose que le dévoilement d'un personnage, proposant par exemple la livraison « telle quelle » d'une mentalité plausible et largement obscure, et alors il a eu tort de focaliser l'attention sur des énigmes qu'il a progressivement levées, ou bien dans son projet d'explicitation d'une étrange humeur il a failli à en identifier les causes, se laissant déborder par l'ampleur du caractère qu'il souhaitait d'emblée dépeindre et qu'il n'a pas réussi à démêler, et alors il a eu tort de vouloir passer son incapacité, son insuffisance, son renoncement et sa déception en la vraisemblance selon quoi « un homme réel ne saurait entièrement se définir » ; autrement dit, ou bien il inclut un personnage relativement arbitraire dans la fiction comme une personne surgissant impromptue dans l'existence, ou bien il propose l'examen méthodique de ce personnage réaliste dont il fait le sujet même de sa fiction, mais, en l'occurrence, Faulkner, après avoir imité le psychologue et l'analyste, finit par abandonner la gageure qu'il s'est fixée en s'écriant : « la psychologie et l'analyse sont dérisoires à remonter l'origine de cet homme… et voilà qui est heureux ! » : pétition de principe où il finit par admettre la réalité d'un homme qu'il n'est pas parvenu à créer dans toute sa vraisemblance… oui, ça semble une sagesse ainsi dit, ce miracle du personnage qui, indéfinissable au juste, prend vie, à l'exception que c'est lui qui a fabriqué son sujet, ce qu'il ne faut tout de même pas oublier !
Car enfin, il faut y insister, Sutpen pas davantage que la plupart des autres personnages du roman n'est expliqué de façon satisfaisante, il n'est pas crédible d'un point de vue humain, il ne s'élabore pas, au bout du compte, comme une mentalité cohérente, toutes ses péripéties ne traduisent pas une volonté intègre et constante et aucune ne justifie ce qu'il est devenu, au point que ce qu'il reste de plus fascinant chez cette figure – comme chez Heathcliff, Kurtz, Lord Jim, James Durie et peut-être Gatsby (je ne sais plus) – c'est leur dimension absurde et arbitraire, c'est la façon dont le drame romanesque, en un maniérisme excessif, introduit dans des intrigues vraisemblables des éléments irrationnels que le contexte plausible enrobe et emporte, par abus du lecteur sentimental et naïf, ce lecteur décidément sans distance sur ce qu'il fait quand il lit une histoire, ce lecteur sans recul critique ni analyse élémentaire, éléments irrationnels qu'il rapporte dans le tout façonné et relativement plausible d'un univers crédible, feignant de prêter lui-même, auteur, foi aux inventions les plus énormes, comme on échafaude le faux témoignage convaincant à partir de vérités majoritaires auxquelles il ajoute de ponctuels mensonges. Mais ce n'est qu'à la condition de ce sentimentalisme et de cette naïveté principiels justement, que je ne suppose pourtant point l'apanage de la littérature ni le nécessaire pour entrer efficacement dans un récit, que ces héros transportent, que le lecteur se laisse envahir par ces idioties, qu'il abdique son esprit en bienheureuse confiance, et que la mémoire d'une postérité conserve de pareils fantoches comme références, parce qu'ils sont plus que largement bizarres, au même titre que nombre de difformités de Shakespeare ou de Hugo, comme des trésors d'imagination, alors qu'ils ne consistent en fait qu'en des grotesques introduits en semi-tapinois dans la réalité à l'occasion d'un endormissement de vigilance du lecteur. Jamais Sutpen ne donne à l'examen du philologue sérieux une impression de bon aloi et de science, de rigueur : l'obstination même du lecteur à le comprendre ne procède que de cette promesse tacite qu'au terme du roman ses étrangetés seront découvertes et expliquées, faute de cela le lecteur ne s'y intéresserait même pas tant – est-ce qu'on comprend davantage Heathcliff ou Kurtz ? La persistance de l'énigme au-delà du livre, loin de fonder le gage d'une fascinante réussite, est, j'ose le dire, u
Lien : http://henrywar.canalblog.com
On ne peut pas reprocher à un roman, je pense, la singulière littérarité qui en fait une oeuvre, c'est-à-dire une pièce d'art, au style distinct et ouvragé, élaborée : c'est un livre d'auteur véritable et original, que caractérise une fluence particulière et reconnaissable, un pléthorisme plutôt mathématique de la syntaxe, où les incises variées se juxtaposent sans souci de priorité thématique, où surabondent des détails de circonstances, où des développements de théorème s'encastrent selon des lois pratiques de comptables, où le travail des insertions et encastrements implique un calcul de binarités, où la complémentation de phrase devient une habitude qui tend à soustraire la simplicité de la beauté, où les inclusions, intégrations et accumulations servent un goût d'allongement où la loquacité presque complaisante frôle la verbosité superflue. Toutes ces exacerbations, chez le lecteur philologue, créent perplexité et soupçon, car elles confinent au déploiement d'épate, au point qu'il n'est pas douteux que l'auteur lui-même se soit contraint à reporter, ici ou là, comme une retenue, la proposition principale. Ces périodes arrêtées, dont la fixation traduit comme un arbitraire de pseudo-audace et de caractérisation, bien qu'assez fines pour ne jamais confiner à l'asphyxie (si Faulkner à un génie, c'est celui de la dose-limite ; il a la science de la posologie où le lecteur s'estime instruit et élevé de sa patience sans pour autant se trouver épuisé de multiplications circonstancielles – c'est très malin, cette façon d'aller à la rencontre d'un public de culture qui ne soit pas encore un public de niche, pas aussi rare), constituent, par le dessin de leurs arabesques et la densité qu'elles suggèrent, pour le lecteur un additif typique à la sensation de profondeur, et pour l'auteur sans doute un repère idéal de haut style. Or, c'est également, comme tout effet qu'un écrivain a trouvé et dont il ne se sépare plus, une sorte de tic ou de méthode, un procédé traduisant une image personnelle à rendre (peut-être l'image de sagesse que confère la réalisation d'une certaine complication vaine) ou un système déterminé à ne pas déroger (c'est une expérience commune, quand on s'est reconnu une patte en des figures récurrentes, de craindre d'en changer et d'attribuer le principal de sa confiance à la perpétuation de procédés identiques) plutôt qu'un moyen de vérité ou de transmission, et ce mécanisme de complémentation figure en maints endroits une technique manifestement inutile et probablement forcée, sans autre apport qu'un maniérisme et qu'une démonstration, et même une entrave au message, trop ostentatoire, un leurre peut-être, une illusion de bravoure en ce que ces amples rebonds, ces phrases perpétuellement relancées, renvoient un peu facilement à une représentation de profondeur comme les euphuismes de Shakespeare, confortant l'auteur lui-même, que je soupçonne d'avoir été au moins aussi finaud que fin, dans une posture d'artiste novateur, tandis qu'à bien y regarder ces longues prothèses syntaxiques, qui ne sont pas si ardues à produire et nécessitent plus de science et de patience que de sensibilité et de poésie, ne servent guère au sens, sinon, d'artifice ou d'autorité, en induisant une sensation d'épanchement intarissable, un sentiment d'irrépressible humanité, une conception de ductilité fatidique de la parole, sans parler de la théorie absolument fausse d'une transcription de l'oralité, théorie que, dans notre monde d'universitariens artificiels et appesantis, il est impossible qu'un microcosme aussi savant qu'artificieux n'ait pas reconnue. Il est d'usage, particulièrement chez les auteurs que des usages ont salués et installés dans le respect inconditionnel de la postérité, parmi ceux où l'on traque les valeurs bien davantage que la réalité des vices et des vertus, de confondre le haut style avec une syntaxe simplement allongée, de fabriquer de la profondeur spirituelle sur un fonds d'emphases et d'hypotaxes, d'indissocier définitivement l'envol supposé des pensées avec les excès de l'expression – où le génie ne devrait pas nécessairement appartenir à celui qui épate et qui enfle, à mon avis, mais je ne veux, à ce stade de mon article, rien présumer de Faulkner lui-même. Seulement, je remarque que l'indéniable méticulosité de son style et de son vocabulaire, qualité irréfragable de l'écrivain qui compose et élabore, s'accompagne malgré tout de superfétations caractérisées qui ne semblent souvent servir qu'à marquer l'idiosyncrasie à la façon des impressionnistes ou des pointillistes, qu'à insister sur la singularité à la façon des nouveaux-romanciers, qu'à induire l'idée d'une rupture à la façon des conceptualistes, mais sans nets apports expressifs ou spirituels – comme on trouva moderne et opportun de procéder dès la fin du XIXe siècle et en tous arts après avoir constaté les triomphes de la publicité dans une florissante et superficielle société de consommation où lançage et tapage attiraient bien plus l'attention que la qualité et l'effort. Et, en l'occurrence, j'affirme qu'il n'est pas vraisemblable qu'un esprit ait développé le style de ce Faulkner à l'imitation d'un sentiment intime et d'une nécessité impérieuse, il s'y mêle trop de factice, d'abruption, d'incohérence, d'inconséquence, en un mot appliqué ici à l'esprit de « solution de continuité », en décalage avec les ressorts (psycho)logiques de l'imagination et du langage, et que d'ailleurs c'est régulièrement qu'on peut percevoir, examiner et démontrer la façon dont l'écrivain, arrivant au bout de son période mental, s'efforce d'y adjoindre par contrainte une multitude de propositions circonstancielles sans qu'elles y apportent plus, à cet endroit d'essoufflement précis, qu'une parure relative et qu'une unifiante référence – comme, disais-je, une tentative de style qui aurait finalement bien pris, stratagème d'entre-deux ou d'après-guerre valorisé par une époque entichée de mode et dont le clinquant relatif faisait les engouements et les succès populaires ou critiques – ; Faulkner me paraît en cela aussi un poseur, « aussi » c'est-à-dire : sans exclusion de talent.
Quant à la composition, Absalon, Absalon ! relève sans conteste d'une intrigue fouillée et intelligemment mise en scène, difficile et subtile, délicate, abondante d'intentions et de défis, avec sa succession de narrateurs parvenant à compléter par révélations successives et insérées astucieusement, la relation d'une vie, celle de Thomas Sutpen, dont la brutale irruption dans un village du sud des États-Unis évoque les entités sombres et inhumaines, instables et torturées, de créatures des Brontë ou de Conrad, je pense à Heathcliff et à Kurtz, à Lord Jim ou à James Durie chez Stevenson. La progression, extrêmement soignée et planifiée, livre de façon comme involontaire et fortuite, les secrets du protagoniste, ses motifs profonds, ses recels d'expériences et de frustration, ses excuses l'ayant mené aux entreprises hardies et a priori incompréhensibles qu'on constate au début du roman, en un récit achronologique qui établit les causes principales et de plus en plus intimes de son caractère, et qui explique une partie de ses bizarreries et de ses violences, mais, exactement à l'instar des personnages que j'ai cités, sans éclaircir foncièrement toutes ses réactions et la tournure étrangère, imprévisible et démoniaque, de son esprit intrus. C'est alors par besoin d'auteur et probablement encore par astuce que se mêle au portrait de ces sombreurs que l'intégralité de leur histoire ne suffit à circonvenir un ingrédient supplémentaire, en l'espèce d'une destinée, d'une force maudite, d'une tension de paria, qui est malgré tout un instrument trop commode et devrait censément excuser les développements peu crédibles d'une personnalité. Car, en somme, ni Sutpen, ni Heatcliff, ni Kurtz, ni Lord Jim et ni James Durie ne sont ni ne seront véritablement ou même profondément expliqués ; ce que leur relation apprend au lecteur ne justifie pas ce qu'ils sont devenus ni comment ils se comportent, leur intrinsèque inhumanité, leur altérité ou leur aliénité (si l'on me pardonne cette création), tandis que le roman s'était initialement proposé leur peinture éclairante, incapable in fine de tenir sa promesse : on prétendra que le personnage « déborde la fiction » et qu'il a pris telle consistance et telle densité qu'il échappe à l'emprise de son auteur et du récit, qu'il a surgi dans le monde des hommes en quittant celui des personnages circonscrits à force de vraisemblance, et ce sera alors un joli mot de piètre critique, dans une analyse favorablement prévenue, que d'affirmer la preuve que le personnage est supérieurement développé puisqu'il devient alors un être qu'il est impossible « comme dans la réalité » (à ce qu'on veut croire) de définir tout à fait par le récit et la somme de ses expériences, belle vantardise littéraire ! Mais d'autres plus profonds et plus justes auront des scrupules à soutenir de pareilles naïvetés, voyant que pas davantage Fitzgerald n'explique Gatsby, et que la manière dont l'écrivain achoppe à tenir la cohérence d'un protagoniste dont l'oeuvre repose a priori sur l'intérêt d'un mystère progressivement dévoilé et d'une explicitation complète d'un individu constitue une inaptitude et une déception, un aveu d'échec ou plutôt une dissimulation d'échec, en somme que l'auteur a failli à son propre but que rien ni personne ne l'obligeait à fixer : ce n'est pas, au contraire de ce qu'on vante, que le personnage fut si finement tracé qu'il est devenu plus vrai que nature et ainsi ne peut plus trouver d'explication dans le cadre même du récit et de la conscience de son propre créateur (parce qu'il aurait, en quelque sorte, évolué par lui-même et acquis une réalité autonome en-dehors de la conception du démiurge) – cette vision romantique n'a rien de technique ou de critique, elle considère par défaut que le personnage est une conscience, c'est une vision poétique, symboliste et puérile qui fait fit de toute notion narratologique et créative –, mais c'est que l'auteur n'a pas tenu les rênes de son projet en se cantonnant aux règles de vraisemblance, car en vérité cet être de papier n'existe pas davantage à dépasser les normes de la psychologie et de la cohérence humaines, bien au contraire il existe moins, il est moins un individu et plus une convention, il devient une représentation et un acteur puisqu'il n'a pas de causalité à la différence d'une personne véritable (car au monde, foin des mièvreries ! il n'existe pas de mentalité sans étroite cohérence c'est-à-dire de psychologie inexplicable), il est surtout un rôle que le dramaturge n'est pas parvenu à rendre plausible, dont il a oublié ou abandonné la peinture de pans si vastes et nécessaires que le portrait est demeuré inachevé par bien des morceaux auxquels il accorde in extremis le nom de « mystères » pour se rattraper : et par quelle complaisance se satisfaire que le tableau expose la trame blanche de la toile non peinte au prétexte qu'ainsi on ignore davantage le sujet présenté, qu'on le perçoit moins net, ce qui correspondrait, pour les gens ignorants ou incurieux de la vie, au caractère de tout sujet réel ? Si l'on se propose à composer une mélodie comme on dresse avec art une méticuleuse et exacte description, ce n'est sans doute pas pour finir par indiquer qu'on ne sait pas à quoi sert telle mesure ou telle note, que la symphonie est essentiellement un hasard, et que c'est d'ailleurs une preuve de perfection qu'on ne puisse pas expliquer comment elle est construite et se justifie puisque « dans la nature » rien ne précise l'origine des sons. C'est une question de cohérence et de fidélité à un projet : si en particulier un romancier propose principalement le dévoilement de l'énigme d'un caractère, je n'aurais pas mon compte à ce qu'il arguât que son personnage, dont je ne suis pas dupe qu'il l'a inventé de (presque) toutes pièces, est « à ce point humain et crédible qu'il ne se décèle pas en son entier » car ce n'est rien qu'un personnage, contrairement à l'illusion que l'auteur veut en donner d'une personne réelle dont la compréhension, pour le siècle ordinaire des apparences, ne saurait être absolue, quelles que soient les analogies de vérités qu'il sert dans son livre pour entretenir une semblable illusion d'authenticité. Ici, on lit, page 127 : « Oui, Judith, Bon, Henry, Sutpen, tous autant qu'ils sont. Les voilà tous, mais il manque quelque chose : on dirait une formule chimique exhumée en même temps que les lettres de ce coffre oublié, avec précaution, le papier ancien et passé tombant en morceaux, l'écriture passée, presque indéchiffrable, mais significative, familière dans sa forme et son sens, disant le nom et la présence de forces instables et vivantes ; on les mélange dans les proportions requises, mais rien ne se produit ; on relit la formule, lentement, attentivement, pour s'y absorber et s'assurer qu'on n'a rien oublié, qu'on ne s'est pas trompé dans ses calculs ; on mélange de nouveau et, de nouveau, rien ne se produit ; rien que les mots, les symboles, les formes elles-mêmes, indistinctes, énigmatiques et sereines, sur cette toile de fond déclamatoire d'une atroce et sanglante mésaventure humaine. » ; et je pardonne cette insistance à entretenir l'illusion, il n'y a même rien à pardonner puisque la citation s'inscrit elle-même dans l'illusion de la fiction, prêtant aux personnages du roman une indubitable réalité comme s'ils avaient existé et comme s'ils étaient patiemment reconstitués par leurs témoins et successeurs (ce qui est un procédé dont a priori nul n'est dupe), mais, quand il l'écrit, Faulkner sait pertinemment que la seule vérité de cette citation c'est sa généralisation à toute autre chose qu'au roman même qu'il rédige, que le seul univers auquel il est certain que cette citation ne peut pas s'appliquer est précisément celui qu'il a fabriqué pour Absalon, Absalon !, et l'on peut l'imaginer sans mal s'amuser de ce mensonge et se dire : « Mais Judith, Bon, Henry et Sutpen tous autant qu'ils ne sont pas, justement ! Hé ! La bonne trouvaille que d'en faire sortir des lettres d'une malle : leurs papiers, ce ne sont que les mots que j'ai, moi, inventés et que j'arbore comme des pièces certifiées, tous ces faux en écriture ! » Ainsi, son personnage est bel et bien création et composition et non transposition ou témoignage, et si son dessein est de ramener au domaine de la vraisemblance un être de fiction dont les attitudes sont d'emblée inexplicables, alors il est logique de considérer que toute l'oeuvre doit être, du point de vue des motivations, une démonstration de rigueur et de contrôle, au même titre que Les quatre saisons de Vivaldi ne peut se permettre d'inclure un nombre essentiel de sonorités qui n'empruntent rien à la nature que son projet consiste à imiter. Dès lors, l'excuse du personnage qui serait « devenu si réel qu'il ne trouve pas d'explication » trompe et entourloupe, c'est une façon de jouer sur plusieurs plans et d'abuser ensuite de la confusion du lecteur et de son oubli de l'intention initiale, car ou bien l'auteur proposait autre chose que le dévoilement d'un personnage, proposant par exemple la livraison « telle quelle » d'une mentalité plausible et largement obscure, et alors il a eu tort de focaliser l'attention sur des énigmes qu'il a progressivement levées, ou bien dans son projet d'explicitation d'une étrange humeur il a failli à en identifier les causes, se laissant déborder par l'ampleur du caractère qu'il souhaitait d'emblée dépeindre et qu'il n'a pas réussi à démêler, et alors il a eu tort de vouloir passer son incapacité, son insuffisance, son renoncement et sa déception en la vraisemblance selon quoi « un homme réel ne saurait entièrement se définir » ; autrement dit, ou bien il inclut un personnage relativement arbitraire dans la fiction comme une personne surgissant impromptue dans l'existence, ou bien il propose l'examen méthodique de ce personnage réaliste dont il fait le sujet même de sa fiction, mais, en l'occurrence, Faulkner, après avoir imité le psychologue et l'analyste, finit par abandonner la gageure qu'il s'est fixée en s'écriant : « la psychologie et l'analyse sont dérisoires à remonter l'origine de cet homme… et voilà qui est heureux ! » : pétition de principe où il finit par admettre la réalité d'un homme qu'il n'est pas parvenu à créer dans toute sa vraisemblance… oui, ça semble une sagesse ainsi dit, ce miracle du personnage qui, indéfinissable au juste, prend vie, à l'exception que c'est lui qui a fabriqué son sujet, ce qu'il ne faut tout de même pas oublier !
Car enfin, il faut y insister, Sutpen pas davantage que la plupart des autres personnages du roman n'est expliqué de façon satisfaisante, il n'est pas crédible d'un point de vue humain, il ne s'élabore pas, au bout du compte, comme une mentalité cohérente, toutes ses péripéties ne traduisent pas une volonté intègre et constante et aucune ne justifie ce qu'il est devenu, au point que ce qu'il reste de plus fascinant chez cette figure – comme chez Heathcliff, Kurtz, Lord Jim, James Durie et peut-être Gatsby (je ne sais plus) – c'est leur dimension absurde et arbitraire, c'est la façon dont le drame romanesque, en un maniérisme excessif, introduit dans des intrigues vraisemblables des éléments irrationnels que le contexte plausible enrobe et emporte, par abus du lecteur sentimental et naïf, ce lecteur décidément sans distance sur ce qu'il fait quand il lit une histoire, ce lecteur sans recul critique ni analyse élémentaire, éléments irrationnels qu'il rapporte dans le tout façonné et relativement plausible d'un univers crédible, feignant de prêter lui-même, auteur, foi aux inventions les plus énormes, comme on échafaude le faux témoignage convaincant à partir de vérités majoritaires auxquelles il ajoute de ponctuels mensonges. Mais ce n'est qu'à la condition de ce sentimentalisme et de cette naïveté principiels justement, que je ne suppose pourtant point l'apanage de la littérature ni le nécessaire pour entrer efficacement dans un récit, que ces héros transportent, que le lecteur se laisse envahir par ces idioties, qu'il abdique son esprit en bienheureuse confiance, et que la mémoire d'une postérité conserve de pareils fantoches comme références, parce qu'ils sont plus que largement bizarres, au même titre que nombre de difformités de Shakespeare ou de Hugo, comme des trésors d'imagination, alors qu'ils ne consistent en fait qu'en des grotesques introduits en semi-tapinois dans la réalité à l'occasion d'un endormissement de vigilance du lecteur. Jamais Sutpen ne donne à l'examen du philologue sérieux une impression de bon aloi et de science, de rigueur : l'obstination même du lecteur à le comprendre ne procède que de cette promesse tacite qu'au terme du roman ses étrangetés seront découvertes et expliquées, faute de cela le lecteur ne s'y intéresserait même pas tant – est-ce qu'on comprend davantage Heathcliff ou Kurtz ? La persistance de l'énigme au-delà du livre, loin de fonder le gage d'une fascinante réussite, est, j'ose le dire, u
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Le Sud, n'est-ce-pas, au moins en partie, ces planteurs blancs à l'esprit chevaleresque et ces belles dames tout aussi blanches pétries de bon sentiments, évoluant avec grâce dans leur société bourgeoise et ségréguée, et pleines de bonnes intentions vis-à-vis de leurs esclaves noirs ? N'est-ce-pas aussi la pureté de la race blanche protégée par les interdits touchant les relations sexuelles entre blancs et noirs ?
Mais tout cela, c'est de la façade ! C'est ce que nous montre (ou plutôt nous force à découvrir) William Faulkner dans Absalon Absalon (paru en 1936).
Nous avons un enfant blanc et pauvre traumatisé et humilié d'avoir été éconduit par un esclave noir à la belle livrée de valet lui interdisant l'accès à l'entrée principale d'une maison de planteur où il devait porter un message. Thomas Sutpen, devenu jeune homme, se jure d'établir une dynastie de planteurs blancs dans un immense domaine qu'il acquiert on ne sait comment à Jefferson où il s'établit avant son second mariage. Après s'être marié auparavant avec Eulalie Bon, une femme qui, horreur, avait tout au plus un huitième de sang noir ainsi que l'a découvert une fois marié Thomas, mais avec laquelle il a eu un fils, Charles, il la répudie après avoir assuré son avenir financier et épouse Ellen, blanche garantie à 100 % d'une famille respectable de Jefferson, avec laquelle il a un garçon, Henry, et une fille, Judith.
De plus il fait un enfant, Clytie, à une esclave noire de sa plantation, ainsi qu'à Millie, une très jeune petite-fille d'un noir vivant dans le domaine.
Son premier fils, Charles Bon, presque blanc, fait à une femme noire un fils, Charles-Étienne Bon, lequel fait de même à une autre femme noire un fils, Jim Bon.
Nous nous trouvons finalement avec un climat quasi incestueux dans cette famille, avec entre autres la proximité au moins d'esprit entre le fils Henry et la fille Judith de Thomas et Ellen Sutpen, ou encore entre Henry et Charles Bon (que Henry ignore longtemps être son demi-frère).
Dans ces circonstances les différents drames et morts violentes auxquels nous assistons aboutiront peut-être à la pérennité de la lignée Sutpen à la tête de la plantation, mais en tout cas sans que cette lignée ne puisse être blanche puisque l'héritier final ne pourra être que Jim Bond, arrière petit-fils de Thomas avec un peu plus de 50 % de sang noir.
Cette histoire nous est contée par quatre voix qui entremêlent leurs récits à tour de rôle : Rosa, soeur d'Ellen et belle-soeur de Thomas Sutpen, Mr Compson, ami de Thomas Sutpen, Quentin Compson, petit-fils du précédent, et Shreve ami de Quentin. Avec cette habilité de construction nous retrouvons aussi d'autres caractéristiques de William Faulkner, comme le fait de cacher, ou de dévoiler par bribe et progressivement ce qu'il veut montrer, quasiment en creux donc, comme le fait que les narrateurs, à plusieurs, regardent toujours en arrière, vers le passé parfois lointain, et jamais vers le présent et encore moins vers l'avenir. Est-ce pour témoigner que cette société sudiste a complètement sombré après la guerre de Sécession ? Est-ce le contrecoup du hiatus béant entre les idéaux de noble pureté affichés par la société sudiste et la réalité du comportement de ses membres (relations entre blancs et noirs, inceste et homosexualité latents) ?
Tout ceci est exprimé d'une façon très élaborée et, dirait-on, très travaillée par William Faulkner, dans une langue riche et variée, avec un style dense, plein d'images, à base de longues phrases et de paragraphes imposants, n'hésitant pas, par exemple, aux répétitions rapprochées, comme si l'auteur voulait faire progresser son propos par à-coups successifs, à la façon de vagues à l'assaut d'une côte, différentes mais toujours mêmes.
Cette ingénierie littéraire, cette puissance du propos nous mettent assurément en présence d'un monument de la littérature qui demande un effort certain du lecteur et mérite même plusieurs lectures, ainsi par exemple que "Le Bruit et la Fureur". Tout en reconnaissant le génie à l'oeuvre dans Absalon Absalon, ma préférence personnelle va toutefois vers "Lumière d'Août", Faulkner étant de toutes façons incontournable pour tout amateur de grande et belle littérature.
Traduction René-Noël Raimbault & Charles P. Vorce
Mais tout cela, c'est de la façade ! C'est ce que nous montre (ou plutôt nous force à découvrir) William Faulkner dans Absalon Absalon (paru en 1936).
Nous avons un enfant blanc et pauvre traumatisé et humilié d'avoir été éconduit par un esclave noir à la belle livrée de valet lui interdisant l'accès à l'entrée principale d'une maison de planteur où il devait porter un message. Thomas Sutpen, devenu jeune homme, se jure d'établir une dynastie de planteurs blancs dans un immense domaine qu'il acquiert on ne sait comment à Jefferson où il s'établit avant son second mariage. Après s'être marié auparavant avec Eulalie Bon, une femme qui, horreur, avait tout au plus un huitième de sang noir ainsi que l'a découvert une fois marié Thomas, mais avec laquelle il a eu un fils, Charles, il la répudie après avoir assuré son avenir financier et épouse Ellen, blanche garantie à 100 % d'une famille respectable de Jefferson, avec laquelle il a un garçon, Henry, et une fille, Judith.
De plus il fait un enfant, Clytie, à une esclave noire de sa plantation, ainsi qu'à Millie, une très jeune petite-fille d'un noir vivant dans le domaine.
Son premier fils, Charles Bon, presque blanc, fait à une femme noire un fils, Charles-Étienne Bon, lequel fait de même à une autre femme noire un fils, Jim Bon.
Nous nous trouvons finalement avec un climat quasi incestueux dans cette famille, avec entre autres la proximité au moins d'esprit entre le fils Henry et la fille Judith de Thomas et Ellen Sutpen, ou encore entre Henry et Charles Bon (que Henry ignore longtemps être son demi-frère).
Dans ces circonstances les différents drames et morts violentes auxquels nous assistons aboutiront peut-être à la pérennité de la lignée Sutpen à la tête de la plantation, mais en tout cas sans que cette lignée ne puisse être blanche puisque l'héritier final ne pourra être que Jim Bond, arrière petit-fils de Thomas avec un peu plus de 50 % de sang noir.
Cette histoire nous est contée par quatre voix qui entremêlent leurs récits à tour de rôle : Rosa, soeur d'Ellen et belle-soeur de Thomas Sutpen, Mr Compson, ami de Thomas Sutpen, Quentin Compson, petit-fils du précédent, et Shreve ami de Quentin. Avec cette habilité de construction nous retrouvons aussi d'autres caractéristiques de William Faulkner, comme le fait de cacher, ou de dévoiler par bribe et progressivement ce qu'il veut montrer, quasiment en creux donc, comme le fait que les narrateurs, à plusieurs, regardent toujours en arrière, vers le passé parfois lointain, et jamais vers le présent et encore moins vers l'avenir. Est-ce pour témoigner que cette société sudiste a complètement sombré après la guerre de Sécession ? Est-ce le contrecoup du hiatus béant entre les idéaux de noble pureté affichés par la société sudiste et la réalité du comportement de ses membres (relations entre blancs et noirs, inceste et homosexualité latents) ?
Tout ceci est exprimé d'une façon très élaborée et, dirait-on, très travaillée par William Faulkner, dans une langue riche et variée, avec un style dense, plein d'images, à base de longues phrases et de paragraphes imposants, n'hésitant pas, par exemple, aux répétitions rapprochées, comme si l'auteur voulait faire progresser son propos par à-coups successifs, à la façon de vagues à l'assaut d'une côte, différentes mais toujours mêmes.
Cette ingénierie littéraire, cette puissance du propos nous mettent assurément en présence d'un monument de la littérature qui demande un effort certain du lecteur et mérite même plusieurs lectures, ainsi par exemple que "Le Bruit et la Fureur". Tout en reconnaissant le génie à l'oeuvre dans Absalon Absalon, ma préférence personnelle va toutefois vers "Lumière d'Août", Faulkner étant de toutes façons incontournable pour tout amateur de grande et belle littérature.
Traduction René-Noël Raimbault & Charles P. Vorce
Le Titre : Absalom est le fils de David dans l'Ancien Testament (Deuxième livre de Samuel) :
19:1 : le roi, tremblant d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant : « Mon fils Absalom ! Mon fils, mon fils Absalom ! Que ne suis-je mort à ta place ! Absalom mon fils, mon fils ! »
NE CHERCHEZ PAS PLUS LOIN POUR LE MOMENT
Concernant le roman, cinquième chef-d'oeuvre de la grande pentalogie de Faulkner :
Nom de Dieu que c'est complexe. Cent pages très pénibles au départ, si ce n'est plus. Il faut toujours être à l'affut.
Des phrases alambiquées, triturées, commençant par des négations, s'interrompant en des nuances et explications supplémentaires...
Et puis c'est miraculeux. Sombre, sale, maudit pour tous et par tous, selon la vision démoniaque de Thomas Sutpen, le Devil qui went down pas to Georgia mais not too far.
Du début du XIXe siècle et la découverte du petit Thomas de l'esclavage au Mississippi à la question finale posée à Quentin Compson ( The Sound and the Fury) par son camarade d'université Canadien, tout est construit en cercles concentriques autour de Sutpen's Hundred, à Jefferson, Comté de Yoknapatawpha (le théâtre de la Comédie humaine de Faulkner, lieu imaginaire, un peu le Oxford du Mississippi sans l'université, vois-tu).
Évidemment, ce n'est pas dans l'ordre. C'est outrancier, d'une précision et d'un lyrisme noir démoniaque, désespéré, inerte puis brûlant par à-coups... pourquoi pas, le futur appartiendra aux Jim Bond de ce bas-monde. Se réveillant de leur lit en flammes, hurlant, vociférant, de leur petit coin d'enfer personnel (leur petite chambre à soi) : "Absalom, Absalom !" en un vomissement exultant la fureur et le besoin de vivre déchaîné, puis pour conjurer la honte, la fange, les fouets, le viol, l'alcool et tout ce qui fait que Faulkner est un génie universel, et non pas un écrivain de terroir (mais faut-il encore le souligner ?).
Je crois bien qu'il sera difficile d'en sortir, autant qu'il fût difficile d'y entrer.
J'aime bien le style de Faulkner et ses longues phrases bien formulées, mais dans ce roman la complexité des paragraphes et de la narration en général a atteint un niveau limite soporifique. Il y a certes des passages qu'on lit avec plaisir comme ceux du début ou là où il s'agit de l'enfance de Sutpen, mais on tombe souvent sur des redites et des détails alambiqués sur la conduite de certains personnages si longs et si entremêlés que cela devient fatigant. Heureusement que les deux derniers chapitres sont moins lourds.
Un univers tragique digne des maudits Atrides, mais en version fluviale, Mississippi et longues phrases hypnotiques qui charrient l'effarement, les souvenirs et ressassements des fantômes dupés du Sud ténébreux.
Celui de ces fantômes dupés qui est au centre du livre, autour duquel s'enroulent les phrases titubantes et haletantes des narrateurs, c'est Thomas Sutpen. À noter, puisqu'on nous présente parfois Faulkner comme enraciné dans un terroir, Sutpen n'est pas originaire du Mississippi, c'est un déraciné, au départ un petit môme d'un coin de montagne en Virginie-Occidentale, qui ressemble étonnamment chez Faulkner au monde d'avant la société civile de Rousseau:
«là où il habitait, la terre était au premier venu et à tout le monde, si bien que celui qui se serait donné la peine d'en clôturer un lopin en disant «ceci est à moi» aurait été un fou; quant aux biens, personne n'en possédait plus que son voisin, parce que chacun ne possédait que ce qu'il avait la force et l'énergie de prendre et de garder, et qu'il n'y aurait eu que ce fou à se donner la peine de prendre et de désirer plus qu'il n'aurait pu manger ou échanger contre de la poudre ou du whisky.»
C'est en émigrant que Stupen va apprendre que la société peut être divisée en compartiments nettement déterminés selon la quantité de biens que l'on possède et la couleur de sa peau. Et concevoir, alors qu'il n'est qu'un jeune adolescent, l'ambition obstinée d'appartenir à la classe des riches planteurs.
L'histoire d'une ambition, bon, on pourrait penser que c'est un terrain bien balisé. Mais on n'est pas dans un roman du XIXéme siècle, ici les choses sont bien plus compliquées à appréhender, et on a parfois l'impression de se retrouver perdus en forêt profonde. L'aspect si déroutant du roman tient en partie aux particularités des narrateurs, à la «voix revêche, inquiète, effarée» de Rosa Coldfield qui raconte à Quentin Compson son histoire du démon-Sutpen «jusqu'à ce qu'enfin on cessa de l'écouter, qu'on ne l'entendît plus que de façon confuse». À la façon dont Quentin cherche à saisir ou plutôt à rêver cette histoire, écoutant Miss Rosa ou son père, s'interrogeant, se projetant par l'imaginaire au côté des Sutpen, échafaudant des hypothèses en discutant avec son ami Shreve,
«tous deux créant entre eux deux, à l'aide d'un ramassis de vieilles histoires et de vieux ragots, des personnages qui, peut-être, n'avaient jamais existé nulle part».
Un style narratif tumultueux, déboussolant, une écriture poétique, ténébreuse, hantée, qui semble plonger de multiples racines dans la culture universelle: Bible, tragédie grecque, tout aussi bien que la malédiction liée à l'origine de l'inégalité dans le Discours de notre Jean-Jacques «vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne», à laquelle s'ajoute la malédiction du Sud, qui a oublié aussi qu'un être humain ne pouvait être la propriété d'un autre - une écriture unique, puissante, sidérante, qui donne au roman une épaisseur incroyable.
Celui de ces fantômes dupés qui est au centre du livre, autour duquel s'enroulent les phrases titubantes et haletantes des narrateurs, c'est Thomas Sutpen. À noter, puisqu'on nous présente parfois Faulkner comme enraciné dans un terroir, Sutpen n'est pas originaire du Mississippi, c'est un déraciné, au départ un petit môme d'un coin de montagne en Virginie-Occidentale, qui ressemble étonnamment chez Faulkner au monde d'avant la société civile de Rousseau:
«là où il habitait, la terre était au premier venu et à tout le monde, si bien que celui qui se serait donné la peine d'en clôturer un lopin en disant «ceci est à moi» aurait été un fou; quant aux biens, personne n'en possédait plus que son voisin, parce que chacun ne possédait que ce qu'il avait la force et l'énergie de prendre et de garder, et qu'il n'y aurait eu que ce fou à se donner la peine de prendre et de désirer plus qu'il n'aurait pu manger ou échanger contre de la poudre ou du whisky.»
C'est en émigrant que Stupen va apprendre que la société peut être divisée en compartiments nettement déterminés selon la quantité de biens que l'on possède et la couleur de sa peau. Et concevoir, alors qu'il n'est qu'un jeune adolescent, l'ambition obstinée d'appartenir à la classe des riches planteurs.
L'histoire d'une ambition, bon, on pourrait penser que c'est un terrain bien balisé. Mais on n'est pas dans un roman du XIXéme siècle, ici les choses sont bien plus compliquées à appréhender, et on a parfois l'impression de se retrouver perdus en forêt profonde. L'aspect si déroutant du roman tient en partie aux particularités des narrateurs, à la «voix revêche, inquiète, effarée» de Rosa Coldfield qui raconte à Quentin Compson son histoire du démon-Sutpen «jusqu'à ce qu'enfin on cessa de l'écouter, qu'on ne l'entendît plus que de façon confuse». À la façon dont Quentin cherche à saisir ou plutôt à rêver cette histoire, écoutant Miss Rosa ou son père, s'interrogeant, se projetant par l'imaginaire au côté des Sutpen, échafaudant des hypothèses en discutant avec son ami Shreve,
«tous deux créant entre eux deux, à l'aide d'un ramassis de vieilles histoires et de vieux ragots, des personnages qui, peut-être, n'avaient jamais existé nulle part».
Un style narratif tumultueux, déboussolant, une écriture poétique, ténébreuse, hantée, qui semble plonger de multiples racines dans la culture universelle: Bible, tragédie grecque, tout aussi bien que la malédiction liée à l'origine de l'inégalité dans le Discours de notre Jean-Jacques «vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne», à laquelle s'ajoute la malédiction du Sud, qui a oublié aussi qu'un être humain ne pouvait être la propriété d'un autre - une écriture unique, puissante, sidérante, qui donne au roman une épaisseur incroyable.
Un titre biblique qui sonne comme une invocation mais aussi abscons et énigmatique que le roman. Cela fait des années que ce livre traine dans ma bibliothèque (et je ne sais pas comment il y a atterri). je n'avais jamais lu du Faulkner, ce fut une vraie déflagration! Il m'a fallu faire preuve de beaucoup d'attention pour savoir quel personnage s'exprimait, m'y reprendre parfois à plusieurs reprises pour ne pas perdre le fil de l'histoire. car les phrases peuvent être très longues, il y a un mélange de narration et l'intrication des temporalités peut perdre le lecteur inattentif. Cela reproduit sans doute la complexité des relations et sentiments de cette histoire sur fond de Sud agonisant, d'inceste et de liens non assumés avec les noirs, une srte de fersque sur les démons de cette période et de cette région des Etats-Unis..
Une 1ere découverte surprenante de cet auteur, une sorte de montagne à gravir qui marque une différence avec de nombreux autres écrivains. L'écriture est à la hauteur des thèmes et du noeud dramatique que l'on ne découvre vraiment que vers la fin. A mes yeux c'est un hauteur inclassable et il me tarde de lire d'autres ouvrages.
Une 1ere découverte surprenante de cet auteur, une sorte de montagne à gravir qui marque une différence avec de nombreux autres écrivains. L'écriture est à la hauteur des thèmes et du noeud dramatique que l'on ne découvre vraiment que vers la fin. A mes yeux c'est un hauteur inclassable et il me tarde de lire d'autres ouvrages.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de William Faulkner (65)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les titres des œuvres de William Faulkner
Quel est le titre correct ?
Le Bruit et l'Odeur
Le Bruit et la Peur
Le Bruit et la Fureur
Le Bruit et la Clameur
12 questions
173 lecteurs ont répondu
Thème :
William FaulknerCréer un quiz sur ce livre173 lecteurs ont répondu