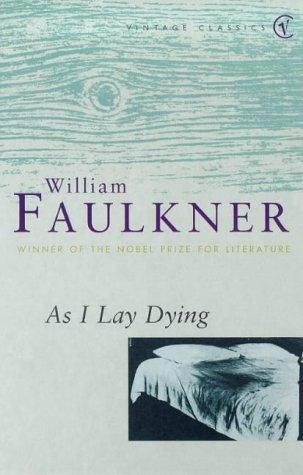William Faulkner
René-Noël Raimbault (Autre)Henri Delgove (Autre)/5 177 notes
René-Noël Raimbault (Autre)Henri Delgove (Autre)/5 177 notes
Résumé :
Pour pénétrer dans l'univers du vieux Sud qui hante l’œuvre de Faulkner, prix Nobel, la meilleure introduction est sans doute "Sartoris."
On y trouve le grand thème social de la décadence, après la guerre de Sécession.
Dans une atmosphère lourde de cauchemars, pleine de souvenirs du passé et de mystères jamais élucidés, apparaissent les principaux personnages de la saga faulknérienne et, au premier rang, ces Sartoris, héroïques et fanfarons, dont aucun... >Voir plus
On y trouve le grand thème social de la décadence, après la guerre de Sécession.
Dans une atmosphère lourde de cauchemars, pleine de souvenirs du passé et de mystères jamais élucidés, apparaissent les principaux personnages de la saga faulknérienne et, au premier rang, ces Sartoris, héroïques et fanfarons, dont aucun... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après SartorisVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (22)
Voir plus
Ajouter une critique
Bienvenue chez les Sartoris, dans cette chronique douce et amère, Faulkner nous emmène chez une famille sudiste à la fin de la première guerre mondiale.
Cette saga familiale sortie tout droit "d'autant en emporte le vent" un peu comme ces vieux albums photos ou le sépia côtoie le noir et blanc , drôle de parallèle pour cet état du sud des Etats-Unis le Tennessee où malgré l'abolition de l'esclavage les relations maitre serviteur n'ont pas évolué.
Le grand-père, Bayard Sartoris dit le "vieux" banquier grincheux gère la propriété familiale. Tante Sally veuve de John Sartoris, le fils de Bayard le vieux. Ce bout de femme sorte de furie s'occupe de manière énergique de la maison. Ensuite Bayard le jeune, petit fils de Bayard le vieux, il a combattu en France, aviateur il a vu son frère se faire abattre dans un combat aérien.
Enfin le personnage que j'ai le plus aimé Simon le fidèle serviteur noir, sorte de Falstaff, curieux, insolent....
Le trait d'union de ces personnages Sartoris outre le prénom c'est la fâcheuse tendance qu'ils ont à mourir de façon violente.
L'histoire en elle même n'a rien d'extraordinaire, le personnage principal Bayard le jeune, casse-cou que rien n'effraye s'ennuie. désoeuvré il passe son temps dans son auto à côtoyer la mort au grand désespoir de sa tante Sally.
Le style de Faulkner peut dérouter, c'est vrai s'est ce qui fait son talent.
J'ai adoré sa façon de décrire ces paysages ces fleurs, ces jasmins en fleurs qui le soir venu libèrent ces parfums, ou encore ce fameux oiseau-moqueur, sorte de rossignol qui a le don d'imiter d'autres oiseaux.
Je me suis vu assis dans un rocking-chair, un verre de thé glacé à la main entrain d'écouter ces bruits, respirer à plein poumon ces parfums enivrants.
J'ai aimé ce roman, ce son et lumière qui nous donne envie d'ailleurs.
Cette saga familiale sortie tout droit "d'autant en emporte le vent" un peu comme ces vieux albums photos ou le sépia côtoie le noir et blanc , drôle de parallèle pour cet état du sud des Etats-Unis le Tennessee où malgré l'abolition de l'esclavage les relations maitre serviteur n'ont pas évolué.
Le grand-père, Bayard Sartoris dit le "vieux" banquier grincheux gère la propriété familiale. Tante Sally veuve de John Sartoris, le fils de Bayard le vieux. Ce bout de femme sorte de furie s'occupe de manière énergique de la maison. Ensuite Bayard le jeune, petit fils de Bayard le vieux, il a combattu en France, aviateur il a vu son frère se faire abattre dans un combat aérien.
Enfin le personnage que j'ai le plus aimé Simon le fidèle serviteur noir, sorte de Falstaff, curieux, insolent....
Le trait d'union de ces personnages Sartoris outre le prénom c'est la fâcheuse tendance qu'ils ont à mourir de façon violente.
L'histoire en elle même n'a rien d'extraordinaire, le personnage principal Bayard le jeune, casse-cou que rien n'effraye s'ennuie. désoeuvré il passe son temps dans son auto à côtoyer la mort au grand désespoir de sa tante Sally.
Le style de Faulkner peut dérouter, c'est vrai s'est ce qui fait son talent.
J'ai adoré sa façon de décrire ces paysages ces fleurs, ces jasmins en fleurs qui le soir venu libèrent ces parfums, ou encore ce fameux oiseau-moqueur, sorte de rossignol qui a le don d'imiter d'autres oiseaux.
Je me suis vu assis dans un rocking-chair, un verre de thé glacé à la main entrain d'écouter ces bruits, respirer à plein poumon ces parfums enivrants.
J'ai aimé ce roman, ce son et lumière qui nous donne envie d'ailleurs.
Tout le monde connaît cette célèbre phrase de Proust: « Chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même ».
Mais Proust a aussi écrit: «Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère ».
Et il nous faut, me semble-t-il, apprendre ces langues.
C'est le sentiment que j'ai eu en lisant avec, cette fois, un immense bonheur, ce roman dont je n'avais pas su comprendre la langue il y a plus de trente ans, l'abandonnant au bout d'une cinquantaine de pages, dérouté, dans mon souvenir, par la lenteur du rythme et la complexité de l'écriture.
Et donc,si je reste toujours le lecteur de moi-même, les années, les lectures m'ont bien changé, au point de ne pas me retrouver dans celui qui n'a pas aimé ce livre il y a trente ans.
Car ce roman est beaucoup moins complexe dans sa construction que Lumière d'août, lu il y a quelques mois, à l'incitation de belles critiques d'ami.e.s babeliotes, et donc plus facile à aborder.
Je l'ai trouvé riche de tant de thèmes différents, où passent cruauté, désespoir, tendresse et amour; et de tant de personnages inoubliables, attachants, émouvants, déroutants, irritants.
Tout d'abord, le récit raconte un moment de l'histoire des Sartoris, situé juste après la première guerre mondiale, qui illustre la déshérence, la décrépitude, de ces grandes familles aristocratiques du Sud des Etats-Unis, abaissées, appauvries par leur défaite lors de la Guerre de Sécession, mais qui refusent de se soumettre, d'accepter la volonté et la puissance de ceux du Nord, de ces yankees qu'ils détestent.
Et les Sartoris, comme, sans doute, bien d'autres familles de cette époque, revivent, ressassent leur passé glorieux, leurs faits d'armes.
Et puis, ces grands propriétaires terriens devenus un peu moins grands, moins prospères en tout cas, restent sans égards pour la communauté noire, les nègres, comme ils les appellent, qui, d'esclaves sont devenus des travailleurs exploités ou, au mieux des domestiques, telle Lenora s'occupant de la cuisine et de la lessive, tel aussi le vieux Simon, serviteur négligent, roublard et retors. Tous ces « nègres » sont traités comme des incapables qu'il faut diriger, surveiller, soumettre, voire humilier..
Les plus jeunes, les frères Johnny et le « jeune » Bayard, ont ajouté un autre volet à l'histoire familiale. Celle de leur participation, par goût de l'aventure et du risque, à la dernière phase de la guerre de 14-18, comme pilotes d'avions de combat. Et l'un d'eux, Johnny, y est mort; et son frère Bayard, revient chez lui, traînant en permanence le sentiment de culpabilité de n'avoir rien pu faire pour le sauver.
Mais en réalité, on comprend que cette guerre, qui fut celle gagnée grâce à l'engagement des yankees en Europe est vécue majoritairement comme la réussite du Nord des États-Unis, et à laquelle le Sud ne sentit pas impliqué.
Et puis, le roman, sur un rythme lent et envoûtant, nous fait vivre les relations complexes entre les hommes, entre les hommes et les femmes, faites de frustration, de colère et de souffrance, parfois tempérées d'instants de tendresse, et où, très souvent, les liens se tissent puis se délitent.
Au premier rang, la famille des Sartoris, et tout d'abord le « vieux Bayard », homme du passé, malade refusant de se faire soigner, propriétaire terrien marqué par la lassitude et manquant d'esprit d'entreprise, tenant à se déplacer à la Banque qu'il possède en calèche à chevaux conduits par son domestique noir, Simon.
Et puis, le « jeune Bayard », rongé par le sentiment de la culpabilité, par la tentation suicidaire, dont nous suivrons le parcours fait de frenésie désespérée, et d'une brève période de paix et d'amour, jeune homme perdu qui cherche d'abord à défier la mort par des courses folles en voiture, puis à fuir ce Sud en parcourant le monde, jusqu'à une fin tragique.
La seule personne solide dans cette famille c'est la très vieille mais très alerte grand-tante Jenny, qui fut la femme du père du vieux Bayard, John Sartoris, et qui mène la maison d'une façon pleine de rudesse mais non dénuée de tendresse, racontant sans cesse les faits et gestes légendaires des Sartoris durant la guerre de Sécession. .
Un autre personnage complexe et émouvant est Narcissa Benbow, femme indépendante, mais fusionnelle avec son jeune frère Horace, homme falot et indécis, qui sera pris dans les filets d'une femme pulpeuse et mariée. Narcissa aura une brève idylle avec le jeune Bayard, et donnera naissance au dernier des Sartoris, qu'elle prénommera de son nom de famille, Benbow, peut-être pour lui faire échapper à la fatale destinée de la lignée.
Le roman fait aussi la place à toute une série de personnages secondaires truculents,au premier rang, le vieux domestique Simon, mais aussi le vieux Docteur Peabody, ou inquiétants comme le caissier Snopes, voyeur et auteur de lettres anonymes.
La beauté unique de ce roman,qui préfigure, je pense, les futurs chefs-d'oeuvre d'architecture romanesque de Faulkner, vient de la narration elliptique et complexe, au rythme lent, parfois même lancinant, et de la description incroyablement belle de la nature, des paysages et des bêtes, une nature que l'on croit voir, sentir.
En conclusion, je me suis fait cette réflexion: à quoi sert cette critique? Si j'en avais lu une du même tonneau il y a trente ans, cela n'aurait rien changé à mon avis, à ma perception de l'oeuvre, je n'étais pas prêt à lire Faulkner. Et donc, je crois qu'elle ne peut s'adresser qu'à celles et ceux qui aiment déjà ce genre de littérature….et donc qui n'en ont pas besoin. Et elle ne pourra convaincre celles et ceux, qui, comme je l'étais autrefois, aiment les narrations fluides et sans mystère.
Donc, elle ne sert à rien, ou presque.
Mais Proust a aussi écrit: «Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère ».
Et il nous faut, me semble-t-il, apprendre ces langues.
C'est le sentiment que j'ai eu en lisant avec, cette fois, un immense bonheur, ce roman dont je n'avais pas su comprendre la langue il y a plus de trente ans, l'abandonnant au bout d'une cinquantaine de pages, dérouté, dans mon souvenir, par la lenteur du rythme et la complexité de l'écriture.
Et donc,si je reste toujours le lecteur de moi-même, les années, les lectures m'ont bien changé, au point de ne pas me retrouver dans celui qui n'a pas aimé ce livre il y a trente ans.
Car ce roman est beaucoup moins complexe dans sa construction que Lumière d'août, lu il y a quelques mois, à l'incitation de belles critiques d'ami.e.s babeliotes, et donc plus facile à aborder.
Je l'ai trouvé riche de tant de thèmes différents, où passent cruauté, désespoir, tendresse et amour; et de tant de personnages inoubliables, attachants, émouvants, déroutants, irritants.
Tout d'abord, le récit raconte un moment de l'histoire des Sartoris, situé juste après la première guerre mondiale, qui illustre la déshérence, la décrépitude, de ces grandes familles aristocratiques du Sud des Etats-Unis, abaissées, appauvries par leur défaite lors de la Guerre de Sécession, mais qui refusent de se soumettre, d'accepter la volonté et la puissance de ceux du Nord, de ces yankees qu'ils détestent.
Et les Sartoris, comme, sans doute, bien d'autres familles de cette époque, revivent, ressassent leur passé glorieux, leurs faits d'armes.
Et puis, ces grands propriétaires terriens devenus un peu moins grands, moins prospères en tout cas, restent sans égards pour la communauté noire, les nègres, comme ils les appellent, qui, d'esclaves sont devenus des travailleurs exploités ou, au mieux des domestiques, telle Lenora s'occupant de la cuisine et de la lessive, tel aussi le vieux Simon, serviteur négligent, roublard et retors. Tous ces « nègres » sont traités comme des incapables qu'il faut diriger, surveiller, soumettre, voire humilier..
Les plus jeunes, les frères Johnny et le « jeune » Bayard, ont ajouté un autre volet à l'histoire familiale. Celle de leur participation, par goût de l'aventure et du risque, à la dernière phase de la guerre de 14-18, comme pilotes d'avions de combat. Et l'un d'eux, Johnny, y est mort; et son frère Bayard, revient chez lui, traînant en permanence le sentiment de culpabilité de n'avoir rien pu faire pour le sauver.
Mais en réalité, on comprend que cette guerre, qui fut celle gagnée grâce à l'engagement des yankees en Europe est vécue majoritairement comme la réussite du Nord des États-Unis, et à laquelle le Sud ne sentit pas impliqué.
Et puis, le roman, sur un rythme lent et envoûtant, nous fait vivre les relations complexes entre les hommes, entre les hommes et les femmes, faites de frustration, de colère et de souffrance, parfois tempérées d'instants de tendresse, et où, très souvent, les liens se tissent puis se délitent.
Au premier rang, la famille des Sartoris, et tout d'abord le « vieux Bayard », homme du passé, malade refusant de se faire soigner, propriétaire terrien marqué par la lassitude et manquant d'esprit d'entreprise, tenant à se déplacer à la Banque qu'il possède en calèche à chevaux conduits par son domestique noir, Simon.
Et puis, le « jeune Bayard », rongé par le sentiment de la culpabilité, par la tentation suicidaire, dont nous suivrons le parcours fait de frenésie désespérée, et d'une brève période de paix et d'amour, jeune homme perdu qui cherche d'abord à défier la mort par des courses folles en voiture, puis à fuir ce Sud en parcourant le monde, jusqu'à une fin tragique.
La seule personne solide dans cette famille c'est la très vieille mais très alerte grand-tante Jenny, qui fut la femme du père du vieux Bayard, John Sartoris, et qui mène la maison d'une façon pleine de rudesse mais non dénuée de tendresse, racontant sans cesse les faits et gestes légendaires des Sartoris durant la guerre de Sécession. .
Un autre personnage complexe et émouvant est Narcissa Benbow, femme indépendante, mais fusionnelle avec son jeune frère Horace, homme falot et indécis, qui sera pris dans les filets d'une femme pulpeuse et mariée. Narcissa aura une brève idylle avec le jeune Bayard, et donnera naissance au dernier des Sartoris, qu'elle prénommera de son nom de famille, Benbow, peut-être pour lui faire échapper à la fatale destinée de la lignée.
Le roman fait aussi la place à toute une série de personnages secondaires truculents,au premier rang, le vieux domestique Simon, mais aussi le vieux Docteur Peabody, ou inquiétants comme le caissier Snopes, voyeur et auteur de lettres anonymes.
La beauté unique de ce roman,qui préfigure, je pense, les futurs chefs-d'oeuvre d'architecture romanesque de Faulkner, vient de la narration elliptique et complexe, au rythme lent, parfois même lancinant, et de la description incroyablement belle de la nature, des paysages et des bêtes, une nature que l'on croit voir, sentir.
En conclusion, je me suis fait cette réflexion: à quoi sert cette critique? Si j'en avais lu une du même tonneau il y a trente ans, cela n'aurait rien changé à mon avis, à ma perception de l'oeuvre, je n'étais pas prêt à lire Faulkner. Et donc, je crois qu'elle ne peut s'adresser qu'à celles et ceux qui aiment déjà ce genre de littérature….et donc qui n'en ont pas besoin. Et elle ne pourra convaincre celles et ceux, qui, comme je l'étais autrefois, aiment les narrations fluides et sans mystère.
Donc, elle ne sert à rien, ou presque.
Faulkner a conseillé de lire Sartoris avant ses autres romans, mais c'est par hasard que je l'ai ouvert, convaincu par Meps de me remettre à Faulkner (40 ans plus tard).
Sartoris est le nom d'une lignée de riches propriétaires du Mississippi, dont les derniers n'ont pas complètement digéré la perte de la guerre de sécession. le roman s'ouvre sur le retour du dernier fils, aviateur pendant la première guerre mondiale. Il s'appelle Bayard, comme son grand-père ; son jumeau s'appelait John comme son père. Rongé par la mort de son frère, dont il se persuade qu'il est partiellement responsable, il va vivre comme ses ancêtres avec pour buts le panache et l'exaltation.
On consomme beaucoup de whisky (de fabrication clandestine) dans ce roman, et manifestement la guerre en Europe a transformé en éponges bien des jeunes autrefois pleins d'énergie. Bayard me semble hésiter : est-il un homme invincible ou un disgracié sans rémission possible , rempli de « son incurable désespérance et [de] la solitude de ce destin dont il ne pouvait s'évader ».
Outre la répétition de deux prénoms à travers au moins cinq générations, Faulkner ne facilite par l'identification de ses personnages : de nombreux paragraphes commencent par un « il » et le lecteur doit reconstruire peu à peu le réseau de relations. Si je comprends bien, lire ce roman avant les autres oeuvres de Faulkner permet d'y voir apparaître de nombreux personnages ou familles, mais je témoigne qu'à travers une seule oeuvre l'auteur brosse beaucoup de portraits vraiment intéressants et variés : aristocrates, noirs libérés mais restant attachés à des familles, paysans pauvres, médecins, femmes fortes même dans l'ombre.
J'ai été rebuté au début par l'accumulation des descriptions, la profusion des adjectifs et des adverbes, qui accompagne la lenteur du récit. Je me suis demandé si la traduction n'en était pas responsable, elle date de 1949, avec un vocabulaire parfois désuet, et l'usage permanent du mot nègre par exemple*. Mais je crois maintenant que c'est vraiment le style de Faulkner, qui s'attarde sur les descriptions d'une nature qu'il admire, de ce Sud qu'il aime et qu'on comprend peu à peu. Quel contraste avec sa façon de décrire par de brèves allusions les sentiments de ses personnages taiseux et leur évolution ! Finalement : tout en me demandant assez tôt de quelle façon tragique le récit allait se clore, j'ai été surpris et amusé par l'humour parfois féroce de l'auteur : par exemple dans des remarques franchement anti-religieuses qui ont dû mal passer à l'époque de la publication.
* Savez vous ce qu'est un cache-poussière ?
Sartoris est le nom d'une lignée de riches propriétaires du Mississippi, dont les derniers n'ont pas complètement digéré la perte de la guerre de sécession. le roman s'ouvre sur le retour du dernier fils, aviateur pendant la première guerre mondiale. Il s'appelle Bayard, comme son grand-père ; son jumeau s'appelait John comme son père. Rongé par la mort de son frère, dont il se persuade qu'il est partiellement responsable, il va vivre comme ses ancêtres avec pour buts le panache et l'exaltation.
On consomme beaucoup de whisky (de fabrication clandestine) dans ce roman, et manifestement la guerre en Europe a transformé en éponges bien des jeunes autrefois pleins d'énergie. Bayard me semble hésiter : est-il un homme invincible ou un disgracié sans rémission possible , rempli de « son incurable désespérance et [de] la solitude de ce destin dont il ne pouvait s'évader ».
Outre la répétition de deux prénoms à travers au moins cinq générations, Faulkner ne facilite par l'identification de ses personnages : de nombreux paragraphes commencent par un « il » et le lecteur doit reconstruire peu à peu le réseau de relations. Si je comprends bien, lire ce roman avant les autres oeuvres de Faulkner permet d'y voir apparaître de nombreux personnages ou familles, mais je témoigne qu'à travers une seule oeuvre l'auteur brosse beaucoup de portraits vraiment intéressants et variés : aristocrates, noirs libérés mais restant attachés à des familles, paysans pauvres, médecins, femmes fortes même dans l'ombre.
J'ai été rebuté au début par l'accumulation des descriptions, la profusion des adjectifs et des adverbes, qui accompagne la lenteur du récit. Je me suis demandé si la traduction n'en était pas responsable, elle date de 1949, avec un vocabulaire parfois désuet, et l'usage permanent du mot nègre par exemple*. Mais je crois maintenant que c'est vraiment le style de Faulkner, qui s'attarde sur les descriptions d'une nature qu'il admire, de ce Sud qu'il aime et qu'on comprend peu à peu. Quel contraste avec sa façon de décrire par de brèves allusions les sentiments de ses personnages taiseux et leur évolution ! Finalement : tout en me demandant assez tôt de quelle façon tragique le récit allait se clore, j'ai été surpris et amusé par l'humour parfois féroce de l'auteur : par exemple dans des remarques franchement anti-religieuses qui ont dû mal passer à l'époque de la publication.
* Savez vous ce qu'est un cache-poussière ?
Sartoris
Traduction : R. N. Raimbault & H. Delgove
ISBN : 9782070369201
Sartoris ... Nom de grandeur, nom de folie, nom de l'une de ces grandes familles de l'aristocratie sudiste si chères à Faulkner parce que, jusque dans leur dégénérescence, leurs membres refusent de s'incliner devant le vainqueur yankee. Pour eux, le Sud, avec ses toddies que l'on déguste sur les vérandas en regardant le soleil se coucher, ses immenses champs de cotonniers blanchis par la saison, ses Noirs d'abord esclaves, puis domestiques, mais toujours liés aux familles blanches par des chaînes dont le Yankee primaire ne comprendra jamais l'étonnante et sulfureuse complexité, le Sud avec tous ses rêves et ses fantasmes, tous les siens et tous ceux que l'on projette sur son Histoire - ce Sud-là n'a jamais capitulé et il convient de continuer à le célébrer.
Car même s'il ne fait pas l'impasse sur les défauts et les excès du système dans lequel il naquit - voyez par exemple "Absalon ! Absalon !" - c'est bien à une célébration que nous invite le grand romancier américain. Une célébration amère, nostalgique, et pourtant fière, fière de tous ses Sudistes, depuis les rescapés de la bonne société de jadis que sont les Sartoris ou les Compson jusqu'aux "pauv' blancs" de "Tandis Que J'Agonise" ou encore la famille Snope en passant par les Noirs, domestiques, ouvriers, silhouettes à peine entrevues et pourtant si vivantes. Tous, il les dessine, les peint, les habille, fait naître en eux vertus et défauts, espoirs et désirs, tristesses et échecs. Et puis il les lâche dans ses pages, les laisse s'y pavaner, s'y déchirer, s'y tuer afin qu'ils l'aident à rendre au Sud l'un des hommages les plus grandioses qu'ait jamais connus la littérature américaine.
"Sartoris" - parfois publié sous le titre "Etendards dans la Poussière" - est le premier vrai roman de Faulkner sur le Sud et l'on peut y voir le point de départ de la saga qui aura pour décor le comté de Yoknapatawpha. L'action se situe à la fin de la Grande guerre, quand le jeune Bayard Sartoris, qui a vu son frère John, pilote de chasse comme lui, mourir au combat, revient dans la grande maison familiale. le caractère déjà difficile de Bayard ne s'est guère arrangé, d'autant que, n'ayant pu rattraper son frère, qui venait de sauter de son appareil en flammes, dans son propre avion, il se sent coupable de sa mort.
A partir de là, on peut dire que, sauf durant le bref intermède de sa passion pour Narcissa Benbow, qu'il finit par épouser, Bayard le Violent, Bayard le Casse-cou, Bayard le Hanté va tout faire pour mourir avant l'heure.
Son entourage le regarde faire sans pouvoir lui imposer de frein. Miss Jenny, son arrière-arrière-grand-tante, l'une de ces femmes du Sud au dos plus rigide qu'un cierge et au tempérament d'acier, vous le dira - mais peut-être pas en ces termes : chez les Sartoris, les mâles ont tous un grain. Depuis le Grand Ancêtre, le colonel John Sartoris, qui combattit vaillamment les Nordistes et fut assassiné pendant la Reconstruction, après avoir lui-même froidement abattu deux politicards yankees qui voulaient faire élire des Noirs, c'est à qui, parmi ses descendants, sera le premier à mourir de mort violente et inattendue.
Peut-être est-ce pour cette raison que Miss Jenny, grande, sèche, tourmentée mais aimante, veille sur le vieux Bayard (le grand-père de notre Bayard suicidaire) comme une poule sur le dernier de ses poussins. Avec un peu de chance, celui-là finira dans son lit.
Mais c'est sous-évaluer l'adversaire, ce Destin omniprésent dans l'oeuvre de Faulkner ...
Par delà la traduction, le style est riche, d'une poésie colorée et puissante qui nous fait voir, humer, sentir, entendre le Sud de Faulkner au début des années vingt. Comme l'a chanté quelqu'un, le temps y dure longtemps ; les après-midis au soleil s'y étirent indéfiniment ; dans le jardin, Miss Jenny se chamaille avec Isom, le jeune jardinier noir, puis, aussi vexés l'un que l'autre, chacun part de son côté, un outil à la main, et n'en fait qu'à sa tête ; dans l'office, Elnora, la mère d'Isom, prépare le repas et chantonne ; Simon, le majordome et cocher, grand-père d'Isom, attelle les chevaux pour aller chercher le vieux Bayard à sa banque ; et la petite voiture de Miss Benbow se profile à l'horizon, venant de la ville aux rues poussiéreuses et endormies ; là-bas, le vieux docteur Loosh Peabody, qui demanda jadis la main de Miss Jenny, attend paisiblement ses clients en lisant et relisant des romans de quatre sous, allongé sur son canapé ; son confrère et néanmoins ami, le jeune Dr Alford, fait des projets de mariage dont Miss Benbow est le centre ; comme elle est le centre des fantasmes de Snope, l'employé de banque, qui lui envoie des lettres anonymes qu'elle s'en vient régulièrement montrer à Miss Jenny ; et puis, il y a encore le vieux Falls, qui a connu l'époque de la Sécession et qui, tous les mois, se rend dans le bureau du vieux Bayard, à la banque, pour y évoquer le bon vieux temps, un bon vieux temps que Faulkner brosse avec panache et mélancolie dans un long récit d'ouverture qui ressuscite Jeb Stuart, la plume au chapeau, fonçant avec ses troupes, tel un diable gris et or, au beau milieu d'un camp de nordistes au repos et y faisant prisonnier, avec une si exquise courtoisie, un major ennemi confondu par tant de politesse ...
Et malgré tout cela, il y en a pour prétendre que, dans "Sartoris", il ne se passe rien. J'espère bien que vous lirez ce livre à votre tour et que vous vous joindrez à moi pour affirmer que celui qui affirme pareille chose ou n'a pas bien lu, ou ne sait carrément pas lire. ;o)
Traduction : R. N. Raimbault & H. Delgove
ISBN : 9782070369201
Sartoris ... Nom de grandeur, nom de folie, nom de l'une de ces grandes familles de l'aristocratie sudiste si chères à Faulkner parce que, jusque dans leur dégénérescence, leurs membres refusent de s'incliner devant le vainqueur yankee. Pour eux, le Sud, avec ses toddies que l'on déguste sur les vérandas en regardant le soleil se coucher, ses immenses champs de cotonniers blanchis par la saison, ses Noirs d'abord esclaves, puis domestiques, mais toujours liés aux familles blanches par des chaînes dont le Yankee primaire ne comprendra jamais l'étonnante et sulfureuse complexité, le Sud avec tous ses rêves et ses fantasmes, tous les siens et tous ceux que l'on projette sur son Histoire - ce Sud-là n'a jamais capitulé et il convient de continuer à le célébrer.
Car même s'il ne fait pas l'impasse sur les défauts et les excès du système dans lequel il naquit - voyez par exemple "Absalon ! Absalon !" - c'est bien à une célébration que nous invite le grand romancier américain. Une célébration amère, nostalgique, et pourtant fière, fière de tous ses Sudistes, depuis les rescapés de la bonne société de jadis que sont les Sartoris ou les Compson jusqu'aux "pauv' blancs" de "Tandis Que J'Agonise" ou encore la famille Snope en passant par les Noirs, domestiques, ouvriers, silhouettes à peine entrevues et pourtant si vivantes. Tous, il les dessine, les peint, les habille, fait naître en eux vertus et défauts, espoirs et désirs, tristesses et échecs. Et puis il les lâche dans ses pages, les laisse s'y pavaner, s'y déchirer, s'y tuer afin qu'ils l'aident à rendre au Sud l'un des hommages les plus grandioses qu'ait jamais connus la littérature américaine.
"Sartoris" - parfois publié sous le titre "Etendards dans la Poussière" - est le premier vrai roman de Faulkner sur le Sud et l'on peut y voir le point de départ de la saga qui aura pour décor le comté de Yoknapatawpha. L'action se situe à la fin de la Grande guerre, quand le jeune Bayard Sartoris, qui a vu son frère John, pilote de chasse comme lui, mourir au combat, revient dans la grande maison familiale. le caractère déjà difficile de Bayard ne s'est guère arrangé, d'autant que, n'ayant pu rattraper son frère, qui venait de sauter de son appareil en flammes, dans son propre avion, il se sent coupable de sa mort.
A partir de là, on peut dire que, sauf durant le bref intermède de sa passion pour Narcissa Benbow, qu'il finit par épouser, Bayard le Violent, Bayard le Casse-cou, Bayard le Hanté va tout faire pour mourir avant l'heure.
Son entourage le regarde faire sans pouvoir lui imposer de frein. Miss Jenny, son arrière-arrière-grand-tante, l'une de ces femmes du Sud au dos plus rigide qu'un cierge et au tempérament d'acier, vous le dira - mais peut-être pas en ces termes : chez les Sartoris, les mâles ont tous un grain. Depuis le Grand Ancêtre, le colonel John Sartoris, qui combattit vaillamment les Nordistes et fut assassiné pendant la Reconstruction, après avoir lui-même froidement abattu deux politicards yankees qui voulaient faire élire des Noirs, c'est à qui, parmi ses descendants, sera le premier à mourir de mort violente et inattendue.
Peut-être est-ce pour cette raison que Miss Jenny, grande, sèche, tourmentée mais aimante, veille sur le vieux Bayard (le grand-père de notre Bayard suicidaire) comme une poule sur le dernier de ses poussins. Avec un peu de chance, celui-là finira dans son lit.
Mais c'est sous-évaluer l'adversaire, ce Destin omniprésent dans l'oeuvre de Faulkner ...
Par delà la traduction, le style est riche, d'une poésie colorée et puissante qui nous fait voir, humer, sentir, entendre le Sud de Faulkner au début des années vingt. Comme l'a chanté quelqu'un, le temps y dure longtemps ; les après-midis au soleil s'y étirent indéfiniment ; dans le jardin, Miss Jenny se chamaille avec Isom, le jeune jardinier noir, puis, aussi vexés l'un que l'autre, chacun part de son côté, un outil à la main, et n'en fait qu'à sa tête ; dans l'office, Elnora, la mère d'Isom, prépare le repas et chantonne ; Simon, le majordome et cocher, grand-père d'Isom, attelle les chevaux pour aller chercher le vieux Bayard à sa banque ; et la petite voiture de Miss Benbow se profile à l'horizon, venant de la ville aux rues poussiéreuses et endormies ; là-bas, le vieux docteur Loosh Peabody, qui demanda jadis la main de Miss Jenny, attend paisiblement ses clients en lisant et relisant des romans de quatre sous, allongé sur son canapé ; son confrère et néanmoins ami, le jeune Dr Alford, fait des projets de mariage dont Miss Benbow est le centre ; comme elle est le centre des fantasmes de Snope, l'employé de banque, qui lui envoie des lettres anonymes qu'elle s'en vient régulièrement montrer à Miss Jenny ; et puis, il y a encore le vieux Falls, qui a connu l'époque de la Sécession et qui, tous les mois, se rend dans le bureau du vieux Bayard, à la banque, pour y évoquer le bon vieux temps, un bon vieux temps que Faulkner brosse avec panache et mélancolie dans un long récit d'ouverture qui ressuscite Jeb Stuart, la plume au chapeau, fonçant avec ses troupes, tel un diable gris et or, au beau milieu d'un camp de nordistes au repos et y faisant prisonnier, avec une si exquise courtoisie, un major ennemi confondu par tant de politesse ...
Et malgré tout cela, il y en a pour prétendre que, dans "Sartoris", il ne se passe rien. J'espère bien que vous lirez ce livre à votre tour et que vous vous joindrez à moi pour affirmer que celui qui affirme pareille chose ou n'a pas bien lu, ou ne sait carrément pas lire. ;o)
Dans l'Amérique du sud qui lui est familière, William Faulkner narre une nouvelle fois les thèmes qui lui sont chers: les grandes familles du Sud déchues par la guerre de Sécession, les communautés et la ségrégation, les drames familiaux et leurs lots de confusion, la passion des hommes qui leur donne ardeur et ambition, et leur folie, qui les en éloigne. Pour beaucoup, « Sartoris » est le roman le plus « représentatif » de Faulkner, s'il n'est pas son plus brillant.
A côté d'un « Tandis que j'agonise« , d'un « Absalon!Absalon! » ou d'un « Lumière d'août« , « Sartoris » est un roman certes plus discret, mais il n'en n'est pas moins aussi fort et intense que les autres titres de l'écrivain. « Sartoris » est d'ailleurs son troisième roman, écrit en 1929, on dit que Faulkner eut du mal à le faire publier et reconnaître, alors qu'il le présentait comme « le » roman qui présageait tous les autres. Et pour cause. Matrice même de la conception familiale de la vieille Amérique aristocratique, les Sartoris sont le type de la famille réputée, renommée, mais au destin tragique, turbulant et surtout poussiéreux.
Descendant de soldats héroïques, les Sartoris sont des braves, des travailleurs, des valeureux…mais on dit qu'aucun d'eux n'est mort de fin naturelle. Dans cette confusion des générations qui est propre à Faulkner, les hommes se prénomment John et Bayard de père en fils, et ainsi semble descendre d'enfant, en petit-enfant, ce goût du risque et de la démesure. Car l'ubris est bien le propre de ces héros d'une autre époque, des héros qui ne seraient plus d'une réalité nouvelle, qui les rejette, et les fait paraître désuet.
Le vieux colonel Sartoris voit son petit-fils Bayard revenir après la guerre en Europe. Ce dernier, passionné d'aviation (comme Faulkner lui-même) fait face au deuil de son frère John, avec une attitude désinvolte et dangereuse, notamment en s'enivrant de la vitesse des nouvelles automobiles alors disponibles. Dans un engrenage douloureux, Bayard essaie de s'auto-détruire pour noyer sa culpabilité, entraînant malgré lui le colonel, et ceux qu'il aime.
Telle la Cassandre de la famille, Miss Jenny, la tante des Sartoris, prévoit avec pessimisme et rancune la fin de cette lignée de garçons d'un autre temps. Mais alors qu'une nouvelle ère s'ouvre, elle s'attache malgré elle à parler à ces fantômes, des hommes que l'on n'aime finalement mieux sur les portraits que l'on chérit, sur leurs tombes que l'on fleurit, que dans une réalité où ils sont finalement insupportables.
Faulkner dépeint avec intensité cette époque de mutation pour l'Amérique, qui peine à se dessiner une nouvelle cohérence sociale après la guerre de Sécession, et qui entre en guerre de l'autre côté de l'Atlantique. Les rapports entre les différentes communautés Noires et Blanches sont encore terriblement marqués par les ravages de l'esclavage, et la cohésion sera effectivement plus lente dans les Etats du Sud.
Figure d'une Amérique vieillissante, hésitante, « Sartoris » est la poussière d'une époque, la nostalgie poétique de grandes figures devenues détestables, la déchéance d'une classe qui n'en n'a pas moins marqué l'imaginaire américain.
« Sartoris » est donc sans conteste le roman d'un déclin douloureux, une fresque sociale juste et puissante, qui nous rappelle que bien souvent, la société préfère ses héros lorsqu'ils sont morts, sans quoi elle ne les assumerait pas.
Lien : http://madamedub.com/WordPre..
A côté d'un « Tandis que j'agonise« , d'un « Absalon!Absalon! » ou d'un « Lumière d'août« , « Sartoris » est un roman certes plus discret, mais il n'en n'est pas moins aussi fort et intense que les autres titres de l'écrivain. « Sartoris » est d'ailleurs son troisième roman, écrit en 1929, on dit que Faulkner eut du mal à le faire publier et reconnaître, alors qu'il le présentait comme « le » roman qui présageait tous les autres. Et pour cause. Matrice même de la conception familiale de la vieille Amérique aristocratique, les Sartoris sont le type de la famille réputée, renommée, mais au destin tragique, turbulant et surtout poussiéreux.
Descendant de soldats héroïques, les Sartoris sont des braves, des travailleurs, des valeureux…mais on dit qu'aucun d'eux n'est mort de fin naturelle. Dans cette confusion des générations qui est propre à Faulkner, les hommes se prénomment John et Bayard de père en fils, et ainsi semble descendre d'enfant, en petit-enfant, ce goût du risque et de la démesure. Car l'ubris est bien le propre de ces héros d'une autre époque, des héros qui ne seraient plus d'une réalité nouvelle, qui les rejette, et les fait paraître désuet.
Le vieux colonel Sartoris voit son petit-fils Bayard revenir après la guerre en Europe. Ce dernier, passionné d'aviation (comme Faulkner lui-même) fait face au deuil de son frère John, avec une attitude désinvolte et dangereuse, notamment en s'enivrant de la vitesse des nouvelles automobiles alors disponibles. Dans un engrenage douloureux, Bayard essaie de s'auto-détruire pour noyer sa culpabilité, entraînant malgré lui le colonel, et ceux qu'il aime.
Telle la Cassandre de la famille, Miss Jenny, la tante des Sartoris, prévoit avec pessimisme et rancune la fin de cette lignée de garçons d'un autre temps. Mais alors qu'une nouvelle ère s'ouvre, elle s'attache malgré elle à parler à ces fantômes, des hommes que l'on n'aime finalement mieux sur les portraits que l'on chérit, sur leurs tombes que l'on fleurit, que dans une réalité où ils sont finalement insupportables.
Faulkner dépeint avec intensité cette époque de mutation pour l'Amérique, qui peine à se dessiner une nouvelle cohérence sociale après la guerre de Sécession, et qui entre en guerre de l'autre côté de l'Atlantique. Les rapports entre les différentes communautés Noires et Blanches sont encore terriblement marqués par les ravages de l'esclavage, et la cohésion sera effectivement plus lente dans les Etats du Sud.
Figure d'une Amérique vieillissante, hésitante, « Sartoris » est la poussière d'une époque, la nostalgie poétique de grandes figures devenues détestables, la déchéance d'une classe qui n'en n'a pas moins marqué l'imaginaire américain.
« Sartoris » est donc sans conteste le roman d'un déclin douloureux, une fresque sociale juste et puissante, qui nous rappelle que bien souvent, la société préfère ses héros lorsqu'ils sont morts, sans quoi elle ne les assumerait pas.
Lien : http://madamedub.com/WordPre..
critiques presse (1)
L’écrivain le plus significatif sur le plan de la narration d’histoires. Un génie qui crée un monde à la fois fantasmé et incroyablement tangible. Une analyse spectrale de l’Amérique, qui nous donne les clés de ce qui la fait encore agir aujourd’hui...
Lire la critique sur le site : LeJournaldeQuebec
Citations et extraits (28)
Voir plus
Ajouter une citation
Merde, dit-il, étendu sur le dos, en regardant par la fenêtre où il n'y avait rien à voir, attendant le sommeil sans savoir s'il viendrait ou non et sans se demander vraiment s'il arriverait. Rien à voir et cette longue, longue durée de la vie d'un homme. Soixante-dix ans à traîner dans le monde ce corps obstiné et à tromper ses exigences perpétuelles. Soixante-dix ans, disait la Bible. Et il n'en avait que vingt-six. Pas beaucoup plus qu'un tiers de passé. Merde !
[...] ... Juin, maintenant, touchait presque à sa fin. L'odeur du jasmin, transplanté jadis par Miss Jenny s'insinuait insensiblement dans la maison, la submergeait tout entière de ses flots incessants et pressés semblables aux sons mourants des violes. Les fleurs plus précoces étaient passées ; les oiseaux avaient achevé de picorer les fraises et, maintenant, se tenaient toute la journée perchés aux alentours des bouquets de figuiers en attendant que les figures fussent mûres. Des zinnias, des renoncules fleurissaient, sans qu'Isom en prît le moindre soin. Car depuis que Caspey [= oncle d'Isom], qui n'était pas encore prêt de prendre sa retraite, était redevenu à peu près normal, on pouvait trouver Isom près de la haie de troènes qui bordait la clôture du jardin, du côté de l'ombre, en train de tailler une par une, avec une paire de ciseaux à tondre les mulets, les feuilles d'une unique branchette, et cela jusqu'à ce l'heure où Miss Jenny rentrait à la maison. Après quoi, il disparaissait, et allait s'allonger le reste de l'après-midi au bord du ruisseau, son chapeau sur les yeux, une canne à pêche calée entre ses orteils.
Simon bricolait en geignant, quelque part dans la propriété. Son cache-poussière de toile et son chapeau haut-de-forme pendus à un clou dans la sellerie accumulaient brins de paille et poussière. Les chevaux au pâturage engraissaient, devenaient paresseux et rossards. On ne décrochait plus maintenant le cache-poussière et le haut-de-forme du clou de la sellerie, on n'attelait plus les chevaux à la voiture qu'une fois par semaine, le dimanche, pour aller en ville à l'église. Miss Jenny déclarait qu'elle avait encore trop à faire pour son salut sans le compromettre en se rendant à l'église à cinquante milles à l'heure, qu'elle avait à son actif autant de péchés que pouvait en comporter son train de vie coutumier, surtout depuis qu'elle avait charge, par dessus le marché, de ménager coûte que coûte une entrée au ciel à l'âme du vieux Bayard qui, chaque après-midi, sillonnait à toute vitesse les routes de la contrée en compagnie du jeune Bayard, au risque de se casser le cou. Quant à l'âme du jeune Bayard, Miss Jenny était bien tranquille : il n'en avait pas. ... [...]
Simon bricolait en geignant, quelque part dans la propriété. Son cache-poussière de toile et son chapeau haut-de-forme pendus à un clou dans la sellerie accumulaient brins de paille et poussière. Les chevaux au pâturage engraissaient, devenaient paresseux et rossards. On ne décrochait plus maintenant le cache-poussière et le haut-de-forme du clou de la sellerie, on n'attelait plus les chevaux à la voiture qu'une fois par semaine, le dimanche, pour aller en ville à l'église. Miss Jenny déclarait qu'elle avait encore trop à faire pour son salut sans le compromettre en se rendant à l'église à cinquante milles à l'heure, qu'elle avait à son actif autant de péchés que pouvait en comporter son train de vie coutumier, surtout depuis qu'elle avait charge, par dessus le marché, de ménager coûte que coûte une entrée au ciel à l'âme du vieux Bayard qui, chaque après-midi, sillonnait à toute vitesse les routes de la contrée en compagnie du jeune Bayard, au risque de se casser le cou. Quant à l'âme du jeune Bayard, Miss Jenny était bien tranquille : il n'en avait pas. ... [...]
[...] C'était un après-midi ensoleillé d'octobre. Narcissa et Bayard étaient partis en auto peu de temps après le déjeuner, et Miss Jenny ainsi que le vieux Bayard étaient assis au soleil, au bout de la véranda lorsque, précédée de Simon, la députation, débouchant de par derrière, apparut solennellement au coin de la maison. Elle se composait de six nègres diversement endimanchés : l'un d'eux, énorme, au cou de taureau, en redingote et faux-col ecclésiastique, marchait à leur tête, l'air majestueux, l'oeil farouche et autoritaire.
- "Les v'là, col'nel," annonça Simon et, sans attendre, il gravit les marches et fit volte-face, ne laissant à personne le moindre doute sur le parti auquel il entendait se ranger.
La députation fit halte et s'aligna avec un léger flottement en un groupe solennel et décoratif.
- "Qu'est-ce que c'est ?" demanda Miss Jenny. "C'est vous, Oncle Bird ?
- Oui, Miss Jenny."
L'un des membres de la délégation découvrit en s'inclinant sa toison laineuse et grisonnante.
- "C'ment qu'vous allez ?"
Les autres se dandinèrent d'un pied sur l'autre et, un à un, enlevèrent leur chapeau. Le chef de la délégation serra le sien sur son estomac, comme un député au Congrès en train de se faire photographier.
- "Enfin, Simon", demanda le vieux Bayard, "que signifie tout cela ? Pourquoi nous amènes-tu tous ces nègres ici ?
- Y viennent pou' leu' argent", expliqua Simon.
- "Leur argent ?" répéta Miss Jenny, intriguée. "Quel argent, Simon ?
- Y viennent pou' c'argent qu'vous leu' avez promis," hurla Simon. [Le vieux Bayard est sourd.]
- "Je t'ai déclaré que je ne leur donnerai pas un sou," fit le vieux Bayard. "Est-ce que Simon vous a dit que j'allais vous rembourser ?" demanda-t-il à la délégation.
- Quel argent ?" reprit Miss Jenny. "De quoi veux-tu parler, Simon ?"
Le chef de l'ambassade fit mine de parler mais Simon le devança.
- "Voyons, m'col'nel, vous m'avez dit vous-même d'dire à ces nègres que vous leur-z-y-payeriez.
- Je n'ai jamais dit chose pareille," répondit le vieux Bayard avec violence. "Je t'ai dit que, s'ils voulaient te faire fiche en prison, ils n'avaient qu'à ne pas se gêner. C'est cela que je t'ai dit. ..." [...]
- "Les v'là, col'nel," annonça Simon et, sans attendre, il gravit les marches et fit volte-face, ne laissant à personne le moindre doute sur le parti auquel il entendait se ranger.
La députation fit halte et s'aligna avec un léger flottement en un groupe solennel et décoratif.
- "Qu'est-ce que c'est ?" demanda Miss Jenny. "C'est vous, Oncle Bird ?
- Oui, Miss Jenny."
L'un des membres de la délégation découvrit en s'inclinant sa toison laineuse et grisonnante.
- "C'ment qu'vous allez ?"
Les autres se dandinèrent d'un pied sur l'autre et, un à un, enlevèrent leur chapeau. Le chef de la délégation serra le sien sur son estomac, comme un député au Congrès en train de se faire photographier.
- "Enfin, Simon", demanda le vieux Bayard, "que signifie tout cela ? Pourquoi nous amènes-tu tous ces nègres ici ?
- Y viennent pou' leu' argent", expliqua Simon.
- "Leur argent ?" répéta Miss Jenny, intriguée. "Quel argent, Simon ?
- Y viennent pou' c'argent qu'vous leu' avez promis," hurla Simon. [Le vieux Bayard est sourd.]
- "Je t'ai déclaré que je ne leur donnerai pas un sou," fit le vieux Bayard. "Est-ce que Simon vous a dit que j'allais vous rembourser ?" demanda-t-il à la délégation.
- Quel argent ?" reprit Miss Jenny. "De quoi veux-tu parler, Simon ?"
Le chef de l'ambassade fit mine de parler mais Simon le devança.
- "Voyons, m'col'nel, vous m'avez dit vous-même d'dire à ces nègres que vous leur-z-y-payeriez.
- Je n'ai jamais dit chose pareille," répondit le vieux Bayard avec violence. "Je t'ai dit que, s'ils voulaient te faire fiche en prison, ils n'avaient qu'à ne pas se gêner. C'est cela que je t'ai dit. ..." [...]
Une glycine qui grimpait à l'une des extrémités de la véranda avait fleuri et défleuri ; une neige légère de pétales mettait sa note pâle sur ses sombres racines et celles d'un rosier qui montait également le long du bâti. Lentement, résolument, le rosier étouffait l'autre plante. Il était pour le moment en pleine floraison, des boutons pas plus gros que l'ongle d'un pouce, des fleurs épanouies pas plus larges qu'une pièce d'un dollar, par myriades, inodores et incueillables.
Bayard sommeillait, à présent. Lorsqu’elle (Narcissa Benbow) s’en aperçut, elle se rendit compte en même temps qu’elle ne savait plus au juste quand elle avait cessé de lire. Assise sur sa chaise, le livre ouvert sur ses genoux, à une page où les mots n’avaient pas éveillé le moindre écho dans son esprit, elle regardait le calme visage du dormeur. Il était de nouveau comme un masque de bronze, purifié par la maladie de sa violence impulsive, bien qu’il y transparût encore une violence latente et seulement un peu apaisée… Elle détourna les yeux, ses mains toujours étendues, immobiles, sur la page du livre ouvert, regardant vaguement par la fenêtre. Les rideaux pendaient sans mouvement. Sur la branche qui passait devant la fenêtre, les feuilles demeuraient inertes sous la caresse intermittente du soleil. Elle-même, assise sans vie, l’étoffe de son corsage à peine soulevée par son imperceptible respiration, se disait qu’il n’existerait de paix pour elle que dans un monde où il n’y aurait aucun homme.
(p. 308)
(p. 308)
Videos de William Faulkner (21)
Voir plusAjouter une vidéo
Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
De quel écrivain génial André Malraux parlait-il quand il a dit : « C'est l'intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier » ?
« le Bruit et la fureur » de William Faulkner, c'est à lire en poche chez Folio.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
De quel écrivain génial André Malraux parlait-il quand il a dit : « C'est l'intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier » ?
« le Bruit et la fureur » de William Faulkner, c'est à lire en poche chez Folio.
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de William Faulkner (65)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les titres des œuvres de William Faulkner
Quel est le titre correct ?
Le Bruit et l'Odeur
Le Bruit et la Peur
Le Bruit et la Fureur
Le Bruit et la Clameur
12 questions
173 lecteurs ont répondu
Thème :
William FaulknerCréer un quiz sur ce livre173 lecteurs ont répondu