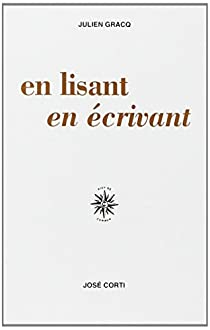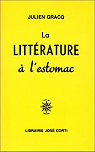Citations sur En lisant en écrivant (43)
Quelle bouffonerie, au fond, et quelle imposture, que le métier de critique : un expert en objets aimés ! Car après tout, si la littérature n'est pas pour le lecteur un répertoire de femmes fatales, et de créatures de perdition, elle ne vaut pas qu'on s'en occupe.
Tout grand paysage est une invitation à le posséder par la marche;
le genre d’enthousiasme qu'il communique est une ivresse du parcours.
le genre d’enthousiasme qu'il communique est une ivresse du parcours.
Un livre qui m'a séduit est comme une femme qui me fait tomber sous le charme : au diable ses ancêtres, son lieu de naissance, son milieu, ses relations, son éducation, ses amies d'enfance !
Quand j'ai commencé à écrire, il me semble que ce que je cherchais, c'était à matérialiser l'espace, la profondeur d'une certaine effervescence imaginative débordante, un peu comme on crie dans l'obscurité d'une caverne pour en mesurer les dimensions d'après l'écho.
Une histoire de la littérature, contrairement à l'histoire tout court, ne devrait comporter que des noms de victoires, puisque les défaites n'y sotn une victoire pour personne.
Tout ce qu’on introduit dans un roman devient signe : impossible d’y faire pénétrer un élément qui peu ou prou ne le
change, pas plus que dans une équation un chiffre, un signe
algébrique ou un exposant superflu. Quelquefois rarement, car
une des vertus cardinales du romancier est une belle et intrépide inconscience dans un jour de penchant critique il m’est arrivé de sentir une phrase que je venais d’écrire dresser, comme
dit Rimbaud, des épouvantes devant moi: aussitôt intégrée au
récit, assimilée par lui, happée sans retour par une continuité
impitoyable, je sentais l’impossibilité radicale de discerner l’effet ultime de ce que j’enfournais là à un organisme délicat en
pleine croissance : aliment ou poison? Une énorme atténuation
de responsabilité figure, heureusement parmi les caractéristiques romancières; il faut aller de l’avant sans trop réfléchir,
avoir l’optimisme au moins de croire tirer parti de ses bévues.
Parmi les millions de possibles qui se présentent chaque jour au
cours d’une vie, quelques-uns à peine écloront, échapperont au
massacre, comme font les œufs de poisson ou d’insecte, c’est-àdire porteront conséquence : si je me promène dans les rues de
ma ville, les cent maisons familières devant lesquelles je passe
chaque jour non perçues, anéanties à mesure — sont comme
si elles n’avaient jamais été. Dans un roman, au contraire, aucun possible n’est anéanti, aucun ne reste sans conséquence,
puisqu’il a reçu la vie têtue et dérangeante de l’écriture : si
j’écris dans un récit: « il passa devant une maison de petite apparence, dont les volets verts étaient rabattus », rien ne fera plus
que s’efface ce menu coup d’ongle sur l’esprit du lecteur, coup
d’ongle qui entre en composition aussitôt avec tout le reste ; un
timbre d’alarme grelotte : quelque chose s’est passé dans cette
maison, ou va se passer, quelqu’un l’habite, ou l’a habitée, dont
il va être question plus loin. Tout ce qui est dit déclenche attente
ou ressouvenir, tout est porté en compte, positif ou négatif, encore que la totalisation romanesque procède plutôt par agglutination que par addition. Ici apparaît la faiblesse de l’attaque de
Valery contre le roman: la vérité est que le romancier ne peut
pas dire «La marquise sortit à cinq heures »: une telle phrase,
à ce stade de la lecture, n’est même pas perçue : il dépose seulement, dans une nuit non encore éclairée, un accessoire de
scène destiné à devenir significatif plus tard, quand le rideau
sera vraiment levé. Le tout à venir se réserve de reprendre entièrement la partie dans son jeu, de réintégrer cette pierre d’attente d’abord suspendue en l’air, et nul jugement de gratuité ne
peut porter sur une telle phrase, puisqu’il n’est de jugement sur
le roman que le jugement dernier. Le mécanisme romanesque
est tout aussi précis et subtil que le mécanisme d’un poème,
seulement, à cause des dimensions de l’ouvrage, il décourage
le travail critique exhaustif que l’analyse d’un sonnet parfois
ne rebute pas. Le critique de romans, parce que la complexité
d’une analyse réelle excède les moyens de l’esprit, ne travaille
que sur des ensembles intermédiaires et arbitraires, des groupements simplificateurs tres étendus et pris en bloc : des « scènes
«ou des chapitres par exemple, là où un critique de poésie pèserait chaque mot. Mais si le roman en vaut la peine, c’est ligne à ligne que son aventure s’est courue, ligne à ligne qu’elle doit
être discutée, si on la discute. il n’y a pas plus de «détail «dans
le roman que dans aucune œuvre d’art, bien que sa masse le
suggère (parce qu’on se persuade avec raison que l’artiste en
effet n’a pu tout contrôler) et toute critique recuite à résumer, à
regrouper et à simplifier, perd son droit et son crédit, ici comme
ailleurs.
Déjà dit, ainsi ou autrement, et à redire encore.
change, pas plus que dans une équation un chiffre, un signe
algébrique ou un exposant superflu. Quelquefois rarement, car
une des vertus cardinales du romancier est une belle et intrépide inconscience dans un jour de penchant critique il m’est arrivé de sentir une phrase que je venais d’écrire dresser, comme
dit Rimbaud, des épouvantes devant moi: aussitôt intégrée au
récit, assimilée par lui, happée sans retour par une continuité
impitoyable, je sentais l’impossibilité radicale de discerner l’effet ultime de ce que j’enfournais là à un organisme délicat en
pleine croissance : aliment ou poison? Une énorme atténuation
de responsabilité figure, heureusement parmi les caractéristiques romancières; il faut aller de l’avant sans trop réfléchir,
avoir l’optimisme au moins de croire tirer parti de ses bévues.
Parmi les millions de possibles qui se présentent chaque jour au
cours d’une vie, quelques-uns à peine écloront, échapperont au
massacre, comme font les œufs de poisson ou d’insecte, c’est-àdire porteront conséquence : si je me promène dans les rues de
ma ville, les cent maisons familières devant lesquelles je passe
chaque jour non perçues, anéanties à mesure — sont comme
si elles n’avaient jamais été. Dans un roman, au contraire, aucun possible n’est anéanti, aucun ne reste sans conséquence,
puisqu’il a reçu la vie têtue et dérangeante de l’écriture : si
j’écris dans un récit: « il passa devant une maison de petite apparence, dont les volets verts étaient rabattus », rien ne fera plus
que s’efface ce menu coup d’ongle sur l’esprit du lecteur, coup
d’ongle qui entre en composition aussitôt avec tout le reste ; un
timbre d’alarme grelotte : quelque chose s’est passé dans cette
maison, ou va se passer, quelqu’un l’habite, ou l’a habitée, dont
il va être question plus loin. Tout ce qui est dit déclenche attente
ou ressouvenir, tout est porté en compte, positif ou négatif, encore que la totalisation romanesque procède plutôt par agglutination que par addition. Ici apparaît la faiblesse de l’attaque de
Valery contre le roman: la vérité est que le romancier ne peut
pas dire «La marquise sortit à cinq heures »: une telle phrase,
à ce stade de la lecture, n’est même pas perçue : il dépose seulement, dans une nuit non encore éclairée, un accessoire de
scène destiné à devenir significatif plus tard, quand le rideau
sera vraiment levé. Le tout à venir se réserve de reprendre entièrement la partie dans son jeu, de réintégrer cette pierre d’attente d’abord suspendue en l’air, et nul jugement de gratuité ne
peut porter sur une telle phrase, puisqu’il n’est de jugement sur
le roman que le jugement dernier. Le mécanisme romanesque
est tout aussi précis et subtil que le mécanisme d’un poème,
seulement, à cause des dimensions de l’ouvrage, il décourage
le travail critique exhaustif que l’analyse d’un sonnet parfois
ne rebute pas. Le critique de romans, parce que la complexité
d’une analyse réelle excède les moyens de l’esprit, ne travaille
que sur des ensembles intermédiaires et arbitraires, des groupements simplificateurs tres étendus et pris en bloc : des « scènes
«ou des chapitres par exemple, là où un critique de poésie pèserait chaque mot. Mais si le roman en vaut la peine, c’est ligne à ligne que son aventure s’est courue, ligne à ligne qu’elle doit
être discutée, si on la discute. il n’y a pas plus de «détail «dans
le roman que dans aucune œuvre d’art, bien que sa masse le
suggère (parce qu’on se persuade avec raison que l’artiste en
effet n’a pu tout contrôler) et toute critique recuite à résumer, à
regrouper et à simplifier, perd son droit et son crédit, ici comme
ailleurs.
Déjà dit, ainsi ou autrement, et à redire encore.
La taïga, par toutes les fissures de la ville, y insuffle son haleine verte comme souffle un mufle de bête sous une porte.
Qu’entend-on – qu’entend l’écrivain quand il parle de ses lecteurs? Il arrive couramment qu’on transfère à un nom, sans y
réfléchir, l’attachement qu’on a en réalité pour un seul ouvrage.
L’admiration, même sans arrière-pensée, vouée à un auteur
s’accommode plus d’une fois de la plus complète indifférence
pour tel nouveau livre de lui dont la publication est annoncée.
L’écrivain est achevé pour nous parce que nous le voulons garder tel ; l’action de la curiosité est éteinte. Certaines lectures
proscrivent même d’avance, ou frappent après elles d’interdit,
tout ce qui peut venir après elles de la même source : mécanisme d’auto-sterilisation qui fait penser à ces plantes dont la
première récolte est luxuriante, mais qui secrètent un toxique
rendant pour des années le sol inapte à leur reproduction, et à
elle seule. On peut comprendre à la rigueur, en raison du passage de la peinture d’un caractère à l’évocation d’une époque,
que les fervents de l’Education Sentimentale — et vice-versa ne
soient presque jamais ceux de Madame Bovary, mais il y a tout
aussi peu de lecteurs férus de manière égale de La Chartreuse
et de Le Rouge et le Noir. Disons-le franchement: l’amour
qu’on a pour un livre, ce plus insubstantiel et énigmatique, mais
de toute importance, dont il est marqué pour nous, implique
comme tout autre amour un moins dans l’intérêt qu’on peut
porter à tout ce qui lui ressemble, ou lui est apparenté. Seulement, ce que tout le monde accepte en amour, ou l’exclusivité
est de mise, est loin d’être pris en aussi bonne part en littérature, où l’auteur est tenu pour le commun dénominateur de tous
ses livres, et à cette pression d’une idée reçue nous cédons sans
même nous en apercevoir. Si on me questionne, je répondrai
sans même réfléchir que « j’aime Balzac «. Si je m’interroge
plus précisément sur mon goût véritable, je constate que je reprends et que je relis sans m’en lasser Beatrix et Les Chouans,
quelquefois Le Lys ou Séraphita .Les autres livres de Balzac, s’il
m’arrive de les rouvrir, ne donnent lieu le plus souvent qu’à une
ratification d’estime un peu distraite: le plaisir, largement commande par une glorification universelle, qu’ils me dispensent,
est celui que pourraient me donner en réalité quinze ou vingt
autres romanciers. De même « j’aime Wagner « signifie pour
moi en réalité : Parsifal et Lohengrin ôtés, dont je ne retrancherais pas une note, et partiellement Tristan, je n’ai envie que de
grappiller çà et là dans le reste quelques motifs, quelques scènes,
quelques passages d’orchestre isolés: la Tétralogie, son climat,
ses héros, son intrigue, me restent aussi étrangers qu’une saga
traduite du finnois ou du vieil irlandais. Heureux qui, comme
Proust, peut réussir la submersion d’un nom et d’une vie, puis
leur réanimation, dans une œuvre unique, totalisante et récapitulative. Ou encore Joyce, qui peut se recuire à Ulvsse, ou
Musil. Pour les autres, pour presque tous les autres, être « aimés
« signifie en réalité que, de leur substance, qu’ils ont souhaitée
indivisible autant qu’incorruptible, le lecteur le plus fanatique –
les trahissant intimement – jette autant, et plus, qu’il ne garde.
Et si les manuels de la littérature qu’on enseigne dans les lycées prenaient désormais pour base des livres ou des pièces, et
non des auteurs? Une histoire de la littérature, contrairement à
l’histoire tout court, ne devrait comporter que des noms de victoires, puisque les défaites n’y sont une victoire pour personne.
réfléchir, l’attachement qu’on a en réalité pour un seul ouvrage.
L’admiration, même sans arrière-pensée, vouée à un auteur
s’accommode plus d’une fois de la plus complète indifférence
pour tel nouveau livre de lui dont la publication est annoncée.
L’écrivain est achevé pour nous parce que nous le voulons garder tel ; l’action de la curiosité est éteinte. Certaines lectures
proscrivent même d’avance, ou frappent après elles d’interdit,
tout ce qui peut venir après elles de la même source : mécanisme d’auto-sterilisation qui fait penser à ces plantes dont la
première récolte est luxuriante, mais qui secrètent un toxique
rendant pour des années le sol inapte à leur reproduction, et à
elle seule. On peut comprendre à la rigueur, en raison du passage de la peinture d’un caractère à l’évocation d’une époque,
que les fervents de l’Education Sentimentale — et vice-versa ne
soient presque jamais ceux de Madame Bovary, mais il y a tout
aussi peu de lecteurs férus de manière égale de La Chartreuse
et de Le Rouge et le Noir. Disons-le franchement: l’amour
qu’on a pour un livre, ce plus insubstantiel et énigmatique, mais
de toute importance, dont il est marqué pour nous, implique
comme tout autre amour un moins dans l’intérêt qu’on peut
porter à tout ce qui lui ressemble, ou lui est apparenté. Seulement, ce que tout le monde accepte en amour, ou l’exclusivité
est de mise, est loin d’être pris en aussi bonne part en littérature, où l’auteur est tenu pour le commun dénominateur de tous
ses livres, et à cette pression d’une idée reçue nous cédons sans
même nous en apercevoir. Si on me questionne, je répondrai
sans même réfléchir que « j’aime Balzac «. Si je m’interroge
plus précisément sur mon goût véritable, je constate que je reprends et que je relis sans m’en lasser Beatrix et Les Chouans,
quelquefois Le Lys ou Séraphita .Les autres livres de Balzac, s’il
m’arrive de les rouvrir, ne donnent lieu le plus souvent qu’à une
ratification d’estime un peu distraite: le plaisir, largement commande par une glorification universelle, qu’ils me dispensent,
est celui que pourraient me donner en réalité quinze ou vingt
autres romanciers. De même « j’aime Wagner « signifie pour
moi en réalité : Parsifal et Lohengrin ôtés, dont je ne retrancherais pas une note, et partiellement Tristan, je n’ai envie que de
grappiller çà et là dans le reste quelques motifs, quelques scènes,
quelques passages d’orchestre isolés: la Tétralogie, son climat,
ses héros, son intrigue, me restent aussi étrangers qu’une saga
traduite du finnois ou du vieil irlandais. Heureux qui, comme
Proust, peut réussir la submersion d’un nom et d’une vie, puis
leur réanimation, dans une œuvre unique, totalisante et récapitulative. Ou encore Joyce, qui peut se recuire à Ulvsse, ou
Musil. Pour les autres, pour presque tous les autres, être « aimés
« signifie en réalité que, de leur substance, qu’ils ont souhaitée
indivisible autant qu’incorruptible, le lecteur le plus fanatique –
les trahissant intimement – jette autant, et plus, qu’il ne garde.
Et si les manuels de la littérature qu’on enseigne dans les lycées prenaient désormais pour base des livres ou des pièces, et
non des auteurs? Une histoire de la littérature, contrairement à
l’histoire tout court, ne devrait comporter que des noms de victoires, puisque les défaites n’y sont une victoire pour personne.
Il y a des heures où je n’ai plus de goût que pour les quelques
récits modestes, sans intrigue, sans merveilleux apparent et
même sans poésie éclatante, que l’on quitte avec la certitude
d’être toujours resté en rassurant pays de connaissance. Mais
non sans le sentiment d’une sorte de tendre ensoleillement intérieur, qui bégaye, du fond de sa quiétude mystérieusement
consolée «oui, la vie c’est comme ça».
Aussi bien Nerval dans Sylvie que Tolstoï (Les Cosaques) si
différents, me dispensent ce sentiment avec égalité. Rarement
l’œuvre de Balzac, que le bouillonnement humain, qui monte
parfois à la tête comme un vertige, surpeuple trop. Jamais Flaubert, où l’interposition du regard froid, et de la loupe de l’entomologiste, ne se laisse pas une seconde oublier. Ni Proust: le
crépitement ininterrompu du détail trop rendu, trop éclatant, y
tient continûment à distance le faible engourdissement de l’esprit, comparable à l’éclosion d’un nouveau climat, qui prélude
à ce genre d’enchantement. Et pas davantage Stendhal : il y
a ici un refus de s’engluer dans le monde, et comme un excès
d’autonomie jalouse de l’esprit qui, par l’insolence, par le gé, par l’ironie, se reprend — et reprend le lecteur en main, à
chaque instant.
Peut-être y a-t-il quelque trace de vieillissement dans ce goût
plus prononcé que j’ai de laisser venir à travers le texte – ou de
me donner l’illusion de laisser venir — la vie comme elle est.
Aux écrivains qui me la restituent, une certaine inactivité de
l’esprit, qui se laisse lentement imprégner, est nécessaire, combinée à une plus grande ouverture, sur le champ sensible, du
diaphragme intérieur ce que Degas j’imagine, appelait, avec
un bonheur d’expression ami de la mémoire, « se mettre en espalier «. A vingt ans, à trente ans même, il me semblait que
la vie passait très au large et comme insaisissable ; une ivresse
à arrière-goût d’angoisse se levait de la multiplicité offerte, et
massacrée à mesure, des possibles. La contraction de champ
qu’amène l’âge fixe et leste ce Protée éblouissant et insaisissable. Le monde est plus proche de nous, plus solide et plus sûr,
et l’écrivain, qui sent diminuer l’aptitude de l’imagination à
l’envol, et pour qui Pégase est rétif, retrouve aussi en partie les
ressources d’Antée.
récits modestes, sans intrigue, sans merveilleux apparent et
même sans poésie éclatante, que l’on quitte avec la certitude
d’être toujours resté en rassurant pays de connaissance. Mais
non sans le sentiment d’une sorte de tendre ensoleillement intérieur, qui bégaye, du fond de sa quiétude mystérieusement
consolée «oui, la vie c’est comme ça».
Aussi bien Nerval dans Sylvie que Tolstoï (Les Cosaques) si
différents, me dispensent ce sentiment avec égalité. Rarement
l’œuvre de Balzac, que le bouillonnement humain, qui monte
parfois à la tête comme un vertige, surpeuple trop. Jamais Flaubert, où l’interposition du regard froid, et de la loupe de l’entomologiste, ne se laisse pas une seconde oublier. Ni Proust: le
crépitement ininterrompu du détail trop rendu, trop éclatant, y
tient continûment à distance le faible engourdissement de l’esprit, comparable à l’éclosion d’un nouveau climat, qui prélude
à ce genre d’enchantement. Et pas davantage Stendhal : il y
a ici un refus de s’engluer dans le monde, et comme un excès
d’autonomie jalouse de l’esprit qui, par l’insolence, par le gé, par l’ironie, se reprend — et reprend le lecteur en main, à
chaque instant.
Peut-être y a-t-il quelque trace de vieillissement dans ce goût
plus prononcé que j’ai de laisser venir à travers le texte – ou de
me donner l’illusion de laisser venir — la vie comme elle est.
Aux écrivains qui me la restituent, une certaine inactivité de
l’esprit, qui se laisse lentement imprégner, est nécessaire, combinée à une plus grande ouverture, sur le champ sensible, du
diaphragme intérieur ce que Degas j’imagine, appelait, avec
un bonheur d’expression ami de la mémoire, « se mettre en espalier «. A vingt ans, à trente ans même, il me semblait que
la vie passait très au large et comme insaisissable ; une ivresse
à arrière-goût d’angoisse se levait de la multiplicité offerte, et
massacrée à mesure, des possibles. La contraction de champ
qu’amène l’âge fixe et leste ce Protée éblouissant et insaisissable. Le monde est plus proche de nous, plus solide et plus sûr,
et l’écrivain, qui sent diminuer l’aptitude de l’imagination à
l’envol, et pour qui Pégase est rétif, retrouve aussi en partie les
ressources d’Antée.
Ce que j'ai cherché à faire, entre autres choses, dans "Le Rivage des Syrtes", plutôt qu'à raconter une histoire intemporelle, c'est à libérer par distillation un élément volatil, l' "esprit-de-l'Histoire", au sens où on parle d'esprit-de-vin, et à le raffiner suffisamment pour qu'il put s'enflammer au contact de l'imagination. Il y a dans l'Histoire un sortilège embusqué, un élément qui, quoique mêlé à une masse considérable d'excipient inerte, a la vertu de griser.
[Julien GRACQ, "En lisant en écrivant", Librairie José Corti, 1980 – page 216]
[Julien GRACQ, "En lisant en écrivant", Librairie José Corti, 1980 – page 216]
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Julien Gracq (36)
Voir plus
Quiz
Voir plus
900ème : Spécial Julien Gracq
Julien était bel homme, on le qualifiait parfois de beau ...?...
spécimen
ténébreux
gosse
Brummel
11 questions
29 lecteurs ont répondu
Thème :
Julien GracqCréer un quiz sur ce livre29 lecteurs ont répondu