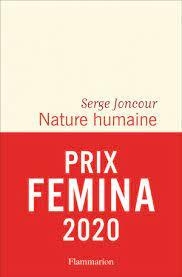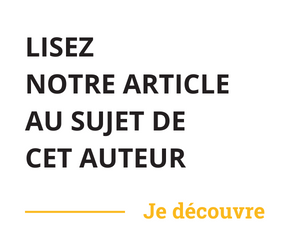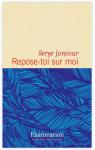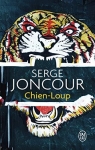un bien beau roman de génération mais qui peut être lu par tous. L'auteur, Serge Joncour a quasiment mon âge (à quelques années près) et presque tout ses souvenirs me parlent. Un livre où l'on prend plaisir à se souvenir des belles choses comme des moins belles.
Alexandre, vit avec ses parents et ses trois soeurs dans une ferme dans le Lot. le récit démarre en 1976, date de la première grosse canicule où la pluie est bénit par beaucoup de monde. Alexandre et ses soeurs, sont de jeunes adolescents ou encore des enfants. Puis nous passons en 1980, où la soeur aînée, Caroline, part vivre en ville à Toulouse pour finir ses études. Les deux petites soeurs, Agathe et Vanessa, rêvent de la ville également. Alexandre est pressenti par les parents et ses soeurs pour faire vivre la ferme familiale. Et les années passent encore...jusqu'en 1999.
A travers cette famille, Alexandre et les siens nous font revivre la vie paysanne et plus tard la fin d'un autre monde. Leurs histoires fait toujours référence à la grande, comme l'élection de Mitterrand, les anti-nucléaires, la catastrophe de Tchernobyl, la grande tempête de 1999. Elle fait nous souvenir également de l'essor technologique, la télé, le téléphone avec fil puis sans fil etc...bref plein de souvenirs qui font plaisir à lire.
Ce roman a eu le prix Fémina 2020, il le mérite amplement.
Alexandre, vit avec ses parents et ses trois soeurs dans une ferme dans le Lot. le récit démarre en 1976, date de la première grosse canicule où la pluie est bénit par beaucoup de monde. Alexandre et ses soeurs, sont de jeunes adolescents ou encore des enfants. Puis nous passons en 1980, où la soeur aînée, Caroline, part vivre en ville à Toulouse pour finir ses études. Les deux petites soeurs, Agathe et Vanessa, rêvent de la ville également. Alexandre est pressenti par les parents et ses soeurs pour faire vivre la ferme familiale. Et les années passent encore...jusqu'en 1999.
A travers cette famille, Alexandre et les siens nous font revivre la vie paysanne et plus tard la fin d'un autre monde. Leurs histoires fait toujours référence à la grande, comme l'élection de Mitterrand, les anti-nucléaires, la catastrophe de Tchernobyl, la grande tempête de 1999. Elle fait nous souvenir également de l'essor technologique, la télé, le téléphone avec fil puis sans fil etc...bref plein de souvenirs qui font plaisir à lire.
Ce roman a eu le prix Fémina 2020, il le mérite amplement.
Nature Humaine d'une surprenante puissance romanesque.
Dans les dernières heures de la tempête de 1999, qui voit se produire le désastre de l'Erika le monde d'Alexandre est au bord de la rupture. La sécheresse de l'année 1976 est encore présente comme l'effondrement de Tchernobyl, Alexandre se pose une fois encore la question de sa responsabilité. Peut-on croire encore à la nature humaine.
Le roman de Serge Joncour nous invite à cette confrontation, un face à face magnifique, d'un romanesque épique, incarné notamment par un Agriculteur, en proie au doute, seul, mais déterminé à prendre en main son destin.
Se faire l'historien de l'agriculture française c'est la certitude de se faire écorcher par une sensibilité philosophique ou religieuse, ou par une école de santé, par l'élu d'un chef lieu, ou d'un chef pieu, souvent par la FNSEA ou la Confédération paysanne... Ce projet d'écriture mené par Serge Joncour, de restituer l'histoire de l'agriculture française entre 1976 et les années 2000, était donc un pari fou, car comment réconcilier autant de sensibilités.
À titre personnel, en 1976 je me trouvais 4 années après l'Agro, et en 2000 4 années avant ma retraite, et prêt à m'aveugler pour un projet utopique, valoriser les sous produits de l'Agroalimentaire, pudiquement appelés, " les déchets".
Ce pari romanesque est une totale réussite. "Nature humaine" deviendra une référence, il interroge sur le devenir des acteurs d'un monde rural essentiel, dans une société numérisée et virtuelle, monde parfois désigné être en déclin. le questionnement est limpide et les acteurs crédibles, vivants, avec leurs défauts et leurs frustrations.
Quelques éléments de la trame romanesque.
Les quelques clés nécessaires à saisir le monde paysan sont posées. En effet sur cette période nous allons connaître dans l'agriculture, les sommets et la chute ; le pétrole vert de Giscard, et les IAA virtuoses du progrès, puis la chasse aux nitrates déclenchée par les écologistes représentés par Eaux et Rivières.
Aujourd'hui les pesticides ont remplacé les nitrates, ce qui représente une avancée spectaculaire. Nous avons subi deux vagues pandémiques d'origine anglaise, la vache folle, et la brucellose, autant de signes collés à leurs bottes, ceux d'une agriculture qui ne sait pas nourrir sainement, trop éloignée du bio, trop industrielle et libérale.
En 1976 l'agriculture et les syndicats agricoles étaient plébiscités. Des les années 2000 la cote d'amour du monde agricole ne fait que baisser, et se redresse timidement depuis 10 ans par le biais de l'agriculture biologique.
En pointant sa plume sur ce monde, Serge Joncour savait lucidement que son livre ne pouvait faire un tabac. Je le vois susciter quelques indulgences, avec cette interrogation, qui est loin de se dissiper, êtes vous ici, oui ou non, pour défendre la cause animale. En second rideau, l'autre interrogation, êtes vous ici, oui ou non pour le bio. Les bons points se distribuent à compte d'auteur.
Pour tous ceux qui placent la nature au niveau le plus élevée des préoccupations humaines, le livre de Serge Joncour, la Nature humaine est un livre irremplaçable, d'une justesse qui balise notre face-à-face avec la terre, et fait de la nature une cause commune, comme si enfin, on affirmait « ensemble écoutons battre la terre » .
Serge Joncour appuie là où les regrets sont les plus vifs, et ça fait mal.
Dans la famille Fabrier Caroline, l'aînée, était bien la seule à avoir confiance en l'avenir, souligne Serge Joncour page 110. Elle sera enseignante, pas agricultrice ni femme d'agriculteur. Pour reprendre l'exploitation il n'y a qu'Alexandre le garçon, qui suit l'école d'agriculture.
Donner du sens à sa vie, est la quête incessante d'Alexandre. Donner un sens à ce que l'on réalise, faire renaître ce que nos avons de plus profond en nous, de plus intime, n'est-ce pas faire revivre notre nature humaine.
Avec qui Alexandre va-t-il pouvoir appréhender ces questions fondamentales ? Si la porte de son père est toujours ouverte, les options qui lui imposent, ne sont pas acceptables. La volonté des parents de restituer à ses soeurs ce qu'Alexandre va recevoir est loin d'être un marché sans risques.
Quel projet va t-il suivre, comment se recentrer vers la nature
Abandonner la culture des anciens, comme le Safran, pour l'hypothétique rentabilité de l'élevage en batterie, ce sera non.
C'est auprès d'un voisin que le jeune Alexandre va comprendre au fil des années les raisons des conflits qui se déroulaient autour des fermes du Larzac. le père Crayssac plongeant dans sa colère lui ouvrira les yeux sur les conséquences de la construction d'une autoroute Paris Toulouse.
Dès la première page Alexandre murmure à lui même, "pour la première fois qu'il se retrouvait seul à la ferme". Seul face à ses choix, malgré Constanze cette jeune femme qui ne cesse d'être en voyage et semble vivre à côté d'elle-même.
Être éleveur ce sera très difficile, et pour un jeune de Gourdon (46) encore plus difficile N'appelez pas les philosophe ou les bienheureux, ils vous diront « jeûnez » ou lâchez prise !
"Chaque vie se tient à l'écart de ce qu'elle aurait pu être mais il ne regrettait rien", page 9. Il garde en lui les parfums du safran, de la menthe et du patchouli comme une trace ineffable du passage de Constanze.
Serge Joncour nous offre aussi, au delà de l'émerveillement qu'il insuffle à ses personnages des subtilités romanesques insolites. Il joue avec des moments de complicité comme ceux passés avec le vieux Crayssac, quand celui-ci montre à Alexandre son trésor. Une confidence bien plus qu'un vrai lingot, un savoir qui donne du bonheur.
Quelle trouvaille de perdre 3 feuillets soit 9 pages et de les disperser dans les pages du livre à des dates inexactes.
C'est tout l'art humoristique et romanesque de Serge Joncour.
Dans les dernières heures de la tempête de 1999, qui voit se produire le désastre de l'Erika le monde d'Alexandre est au bord de la rupture. La sécheresse de l'année 1976 est encore présente comme l'effondrement de Tchernobyl, Alexandre se pose une fois encore la question de sa responsabilité. Peut-on croire encore à la nature humaine.
Le roman de Serge Joncour nous invite à cette confrontation, un face à face magnifique, d'un romanesque épique, incarné notamment par un Agriculteur, en proie au doute, seul, mais déterminé à prendre en main son destin.
Se faire l'historien de l'agriculture française c'est la certitude de se faire écorcher par une sensibilité philosophique ou religieuse, ou par une école de santé, par l'élu d'un chef lieu, ou d'un chef pieu, souvent par la FNSEA ou la Confédération paysanne... Ce projet d'écriture mené par Serge Joncour, de restituer l'histoire de l'agriculture française entre 1976 et les années 2000, était donc un pari fou, car comment réconcilier autant de sensibilités.
À titre personnel, en 1976 je me trouvais 4 années après l'Agro, et en 2000 4 années avant ma retraite, et prêt à m'aveugler pour un projet utopique, valoriser les sous produits de l'Agroalimentaire, pudiquement appelés, " les déchets".
Ce pari romanesque est une totale réussite. "Nature humaine" deviendra une référence, il interroge sur le devenir des acteurs d'un monde rural essentiel, dans une société numérisée et virtuelle, monde parfois désigné être en déclin. le questionnement est limpide et les acteurs crédibles, vivants, avec leurs défauts et leurs frustrations.
Quelques éléments de la trame romanesque.
Les quelques clés nécessaires à saisir le monde paysan sont posées. En effet sur cette période nous allons connaître dans l'agriculture, les sommets et la chute ; le pétrole vert de Giscard, et les IAA virtuoses du progrès, puis la chasse aux nitrates déclenchée par les écologistes représentés par Eaux et Rivières.
Aujourd'hui les pesticides ont remplacé les nitrates, ce qui représente une avancée spectaculaire. Nous avons subi deux vagues pandémiques d'origine anglaise, la vache folle, et la brucellose, autant de signes collés à leurs bottes, ceux d'une agriculture qui ne sait pas nourrir sainement, trop éloignée du bio, trop industrielle et libérale.
En 1976 l'agriculture et les syndicats agricoles étaient plébiscités. Des les années 2000 la cote d'amour du monde agricole ne fait que baisser, et se redresse timidement depuis 10 ans par le biais de l'agriculture biologique.
En pointant sa plume sur ce monde, Serge Joncour savait lucidement que son livre ne pouvait faire un tabac. Je le vois susciter quelques indulgences, avec cette interrogation, qui est loin de se dissiper, êtes vous ici, oui ou non, pour défendre la cause animale. En second rideau, l'autre interrogation, êtes vous ici, oui ou non pour le bio. Les bons points se distribuent à compte d'auteur.
Pour tous ceux qui placent la nature au niveau le plus élevée des préoccupations humaines, le livre de Serge Joncour, la Nature humaine est un livre irremplaçable, d'une justesse qui balise notre face-à-face avec la terre, et fait de la nature une cause commune, comme si enfin, on affirmait « ensemble écoutons battre la terre » .
Serge Joncour appuie là où les regrets sont les plus vifs, et ça fait mal.
Dans la famille Fabrier Caroline, l'aînée, était bien la seule à avoir confiance en l'avenir, souligne Serge Joncour page 110. Elle sera enseignante, pas agricultrice ni femme d'agriculteur. Pour reprendre l'exploitation il n'y a qu'Alexandre le garçon, qui suit l'école d'agriculture.
Donner du sens à sa vie, est la quête incessante d'Alexandre. Donner un sens à ce que l'on réalise, faire renaître ce que nos avons de plus profond en nous, de plus intime, n'est-ce pas faire revivre notre nature humaine.
Avec qui Alexandre va-t-il pouvoir appréhender ces questions fondamentales ? Si la porte de son père est toujours ouverte, les options qui lui imposent, ne sont pas acceptables. La volonté des parents de restituer à ses soeurs ce qu'Alexandre va recevoir est loin d'être un marché sans risques.
Quel projet va t-il suivre, comment se recentrer vers la nature
Abandonner la culture des anciens, comme le Safran, pour l'hypothétique rentabilité de l'élevage en batterie, ce sera non.
C'est auprès d'un voisin que le jeune Alexandre va comprendre au fil des années les raisons des conflits qui se déroulaient autour des fermes du Larzac. le père Crayssac plongeant dans sa colère lui ouvrira les yeux sur les conséquences de la construction d'une autoroute Paris Toulouse.
Dès la première page Alexandre murmure à lui même, "pour la première fois qu'il se retrouvait seul à la ferme". Seul face à ses choix, malgré Constanze cette jeune femme qui ne cesse d'être en voyage et semble vivre à côté d'elle-même.
Être éleveur ce sera très difficile, et pour un jeune de Gourdon (46) encore plus difficile N'appelez pas les philosophe ou les bienheureux, ils vous diront « jeûnez » ou lâchez prise !
"Chaque vie se tient à l'écart de ce qu'elle aurait pu être mais il ne regrettait rien", page 9. Il garde en lui les parfums du safran, de la menthe et du patchouli comme une trace ineffable du passage de Constanze.
Serge Joncour nous offre aussi, au delà de l'émerveillement qu'il insuffle à ses personnages des subtilités romanesques insolites. Il joue avec des moments de complicité comme ceux passés avec le vieux Crayssac, quand celui-ci montre à Alexandre son trésor. Une confidence bien plus qu'un vrai lingot, un savoir qui donne du bonheur.
Quelle trouvaille de perdre 3 feuillets soit 9 pages et de les disperser dans les pages du livre à des dates inexactes.
C'est tout l'art humoristique et romanesque de Serge Joncour.
Tout d'abord je tiens à remercier les éditions Flammarion et l'auteur qui m'ont permis de lire ce roman en avant-première. J'ai découvert les romans de Serge Joncour avec Repose toi sur moi, puis Chien Loup que j'ai particulièrement aimé. J'avais hâte de découvrir ce nouveau roman au titre ambitieux mais aussi énigmatique tant on peut y aborder de sujets…
Dès les premières pages on comprend la place qu'aura la Nature dans le roman ; elle sera un personnage à part entière dans laquelle évolue Alexandre et Constanze sur une période de plus de vingt ans (du milieu des années 70 à 2000). Cette période est celle de mon enfance et adolescence que j'ai revécue avec le recul du temps, et l'analyse critique que l'on peut en avoir aujourd'hui. Les grandes vérités d'hier, l'agriculture intensive, le nucléaire, l'essor sans limite de la grande distribution, le développement de la mobilité tous azimuts …sont vues avec un prisme de 2020, année du confinement et de l'apparition de la notion d'un monde d'après. Pour autant l'auteur ne tombe pas dans un travers moralisateur ou dans des jugements manichéens. Au contraire j'ai trouvé parfois quelques bonnes phrases teintée d'humour et d'ironie positive. Il s'attache à donner du corps au récit grâce à de belles aventures Humaines ; celles d'Alexandre, agriculteur romantique terriblement empathique et Constanze post soixante huitarde éprise de liberté et en quête de sens et terriblement séduisante. Les personnages secondaires sont savoureux ; les soeurs d'Alexandre (que chacun reconnaitra dans sa propre famille), le père Crayssac, et son bon sens terrien….Avec eux Serge Joncour nous fait voyager dans le temps, nous met au vert dans une nature qui convie à l'émerveillement (les champs de menthe en fleur, on a l'impression d'y être), tout en laissant monter une tension qui rend la lecture addictive à la mode d'un page turner… On est quelque part entre le film « Petit Paysan » et la chanson « le pouvoir des fleurs » ; c'est toute la force du roman : de traiter de sujets préoccupants avec une forme de légèreté dans un style léché et une belle densité du fait de la richesse des sujets abordés et de la vie de ses personnages.
Sans vouloir rentrer dans les classements ou préjuger des succès que rencontrera cet ouvrage, il est pour moi un must have pour quiconque a déjà apprécié un roman de Serge Joncour, mais aussi pour ceux qui souhaitent découvrir un auteur, qui arrive comme peu d'autre à raconter des histoires qui aident à réfléchir sur les rapports humains et celui que l'on a à la nature
Dès les premières pages on comprend la place qu'aura la Nature dans le roman ; elle sera un personnage à part entière dans laquelle évolue Alexandre et Constanze sur une période de plus de vingt ans (du milieu des années 70 à 2000). Cette période est celle de mon enfance et adolescence que j'ai revécue avec le recul du temps, et l'analyse critique que l'on peut en avoir aujourd'hui. Les grandes vérités d'hier, l'agriculture intensive, le nucléaire, l'essor sans limite de la grande distribution, le développement de la mobilité tous azimuts …sont vues avec un prisme de 2020, année du confinement et de l'apparition de la notion d'un monde d'après. Pour autant l'auteur ne tombe pas dans un travers moralisateur ou dans des jugements manichéens. Au contraire j'ai trouvé parfois quelques bonnes phrases teintée d'humour et d'ironie positive. Il s'attache à donner du corps au récit grâce à de belles aventures Humaines ; celles d'Alexandre, agriculteur romantique terriblement empathique et Constanze post soixante huitarde éprise de liberté et en quête de sens et terriblement séduisante. Les personnages secondaires sont savoureux ; les soeurs d'Alexandre (que chacun reconnaitra dans sa propre famille), le père Crayssac, et son bon sens terrien….Avec eux Serge Joncour nous fait voyager dans le temps, nous met au vert dans une nature qui convie à l'émerveillement (les champs de menthe en fleur, on a l'impression d'y être), tout en laissant monter une tension qui rend la lecture addictive à la mode d'un page turner… On est quelque part entre le film « Petit Paysan » et la chanson « le pouvoir des fleurs » ; c'est toute la force du roman : de traiter de sujets préoccupants avec une forme de légèreté dans un style léché et une belle densité du fait de la richesse des sujets abordés et de la vie de ses personnages.
Sans vouloir rentrer dans les classements ou préjuger des succès que rencontrera cet ouvrage, il est pour moi un must have pour quiconque a déjà apprécié un roman de Serge Joncour, mais aussi pour ceux qui souhaitent découvrir un auteur, qui arrive comme peu d'autre à raconter des histoires qui aident à réfléchir sur les rapports humains et celui que l'on a à la nature
Serge Joncour dont c'est mon quatrième opus m'avait habitué à plus de pression, plus de tension et plus de férocité dans ses romans précédents.
Celui-ci est une rétrospective musclée des années 70-90 depuis les plateaux de la Corrèze dans une famille d'éleveurs qui constatent avec abattement une pleine mutation de leur avenir vers la mondialisation sur fond de centrales nucléaires en pleine expansion.
Serge Joncour a-t-il voulu réveiller la nostalgie de ces années d'espoir à grand renfort de Mammouth qui écrasait les prix, nous interpeler avec le sourire de Danielle Gilbert à la coiffure de Playmobil nous présentant Plastic Bertrand à Midi- Première.
Ça planait alors pour tout le monde quand on allait chercher du lait chaud dans la ferme du haut.
La mélancolie, ce « Roundup » de la vie aurait-il fait son oeuvre, tout désherbé même le champ des possibles ?
Il nous rappelle aussi qu'à cette époque on faisait le plein chez Antar pour alimenter la GS dans laquelle la radio-K7 Pionner crachait le « One step beyond » de Madness alors que beaucoup ne voulait pas faire un pas plus loin pour ne pas découvrir l'autoroute promise par Chirac sabrer comme une balafre la campagne de leurs racines.
Le soir, à la Telefunken, après Albator et les pubs Dim, Calor et Whiskass, voir la mine éternellement déconfite de Roger Gicquel, me donnait toujours l'impression que toutes les catastrophes avaient échouées sur ses pompes, ce qui n'était pas complétement faux concernant Tchernobyl en 86.
Je me souviens que pendant que je suçais mon Kim-pouss à la vanille mon père fulminait à grands coups de poings sur la toile cirée de la table de la cuisine contre les prises de positions de l'Europe sur la politique agricole commune. « On nous ment, on nous spolie » scandait alors Arlette toujours polie...
Cette débauche de réclames m'a embarrassé, comme une marque indélébile et indécente d'une appartenance à un passé révolu qui, je le sais maintenant, a accouché d'un présent bien pire, sans aucun remord.
Les années de 76 à 99 sont parmi les plus belles de ma vie. Les voir ainsi offertes en pâtures comme de vieux « Jours de France » abandonnés sur la table basse du dentiste m'a déprimé.
It's a joke...Il faut vivre avec son temps ! comme disait ma grand-mère qui n'avait jamais vu la mer et qui trouvait absolument tout incroyablement exotique passé les 20 kms de sa ferme.
Cependant, grâce à la magie Joncour, je n'ai pas pu rester insensible au combat d'Alexandre fils et petit-fils d'éleveurs de bovins englué dans de lourdes obligations, déchiré entre ses choix d'émancipation auprès de Constanze, une jeune allemande écolo et ses devoirs d'héritier alors que ses frangines ont déserté le creuset familial depuis belle lurette pour faire des études à Toulouse ou à Paris.
Au fil des pages, la rétrospective devient lutte. Alexandre ne comprend pas ce monde qu'il n'aime plus. Il n'aime que sa terre à l'odeur de menthe sauvage, que ses belles Salers à la robe rousse, véritables points d'attache chatoyants dans ses verts pâturages.
Contestataires, antinucléaires, révolutionnaires seront ses choix dans cet avenir qu'il ne peut envisager terres à taire.
C'est, par un final magistral qu'une fois encore Serge Joncour m'a séduit de sa vision au champ aussi large qu'incroyable, gorgé de révolte, inondé d'espoir et surtout envahi d'amour.
Celui-ci est une rétrospective musclée des années 70-90 depuis les plateaux de la Corrèze dans une famille d'éleveurs qui constatent avec abattement une pleine mutation de leur avenir vers la mondialisation sur fond de centrales nucléaires en pleine expansion.
Serge Joncour a-t-il voulu réveiller la nostalgie de ces années d'espoir à grand renfort de Mammouth qui écrasait les prix, nous interpeler avec le sourire de Danielle Gilbert à la coiffure de Playmobil nous présentant Plastic Bertrand à Midi- Première.
Ça planait alors pour tout le monde quand on allait chercher du lait chaud dans la ferme du haut.
La mélancolie, ce « Roundup » de la vie aurait-il fait son oeuvre, tout désherbé même le champ des possibles ?
Il nous rappelle aussi qu'à cette époque on faisait le plein chez Antar pour alimenter la GS dans laquelle la radio-K7 Pionner crachait le « One step beyond » de Madness alors que beaucoup ne voulait pas faire un pas plus loin pour ne pas découvrir l'autoroute promise par Chirac sabrer comme une balafre la campagne de leurs racines.
Le soir, à la Telefunken, après Albator et les pubs Dim, Calor et Whiskass, voir la mine éternellement déconfite de Roger Gicquel, me donnait toujours l'impression que toutes les catastrophes avaient échouées sur ses pompes, ce qui n'était pas complétement faux concernant Tchernobyl en 86.
Je me souviens que pendant que je suçais mon Kim-pouss à la vanille mon père fulminait à grands coups de poings sur la toile cirée de la table de la cuisine contre les prises de positions de l'Europe sur la politique agricole commune. « On nous ment, on nous spolie » scandait alors Arlette toujours polie...
Cette débauche de réclames m'a embarrassé, comme une marque indélébile et indécente d'une appartenance à un passé révolu qui, je le sais maintenant, a accouché d'un présent bien pire, sans aucun remord.
Les années de 76 à 99 sont parmi les plus belles de ma vie. Les voir ainsi offertes en pâtures comme de vieux « Jours de France » abandonnés sur la table basse du dentiste m'a déprimé.
It's a joke...Il faut vivre avec son temps ! comme disait ma grand-mère qui n'avait jamais vu la mer et qui trouvait absolument tout incroyablement exotique passé les 20 kms de sa ferme.
Cependant, grâce à la magie Joncour, je n'ai pas pu rester insensible au combat d'Alexandre fils et petit-fils d'éleveurs de bovins englué dans de lourdes obligations, déchiré entre ses choix d'émancipation auprès de Constanze, une jeune allemande écolo et ses devoirs d'héritier alors que ses frangines ont déserté le creuset familial depuis belle lurette pour faire des études à Toulouse ou à Paris.
Au fil des pages, la rétrospective devient lutte. Alexandre ne comprend pas ce monde qu'il n'aime plus. Il n'aime que sa terre à l'odeur de menthe sauvage, que ses belles Salers à la robe rousse, véritables points d'attache chatoyants dans ses verts pâturages.
Contestataires, antinucléaires, révolutionnaires seront ses choix dans cet avenir qu'il ne peut envisager terres à taire.
C'est, par un final magistral qu'une fois encore Serge Joncour m'a séduit de sa vision au champ aussi large qu'incroyable, gorgé de révolte, inondé d'espoir et surtout envahi d'amour.
Ça commençait plutôt bien. La canicule de 1976, la campagne du sud-ouest, encore préservée, presque sauvage, évoquaient des souvenirs ensoleillés et enfouis de mon enfance.
J'ai été d'emblée séduit par l'ambition de Serge Joncour, celle de peindre les luttes d'une époque, la fin du septennat de Giscard d'Estaing, qu'on regarde aujourd'hui avec nostalgie, en oubliant les nombreux attentats et les diverses violences qui l'émaillaient.
Le romancier fait mouche en s'attaquant à la fin des trente glorieuses, ces quelques années où le monde bascule vers le modèle néo-libéral qui régit toujours notre époque. C'est ce moment charnière entre l'ancien monde et le nouveau, cet instant où la fracture entre les « somewhere », les enracinés, les gens du terroir et les « anywhere », les élites mondialisées, les habitants des métropoles devient béante, que tente de saisir le roman. Les figures archétypales de cette fracture sont le héros Alexandre, resté fidèle à la ferme familiale, au prix d'un labeur sans fin et d'une vie quasi monacale et sa bien-aimée, Constanze, une allemande de l'est engagée contre le nucléaire qui parcourt le monde dans un tourbillon continu.
« Nature humaine » nous narre ces années 1976-1981 qui voient se produire en temps réel, la disparition programmée de la ruralité en dépit de promesses politiques jamais vraiment tenues, la victoire du grand sur le petit, celle de l'hypermarché sur le petit commerce, des grandes villes sur les petits bourgs, le développement de l'énergie nucléaire et de ses gigantesques centrales en étant l'illustration emblématique. le jeune Alexandre va, le temps de quelques allers-retours à Toulouse, où étudie sa soeur cadette, découvrir une jeunesse en colère, prête à lutter contre le développement de l'atome, et entrevoir la possibilité d'un destin différent de celui que son histoire familiale a façonné.
Et pourtant la magie romanesque n'opère pas, le roman ne m'a jamais captivé, l'histoire d'amour inextricable entre le taiseux Alexandre et l'exubérante Constanze m'a un instant fait songer à un épisode de « l'amour est dans le pré », tant le roman insiste sur l'impossibilité ontologique d'une vie amoureuse épanouie pour un jeune agriculteur enraciné à son lopin de terre. le style souvent neutre, l'absence de lyrisme, une certaine froideur, la forme de distance avec laquelle sont traités la plupart des personnages, ont achevé de me « sortir » du livre de Serge Joncour.
Voilà, ça commençait plutôt bien, mais j'ai parcouru le roman sans passion, et je n'ai pas été transporté par la beauté apocalyptique du dénouement qui se déroule au coeur de la tempête de 1999, cet instant rare où la nature se met en colère, emporte tout sur son passage, nous rappelle la fragilité de toutes choses, et tente une fois encore de nous prévenir de la terrible impasse où conduit inéluctablement l'hubris humaine.
J'ai été d'emblée séduit par l'ambition de Serge Joncour, celle de peindre les luttes d'une époque, la fin du septennat de Giscard d'Estaing, qu'on regarde aujourd'hui avec nostalgie, en oubliant les nombreux attentats et les diverses violences qui l'émaillaient.
Le romancier fait mouche en s'attaquant à la fin des trente glorieuses, ces quelques années où le monde bascule vers le modèle néo-libéral qui régit toujours notre époque. C'est ce moment charnière entre l'ancien monde et le nouveau, cet instant où la fracture entre les « somewhere », les enracinés, les gens du terroir et les « anywhere », les élites mondialisées, les habitants des métropoles devient béante, que tente de saisir le roman. Les figures archétypales de cette fracture sont le héros Alexandre, resté fidèle à la ferme familiale, au prix d'un labeur sans fin et d'une vie quasi monacale et sa bien-aimée, Constanze, une allemande de l'est engagée contre le nucléaire qui parcourt le monde dans un tourbillon continu.
« Nature humaine » nous narre ces années 1976-1981 qui voient se produire en temps réel, la disparition programmée de la ruralité en dépit de promesses politiques jamais vraiment tenues, la victoire du grand sur le petit, celle de l'hypermarché sur le petit commerce, des grandes villes sur les petits bourgs, le développement de l'énergie nucléaire et de ses gigantesques centrales en étant l'illustration emblématique. le jeune Alexandre va, le temps de quelques allers-retours à Toulouse, où étudie sa soeur cadette, découvrir une jeunesse en colère, prête à lutter contre le développement de l'atome, et entrevoir la possibilité d'un destin différent de celui que son histoire familiale a façonné.
Et pourtant la magie romanesque n'opère pas, le roman ne m'a jamais captivé, l'histoire d'amour inextricable entre le taiseux Alexandre et l'exubérante Constanze m'a un instant fait songer à un épisode de « l'amour est dans le pré », tant le roman insiste sur l'impossibilité ontologique d'une vie amoureuse épanouie pour un jeune agriculteur enraciné à son lopin de terre. le style souvent neutre, l'absence de lyrisme, une certaine froideur, la forme de distance avec laquelle sont traités la plupart des personnages, ont achevé de me « sortir » du livre de Serge Joncour.
Voilà, ça commençait plutôt bien, mais j'ai parcouru le roman sans passion, et je n'ai pas été transporté par la beauté apocalyptique du dénouement qui se déroule au coeur de la tempête de 1999, cet instant rare où la nature se met en colère, emporte tout sur son passage, nous rappelle la fragilité de toutes choses, et tente une fois encore de nous prévenir de la terrible impasse où conduit inéluctablement l'hubris humaine.
Toute petite fille des années 70 et enfant des années 80, la lecture de ce livre a été pour moi un bain de douce nostalgie, parfumé avec bonheur aux pétales champêtres de menthe sauvage. Je me voyais courir dans ces champs, haute comme trois pommes, vêtue d'orange et de marron, dans les herbes hautes, Kim Pousse en bouche et les poussières de Bowie dans les oreilles, telle Laura Ingalls dans la petite maison dans la prairie, du moins ici dans la grande ferme en campagne profonde.
Oui, cette lecture vient de défricher ma mémoire en jachère, a fait remonter des souvenirs enfouis, parfois de tout petits détails de presque rien et m'a de ce fait profondément touchée. Elle va laisser en moi des sillons profonds.
Ce livre fleure bon le soleil, la chaleur, la nature, les vallons, la campagne, les vaches, la famille. Il dégage aussi l'odeur nettement plus écoeurante du modernisme et de ses aberrations dont nous payons le prix fort aujourd'hui, la transformation sans prise de recul de la société, la volonté de dompter la nature, mais aussi les progrès, les luttes, la vie politique, le nucléaire. La façon dont la nature humaine est désormais en péril quand la nature reprend légitimement ses droits. Ce livre permet avec simplicité une compréhension du pourquoi nous en sommes là.
Nous suivons Alexandre et sa famille, agriculteurs, sur plusieurs décennies, observation à la fois de sa vie et radiographie de l'évolution de la société sur presque 25 ans, moments intimes de sa petite histoire et moments de la grande Histoire, entremêlés et coincés entre la sécheresse de 1976 et la tempête de 1999. Alexandre sur les épaules duquel repose la succession de la ferme, Alexandre tiraillé entre le progrès et ses peurs. Alexandre qui semble prendre perpet. Personnage très attachant qu'il m'a été difficile de quitter, j'ai ralenti la lecture à la toute fin, au fur et à mesure que je sentais venir l'apothéose…
Oui, cette lecture vient de défricher ma mémoire en jachère, a fait remonter des souvenirs enfouis, parfois de tout petits détails de presque rien et m'a de ce fait profondément touchée. Elle va laisser en moi des sillons profonds.
Ce livre fleure bon le soleil, la chaleur, la nature, les vallons, la campagne, les vaches, la famille. Il dégage aussi l'odeur nettement plus écoeurante du modernisme et de ses aberrations dont nous payons le prix fort aujourd'hui, la transformation sans prise de recul de la société, la volonté de dompter la nature, mais aussi les progrès, les luttes, la vie politique, le nucléaire. La façon dont la nature humaine est désormais en péril quand la nature reprend légitimement ses droits. Ce livre permet avec simplicité une compréhension du pourquoi nous en sommes là.
Nous suivons Alexandre et sa famille, agriculteurs, sur plusieurs décennies, observation à la fois de sa vie et radiographie de l'évolution de la société sur presque 25 ans, moments intimes de sa petite histoire et moments de la grande Histoire, entremêlés et coincés entre la sécheresse de 1976 et la tempête de 1999. Alexandre sur les épaules duquel repose la succession de la ferme, Alexandre tiraillé entre le progrès et ses peurs. Alexandre qui semble prendre perpet. Personnage très attachant qu'il m'a été difficile de quitter, j'ai ralenti la lecture à la toute fin, au fur et à mesure que je sentais venir l'apothéose…
Quel bonheur que de retrouver la talentueuse écriture de Serge Joncour que j'avais déjà pu apprécier dans "Chien-Loup" et "U.V." ! "Nature humaine" a obtenu le Prix Femina 2020, prix hautement mérité à mes yeux car ce roman au titre si finement choisi décrit admirablement le lien qui unit la nature et l'homme. Serge Joncour nous offre une rétrospective sur plus de 20 ans du monde rural et c'est là tout particulièrement que l'on voit toute la complexité de cette relation aux accents de "Je t'aime, moi non plus" : en jouant à l'apprenti-sorcier, l'être humain déclenche des catastrophes naturelles, comme-ci quelque part, Dame-Nature criait vengeance.
A travers l'histoire d'Alexandre, jeune paysan du Lot qui reprend la petite ferme familiale dans les années 70 alors que ses soeurs n'ont qu'une envie, celle de découvrir de quoi est fait le monde, c'est toute une époque qui défile sous nos yeux, en l'occurrence presque 30 ans de ma vie. L'implantation des premières grandes surfaces, le début des luttes pour préserver les terres agricoles, la tentation de l'élevage intensif, la mondialisation, l'auteur dresse ainsi le constat de tous les bouleversements rencontrés par le monde rural de la fin des années 70 à la fin des années 90, avec ce fameux changement de millénaire dont on attendait tant et dont on retiendra surtout la dramatique tempête de décembre 99.
Un roman qui malgré son sérieux, a soufflé un air de nostalgie et réveillé en moi de bons souvenirs comme l'installation du gros poste téléphonique "gris béton" dans les foyers ou l'écoute de Supertramp sur une cassette qu'il fallait au préalable rembobiner. Une lecture essentielle qui laisse une lueur d'espoir en évoquant une certaine prise de conscience qui s'amplifie au fil des années. Un coup de coeur pour moi qui mérite un 20/20.
A travers l'histoire d'Alexandre, jeune paysan du Lot qui reprend la petite ferme familiale dans les années 70 alors que ses soeurs n'ont qu'une envie, celle de découvrir de quoi est fait le monde, c'est toute une époque qui défile sous nos yeux, en l'occurrence presque 30 ans de ma vie. L'implantation des premières grandes surfaces, le début des luttes pour préserver les terres agricoles, la tentation de l'élevage intensif, la mondialisation, l'auteur dresse ainsi le constat de tous les bouleversements rencontrés par le monde rural de la fin des années 70 à la fin des années 90, avec ce fameux changement de millénaire dont on attendait tant et dont on retiendra surtout la dramatique tempête de décembre 99.
Un roman qui malgré son sérieux, a soufflé un air de nostalgie et réveillé en moi de bons souvenirs comme l'installation du gros poste téléphonique "gris béton" dans les foyers ou l'écoute de Supertramp sur une cassette qu'il fallait au préalable rembobiner. Une lecture essentielle qui laisse une lueur d'espoir en évoquant une certaine prise de conscience qui s'amplifie au fil des années. Un coup de coeur pour moi qui mérite un 20/20.
Je découvre Serge Joncour avec Nature Humaine. le récit est surprenant de justesse. Il capte à merveille l'état d'esprit des annés 1976 à 1980 et leurs impacts sur la suite des événements politiques et sociaux jusqu'en 1999. le roman est bordé par deux événements climatiques, la sécheresse de 1976 et la grande tempête de 1999.
L'auteur était alors encore adolescent en 1976, mais il rapporte de façon étonnante les faits de l'époque. Je retrouve dans les personnages, dans les mots, dans les comportements sociaux, les éléments et les événements caractéristiques de cette période de l'histoire sociale de notre pays.
D'une société dans laquelle les citoyens se positionnaient quasi unanimement pour un modèle d'organisation, (en 1969, Georges Pompidou réunissait 58 % des suffrages contre Alain Poher), à une société plus fracturée qui préfigure celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
En 1974, Giscard capte une partie du besoin légitime de changement des Français mais n'en rassemble qu'à peine plus de 50 % contre Mitterrand. L'inverse se produira en 1981.
Les personnages du roman sont eux aussi tiraillés entre la volonté de suivre la marche du progrès et celle de préserver un mode de vie. le débat était vif à l'époque et Joncour en redonne l'essentiel. On redoutait le veau aux hormones, mais on fonçait faire ses courses au Mammouth. On écoutait Dumont et le Club de Rome, mais on votait Giscard.
Chez les Fabrier, des agriculteurs à Crayssac (quelque part dans le sud de la France vers Millau) le débat est vif entre Alexandre, qui doit reprendre la ferme, ses parents Angèle et Jean, qui hésitent à investir avant de la lui céder, et ses soeurs, Caroline l'aînée qui regarde du côté de la ville et de la modernité (mais se situe politiquement du côté de Mitterrand qu'elle voit comme un sauveur) et Vanessa et Agathe les deux cadettes qui elles voient dans le partage de l'héritage du vivant des parents la solution à leurs problèmes financiers en dépit des charges que cela impose à leur frère.
Au travers de l'histoire de cette famille, Joncour illustre avec brio le malentendu entre les Français et leurs hommes politiques depuis la fin des trente glorieuses.
Au faux modernisme et libéralisme de Giscard succède la fausse gauche de Mitterrand qui aboutira au retour de Chirac. Et depuis, on connait la suite !
Dans ce jeu de chaises musicales, les électeurs sont toujours floués. Alexandre fait figure de sage ou peut-être de naïf, on ne sait jamais où ni comment le situer, mais il assiste à l'éveil de la conscience politique (?) des écolos, et autres alternatifs et participe d'une certain façon à leur combat, mais pas pour les raisons qu'ils imaginent. Il finit par comprendre que le combat politique est vicié et que la vie se situe ailleurs et certainement pas dans les projets de développements agricoles que ses parents et ses soeurs veulent lui imposer pour des raisons de rationnalité économiques dont on sait ce qu'ils ont donnés.
Pour Alexandre, c'est in fine du côté de l'amour et du hasard que les jeux se font...
Un livre qui résonne avec l'actualité, sentiment qui est renforcé par les rétrospectives sur la période 1974-1981 que la mort de Giscard a suscitées et illustrent avec bonheur la saga des Fabrier..
Pour moi, un grand livre, qui donne des clefs de lecture sur l'état de la société Françaises et ses errements.
Lien : https://camalonga.wordpress...
L'auteur était alors encore adolescent en 1976, mais il rapporte de façon étonnante les faits de l'époque. Je retrouve dans les personnages, dans les mots, dans les comportements sociaux, les éléments et les événements caractéristiques de cette période de l'histoire sociale de notre pays.
D'une société dans laquelle les citoyens se positionnaient quasi unanimement pour un modèle d'organisation, (en 1969, Georges Pompidou réunissait 58 % des suffrages contre Alain Poher), à une société plus fracturée qui préfigure celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
En 1974, Giscard capte une partie du besoin légitime de changement des Français mais n'en rassemble qu'à peine plus de 50 % contre Mitterrand. L'inverse se produira en 1981.
Les personnages du roman sont eux aussi tiraillés entre la volonté de suivre la marche du progrès et celle de préserver un mode de vie. le débat était vif à l'époque et Joncour en redonne l'essentiel. On redoutait le veau aux hormones, mais on fonçait faire ses courses au Mammouth. On écoutait Dumont et le Club de Rome, mais on votait Giscard.
Chez les Fabrier, des agriculteurs à Crayssac (quelque part dans le sud de la France vers Millau) le débat est vif entre Alexandre, qui doit reprendre la ferme, ses parents Angèle et Jean, qui hésitent à investir avant de la lui céder, et ses soeurs, Caroline l'aînée qui regarde du côté de la ville et de la modernité (mais se situe politiquement du côté de Mitterrand qu'elle voit comme un sauveur) et Vanessa et Agathe les deux cadettes qui elles voient dans le partage de l'héritage du vivant des parents la solution à leurs problèmes financiers en dépit des charges que cela impose à leur frère.
Au travers de l'histoire de cette famille, Joncour illustre avec brio le malentendu entre les Français et leurs hommes politiques depuis la fin des trente glorieuses.
Au faux modernisme et libéralisme de Giscard succède la fausse gauche de Mitterrand qui aboutira au retour de Chirac. Et depuis, on connait la suite !
Dans ce jeu de chaises musicales, les électeurs sont toujours floués. Alexandre fait figure de sage ou peut-être de naïf, on ne sait jamais où ni comment le situer, mais il assiste à l'éveil de la conscience politique (?) des écolos, et autres alternatifs et participe d'une certain façon à leur combat, mais pas pour les raisons qu'ils imaginent. Il finit par comprendre que le combat politique est vicié et que la vie se situe ailleurs et certainement pas dans les projets de développements agricoles que ses parents et ses soeurs veulent lui imposer pour des raisons de rationnalité économiques dont on sait ce qu'ils ont donnés.
Pour Alexandre, c'est in fine du côté de l'amour et du hasard que les jeux se font...
Un livre qui résonne avec l'actualité, sentiment qui est renforcé par les rétrospectives sur la période 1974-1981 que la mort de Giscard a suscitées et illustrent avec bonheur la saga des Fabrier..
Pour moi, un grand livre, qui donne des clefs de lecture sur l'état de la société Françaises et ses errements.
Lien : https://camalonga.wordpress...
Serge Joncour apporte avec Nature humaine un éclairage saisissant sur les mécanismes qui ont entraîné la France vers la puissance capitaliste qu'elle est aujourd'hui, en traçant le portrait d'une période charnière de son histoire, celle du virage vers l'accélération nette de la modernisation de 1976 à 1999, caractérisée par l'urbanisation massive du pays, la désertification des campagnes, le développement du nucléaire et des autoroutes, et les débuts d'une mondialisation hors de contrôle. Tout ça, nous le vivons à travers le regard d'Alexandre, fils d'agriculteur, attaché à sa terre, sceptique face au capitalisme galopant mais tenté par cette modernité promettant confort de vie, épanouissement personnel et enrichissement conséquent.
Serge Joncour nous offre une réflexion profonde sur nos campagnes françaises, les modèles productivistes auxquels elles ont dû se conformer et les premières catastrophes qu'ils ont engendrés, dont la vache folle n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il évoque aussi l'émergence de la conscience écologiste chez les jeunes, dont le nucléaire a été l'engrais et Tchernobyl le catalyseur, ainsi que notre fâcheuse tendance à consommer des produits alimentaires achetés en supermarché sans rien savoir de leur provenance ou de leur qualité. Il dénonce un mouvement destructeur déjà l'oeuvre durant ces années-là, que les activistes n'ont pas réussi à arrêter ou à renverser, et qui est directement responsable de l'état du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Jouant du contraste entre Alexandre et Constanze, jeune Allemande de l'Est dont il est amoureux, l'auteur oppose deux mondes qui, s'ils semblaient pouvoir rester proches au départ, n'ont fait que s'éloigner l'un de l'autre au fil des années : un monde où la simplicité et le bon sens font loi, où la vie s'organise en retrait et en fonction de la nature, et puis un monde où le voyage est un nouveau mode de vie, où la ville est un horizon en soi, où toute attache à la terre a été involontairement perdue. Constanze est comme une fenêtre sur une autre réalité, qui permet à Alexandre de voir la société évoluer vers le consumérisme de masse tandis qu'il se bat pour garder les vertes prairies des Bertranges inchangées. C'est une prise de conscience que nous propose ici Serge Joncour, une explication du sens de l'Histoire pour nous encourager à le remettre en question et à le renverser.
Lien : https://theunamedbookshelf.c..
Serge Joncour nous offre une réflexion profonde sur nos campagnes françaises, les modèles productivistes auxquels elles ont dû se conformer et les premières catastrophes qu'ils ont engendrés, dont la vache folle n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il évoque aussi l'émergence de la conscience écologiste chez les jeunes, dont le nucléaire a été l'engrais et Tchernobyl le catalyseur, ainsi que notre fâcheuse tendance à consommer des produits alimentaires achetés en supermarché sans rien savoir de leur provenance ou de leur qualité. Il dénonce un mouvement destructeur déjà l'oeuvre durant ces années-là, que les activistes n'ont pas réussi à arrêter ou à renverser, et qui est directement responsable de l'état du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Jouant du contraste entre Alexandre et Constanze, jeune Allemande de l'Est dont il est amoureux, l'auteur oppose deux mondes qui, s'ils semblaient pouvoir rester proches au départ, n'ont fait que s'éloigner l'un de l'autre au fil des années : un monde où la simplicité et le bon sens font loi, où la vie s'organise en retrait et en fonction de la nature, et puis un monde où le voyage est un nouveau mode de vie, où la ville est un horizon en soi, où toute attache à la terre a été involontairement perdue. Constanze est comme une fenêtre sur une autre réalité, qui permet à Alexandre de voir la société évoluer vers le consumérisme de masse tandis qu'il se bat pour garder les vertes prairies des Bertranges inchangées. C'est une prise de conscience que nous propose ici Serge Joncour, une explication du sens de l'Histoire pour nous encourager à le remettre en question et à le renverser.
Lien : https://theunamedbookshelf.c..
Le monde rural une nouvelle fois mis en exergue dans le dernier roman de Serge Joncour. Et même s'il est davantage question de son exode, ici, et de l'impact de la mondialisation sur ce monde rural, les mots de l'auteur ont été, pour moi, une délicate et douce reconnexion à la terre, à la nature.
Avec Nature humaine, Serge Joncour balaie le paysage politique et social de la France du milieu des années 70 aux portes de l'an 2000. Une rétrospective dense, haletante, visionnaire sur une période jalonnée d'événements marquants plus ou moins joyeux (, la chute du mur de Berlin, Tchernobyl, la vache folle, la tempête de 1999...). Un regard époustouflant de justesse sur la relation de l'homme à la nature.
« Au journal de treize heures ils montrèrent les images des candidats en train de voter. le président Giscard d'Estaing à Chanonat, petit village dans un repli du Puy-de-Dôme, Chirac au fin fond de la Corrèze, Debré avait rempli son devoir à Amboise, Crépeau à La Rochelle [...] Mitterrand était toujours attendu dans son coin perdu de la Nièvre, chacun puisait sa force au sein d'une terre d'origine, signe que la terre, c'était bien de là qu'un Président tirai sa force et sa légitimité, pour être élu il devait d'abord valider sa parcelle d'humanité faite de la même argile que le peuple, de la même terre. Plus les hommes politiques devenaient citadins, et plus ils prétendaient être de la campagne. »
« Autour de moi je vois de plus en plus de gens qui ne rêvent plus, je ne retrouve rien de la folie des années 1970 ... Maintenant ceux qui rêvent, eh bien ils rêvent d'avoir une vie comme tout le monde… »
Le monde rural : un havre de paix et de liberté, pourtant, c'est un monde en déclin depuis des décennies. La mondialisation est passée par là, rendant les petits villages de moins en moins accessibles, les dépouillant de leurs habitants, de leurs commerces...
Chacun des personnages apporte un témoignage sur les aspirations de l'époque : les vieux de la vieille, à l'instar de Crayssac, qui voient d'un mauvais oeil l'arrivée des téléphones en bakélite, réfractaires à toute avancée technologique, réacs et activistes, prêts à tout pour se défendre, défendre leur bout de terre, leur paradis ..., les plus jeunes aspirant à vivre à la ville, aimant la modernité, les voyages, désirant à une vie plus enivrante, plus en mouvement... et ceux dont les nouvelles technologies permettent de faire plus, encore plus, toujours plus. Plus de rendement notamment pour alimenter le Mammouth qui vient juste d'ouvrir à Cahors, celui qui simplifie la vie des ménages, écrase les prix ! À quel prix ... justement. Au détriment des "petits", au détriment de la qualité, au détriment de la nature elle-même.
« Depuis que Crayssac luttait sur le Larzac, il était devenu une figure. [...] Plus proche du parti communiste que des hippies, Crayssac était sur le Larzac comme chez lui, il faisait corps avec les enflammés des syndicats et de la Lutte occitane, aussi bien qu'avec ceux de la Jeunesse agricole catholique et de ces artistes venus de Paris. Il avait jeûné avec les évêques de Rodez et de Montpellier, même François Mitterrand les avait rejoints, faisant lui aussi une grève de la faim, une grève de la faim de trois quarts d'heure seulement, mais qui avait quand même marqué les esprits. le socialiste avait juré que s'il accédait un jour au pouvoir son premier acte serait de rendre le causse aux paysans… le Larzac, donc, ce n'était pas rien, et dans un monde hypnotisé par la modernité, c'était bien la preuve que la nature était au centre de tout. »
L'arrivée des hypermarchés, du TGV, des pesticides, du nucléaire...et avec ce moderne package, forcément une première prise de conscience : l'humain impacte son environnement. Les premières grandes luttes sociales, qui font échos à celles menées aujourd'hui, s'organisent, militent, sonnent l'alerte. Une alerte restée lettre morte ou presque. On peut légitimement se poser la question, non ?
Serge Joncour n'est pas un donneur de leçon, il nous offre une rétrospective riche et clairvoyante sur notre monde, passe au scalpel la complexité de la nature humaine, et l'on se délecte de cette belle parenthèse.
Au coeur de la folie et des contradictions de notre humanité.
Un roman rural et social, un roman de la nature qui instruit, passionne, questionne, amène à la réflexion.
Une belle moisson de mots !
« Les grands moments de l'Histoire sont la consigne de nos souvenirs personnels. »
Un ouvrage plus profond que "Repose-toi sur moi", à mon humble avis. "L'écrivain National" m'avait quant à lui beaucoup touchée. Je lirai, à l'occasion, "Chien-Loup", Landerneau 2018.
Lien : https://seriallectrice.blogs..
Avec Nature humaine, Serge Joncour balaie le paysage politique et social de la France du milieu des années 70 aux portes de l'an 2000. Une rétrospective dense, haletante, visionnaire sur une période jalonnée d'événements marquants plus ou moins joyeux (, la chute du mur de Berlin, Tchernobyl, la vache folle, la tempête de 1999...). Un regard époustouflant de justesse sur la relation de l'homme à la nature.
« Au journal de treize heures ils montrèrent les images des candidats en train de voter. le président Giscard d'Estaing à Chanonat, petit village dans un repli du Puy-de-Dôme, Chirac au fin fond de la Corrèze, Debré avait rempli son devoir à Amboise, Crépeau à La Rochelle [...] Mitterrand était toujours attendu dans son coin perdu de la Nièvre, chacun puisait sa force au sein d'une terre d'origine, signe que la terre, c'était bien de là qu'un Président tirai sa force et sa légitimité, pour être élu il devait d'abord valider sa parcelle d'humanité faite de la même argile que le peuple, de la même terre. Plus les hommes politiques devenaient citadins, et plus ils prétendaient être de la campagne. »
« Autour de moi je vois de plus en plus de gens qui ne rêvent plus, je ne retrouve rien de la folie des années 1970 ... Maintenant ceux qui rêvent, eh bien ils rêvent d'avoir une vie comme tout le monde… »
Le monde rural : un havre de paix et de liberté, pourtant, c'est un monde en déclin depuis des décennies. La mondialisation est passée par là, rendant les petits villages de moins en moins accessibles, les dépouillant de leurs habitants, de leurs commerces...
Chacun des personnages apporte un témoignage sur les aspirations de l'époque : les vieux de la vieille, à l'instar de Crayssac, qui voient d'un mauvais oeil l'arrivée des téléphones en bakélite, réfractaires à toute avancée technologique, réacs et activistes, prêts à tout pour se défendre, défendre leur bout de terre, leur paradis ..., les plus jeunes aspirant à vivre à la ville, aimant la modernité, les voyages, désirant à une vie plus enivrante, plus en mouvement... et ceux dont les nouvelles technologies permettent de faire plus, encore plus, toujours plus. Plus de rendement notamment pour alimenter le Mammouth qui vient juste d'ouvrir à Cahors, celui qui simplifie la vie des ménages, écrase les prix ! À quel prix ... justement. Au détriment des "petits", au détriment de la qualité, au détriment de la nature elle-même.
« Depuis que Crayssac luttait sur le Larzac, il était devenu une figure. [...] Plus proche du parti communiste que des hippies, Crayssac était sur le Larzac comme chez lui, il faisait corps avec les enflammés des syndicats et de la Lutte occitane, aussi bien qu'avec ceux de la Jeunesse agricole catholique et de ces artistes venus de Paris. Il avait jeûné avec les évêques de Rodez et de Montpellier, même François Mitterrand les avait rejoints, faisant lui aussi une grève de la faim, une grève de la faim de trois quarts d'heure seulement, mais qui avait quand même marqué les esprits. le socialiste avait juré que s'il accédait un jour au pouvoir son premier acte serait de rendre le causse aux paysans… le Larzac, donc, ce n'était pas rien, et dans un monde hypnotisé par la modernité, c'était bien la preuve que la nature était au centre de tout. »
L'arrivée des hypermarchés, du TGV, des pesticides, du nucléaire...et avec ce moderne package, forcément une première prise de conscience : l'humain impacte son environnement. Les premières grandes luttes sociales, qui font échos à celles menées aujourd'hui, s'organisent, militent, sonnent l'alerte. Une alerte restée lettre morte ou presque. On peut légitimement se poser la question, non ?
Serge Joncour n'est pas un donneur de leçon, il nous offre une rétrospective riche et clairvoyante sur notre monde, passe au scalpel la complexité de la nature humaine, et l'on se délecte de cette belle parenthèse.
Au coeur de la folie et des contradictions de notre humanité.
Un roman rural et social, un roman de la nature qui instruit, passionne, questionne, amène à la réflexion.
Une belle moisson de mots !
« Les grands moments de l'Histoire sont la consigne de nos souvenirs personnels. »
Un ouvrage plus profond que "Repose-toi sur moi", à mon humble avis. "L'écrivain National" m'avait quant à lui beaucoup touchée. Je lirai, à l'occasion, "Chien-Loup", Landerneau 2018.
Lien : https://seriallectrice.blogs..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Serge Joncour (17)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Nature humaine : Serge Joncour
Les événements du roman se déroulent entre 1976 et 1999
VRAI
FAUX
10 questions
29 lecteurs ont répondu
Thème : Nature humaine de
Serge JoncourCréer un quiz sur ce livre29 lecteurs ont répondu