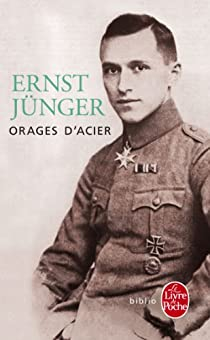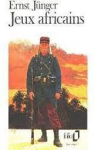En janvier 1915, le jeune Ernst Jünger, à peine âgé de vingt ans, arrive sur le front quelque part dans la Champagne crayeuse non loin de la petite ville de Bazancourt. L'ambiance qu'il y découvre lui semble plutôt calme. Les temps de permission à l'arrière se passent en joyeuses beuveries parmi une population française amicale. Mais tout change soudainement quand il se retrouve du côté des Eparges. Là, c'est un véritable baptème du feu pour lui, un déluge de fer et de feu avec une hécatombe de soldats. Lui-même est blessé à la cuisse. Rétabli, il remonte sur le front à l'automne suivant du côté de Douchy, mais cette fois à titre de sous-officier. Il participe à la première bataille de la Somme où à nouveau il est blessé légèrement. Il s'illustrera ensuite à la bataille de Cambrai ainsi qu'à celle des Flandres. Il aura comme adversaire des Français, des Hindous, des Ecossais et des Néo-Zélandais. Il sortira vivant et décoré de toutes ces années de guerre mais avec sept blessures dont certaines fort graves et rien moins qu'une vingtaine d'impacts dans le corps.
« Orages d'acier » est le témoignage au jour le jour d'un soldat allemand lambda qui monte les échelons, subit toutes les épreuves de cette terrible guerre, le froid, la boue, l'humidité, les rats, les gaz, les pilonnages d'artillerie, les combats à la grenade ou au corps à corps avec un courage et une abnégation remarquable. Son récit assez brut de décoffrage reste dans la lignée d' « À l'ouest rien de nouveau » d'Eric-Maria Remarque côté allemand ou des « Croix de bois » de Roland Dorgelès, voire du « Feu » d'Henri Barbusse côté français. Mais sans aucun romantisme ni pathos. Junger ne se plaint jamais. Il subit tout avec calme et constance. Il parle français, s'entend parfaitement avec les gens qui le logent et n'a pas le moindre mot haineux ou méprisant envers ses adversaires. Chevaleresque, il leur rend hommage pour leur courage et leur détermination quand certains sont ses prisonniers. Il est même très impressionné par la bravoure des Highlanders écossais. Son récit, qui n'est qu'une longue suite de combats, de descriptions de soldats blessés ou tués de toutes les manières possibles et imaginables, donne une idée de ce que nos anciens ont dû endurer des deux côtés de la ligne de front.
Lien : http://www.bernardviallet.fr
« Orages d'acier » est le témoignage au jour le jour d'un soldat allemand lambda qui monte les échelons, subit toutes les épreuves de cette terrible guerre, le froid, la boue, l'humidité, les rats, les gaz, les pilonnages d'artillerie, les combats à la grenade ou au corps à corps avec un courage et une abnégation remarquable. Son récit assez brut de décoffrage reste dans la lignée d' « À l'ouest rien de nouveau » d'Eric-Maria Remarque côté allemand ou des « Croix de bois » de Roland Dorgelès, voire du « Feu » d'Henri Barbusse côté français. Mais sans aucun romantisme ni pathos. Junger ne se plaint jamais. Il subit tout avec calme et constance. Il parle français, s'entend parfaitement avec les gens qui le logent et n'a pas le moindre mot haineux ou méprisant envers ses adversaires. Chevaleresque, il leur rend hommage pour leur courage et leur détermination quand certains sont ses prisonniers. Il est même très impressionné par la bravoure des Highlanders écossais. Son récit, qui n'est qu'une longue suite de combats, de descriptions de soldats blessés ou tués de toutes les manières possibles et imaginables, donne une idée de ce que nos anciens ont dû endurer des deux côtés de la ligne de front.
Lien : http://www.bernardviallet.fr
Orages d'acier est un mélange de tout ce que recèle la guerre en même temps que tous les sentiments qu'elle suscite. C'est le livre d'un vaincu, dont le goût de l'héroïsme jusqu'au-boutiste peut parfois dérouter, mais il y a dans ces pages un témoignage d'une puissance rare.
Puissance souvent ténébreuse, exprimée notamment par des phrases telles que celle-ci : « Parmi ces grandes images sanglantes, il régnait une gaieté sauvage, inconnue. » Vérité, honteuse peut-être et pourtant bien réelle, comme l'auteur le note lors d'un assaut : « Quand nous avançâmes, une fureur guerrière s'empara de nous, comme si, de très loin, se déversait en nous la force de l'assaut. Elle arrivait avec tant de vigueur qu'un sentiment de bonheur, de sérénité me saisit. »
Revers de la médaille, cette constatation qui hante l'avenir de nombreux combattants, une fois le feu de la guerre éteint : « Il existe une responsabilité dont l'État ne peut nous décharger ; c'est un compte à régler avec nous-mêmes. Elle pénètre jusque dans les profondeurs de nos rêves. »
Jünger – qui s'appuie sur des carnets remplis sur le front pour livrer son témoignage – analyse ainsi de terribles sentiments qu'il lui arrivait d'éprouver lui-même et plus seulement de constater chez les autres : « Ainsi, en ces instants, je ne ressentais pas de crainte, mais une aisance supérieure et presque démoniaque. » Plus loin, il écrit : « L'oeil et l'oreille étaient comme fascinés par cette destruction tourbillonnante. »
Mais si, au début, il y a le « courage de l'inexpérience », assez vite surviennent des remarques qui crient l'absurdité de cette guerre fratricide, ce suicide de l'Europe : « Les manifestations de la volonté guerrière me paraissaient étranges et incohérentes, comme des chaînes d'événements sur un autre astre. » La désolation devient l'ordinaire : « Pas de pied de terre où ne se fût joué un drame, pas une traverse derrière laquelle ne fût embusqué le destin, jour et nuit, prêt à accueillir au hasard une victime. » C'est là une « orgie de destruction » où l'on erre « comme un immense tas de décombres au-delà du monde connu ».
Précipité dans des batailles particulièrement éprouvantes – comme celles de la Somme ou Cambrai –, le lieutenant Jünger retranscrit avec un sens visuel implacablement net la réalité de la mort : « L'odeur de décomposition, dans cet air lourd, avait crû jusqu'à devenir intolérable » ; « Des filets de sang, à la surface de certains trous de marmite, révélaient que déjà plus d'un homme s'y était englouti ».
Le lieutenant Jünger est un observateur méticuleux de son environnement, il décrit la guerre dans ses moindres détails, même les plus vils, comme la destruction systématique des villages et l'empoisonnement des puits en prévision de l'avancée ennemie : « Ce fut la première fois où je vis à l'oeuvre la destruction préméditée, systématique, que j'allais rencontrer jusqu'à l'écoeurement dans les années suivantes. »
Orages d'acier, qui raconte les divers « visages » de la guerre, est aussi une oeuvre littéraire à part entière, et ne saurait être cantonné au simple témoignage. Dans ces pages naissait un écrivain, ce que l'avenir ne démentit pas…
Ex
Puissance souvent ténébreuse, exprimée notamment par des phrases telles que celle-ci : « Parmi ces grandes images sanglantes, il régnait une gaieté sauvage, inconnue. » Vérité, honteuse peut-être et pourtant bien réelle, comme l'auteur le note lors d'un assaut : « Quand nous avançâmes, une fureur guerrière s'empara de nous, comme si, de très loin, se déversait en nous la force de l'assaut. Elle arrivait avec tant de vigueur qu'un sentiment de bonheur, de sérénité me saisit. »
Revers de la médaille, cette constatation qui hante l'avenir de nombreux combattants, une fois le feu de la guerre éteint : « Il existe une responsabilité dont l'État ne peut nous décharger ; c'est un compte à régler avec nous-mêmes. Elle pénètre jusque dans les profondeurs de nos rêves. »
Jünger – qui s'appuie sur des carnets remplis sur le front pour livrer son témoignage – analyse ainsi de terribles sentiments qu'il lui arrivait d'éprouver lui-même et plus seulement de constater chez les autres : « Ainsi, en ces instants, je ne ressentais pas de crainte, mais une aisance supérieure et presque démoniaque. » Plus loin, il écrit : « L'oeil et l'oreille étaient comme fascinés par cette destruction tourbillonnante. »
Mais si, au début, il y a le « courage de l'inexpérience », assez vite surviennent des remarques qui crient l'absurdité de cette guerre fratricide, ce suicide de l'Europe : « Les manifestations de la volonté guerrière me paraissaient étranges et incohérentes, comme des chaînes d'événements sur un autre astre. » La désolation devient l'ordinaire : « Pas de pied de terre où ne se fût joué un drame, pas une traverse derrière laquelle ne fût embusqué le destin, jour et nuit, prêt à accueillir au hasard une victime. » C'est là une « orgie de destruction » où l'on erre « comme un immense tas de décombres au-delà du monde connu ».
Précipité dans des batailles particulièrement éprouvantes – comme celles de la Somme ou Cambrai –, le lieutenant Jünger retranscrit avec un sens visuel implacablement net la réalité de la mort : « L'odeur de décomposition, dans cet air lourd, avait crû jusqu'à devenir intolérable » ; « Des filets de sang, à la surface de certains trous de marmite, révélaient que déjà plus d'un homme s'y était englouti ».
Le lieutenant Jünger est un observateur méticuleux de son environnement, il décrit la guerre dans ses moindres détails, même les plus vils, comme la destruction systématique des villages et l'empoisonnement des puits en prévision de l'avancée ennemie : « Ce fut la première fois où je vis à l'oeuvre la destruction préméditée, systématique, que j'allais rencontrer jusqu'à l'écoeurement dans les années suivantes. »
Orages d'acier, qui raconte les divers « visages » de la guerre, est aussi une oeuvre littéraire à part entière, et ne saurait être cantonné au simple témoignage. Dans ces pages naissait un écrivain, ce que l'avenir ne démentit pas…
Ex
Ce livre fut le premier de mon été de lecture 2017.
Je me souviens que j'avais été saisi par le détachement avec lequel Jünger raconte son expérience ; il parvient à expliquer les sentiments qui l'envahisssaient au moment des assauts, mais sans tomber des un discours haineux envers ses ennemis. Si l'horreur du conflit est bien présente, cela ne constitue pas le fond du livre, on aborde plus la psychologie que le sang (omniprésent malgré tout...).
Lien : https://www.facebook.com/AAA..
Je me souviens que j'avais été saisi par le détachement avec lequel Jünger raconte son expérience ; il parvient à expliquer les sentiments qui l'envahisssaient au moment des assauts, mais sans tomber des un discours haineux envers ses ennemis. Si l'horreur du conflit est bien présente, cela ne constitue pas le fond du livre, on aborde plus la psychologie que le sang (omniprésent malgré tout...).
Lien : https://www.facebook.com/AAA..
Concernant Ernst Jünger et son récit autobiographique sur la Première Guerre mondiale "Orages d'acier" André Gide écrivait : "Orages d'acier, est incontestablement le plus beau livre de guerre que j'aie lu."
André Gide avait du flair car "Orages d'acier", écrit "à chaud" et publié en 1920, a été depuis constamment réédité, et pas seulement en Allemagne. Un siècle après son écriture "Orages d'acier" demeure l'un des meilleurs témoignages, écrit par un combattant -jeune lieutenant, sur cette guerre. Ernst Jünger décrit avec acuité le quotidien des soldats, la fatigue, les blessés, les morts, mais aussi avec une très grande force les assauts, la peur qu'il faut dominer, la logique, l'incohérence et l'ivresse des batailles.
Lien : https://www.amazon.fr/LArtil..
André Gide avait du flair car "Orages d'acier", écrit "à chaud" et publié en 1920, a été depuis constamment réédité, et pas seulement en Allemagne. Un siècle après son écriture "Orages d'acier" demeure l'un des meilleurs témoignages, écrit par un combattant -jeune lieutenant, sur cette guerre. Ernst Jünger décrit avec acuité le quotidien des soldats, la fatigue, les blessés, les morts, mais aussi avec une très grande force les assauts, la peur qu'il faut dominer, la logique, l'incohérence et l'ivresse des batailles.
Lien : https://www.amazon.fr/LArtil..
C'est un récit, un témoignage fort au plus près, puisque l'auteur a remis en forme les notes qu'il prenait dans les combats. Ou plutôt, sous la pluie d'artillerie, tant cette Grande Guerre, qui n'est pas encore la Première, n'est qu'un déluge de feu et d'aciers, de bombes, d'obus, de balles, de mitrailles et autre projectiles. Il y a finalement peu de combats directs, au corps à corps, entre adversaires. Il ne peut donc pas y avoir de tonalité épique, puisque l'épopée est impossible dans un combat où le principal ennemi est une force mécanique et industrielle, la machine qui tombe du ciel. La mort est donc aveugle et aléatoire, et frappe au hasard, à quelques centimètres près l'un ou l'autre des soldats. Si l'auteur survit, ce n'est même pas vraiment de la chance, mais le destin.
Jünger nous dresse un paysage apocalyptique qui fait appel à tous les sens : le bruit des bombes, les odeurs des cadavres en décomposition, le goût du vin dont on s'enivre pour oublier ou celui de la soupe trop claire et inconsistante, le toucher de la boue et des vermines grouillantes, la vue des entrailles et des membres décomposés. Certaines scènes sont donc difficiles à lire, le lecteur se retrouve immergé parmi les combattants.
Et si ce texte est un si grand texte de guerre, c'est parce qu'il n'y a pas de haine envers l'ennemi. A la lecture, on peut d'ailleurs se demander de quel "côté" se trouve Jünger, les conditions sont exactement les mêmes dans chaque camp. C'est un jeune universitaire cultivé, qui parle français et anglais, apprécie les romans de ces pays. Loin de toute propagande, il ne nie pas l'humanité des ennemis.
En cette année de souvenirs, la mémoire de la Grande Guerre ayant évolué, on ne peut que penser au gâchis terrible d'hommes, Allemands, Français, Anglais ou Hindous, pour des causes inutiles qui les dépassaient.
Jünger nous dresse un paysage apocalyptique qui fait appel à tous les sens : le bruit des bombes, les odeurs des cadavres en décomposition, le goût du vin dont on s'enivre pour oublier ou celui de la soupe trop claire et inconsistante, le toucher de la boue et des vermines grouillantes, la vue des entrailles et des membres décomposés. Certaines scènes sont donc difficiles à lire, le lecteur se retrouve immergé parmi les combattants.
Et si ce texte est un si grand texte de guerre, c'est parce qu'il n'y a pas de haine envers l'ennemi. A la lecture, on peut d'ailleurs se demander de quel "côté" se trouve Jünger, les conditions sont exactement les mêmes dans chaque camp. C'est un jeune universitaire cultivé, qui parle français et anglais, apprécie les romans de ces pays. Loin de toute propagande, il ne nie pas l'humanité des ennemis.
En cette année de souvenirs, la mémoire de la Grande Guerre ayant évolué, on ne peut que penser au gâchis terrible d'hommes, Allemands, Français, Anglais ou Hindous, pour des causes inutiles qui les dépassaient.
Un récit d'une guerre horrible et de personnes courageuses
Ernst Jünger fait paraître dès 1920 Orages d'acier. Il est remarquable de lire à quel point un homme, envoyé tout jeune encore dans les tranchées, plongé dans l'horreur absolue du « No man's land », sait trouver dans l'écriture une sorte de rédemption.
En effet, la force de ce récit, sorte de journal de guerre, repose sur l'écriture travaillée par des métaphores, à l'image du titre. L'auteur introduit de nombreuses citations ou allusions bibliques dans les moments forts du roman comme si seules ces comparaisons puissantes étaient capables de décrire l'innommable. « La route offre un spectacle de Jugement Dernier. La mort fauchait de droite à gauche. »
Les images apocalyptiques, les descriptions pathétiques de ce qu'endurent les soldats mettent à l'épreuve du lecteur. Mais elles permettent aussi de comprendre à quel point l'écriture, pour Ernst Jünger, est une façon de dépasser son traumatisme et de livrer son expérience terrible. Finalement son regard sur la guerre montre combien la souffrance, allemande ou française, est scandaleuse et absurde. « Les Français avaient dû tenir des mois auprès de leurs camarades abattus, sans pouvoir les ensevelir. »
Orages d'Acier est l'un des romans de guerre les plus poignants que j'ai lu : le lecteur est plongé dans l'horreur mais partage aussi les moments de communion avec des soldats liés par une puissante fraternité.
En effet, la force de ce récit, sorte de journal de guerre, repose sur l'écriture travaillée par des métaphores, à l'image du titre. L'auteur introduit de nombreuses citations ou allusions bibliques dans les moments forts du roman comme si seules ces comparaisons puissantes étaient capables de décrire l'innommable. « La route offre un spectacle de Jugement Dernier. La mort fauchait de droite à gauche. »
Les images apocalyptiques, les descriptions pathétiques de ce qu'endurent les soldats mettent à l'épreuve du lecteur. Mais elles permettent aussi de comprendre à quel point l'écriture, pour Ernst Jünger, est une façon de dépasser son traumatisme et de livrer son expérience terrible. Finalement son regard sur la guerre montre combien la souffrance, allemande ou française, est scandaleuse et absurde. « Les Français avaient dû tenir des mois auprès de leurs camarades abattus, sans pouvoir les ensevelir. »
Orages d'Acier est l'un des romans de guerre les plus poignants que j'ai lu : le lecteur est plongé dans l'horreur mais partage aussi les moments de communion avec des soldats liés par une puissante fraternité.
Si ce livre d'Ernst Junger est, à l'instar de Ceux de 14 de Genevoix, auquel il est souvent comparé, un témoignage essentiel sur la Grande Guerre, il m'a pourtant moins enthousiasmé, et cela ne tient pas au fait qu'il soit vu du côté allemand (car j'ai adoré "À l'ouest rien de nouveau" de Erich Maria Remarque), mais au fait qu'il soit - paradoxalement - au ton plus martial, plus patriotique. Là où on sent Genevoix, Remarque, Barbusse, Chevallier faire leur devoir avec plus ou moins de fatalisme, on sent chez Junger davantage d'enthousiasme guerrier. De tous ceux que j'ai lus, il me semble que c'est celui qui a pris le plus de plaisir, ou tout du moins qui a manifesté le plus d'enthousiasme patriotique. Il ne nie pas les horreurs de la guerre, mais il en fait malgré tout une aventure qui mérite d'être vécue, c'est ce qui fait que j'ai eu davantage de mal à adhérer au propos. Il a aussi, il faut le dire, un style très littéraire, pour ne pas dire ampoulé, qui s'accommode parfois assez mal avec les choses qu'il décrit.
Ernst JUNGER nous livre ici "sans jugement" sa guerre de 14. Il décrit avec précision son engagement dans ce conflit meurtrier et comment il va se distinguer au sein d'une unité d'élite avec modestie. Il décrit aussi la guerre de position, les "coups", les blessures, la chance de rester vivant au milieu de ce déluge de bombes et de projectiles. Poignant.
Trop intense et réaliste. Très surprenant, ou la psychologie et excellemment décrite
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Ernst Jünger (74)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1754 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1754 lecteurs ont répondu