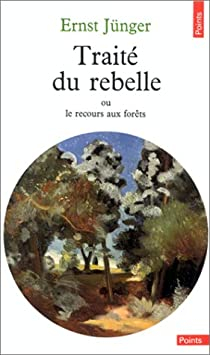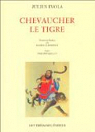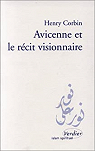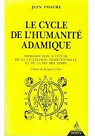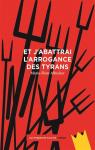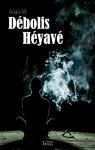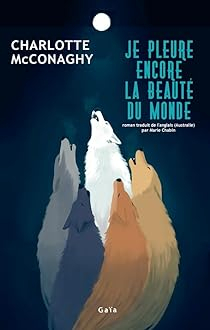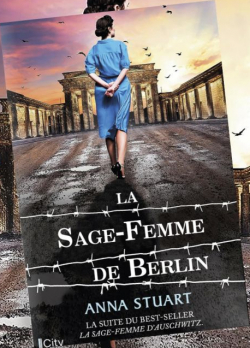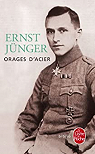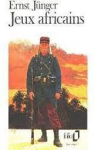À travers les différents ouvrages que l'auteur a écrit pendant et après ses voyages à travers le monde, la poésie a pris une place importante. Mais pas que ! Sylvain Tesson est venu sur le plateau de la grande librairie avec les livres ont fait de lui l'écrivain qu'il est aujourd'hui, au-delàs de ses voyages. "Ce sont les livres que je consulte tout le temps. Je les lis, je les relis et je les annote" raconte-il à François Busnel. Parmi eux, "Entretiens" de Julien Gracq, un professeur de géographie, "Sur les falaises de marbres" d'Ernst Jünger ou encore, "La Ferme africaine" de Karen Blixen.
Retrouvez l'intégralité de l'interview ci-dessous : https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/

Ernst Jünger
Henri Plard (Autre)/5 15 notes
Henri Plard (Autre)/5 15 notes
Résumé :
J'ai traduit par "Rebelle", faute d'un équivalent français tout à fait exact, le mot allemand de Waldgänger, emprunté lui-même à une coutume de l'ancienne Islande.
Le proscrit norvégien, dans le haut Moyen Age scandinave, avait " recours aux forêts " : il s'y réfugiait et y vivait librement, mais pouvait être abattu par quiconque le rencontrait. Il serait aussi facile que vain de citer les " Rebelles " qui, à diverses époques, ont élu la solitude, la ... >Voir plus
Le proscrit norvégien, dans le haut Moyen Age scandinave, avait " recours aux forêts " : il s'y réfugiait et y vivait librement, mais pouvait être abattu par quiconque le rencontrait. Il serait aussi facile que vain de citer les " Rebelles " qui, à diverses époques, ont élu la solitude, la ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Traité du rebelle, ou le recours aux forêts ; suivi de, PolarisationsVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (2)
Ajouter une critique
Ernst Jünger est un penseur intéressant et surtout déroutant, car ses réflexions se construisent à l'écart des grands systèmes qui les rendraient repérables, étiquetables (gauche, droite, marxisme, nationalisme, etc). Donc le lecteur, désorienté, risque de perdre son temps à chercher "d'où vient" la réflexion qu'il suit, et à oublier l'intérêt propre et la grande étrangeté du livre. Cet intérêt et cette étrangeté résident dans le lien inattendu que Jünger établit entre la plus ancienne tradition, celle du retrait "dans la forêt", et la notion ultra-moderne de rébellion. Jünger était sceptique devant les grandes révolutions du XX°s, qui cherchaient à créer collectivement un nouvel ordre humain et un nouvel homme. Pour lui, la rébellion n'était pas un impératif moderniste et collectif de changement global ( à la manière du caricatural "Indignez-vous", au pluriel), mais un acte individuel, celui qui oppose tout individu libre à tout ordre social, serait-il juste et protecteur. On le voit, il n'entre dans aucune case, pas même celle de l'anarchisme, fût-il "de droite".
Jünger est un auteur hors normes, et le Traité du Rebelle est injustement méconnu, du moins en France. Les liens de l'auteur avec le nazisme n'y sont sans doute pas étranger. On a pourtant tout à gagner à lire ce traité. Outre la qualité de sa plume, Jünger porte un regard intéressant sur le concept de rébellion.
Citations et extraits (28)
Voir plus
Ajouter une citation
Le Rebelle est l’individu concret, agissant dans le cas concret. Il n’a pas besoin de théories, de lois forgées par les juristes du parti, pour savoir où se trouve le droit. Il descend jusqu’aux sources de la moralité, que n’ont pas encore divisées les canaux des institutions. Tout y devient simple, s’il survit en lui quelque pureté.
Nous avons vu que la grande surprise des forêts est la rencontre avec soi-même, le noyau inaltérable du moi, l’essence dont se nourrit le phénomène temporel et individuel. Cette rencontre, qui peut tout faire pour la guérison et le triomphe sur la crainte, tient aussi, en morale, le rang le plus haut. Car elle mène jusqu’à cette strate qui fonde toute vie sociale et contient depuis les origines toute communauté. Elle conduit vers cet homme en qui réside, en deçà de l’individuel, notre richesse première, et dont rayonnent les individuations.
Cette zone a plus à nous offrir que la communion : là se trouve l’identité : ce dont le symbole de l’éternité donne le pressentiment.
Le moi se reconnait en l’autre : il se conforme à la vieille formule : « Tu es celui-là ! » L’autre peut être la bien-aimée, ou encore le frère, le dolent, le dépourvu. Lui prêtant secours, le moi se fortifie par là même dans l’impérissable. Acte en lequel se confirme la structure morale du monde.
Ce sont des faits d’expérience. On ne saurait compter, de nos jours, ceux qui ont dépassé les centres de l’enchaînement nihiliste, les lieux mortels du maelström. Ils savent qu’ailleurs le mécanisme dévoile de plus en plus clairement ses menaces ; l’homme se trouve au centre d’une grande machine, agencée de manière à le détruire. Ils ont aussi dû constater que tout rationalisme mène au mécanisme et tout mécanisme à la torture, comme à sa conséquence logique : ce qu’on ne voyait pas encore au XIXe siècle. (pp. 125-126)
Nous avons vu que la grande surprise des forêts est la rencontre avec soi-même, le noyau inaltérable du moi, l’essence dont se nourrit le phénomène temporel et individuel. Cette rencontre, qui peut tout faire pour la guérison et le triomphe sur la crainte, tient aussi, en morale, le rang le plus haut. Car elle mène jusqu’à cette strate qui fonde toute vie sociale et contient depuis les origines toute communauté. Elle conduit vers cet homme en qui réside, en deçà de l’individuel, notre richesse première, et dont rayonnent les individuations.
Cette zone a plus à nous offrir que la communion : là se trouve l’identité : ce dont le symbole de l’éternité donne le pressentiment.
Le moi se reconnait en l’autre : il se conforme à la vieille formule : « Tu es celui-là ! » L’autre peut être la bien-aimée, ou encore le frère, le dolent, le dépourvu. Lui prêtant secours, le moi se fortifie par là même dans l’impérissable. Acte en lequel se confirme la structure morale du monde.
Ce sont des faits d’expérience. On ne saurait compter, de nos jours, ceux qui ont dépassé les centres de l’enchaînement nihiliste, les lieux mortels du maelström. Ils savent qu’ailleurs le mécanisme dévoile de plus en plus clairement ses menaces ; l’homme se trouve au centre d’une grande machine, agencée de manière à le détruire. Ils ont aussi dû constater que tout rationalisme mène au mécanisme et tout mécanisme à la torture, comme à sa conséquence logique : ce qu’on ne voyait pas encore au XIXe siècle. (pp. 125-126)
On ne revient pas en arrière pour reconquérir le mythe ; on le rencontre à nouveau, quand le temps tremble jusqu’en ses bases, sous l’empire de l’extrême danger. Il ne faut pas dire non plus : ou le cep ou le navire, mais : et le cep et le navire. Le nombre de ceux qui songent à abandonner le navire croît, et l’on trouve parmi eux aussi des têtes claires et des esprits fermes. Mais au fond, ce serait là débarquer en pleine mer. Surviennent alors la faim, le cannibalisme et les requins, bref, toutes les horreurs que l’on rapporte sur le radeau de la Méduse. Il est donc prudent, quoi qu’il arrive, de demeurer à bord et sur le pont, fût-ce au risque de sauter avec les autres.
Quand toutes les institutions deviennent équivoques, voire suspectes, et que dans les églises même on entend prier publiquement, non pour les persécutés, mais pour les persécuteurs, c'est alors que la responsabilité morale passe à l'individu ou, pour mieux dire, à l'individu qui ne s'est pas encore laissé abattre.
Le rebelle est l'individu concret, agissant dans le cas concret. Il n'a pas besoin de théories, de lois forgées par les juristes du parti, pour savoir où se trouve le droit. Il descend jusqu'aux sources de la moralité, que n'ont pas encore divisées les canaux des institutions. Tout y devient simple, s'il survit en lui quelque pureté.
Le rebelle est l'individu concret, agissant dans le cas concret. Il n'a pas besoin de théories, de lois forgées par les juristes du parti, pour savoir où se trouve le droit. Il descend jusqu'aux sources de la moralité, que n'ont pas encore divisées les canaux des institutions. Tout y devient simple, s'il survit en lui quelque pureté.
La forêt est secrète. Le mot est l’un de ceux, dans notre langage, qui recèlent ses contradictions. Le secret, c’est l’intime, le foyer bien clos, la citadelle de sécurité. Mais c’est aussi le clandestin, et ce sens le rapproche de l’insolite, de l’équivoque. Quand nous rencontrons de telles racines, nous pouvons être sûrs qu’elles trahissent la grande antithèse et l’identité, plus grande encore, de la vie et de la mort, que les mystères s’attachent à déchiffrer.
Les catastrophes éprouvent à quelle profondeur hommes et peuples demeurent enracinés dans leurs origines. Qu’une racine, du moins, puise directement au sol nourricier – la santé et les chances de survie en dépendent, alors même que la civilisation et ses assurances ont disparu.
Videos de Ernst Jünger (8)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Ernst Jünger (74)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz: l'Allemagne et la Littérature
Les deux frères Jacob et Whilhelm sont les auteurs de contes célèbres, quel est leur nom ?
Hoffmann
Gordon
Grimm
Marx
10 questions
415 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature allemande
, guerre mondiale
, allemagneCréer un quiz sur ce livre415 lecteurs ont répondu