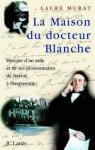Critiques filtrées sur 5 étoiles
Princesse, Laure Murat l'est vraiment. Et non pas comme la petite chienne que son maître rappelle dans la rue et qui la fait se retourner, ainsi qu'elle aime en raconter l'anecdote. Son père est de la lignée du maréchal de Napoléon, promu roi de Naples après son mariage avec la soeur de ce dernier, et de l'autre aristocratie, vue comme la plus légitime du côté de sa mère puisqu'elle remonte à très loin dans l'Histoire. Mais l'auteure n'a que faire de toute cette tartine de conventions vers lesquelles les siens la condamnent parce qu'issue de ces deux écrasantes lignées. À vingt ans elle lit La Recherche et elle comprend soudain tout des mondanités surannées et gluantes que les deux bords familiaux essaient de lui imposer. Surtout celui de sa mère qui lui renvoie froidement son mépris pour son homosexualité déclarée. Proust lui donne les outils de son propre mépris pour cette caste tellement hors du temps qu'elle n'en réalise pas son insignifiance dans le monde présent.
Lien : https://franqueuil.com/2023/..
Lien : https://franqueuil.com/2023/..
Il était une fois une princesse qui ne s'est pas mariée, qui n'a pas eu d'enfant, et qui, pour comble, est devenue gauchiste, féministe et homosexuelle.
La princesse déchue doit son salut à Marcel Proust.
Proust, roman familial suggère que c'est Proust qui a composé le roman familial de Laure Murat, et c'est d'une certaine façon la vérité, car en tant que chroniqueur de gazette mondaine, Marcel Proust était de toutes les fêtes du microcosme aristocrate, de la fin du XIXème au début du XXème, où figurait en bonne position les arrière-grands-parents de l'autrice.
À force d'en entendre parler, dès sa tendre enfance, Laure Murat considère le grand écrivain comme quelqu'un de sa famille, qui plus est comme un ange gardien, qu'elle honore par les mots de la fin de son ouvrage.
« À ce titre, il ne serait pas exagéré de dire que Proust m'a sauvée ».
Marcel Proust lui a décillé les yeux et permis de faire sa résilience face à la cruauté du rejet de sa famille quand elle a fait son coming out : « Tu es une fille perdue», lui crache à la figure sa mère avant de se mettre à pleurer, comble de l'ignominie pour une noble !
« À l'aristocratie est souvent rattaché le mot de prestige. […]. Personnellement, je préfère le « proustige ». […] Je ne m'arroge en rien le prestige de Proust parce qu'il aurait décrit le monde où je suis née, mais je loue sa magie à m'en avoir sortie, en authentique proustigitateur ». (p.16)
Les personnages de "À la Recherche du Temps perdu" sont inspirés de réels aristocrates, sans oublier de nombreux membres de la dynastie Murat – Luynes, croisement de la noblesse d'empire (Napoléon) et de la noblesse de sang. L'intérêt de Laure Murat va au-delà de l'évocation pure et simple de sa famille, et s'étend à l'aristocratie toute entière que Marcel Proust dépeint merveilleusement, comme des errants voltigeant dans leur bulle, en constante représentation.
« Limité au surgissement de noms familiers dans le cadre d'un roman, le trouble de ma lecture serait resté anecdotique. Mais le plus sidérant, c'était que toutes les scènes « lues » où l'aristocratie entrait en jeu étaient infiniment plus vivantes que les scènes « vécues » dont j'avais été témoin, comme si Proust, à l'image du Dr Frankenstein, élaborait sous mes yeux le mode d'emploi des créatures que nous étions. Il mettait en mots et en paragraphes intelligibles ce qui se mouvait sous mes yeux depuis que j'étais née ». ((p.78)
Ces chevaliers d'un autre temps se doivent d'évoluer comme des notes dans un morceau de musique, la moindre fausse note est vécue comme un drame sans nom. C'est tout un ensemble de codes qu'ils doivent appliquer au pied et à la lettre.
Il faut respecter l'élocution aristocratique, « l'accent de classe ».
« Une année, une de mes soeurs avait spontanément adopté le tic d'une de ses professeures* d'école qui ajoutait des « eu » traînants à la suite de certains mots, comme dans « je suis allée à la piscin-eu » […] je vois encore la panique sur le visage de ma mère, comme si la famille groseille au complet avait pris possession du larynx de ma soeur ». (p.172)
*oh mes aïeux !
Cet « accent de classe » doit se dérouler dans un certain rythme.
« Cette musicalité un peu nerveuse, faite d'accélérations et de lenteurs étudiées pour conduire le plus sûrement à la chute, convient aux mots d'esprit et à l'art de la conversation, où il est déconseillé de s'appesantir ». (p.19)
C'est tout un apprentissage de parler pour ne rien dire ou pratiquer la langue de bois.
« Car, aussi prévisible soit-il à bien des égards, ce milieu conserve en même temps, et jalousement, le secret de sa liturgie, qui fonctionne comme des actes de langage indirect, ces énoncés qui disent une chose pour en signifier une autre ». (p.87)
« Proust écrit : « j'avais assez fréquenté de gens du monde pour savoir que ce sont eux les véritables illettrés, et non les ouvriers électriciens ». (p.32)
C'est fatigant d'être en constante représentation, rares sont les instants où l'attention se relâche, comme ce moment où le baron de Charlus, ne se sachant pas observé, sort de l'hôtel de Mme de Villeparisis.
« Dans ce passage où le narrateur observe M. de Charlus à son insu, baissant les paupières au soleil dans la cour de l'hôtel de Guermantes, vaut mieux que toutes les explications. Parce qu'il est convaincu de n'être pas observé, le baron a « relâché dans son visage cette tension, amorti cette vitalité factice », oublié d'arborer sa « brutalité postiche » pour laisser « l'aménité, la bonté […] s'étaler si naïvement sur son visage ». (p.82)
Il est formellement interdit de manifester des sentiments, sont exclues toutes circonstances atténuantes.
« « On ne pleure pas comme une domestique », répétait mon arrière-grand-mère, que la haine de l'effusion avait poussée à donner un bal à la mort d'un de ses fils, engagé volontaire, tombé pour la France en 1916, à l'aube de son vingtième anniversaire ». (p.18)
Ces aristocrates ont appris par coeur leur rôle et sont incapables d'improviser. Il faut comprendre le désarroi de la duchesse de Guermantes quand elle demande à Swan pourquoi il ne veut pas l'accompagner en Italie, et que ce dernier lui répond que le médecin lui a donné peu de temps à vivre. Cette pauvre dame est perdue car dans son « code de convenances », il n'est pas fait référence à ce qu'il convient de dire dans ce cas précis. Elle esquive la difficulté en rétorquant qu'il s'agit certainement d'une plaisanterie. (p.101)
C'est un truisme de dire que ces gens-là ne travaillent pas et sont totalement ignorants des questions pratiques et de la vie ordinaire. Laure Murat relate que la seule fois où elle a pris le bus avec son père, elle ne savait pas où se mettre quand ce dernier s'adressant au chauffeur a demandé très sérieusement : « on m'a beaucoup parlé de cette carte qu'on dit « orange ». Vous me la conseillez ? ». (p.176)
Cet atavisme les conduit à considérer comme des affaires d'état, des choses insignifiantes, comme le fait que la duchesse de Guermantes puisse porter des souliers rouges avec une robe noire.
Laure Murat nous livre, pour notre grand bonheur, son prisme de lecture de "À la recherche du temps perdu", qui correspond à sa connotation personnelle du temps comme recherche pour comprendre son histoire familiale, même si elle ne l'enferme pas dans ce carcan.
« Ce livre immense m'enchantait comme un kaléidoscope dont chaque mouvement révèle des figures et des combinaisons insoupçonnables, des mondes infinis ». (p.69)
Proust aimait à dire que chaque lecteur lisait en lui-même en lisant La recherche du temps perdu, toutefois il n'appréciait pas toutes les interprétations, d'où sa colère, quand le critique Marcel Boulenger, à propos de "À l'ombre des jeunes filles en fleur", a parlé du portrait flatteur d'une « noblesse imaginaire ».
Pour corroborer cette idée, j'ajoute qu'il s'est mis à dos beaucoup d'aristocrates, comme Mme de Villeparis qui a brûlé toute leur correspondance, où le Marquis de Breteuil qui a cessé de le recevoir alors qu'il avait eu une chambre attitrée.
Je n'ai pas encore pris le temps de partir à La Recherche du Temps perdu. Je n'aurais pas l'outrecuidance de me targuer d'avoir lu « un amour de Swan » pour le bac de français, ou « La prisonnière » suite au film « La captive » avec Sylvie Testud, car ma mémoire ne résisterait pas au moindre interrogatoire.
J'ai acheté Proust, roman familial pour l'offrir à mon mari, qui lui a lu toute La Recherche du Temps perdu en entier deux fois, et plusieurs fois partiellement. Maintenant, je me le suis accaparé et aurai plaisir à le lire et le relire quand mon amie, à qui je viens de le prêter, me le rendra.
Je vais vous faire un aveu. Je suis très touchée par ce sentiment d'étrangeté de Laure Murat.
La princesse déchue doit son salut à Marcel Proust.
Proust, roman familial suggère que c'est Proust qui a composé le roman familial de Laure Murat, et c'est d'une certaine façon la vérité, car en tant que chroniqueur de gazette mondaine, Marcel Proust était de toutes les fêtes du microcosme aristocrate, de la fin du XIXème au début du XXème, où figurait en bonne position les arrière-grands-parents de l'autrice.
À force d'en entendre parler, dès sa tendre enfance, Laure Murat considère le grand écrivain comme quelqu'un de sa famille, qui plus est comme un ange gardien, qu'elle honore par les mots de la fin de son ouvrage.
« À ce titre, il ne serait pas exagéré de dire que Proust m'a sauvée ».
Marcel Proust lui a décillé les yeux et permis de faire sa résilience face à la cruauté du rejet de sa famille quand elle a fait son coming out : « Tu es une fille perdue», lui crache à la figure sa mère avant de se mettre à pleurer, comble de l'ignominie pour une noble !
« À l'aristocratie est souvent rattaché le mot de prestige. […]. Personnellement, je préfère le « proustige ». […] Je ne m'arroge en rien le prestige de Proust parce qu'il aurait décrit le monde où je suis née, mais je loue sa magie à m'en avoir sortie, en authentique proustigitateur ». (p.16)
Les personnages de "À la Recherche du Temps perdu" sont inspirés de réels aristocrates, sans oublier de nombreux membres de la dynastie Murat – Luynes, croisement de la noblesse d'empire (Napoléon) et de la noblesse de sang. L'intérêt de Laure Murat va au-delà de l'évocation pure et simple de sa famille, et s'étend à l'aristocratie toute entière que Marcel Proust dépeint merveilleusement, comme des errants voltigeant dans leur bulle, en constante représentation.
« Limité au surgissement de noms familiers dans le cadre d'un roman, le trouble de ma lecture serait resté anecdotique. Mais le plus sidérant, c'était que toutes les scènes « lues » où l'aristocratie entrait en jeu étaient infiniment plus vivantes que les scènes « vécues » dont j'avais été témoin, comme si Proust, à l'image du Dr Frankenstein, élaborait sous mes yeux le mode d'emploi des créatures que nous étions. Il mettait en mots et en paragraphes intelligibles ce qui se mouvait sous mes yeux depuis que j'étais née ». ((p.78)
Ces chevaliers d'un autre temps se doivent d'évoluer comme des notes dans un morceau de musique, la moindre fausse note est vécue comme un drame sans nom. C'est tout un ensemble de codes qu'ils doivent appliquer au pied et à la lettre.
Il faut respecter l'élocution aristocratique, « l'accent de classe ».
« Une année, une de mes soeurs avait spontanément adopté le tic d'une de ses professeures* d'école qui ajoutait des « eu » traînants à la suite de certains mots, comme dans « je suis allée à la piscin-eu » […] je vois encore la panique sur le visage de ma mère, comme si la famille groseille au complet avait pris possession du larynx de ma soeur ». (p.172)
*oh mes aïeux !
Cet « accent de classe » doit se dérouler dans un certain rythme.
« Cette musicalité un peu nerveuse, faite d'accélérations et de lenteurs étudiées pour conduire le plus sûrement à la chute, convient aux mots d'esprit et à l'art de la conversation, où il est déconseillé de s'appesantir ». (p.19)
C'est tout un apprentissage de parler pour ne rien dire ou pratiquer la langue de bois.
« Car, aussi prévisible soit-il à bien des égards, ce milieu conserve en même temps, et jalousement, le secret de sa liturgie, qui fonctionne comme des actes de langage indirect, ces énoncés qui disent une chose pour en signifier une autre ». (p.87)
« Proust écrit : « j'avais assez fréquenté de gens du monde pour savoir que ce sont eux les véritables illettrés, et non les ouvriers électriciens ». (p.32)
C'est fatigant d'être en constante représentation, rares sont les instants où l'attention se relâche, comme ce moment où le baron de Charlus, ne se sachant pas observé, sort de l'hôtel de Mme de Villeparisis.
« Dans ce passage où le narrateur observe M. de Charlus à son insu, baissant les paupières au soleil dans la cour de l'hôtel de Guermantes, vaut mieux que toutes les explications. Parce qu'il est convaincu de n'être pas observé, le baron a « relâché dans son visage cette tension, amorti cette vitalité factice », oublié d'arborer sa « brutalité postiche » pour laisser « l'aménité, la bonté […] s'étaler si naïvement sur son visage ». (p.82)
Il est formellement interdit de manifester des sentiments, sont exclues toutes circonstances atténuantes.
« « On ne pleure pas comme une domestique », répétait mon arrière-grand-mère, que la haine de l'effusion avait poussée à donner un bal à la mort d'un de ses fils, engagé volontaire, tombé pour la France en 1916, à l'aube de son vingtième anniversaire ». (p.18)
Ces aristocrates ont appris par coeur leur rôle et sont incapables d'improviser. Il faut comprendre le désarroi de la duchesse de Guermantes quand elle demande à Swan pourquoi il ne veut pas l'accompagner en Italie, et que ce dernier lui répond que le médecin lui a donné peu de temps à vivre. Cette pauvre dame est perdue car dans son « code de convenances », il n'est pas fait référence à ce qu'il convient de dire dans ce cas précis. Elle esquive la difficulté en rétorquant qu'il s'agit certainement d'une plaisanterie. (p.101)
C'est un truisme de dire que ces gens-là ne travaillent pas et sont totalement ignorants des questions pratiques et de la vie ordinaire. Laure Murat relate que la seule fois où elle a pris le bus avec son père, elle ne savait pas où se mettre quand ce dernier s'adressant au chauffeur a demandé très sérieusement : « on m'a beaucoup parlé de cette carte qu'on dit « orange ». Vous me la conseillez ? ». (p.176)
Cet atavisme les conduit à considérer comme des affaires d'état, des choses insignifiantes, comme le fait que la duchesse de Guermantes puisse porter des souliers rouges avec une robe noire.
Laure Murat nous livre, pour notre grand bonheur, son prisme de lecture de "À la recherche du temps perdu", qui correspond à sa connotation personnelle du temps comme recherche pour comprendre son histoire familiale, même si elle ne l'enferme pas dans ce carcan.
« Ce livre immense m'enchantait comme un kaléidoscope dont chaque mouvement révèle des figures et des combinaisons insoupçonnables, des mondes infinis ». (p.69)
Proust aimait à dire que chaque lecteur lisait en lui-même en lisant La recherche du temps perdu, toutefois il n'appréciait pas toutes les interprétations, d'où sa colère, quand le critique Marcel Boulenger, à propos de "À l'ombre des jeunes filles en fleur", a parlé du portrait flatteur d'une « noblesse imaginaire ».
Pour corroborer cette idée, j'ajoute qu'il s'est mis à dos beaucoup d'aristocrates, comme Mme de Villeparis qui a brûlé toute leur correspondance, où le Marquis de Breteuil qui a cessé de le recevoir alors qu'il avait eu une chambre attitrée.
Je n'ai pas encore pris le temps de partir à La Recherche du Temps perdu. Je n'aurais pas l'outrecuidance de me targuer d'avoir lu « un amour de Swan » pour le bac de français, ou « La prisonnière » suite au film « La captive » avec Sylvie Testud, car ma mémoire ne résisterait pas au moindre interrogatoire.
J'ai acheté Proust, roman familial pour l'offrir à mon mari, qui lui a lu toute La Recherche du Temps perdu en entier deux fois, et plusieurs fois partiellement. Maintenant, je me le suis accaparé et aurai plaisir à le lire et le relire quand mon amie, à qui je viens de le prêter, me le rendra.
Je vais vous faire un aveu. Je suis très touchée par ce sentiment d'étrangeté de Laure Murat.
« À chaque lecture, Proust a modifié ma compréhension du monde. Par les circonvolutions envoûtantes de ses phrases il m'a sortie de l'ignorance et de la confusion. Sa précision, sa lucidité, sa tendresse, sa grandeur comique m'ont épargné des années de mécompréhensions et d'atermoiements stériles. C'est pourquoi il m'a, chaque fois, consolée. »
Il me semble que l'ambition et l'humilité de l'autrice, son infinie reconnaissance à l'égard d'une oeuvre qui la suit partout depuis trente ans, sont tout entières contenues dans ces quelques lignes. Et c'est, à mes yeux, ce qui fait la force, la grandeur, la beauté de son livre. Un livre qui, bien qu'étayé par des milliers d'heures de lecture et de recherches, n'est pas un énième ouvrage savant prétendant apporter un éclairage érudit ou inédit sur une oeuvre qui donne lieu depuis sa parution à une glose exponentielle. Non, c'est un livre qui, partant du coeur tout en s'appuyant constamment sur l'exercice de la raison, nous donne à voir un condensé saisissant du dialogue fécond, salvateur, indéfiniment enrichi au fil du temps, qu'entretient Laure Murat avec Proust.
Issue d'un milieu, l'aristocratie, dans lequel l'implicite, le non-dit, la retenue, voire le refoulement, sont érigés en règle de vie, où l'expression des sentiments est perçue comme une faute de goût, où tout élan sensible, jusqu'aux plus intimes tragédies comme la perte d'un être cher, est converti en exercice de style, Laure Murat est parvenue à clarifier grâce à Proust ce qu'elle percevait confusément, douloureusement depuis l'enfance :
« Mon ambivalence vis-à-vis de l'aristocratie trouvait sa résolution : sensible, à l'occasion, à son sens du panache, mais aussi aux délicatesses morales de la grande politesse, je ressentais, dans le temps, un profond désarroi et même une angoisse face à son discours creux et sa complaisance passionnée pour le mensonge social. »
L'exercice de démystification méthodique de l'aristocratie auquel se livre Proust qui, après l'avoir élevée au firmament de l'esprit et de l'élégance, après avoir érigé ses membres au rang de Dieux de l'Olympe, les précipite plus bas que terre, les renvoyant à leur vacuité abyssale, n'offre pas seulement à Laure Murat une clarification salutaire, il lui en dévoile les ressorts intimes, l'irrésistible mécanique interne :
« Mais le plus sidérant, c'était que toutes les scènes lues où l'aristocratie entrait en jeu étaient infiniment plus vivantes que les scènes vécues dont j'avais été le témoin, comme si Proust, à l'image du Dr Frankenstein, élaborait sous mes yeux le mode d'emploi des créatures que nous étions. »
À partir de là s'enclenche le processus libérateur qui, en lui permettant d'identifier ce qui relève, en elle, de l'aliénation sociale et familiale, l'autorise du même coup à s'émanciper et à affirmer sa singularité. Mais dans un milieu dont l'idéologie conservatrice sacralise l'immuabilité et vitupère le changement, un milieu dans lequel il convient de tenir son rôle, l'émancipation n'est pas de mise, surtout quand celle-ci passe par l'énonciation explicite d'une homosexualité honnie. « Fille perdue » pour sa mère, subissant l'opprobre de sa nombreuse famille, il ne lui reste pas d'autre choix « que de commencer une nouvelle vie, dont l'horizon irait chaque jour s'élargissant. »
On comprend mieux, à présent, le sens de la phrase que je citais en introduction : « C'est pourquoi il m'a, chaque fois, consolée. » Mais Laure Murat ne s'arrête pas à son cas particulier. Elle élargit la focale à tous ceux pour lesquels, à travers le monde entier, « Proust, mieux qu'aucun autre écrivain, a si souvent incarné à la fois une bouée et un phare dans la tragédie. » Car « nous sommes tous et toutes inconsolables ». Chacun d'entre nous, dont la venue au monde, après nous avoir arrachés au refuge du ventre maternel, nous voue à jamais à la solitude et à l'angoisse de la mort, ressent le besoin inassouvissable d'être consolé. À commencer par le narrateur de la Recherche qui, soir après soir à Combray, attend anxieusement le précieux viatique qui ouvrira toutes grandes les portes du sommeil et du rêve, en l'absence duquel il n'y aura pas de repos possible, le baiser maternel :
« Il y a bien longtemps aussi que mon père a cessé de pouvoir dire à maman : « Va avec le petit. » La possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi. Mais depuis peu de temps, je recommence à très bien percevoir si je prête l'oreille, les sanglots que j'eus la force de contenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvai seul avec maman. En réalité ils n'ont jamais cessé. »
(Du côté de chez Swann)
Ce constat tragique, Proust en fait non pas l'objet d'une plainte complaisante, mais le coeur d'une recherche, transmuant le plomb en or, transformant une catastrophe en oeuvre d'art. Nous savons qu'il s'est véritablement attelé à l'écriture de la Recherche en 1906, un an après la mort de sa mère. Sa vie ayant désormais, comme il le confie à Robert de Montesquiou, « perdu son seul but, sa seule douceur, son seul amour, sa seule consolation », il ne lui reste plus qu'à se mettre à la tâche tant de fois différée afin d'offrir à sa mère disparue la consolation qu'il ne put lui offrir de son vivant, celle d'accomplir l'oeuvre à laquelle elle le savait secrètement promis.
« Proust se doutait-il seulement qu'en échafaudant son roman il inventait un secours plus puissant que la tendresse d'une mère absente ? (…)
Il n'endort pas nos douleurs dans les volutes de sa prose, il excite sans cesse notre désir de savoir qui, en séparant l'enfant de sa mère, nous affranchit plus sûrement du malheur que tous les mots de la compassion.
À ce titre, il ne serait pas exagéré de dire que Proust m'a sauvée. »
Un merci particulièrement reconnaissant à Hélène (@4bis) qui, la première, a attiré mon attention sur ce livre.
Il me semble que l'ambition et l'humilité de l'autrice, son infinie reconnaissance à l'égard d'une oeuvre qui la suit partout depuis trente ans, sont tout entières contenues dans ces quelques lignes. Et c'est, à mes yeux, ce qui fait la force, la grandeur, la beauté de son livre. Un livre qui, bien qu'étayé par des milliers d'heures de lecture et de recherches, n'est pas un énième ouvrage savant prétendant apporter un éclairage érudit ou inédit sur une oeuvre qui donne lieu depuis sa parution à une glose exponentielle. Non, c'est un livre qui, partant du coeur tout en s'appuyant constamment sur l'exercice de la raison, nous donne à voir un condensé saisissant du dialogue fécond, salvateur, indéfiniment enrichi au fil du temps, qu'entretient Laure Murat avec Proust.
Issue d'un milieu, l'aristocratie, dans lequel l'implicite, le non-dit, la retenue, voire le refoulement, sont érigés en règle de vie, où l'expression des sentiments est perçue comme une faute de goût, où tout élan sensible, jusqu'aux plus intimes tragédies comme la perte d'un être cher, est converti en exercice de style, Laure Murat est parvenue à clarifier grâce à Proust ce qu'elle percevait confusément, douloureusement depuis l'enfance :
« Mon ambivalence vis-à-vis de l'aristocratie trouvait sa résolution : sensible, à l'occasion, à son sens du panache, mais aussi aux délicatesses morales de la grande politesse, je ressentais, dans le temps, un profond désarroi et même une angoisse face à son discours creux et sa complaisance passionnée pour le mensonge social. »
L'exercice de démystification méthodique de l'aristocratie auquel se livre Proust qui, après l'avoir élevée au firmament de l'esprit et de l'élégance, après avoir érigé ses membres au rang de Dieux de l'Olympe, les précipite plus bas que terre, les renvoyant à leur vacuité abyssale, n'offre pas seulement à Laure Murat une clarification salutaire, il lui en dévoile les ressorts intimes, l'irrésistible mécanique interne :
« Mais le plus sidérant, c'était que toutes les scènes lues où l'aristocratie entrait en jeu étaient infiniment plus vivantes que les scènes vécues dont j'avais été le témoin, comme si Proust, à l'image du Dr Frankenstein, élaborait sous mes yeux le mode d'emploi des créatures que nous étions. »
À partir de là s'enclenche le processus libérateur qui, en lui permettant d'identifier ce qui relève, en elle, de l'aliénation sociale et familiale, l'autorise du même coup à s'émanciper et à affirmer sa singularité. Mais dans un milieu dont l'idéologie conservatrice sacralise l'immuabilité et vitupère le changement, un milieu dans lequel il convient de tenir son rôle, l'émancipation n'est pas de mise, surtout quand celle-ci passe par l'énonciation explicite d'une homosexualité honnie. « Fille perdue » pour sa mère, subissant l'opprobre de sa nombreuse famille, il ne lui reste pas d'autre choix « que de commencer une nouvelle vie, dont l'horizon irait chaque jour s'élargissant. »
On comprend mieux, à présent, le sens de la phrase que je citais en introduction : « C'est pourquoi il m'a, chaque fois, consolée. » Mais Laure Murat ne s'arrête pas à son cas particulier. Elle élargit la focale à tous ceux pour lesquels, à travers le monde entier, « Proust, mieux qu'aucun autre écrivain, a si souvent incarné à la fois une bouée et un phare dans la tragédie. » Car « nous sommes tous et toutes inconsolables ». Chacun d'entre nous, dont la venue au monde, après nous avoir arrachés au refuge du ventre maternel, nous voue à jamais à la solitude et à l'angoisse de la mort, ressent le besoin inassouvissable d'être consolé. À commencer par le narrateur de la Recherche qui, soir après soir à Combray, attend anxieusement le précieux viatique qui ouvrira toutes grandes les portes du sommeil et du rêve, en l'absence duquel il n'y aura pas de repos possible, le baiser maternel :
« Il y a bien longtemps aussi que mon père a cessé de pouvoir dire à maman : « Va avec le petit. » La possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi. Mais depuis peu de temps, je recommence à très bien percevoir si je prête l'oreille, les sanglots que j'eus la force de contenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvai seul avec maman. En réalité ils n'ont jamais cessé. »
(Du côté de chez Swann)
Ce constat tragique, Proust en fait non pas l'objet d'une plainte complaisante, mais le coeur d'une recherche, transmuant le plomb en or, transformant une catastrophe en oeuvre d'art. Nous savons qu'il s'est véritablement attelé à l'écriture de la Recherche en 1906, un an après la mort de sa mère. Sa vie ayant désormais, comme il le confie à Robert de Montesquiou, « perdu son seul but, sa seule douceur, son seul amour, sa seule consolation », il ne lui reste plus qu'à se mettre à la tâche tant de fois différée afin d'offrir à sa mère disparue la consolation qu'il ne put lui offrir de son vivant, celle d'accomplir l'oeuvre à laquelle elle le savait secrètement promis.
« Proust se doutait-il seulement qu'en échafaudant son roman il inventait un secours plus puissant que la tendresse d'une mère absente ? (…)
Il n'endort pas nos douleurs dans les volutes de sa prose, il excite sans cesse notre désir de savoir qui, en séparant l'enfant de sa mère, nous affranchit plus sûrement du malheur que tous les mots de la compassion.
À ce titre, il ne serait pas exagéré de dire que Proust m'a sauvée. »
Un merci particulièrement reconnaissant à Hélène (@4bis) qui, la première, a attiré mon attention sur ce livre.
Un bel ouvrage qui nous plonge dans les replis de la famille de l'auteur. C'est toujours curieux de voir comment vivent les autres : on a l'impression de regarder par une fenêtre éclairée... Néanmoins je pense que si vous n'avez pas lu Proust, vous passerez en partie à côté : il faut connaître les Verdurin, Charlus et les autres pour comprendre de quoi parle l'auteur. A moins que cela ne vous donne l'envie de vous plonger dans La Recherche, ce qui pourrait être une révélation comme pour le personnage de Clara dans Clara lit Proust, un autre ouvrage à conseiller.
La généalogie de Laure Murat, princesse Murat, est peu banale : sa famille maternelle, les de Luynes, noblesse d'ancien régime, remonte en droite ligne à Charlemagne, son père, noblesse d'empire, est l'arrière petit neveu de Napoléon 1er : « Avant de savoir lire, je savais que je descendais de Charles VII, de Colbert et de Napoléon, que mes ancêtres s'étaient distingués dans toute l'Europe, à la cour et sur le champ de bataille. »
Comment définir cet ouvrage ? Pas du tout un roman, malgré son titre, pas une simple autobiographie, malgré de nombreux passages très amusants, cocasses mais aussi parfois glaçants sur sa famille et son milieu, pas une simple analyse littéraire ou une ultime thèse sur Proust, mais un subtil mélange de tout cela et cela donne un livre merveilleux et très original.
Certes il n'est pas donné à tout le monde de se rendre compte qu'on a un lien de parenté avec des personnages inventés, que le duc et la duchesse de Guermantes seraient ses grand-oncle et tante, que le duc d'Uzès, un véritable et réel arrière-grand-oncle est décrit par Proust comme un ami très proche de Robert de Saint-Loup, personnage de la Recherche, que tout ce grand ou petit monde est reçu à diner à l'Hôtel Murat et, qu'enfin, le jeune Proust était reçu à diner par son arrière-grand-mère, Cécile Ney d'Elchinguen, qui disait de lui : « Ah oui, ce petit journaliste que je mettais en bout de table… ».
Mais tout ceci ne suffirait pas à justifier ce livre. Il manquerait le lien, le parallèle fait avec verve et brio par Laure Murat entre sa vie et La Recherche. Proust lui a, ainsi qu'elle le dit, « décillé » ses yeux sur son monde familial, l'aristocratie, il lui a révélé que ce monde n'est que théâtre, représentation, société qui danse sur le vide, dont l'objectif est de « tenir » et de « se tenir », de conserver sa place. Laure Murat nous démontre, en s'appuyant sur de nombreux analyses de l'oeuvre de Proust, que ce dernier ne s'est pas borné à faire une description complaisante du monde aristocratique, contrairement à un certain nombre d'idées reçues, notamment de lecteurs qui n'ont pas été au-delà de « du côté de chez Swan » ou de « A l'ombre des jeunes filles en fleurs », mais qu'il a en réalité peint la vacuité, la vulgarité et la brutalité de ce milieu aristocratique.
Enfin, et surtout sans doute, la lecture de la Recherche à 20 ans, a permis à Laure Murat d'assumer sa différence, son homosexualité et de se confronter de ce fait aux codes de sa famille. Proust l'a aidée à sortir du placard, l'a délivrée de sa prison familiale. Mais ce livre n'est pas non plus un simple règlement de compte, les pages écrites sur sa mère sont terribles mais celles relatives à son père ne le sont pas et sont empreintes d'affection et de respect.
C'est donc un ouvrage complexe, à la fois très simple et quelquefois assez compliqué, sur les faux-semblants et comment s'en défaire, et sur le pouvoir que peut avoir un ouvrage littéraire sur la vie de ses lecteurs.
Comment définir cet ouvrage ? Pas du tout un roman, malgré son titre, pas une simple autobiographie, malgré de nombreux passages très amusants, cocasses mais aussi parfois glaçants sur sa famille et son milieu, pas une simple analyse littéraire ou une ultime thèse sur Proust, mais un subtil mélange de tout cela et cela donne un livre merveilleux et très original.
Certes il n'est pas donné à tout le monde de se rendre compte qu'on a un lien de parenté avec des personnages inventés, que le duc et la duchesse de Guermantes seraient ses grand-oncle et tante, que le duc d'Uzès, un véritable et réel arrière-grand-oncle est décrit par Proust comme un ami très proche de Robert de Saint-Loup, personnage de la Recherche, que tout ce grand ou petit monde est reçu à diner à l'Hôtel Murat et, qu'enfin, le jeune Proust était reçu à diner par son arrière-grand-mère, Cécile Ney d'Elchinguen, qui disait de lui : « Ah oui, ce petit journaliste que je mettais en bout de table… ».
Mais tout ceci ne suffirait pas à justifier ce livre. Il manquerait le lien, le parallèle fait avec verve et brio par Laure Murat entre sa vie et La Recherche. Proust lui a, ainsi qu'elle le dit, « décillé » ses yeux sur son monde familial, l'aristocratie, il lui a révélé que ce monde n'est que théâtre, représentation, société qui danse sur le vide, dont l'objectif est de « tenir » et de « se tenir », de conserver sa place. Laure Murat nous démontre, en s'appuyant sur de nombreux analyses de l'oeuvre de Proust, que ce dernier ne s'est pas borné à faire une description complaisante du monde aristocratique, contrairement à un certain nombre d'idées reçues, notamment de lecteurs qui n'ont pas été au-delà de « du côté de chez Swan » ou de « A l'ombre des jeunes filles en fleurs », mais qu'il a en réalité peint la vacuité, la vulgarité et la brutalité de ce milieu aristocratique.
Enfin, et surtout sans doute, la lecture de la Recherche à 20 ans, a permis à Laure Murat d'assumer sa différence, son homosexualité et de se confronter de ce fait aux codes de sa famille. Proust l'a aidée à sortir du placard, l'a délivrée de sa prison familiale. Mais ce livre n'est pas non plus un simple règlement de compte, les pages écrites sur sa mère sont terribles mais celles relatives à son père ne le sont pas et sont empreintes d'affection et de respect.
C'est donc un ouvrage complexe, à la fois très simple et quelquefois assez compliqué, sur les faux-semblants et comment s'en défaire, et sur le pouvoir que peut avoir un ouvrage littéraire sur la vie de ses lecteurs.
Après Triste Tigre, ce livre est mon préféré de cette rentrée littéraire. Je ne suis pas certaine qu'il faille être proustienne pour l'apprécier mais il faut avoir quelques connaissances sur La Recherche, au moins en ce qui concerne les personnages. Je reste cependant persuadée que ce livre peut autant donner envie de lire Proust pour la première fois qu'il donne , irrésistiblement envie de le reprendre et de finir son oeuvre puisque Laure Murat insiste sur le fait que la compréhension de cette fresque ne peut être totale qu'après avoir assisté au cheminement du narrateur. L'histoire de sa famille m'a intéressée de manière inégale mais elle est là pour nous montrer (et on pourrait en douter avant la lecture) que ce monde n'a pas changé son système de valeurs et que la critique de Proust est toujours valable.
Si vous n'avez jamais eu l'occasion ou l'envie d'entamer la lecture d'A la recherche du temps perdu, ce livre vous donnera peut-être...non sûrement l'impérieuse tentation de vous y jeter à corps perdu.
Laure Murat nous entraîne dans une "visite guidée" de cette oeuvre colossale...mais ce n'est pas tout. C'est également la description d'un monde dont la seule raison d'exister est de continuer à exister, l'aristocratie.
Parallèlement à Proust, l'autrice nous décrit le comportement aristocratique sous tous ses aspects. Elle le connaît bien puisque c'est son milieu.
Les amateurs d'Histoire ne seront pas déçus : Laure Murat a passé son enfance dans un cadre plein de souvenirs historiques.
Elle a notamment pour aïeux le duc de Luynes, favori du roi Louis XIII, et surtout un des héros les plus marquants de l'Epopée napoléonienne, le maréchal Murat. Il fut l'un des plus grands noms de l'histoire de la cavalerie française. Fils d'aubergiste, donc roturier, il accéda aux plus grands honneurs grâce à son seul courage.
Il y a de belles et intéressantes pages sur les différences entre noblesse d'Ancien régime et noblesse d'Empire.
Et de l'émotion également, celle d'une enfance marquée durablement par une froideur maternelle. La famille de Laure Murat n'a jamais accepté son orientation sexuelle, ce qui amènera à la rupture avec ses parents.
En somme un livre plein d'humanité, de réalisme au sujet d'une caste que certains envient et un plaidoyer pour le respect de chacun quelles que soient ses orientations et ses origines sociales.
Merci à Laure Murat, aux éditions Robert Laffont et à Babelio pour ce beau livre
Laure Murat nous entraîne dans une "visite guidée" de cette oeuvre colossale...mais ce n'est pas tout. C'est également la description d'un monde dont la seule raison d'exister est de continuer à exister, l'aristocratie.
Parallèlement à Proust, l'autrice nous décrit le comportement aristocratique sous tous ses aspects. Elle le connaît bien puisque c'est son milieu.
Les amateurs d'Histoire ne seront pas déçus : Laure Murat a passé son enfance dans un cadre plein de souvenirs historiques.
Elle a notamment pour aïeux le duc de Luynes, favori du roi Louis XIII, et surtout un des héros les plus marquants de l'Epopée napoléonienne, le maréchal Murat. Il fut l'un des plus grands noms de l'histoire de la cavalerie française. Fils d'aubergiste, donc roturier, il accéda aux plus grands honneurs grâce à son seul courage.
Il y a de belles et intéressantes pages sur les différences entre noblesse d'Ancien régime et noblesse d'Empire.
Et de l'émotion également, celle d'une enfance marquée durablement par une froideur maternelle. La famille de Laure Murat n'a jamais accepté son orientation sexuelle, ce qui amènera à la rupture avec ses parents.
En somme un livre plein d'humanité, de réalisme au sujet d'une caste que certains envient et un plaidoyer pour le respect de chacun quelles que soient ses orientations et ses origines sociales.
Merci à Laure Murat, aux éditions Robert Laffont et à Babelio pour ce beau livre
Roman, essai, autobiographie, livre inclassable certes mais particulièrement éclairant sur l'oeuvre de Proust, revenant sur des commentaires passés à la limite du contresens.
En rupture totale avec sa famille du fait de son homosexualité affichée, elle comprend à la lecture de la Recherche de quel milieu sclérosé, théâtralisé, concentré sur les apparences et finalement vulgaire et vide de sens, elle descend. A partir de là elle peut se reconstruire.
Qu'on ait lu ou pas la Recherche, ce livre invite à la quête de soi à partir de la mémoire recomposée. L'écriture aisée, fluide donne non seulement envie de lire/relire Proust mais aussi de découvrir les essais de Laure Murat.
En rupture totale avec sa famille du fait de son homosexualité affichée, elle comprend à la lecture de la Recherche de quel milieu sclérosé, théâtralisé, concentré sur les apparences et finalement vulgaire et vide de sens, elle descend. A partir de là elle peut se reconstruire.
Qu'on ait lu ou pas la Recherche, ce livre invite à la quête de soi à partir de la mémoire recomposée. L'écriture aisée, fluide donne non seulement envie de lire/relire Proust mais aussi de découvrir les essais de Laure Murat.
Bon, voilà, on ne va pas y aller par quatre chemins comme on dit. J'ai pris une décision toute simple, Madame Murat : cette année, c'est moi (avec un peu d'avance) qui décernerai le Goncourt, MON Goncourt, pour la bonne raison que l'évidence s'impose. En effet, le plus intelligent, le plus fin, le plus délicat, le plus bouleversant, le plus merveilleux de tous ces textes, est… (roulements de tambour) : « Proust, roman familial ».
Voilà. La proclamation est faite ! Un grand bravo Laure Murat ! Vous allez pouvoir repartir avec un chèque de 10 euros (que généralement personne n'encaisse) (mais vous ferez comme bon vous semble) et un succès garanti en librairie...
Maintenant, je tente de vous dire pourquoi je vous ai attribué ce prix.
Il y a tellement de raisons que je ne sais pas par laquelle commencer.
Commençons par vous, si vous le voulez bien. Sachez que l'univers de votre famille m'a vraiment fascinée, à la fois effrayée et fascinée. Je vous l'avoue, j'avais l'impression d'être au coeur d'un roman, je veux dire d'une fiction. le cadre ? L'aristocratie : noblesse d'Empire du côté de votre père, le prince Napoléon Murat, arrière-arrière-petit-neveu de l'Empereur ; noblesse d'Ancien Régime du côté de votre mère, Inès d'Albert de Luynes, fille aînée du duc de Luynes,…
Vous voyez le plan!
Comment vit-on chez ces gens-là ?
Franchement, on m'aurait décrit le mode de vie des Sentinelles des îles Andaman que je n'aurais pas été plus stupéfaite. Personne ne travaille (et tout le monde trouve ça normal comme vous dites!), on ne parle JAMAIS de soi, on ne manifeste JAMAIS ses émotions, on se tient TOUJOURS bien, on parle correctement ET distinctement. On ne lit pas ou très peu (sauf, et il faut le souligner, vos parents qui lisaient, notamment votre père, mais je reparlerai tout à l'heure de ce magnifique et très tendre portrait que vous faites de lui). Alors, comme nous avons, à un an près, le même âge, j'ai tenté de m'imaginer grandir dans ce type de milieu peut-être un peu... étouffant (bel euphémisme), complètement hors-sol, totalement coupé du monde réel. Je pense que c'eût été bien difficile. En tout cas, la description très lucide que vous faites de ce monde m'a saisie. J'ajouterai aussi que le chapitre sur le château de Luysne (une vraie forteresse médiévale, n'est-ce pas ?) : « Tombeau pour un château » est vraiment passionnant et tout aussi incroyable...
Donc, de ce monde, il vous a fallu sortir pour exister. Vous saviez que révéler votre homosexualité allait provoquer un tremblement de terre, une catastrophe, un désastre. Et vous l'avez fait et vous avez dû partir. Cela m'a bouleversée. Parce que vous n'avez jamais revu votre famille. Les pages sur vos parents sont extrêmement touchantes. Je sais que certains journalistes vous demandent si ce texte est un règlement de comptes. Bien sûr que non. Ont-ils lu ces pages où l'on sent l'immense amour que vous portez à vos parents, la grande tristesse de n'avoir jamais vraiment connu votre mère et la douleur sans nom d'avoir perdu celui à qui vous ressemblez certainement beaucoup : votre père ?
Et Proust dans tout ça ?
J'imagine votre stupéfaction quand vous avez découvert que des noms de personnes de votre famille figuraient dans La Recherche : ainsi aviez-vous vraiment l'impression de vivre au quotidien avec des personnages de fiction ; et inversement, vous étiez à deux doigts de considérer les êtres de fiction comme des êtres de chair et de sang tellement la frontière entre réalité et fiction devenait mince. Quelle expérience singulière et bouleversante ! Notons en passant que vos arrière-grands- parents avaient effectivement connu Proust...
La lecture de Proust a changé votre vie : en effet, elle a mis à nu un monde reposant sur des conventions, des apparences, du vide. Comme vous le dites, l'aristocrate joue constamment un rôle, toujours le même rôle, il est d'une certaine façon un être de fiction. Il est faux, toujours en représentation. « Il n'y a rien de plus aliéné que l'aristocrate » écrivez-vous.
Proust vous a aidée à y voir clair dans le petit jeu des gens qui vous entouraient : il a « percé le secret de leur pantomime.» En effet, comme le Narrateur de la Recherche, complètement aveuglé au début par ce monde aristocratique, vous allez, petit à petit, mieux comprendre son fonctionnement (un peu comme Swann vis-à-vis d'Odette), un dessillement va progressivement s'opérer. Vous écrivez au sujet de Proust qu'« il nous dévoile un secret : l'échafaudage qui se monte sous nos yeux ne s'appuie sur aucun bâtiment ; c'est une structure solitaire, aérienne et sans support, ne soutenant rien qu'elle-même. » Bref, tout ce monde « repose sur du vide ». Grâce à votre lecture de la Recherche, vous avez mis des mots sur le malaise que vous ressentiez, vous y avez vu clair et vous avez pu prendre vos distances, vous libérer.
Enfin, j'ai trouvé particulièrement saisissantes les analyses que vous proposez sur la notion d'un « MOI » proustien discontinu, instable, fluctuant, changeant, notion qui a été pour vous source d'émancipation. Vous preniez enfin conscience que vous viviez prisonnière dans « l'étau de la permanence et d'une fixité mortifère », vous qui étiez élevée « dans un milieu dont l'idéologie conservatrice sacralisait l'immuabilité et vitupérait le changement. » Vous vous êtes identifiée à ce « Moi » pluriel, multiple, ouvert, riche, libre, à ce « moi » kaléidoscope, fait de strates successives, de temporalités différentes...
La littérature a changé votre vie : elle vous a libérée. Elle vous a permis de comprendre le monde où vous viviez. Elle vous a aussi donné la force de refuser ce qui vous était imposé. « Je passais d'une lecture verticale du monde, monolithe, hiérarchisée, autoritaire, héritée de l'Ancien Régime et du XIXe siècle, à une lecture oblique, plurielle, globale et en trois dimensions de l'univers. de la claustration à l'ouverture. du passé à l'avenir. » de la mort à la vie peut-être aussi.
Merci Laure Murat pour ce texte magnifique que nous porterons en nous longtemps.
Lien : http://lireaulit.blogspot.fr/
Voilà. La proclamation est faite ! Un grand bravo Laure Murat ! Vous allez pouvoir repartir avec un chèque de 10 euros (que généralement personne n'encaisse) (mais vous ferez comme bon vous semble) et un succès garanti en librairie...
Maintenant, je tente de vous dire pourquoi je vous ai attribué ce prix.
Il y a tellement de raisons que je ne sais pas par laquelle commencer.
Commençons par vous, si vous le voulez bien. Sachez que l'univers de votre famille m'a vraiment fascinée, à la fois effrayée et fascinée. Je vous l'avoue, j'avais l'impression d'être au coeur d'un roman, je veux dire d'une fiction. le cadre ? L'aristocratie : noblesse d'Empire du côté de votre père, le prince Napoléon Murat, arrière-arrière-petit-neveu de l'Empereur ; noblesse d'Ancien Régime du côté de votre mère, Inès d'Albert de Luynes, fille aînée du duc de Luynes,…
Vous voyez le plan!
Comment vit-on chez ces gens-là ?
Franchement, on m'aurait décrit le mode de vie des Sentinelles des îles Andaman que je n'aurais pas été plus stupéfaite. Personne ne travaille (et tout le monde trouve ça normal comme vous dites!), on ne parle JAMAIS de soi, on ne manifeste JAMAIS ses émotions, on se tient TOUJOURS bien, on parle correctement ET distinctement. On ne lit pas ou très peu (sauf, et il faut le souligner, vos parents qui lisaient, notamment votre père, mais je reparlerai tout à l'heure de ce magnifique et très tendre portrait que vous faites de lui). Alors, comme nous avons, à un an près, le même âge, j'ai tenté de m'imaginer grandir dans ce type de milieu peut-être un peu... étouffant (bel euphémisme), complètement hors-sol, totalement coupé du monde réel. Je pense que c'eût été bien difficile. En tout cas, la description très lucide que vous faites de ce monde m'a saisie. J'ajouterai aussi que le chapitre sur le château de Luysne (une vraie forteresse médiévale, n'est-ce pas ?) : « Tombeau pour un château » est vraiment passionnant et tout aussi incroyable...
Donc, de ce monde, il vous a fallu sortir pour exister. Vous saviez que révéler votre homosexualité allait provoquer un tremblement de terre, une catastrophe, un désastre. Et vous l'avez fait et vous avez dû partir. Cela m'a bouleversée. Parce que vous n'avez jamais revu votre famille. Les pages sur vos parents sont extrêmement touchantes. Je sais que certains journalistes vous demandent si ce texte est un règlement de comptes. Bien sûr que non. Ont-ils lu ces pages où l'on sent l'immense amour que vous portez à vos parents, la grande tristesse de n'avoir jamais vraiment connu votre mère et la douleur sans nom d'avoir perdu celui à qui vous ressemblez certainement beaucoup : votre père ?
Et Proust dans tout ça ?
J'imagine votre stupéfaction quand vous avez découvert que des noms de personnes de votre famille figuraient dans La Recherche : ainsi aviez-vous vraiment l'impression de vivre au quotidien avec des personnages de fiction ; et inversement, vous étiez à deux doigts de considérer les êtres de fiction comme des êtres de chair et de sang tellement la frontière entre réalité et fiction devenait mince. Quelle expérience singulière et bouleversante ! Notons en passant que vos arrière-grands- parents avaient effectivement connu Proust...
La lecture de Proust a changé votre vie : en effet, elle a mis à nu un monde reposant sur des conventions, des apparences, du vide. Comme vous le dites, l'aristocrate joue constamment un rôle, toujours le même rôle, il est d'une certaine façon un être de fiction. Il est faux, toujours en représentation. « Il n'y a rien de plus aliéné que l'aristocrate » écrivez-vous.
Proust vous a aidée à y voir clair dans le petit jeu des gens qui vous entouraient : il a « percé le secret de leur pantomime.» En effet, comme le Narrateur de la Recherche, complètement aveuglé au début par ce monde aristocratique, vous allez, petit à petit, mieux comprendre son fonctionnement (un peu comme Swann vis-à-vis d'Odette), un dessillement va progressivement s'opérer. Vous écrivez au sujet de Proust qu'« il nous dévoile un secret : l'échafaudage qui se monte sous nos yeux ne s'appuie sur aucun bâtiment ; c'est une structure solitaire, aérienne et sans support, ne soutenant rien qu'elle-même. » Bref, tout ce monde « repose sur du vide ». Grâce à votre lecture de la Recherche, vous avez mis des mots sur le malaise que vous ressentiez, vous y avez vu clair et vous avez pu prendre vos distances, vous libérer.
Enfin, j'ai trouvé particulièrement saisissantes les analyses que vous proposez sur la notion d'un « MOI » proustien discontinu, instable, fluctuant, changeant, notion qui a été pour vous source d'émancipation. Vous preniez enfin conscience que vous viviez prisonnière dans « l'étau de la permanence et d'une fixité mortifère », vous qui étiez élevée « dans un milieu dont l'idéologie conservatrice sacralisait l'immuabilité et vitupérait le changement. » Vous vous êtes identifiée à ce « Moi » pluriel, multiple, ouvert, riche, libre, à ce « moi » kaléidoscope, fait de strates successives, de temporalités différentes...
La littérature a changé votre vie : elle vous a libérée. Elle vous a permis de comprendre le monde où vous viviez. Elle vous a aussi donné la force de refuser ce qui vous était imposé. « Je passais d'une lecture verticale du monde, monolithe, hiérarchisée, autoritaire, héritée de l'Ancien Régime et du XIXe siècle, à une lecture oblique, plurielle, globale et en trois dimensions de l'univers. de la claustration à l'ouverture. du passé à l'avenir. » de la mort à la vie peut-être aussi.
Merci Laure Murat pour ce texte magnifique que nous porterons en nous longtemps.
Lien : http://lireaulit.blogspot.fr/
L'une des héroïnes de ce livre est la littérature.
Celle qui permet d'accéder à soi-même.
L'autre, Laure Murat, grâce à la lecture et relecture de la Recherche du temps perdu de Marcel Proust s'est non seulement « découverte » mais a pu ainsi comprendre et s'échapper du monde codifié auquel elle appartenait.
Un nom, un titre, des ancêtres passés dans l'Histoire, naître et grandir, n'être que porteur et représentant d'une caste, voilà ce que refusa Laure Murat, voilà ce qui la mit au ban de son « Monde ».
Un monde qu'elle nous livre sans concessions : tendresse absente ou camouflée, éducation où l'on ne montre pas ses sentiments, fausse gentillesse doublée de condescendance, codes à tous niveaux, condamnation de ce qui nuit aux bonnes moeurs (homosexualité, etc…) mais qui n'empêche pas une conduite cachée, voire la vulgarité etc…
Un portrait détonnant et choquant s'il n'y avait la présence de l'autre, le grand écrivain, celui par qui les faits s'expliquent et s'éclairent et ces mots, ces gens, ce monde dans le monde, ce snobisme de parade ouvrent grand les portes de la vie et de la réalité.
Des souvenirs personnels, des lieux évocateurs et magiques passés l'été au château de Luynes, les mots terriblement durs et blessants de la mère, les liens entre sa famille et l'oeuvre de Proust, des époques et une société fermée nous sont racontées dans un récit qui ne laisse pas indifférent.
Puis il y a le regard porté sur Proust, une façon de démonter la légende qui l'entoure et perdure.
Non l'écrivain n'est pas le snob que l'on imagine et lire Laure Murat éclaire notre regard et détruit la légende.
Un récit qui bouscule les codes, les a-priori, les fausses images et qui a sans doute permis à son auteure une respiration neuve.
Celle qui permet d'accéder à soi-même.
L'autre, Laure Murat, grâce à la lecture et relecture de la Recherche du temps perdu de Marcel Proust s'est non seulement « découverte » mais a pu ainsi comprendre et s'échapper du monde codifié auquel elle appartenait.
Un nom, un titre, des ancêtres passés dans l'Histoire, naître et grandir, n'être que porteur et représentant d'une caste, voilà ce que refusa Laure Murat, voilà ce qui la mit au ban de son « Monde ».
Un monde qu'elle nous livre sans concessions : tendresse absente ou camouflée, éducation où l'on ne montre pas ses sentiments, fausse gentillesse doublée de condescendance, codes à tous niveaux, condamnation de ce qui nuit aux bonnes moeurs (homosexualité, etc…) mais qui n'empêche pas une conduite cachée, voire la vulgarité etc…
Un portrait détonnant et choquant s'il n'y avait la présence de l'autre, le grand écrivain, celui par qui les faits s'expliquent et s'éclairent et ces mots, ces gens, ce monde dans le monde, ce snobisme de parade ouvrent grand les portes de la vie et de la réalité.
Des souvenirs personnels, des lieux évocateurs et magiques passés l'été au château de Luynes, les mots terriblement durs et blessants de la mère, les liens entre sa famille et l'oeuvre de Proust, des époques et une société fermée nous sont racontées dans un récit qui ne laisse pas indifférent.
Puis il y a le regard porté sur Proust, une façon de démonter la légende qui l'entoure et perdure.
Non l'écrivain n'est pas le snob que l'on imagine et lire Laure Murat éclaire notre regard et détruit la légende.
Un récit qui bouscule les codes, les a-priori, les fausses images et qui a sans doute permis à son auteure une respiration neuve.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Laure Murat (14)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )
Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "
amoureux
positiviste
philosophique
20 questions
864 lecteurs ont répondu
Thèmes :
essai
, essai de société
, essai philosophique
, essai documentCréer un quiz sur ce livre864 lecteurs ont répondu