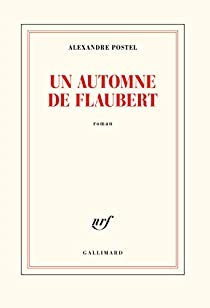Citations sur Un automne de Flaubert (42)
Cet élan s'est perdu qui jadis lui dilatait les narines, lui écarquillait les yeux et le poussait sur les routes du matin jusqu'au soir ; maintenant, ce traînant sur le pourtour sinueux des anses de la baie, il n'éprouve que le poids de sa propre chair. Son pas est lent, son souffle court, et son esprit, loin de s'ouvrir aux forces et aux flux du monde, se resserre sur les menus accidents du chemin, une racine glissante, une roche instable, une ronce à écarter. Le coutil de son pantalon lui colle aux cuisses. Ses compagnons marchent trop vite à son gré, mais par orgueil il se refuse à le leur dire. De temps à autre, Pouchet s'arrête pour lui signaler un détail pittoresque, une algue rare ondulant dans le courant, une curiosité géologique : il profite de ces haltes pour reprendre son souffle, il pose un regard las sur tout ce qu'on lui montre.
(...) il connaît trop la fatigue et les contradictions de l'artiste qui doute de l'art, de l'esprit cédant malgré lui aux séductions confuses de la métaphysique, de l'incroyant qui se grise du parfum des religions desséchées comme une épouse déçue va sentir, au fond d'une armoire, les fleurs fanées de son bouquet de mariée.
Elephanti locustrum generis nigri, des éléphants noirs de l'espèce des langoustes : ainsi Pline décrivait-il le homard, qui n'avait pas de nom dans sa langue. Flaubert se répète ces mots latins, charmé de leur beauté, envieux de ce temps où il restait encore quelque chose à nommer dans le monde.
Étrange loi, qui veut que les êtres les plus à même de nous consoler soient rarement les plus proches de notre coeur.
INCIPIT
À son entrée dans Concarneau, Flaubert crève de sommeil et de faim.
La veille, il était à Deauville afin de conclure devant notaire la vente de sa ferme. De Deauville, il s’est rendu à la gare de Trouville où il a pris le train pour Lisieux ; à Lisieux, il monte à bord d’un tortillard qui descend vers Le Mans. Arrivé au Mans, il attend jusqu’à une heure du matin le passage du rapide de Brest ; mais Flaubert ne va pas à Brest, il descend à Rennes et bifurque vers le sud ; en gare de Redon il rejoint la ligne qui, longeant la côte, remonte vers le Finistère en passant par Auray, Vannes, Lorient, Rosporden ; Rosporden où, après une nuit passée à regarder par la fenêtre du wagon la lune filer derrière les arbres, il descend à dix heures du matin, le jeudi 16 septembre 1875.
Il ne lui reste plus qu’à patienter quatre heures en attendant le départ de la voiture pour Concarneau.
*
À demi éveillé durant ces heures mortes, il se souvient de son précédent passage à Rosporden, presque trente ans plus tôt. Le chemin de fer ne traversait pas encore ces régions ; Du Camp et lui allaient le plus souvent à pied, longeant les cours d’eau et les haies, s’arrêtant dans les églises et les auberges ; ils s’amusaient d’un visage, songeaient devant les tombeaux, contemplaient les clématites en fleur, les vieilles pierres recouvertes de lierre, la forme d’une colline éloignée dans la brume. Rosporden leur avait fait l’impression d’un bourg austère où, même en plein marché, on n’entendait pas un bruit, pas un rire, pas un cri : le silence enveloppait ces transactions de pauvres et tout, jusqu’aux longs cheveux qui semblaient couler sous les chapeaux de feutre, dégageait une tristesse de chien mouillé. Des mendiants harcelaient les voyageurs en marmonnant des prières ; la flèche de pierre de l’église se dressait, grisâtre, dans le ciel gris.
Flaubert avait alors vingt-cinq ans. L’année précédente, à quelques semaines d’intervalle, il avait perdu son père puis sa sœur cadette, emportée par une fièvre puerpérale. Respirer, voilà ce qu’il attendait de cette errance par les champs et par les grèves ; humer à pleine poitrine un air plus vif et plus puissant ; se libérer pour quelques semaines de la tristesse de sa mère et du navrant spectacle de sa nièce, la petite orpheline dont les Flaubert ont obtenu la garde.
Cette vie nouvelle dont il était parti puiser les influx dans le déferlement des vagues, la profondeur des forêts et la monotonie des landes, il songe, en ruminant ses souvenirs dans Rosporden retrouvée, qu’elle est à son tour révolue. Il a cinquante-trois ans : sa deuxième vie a duré exactement aussi longtemps que la première. À présent une autre vie doit commencer, ou plutôt une survie – en attendant la fin qui ne saurait tarder.
*
Autour de lui tout meurt. Son ami Bouilhet, le poète-professeur assez savant pour comprendre ses projets, assez rigoureux pour les éplucher sans pitié, trop délicat pour avoir produit lui-même autre chose que des œuvrettes sans importance ; sa pauvre mère dont il s’est aperçu, mais trop tard, qu’elle était l’être qu’il a le plus aimé ; et puis les autres, Jules de Goncourt, Gautier, le petit Duplan qui comprenait si bien Sade, Ernest Feydeau, tous ces lettrés dont la fréquentation rendait la vie moins ennuyeuse et qui tombent comme des mouches.
Il se sent seul ; souvent il se plaint de vivre dans un cimetière ou, ce qui revient au même, sur le radeau de la Méduse ; il est à la fois le désert, le voyageur et le chameau. Il n’a personne à qui parler de ce qui importe : non pas des lois constitutionnelles et du président Mac Mahon, ni des crues de la Garonne, ni des expéditions africaines de Savorgnan de Brazza, ni de la définition du mètre étalon, mais de ce qui l’attriste et plus encore de ce qui le réjouit, Homère, Goethe, Rabelais, Shakespeare.
Il y aurait bien Tourgueniev, mais le Moscove est toujours par monts et par vaux, tantôt en Russie, tantôt à Bade, tantôt à Bougival, si bien qu’on a les pires peines du monde à le faire venir jusqu’à Croisset pour une bonne causerie. Et puis Tourgueniev, en homme soumis aux volontés de la femme qu’il aime, ne se livre à l’amitié que par saccades : c’est agaçant.
George Sand ? Cette femme est la bonté même ; sa tendresse, sa générosité n’ont pas de bornes. Elle invite sans relâche Flaubert à Nohant où il lui est arrivé de passer quelques jours heureux en compagnie de la tribu qu’elle s’est créée, enfants, petits-enfants, voisins, rassemblés autour d’un spectacle de marionnettes. Mais la mère Sand le fatigue avec ses idées sur le suffrage universel et l’éducation des masses ; elle ignore ce que c’est que la haine.
Quand Flaubert lui avoue qu’il broie du noir et voudrait être mort, elle lui recommande de bien dormir, de bien manger, et surtout de faire de l’exercice : sage conseil à n’en pas douter, très sage conseil, qui ne peut émaner que d’un esprit lucide, calme et borné – borné par choix, mûrement, profondément borné, à la façon de ces médecins de campagne dont on se demande, tant leur face exprime de simplicité, de confiance et de sérénité, si ce sont de parfaits imbéciles ou s’ils détiennent sur la santé, le bonheur et la vie, un savoir inaccessible aux âmes compliquées. George Sand est de cette étoffe-là ; cela ne peut combler les aspirations de Flaubert et elle le sait.
Plus orgueilleuse, elle en aurait pris offense ; plus indifférente, elle se serait contentée de déplorer, entre deux romans champêtres, l’infortune de son ami. Mais George Sand se tient sur la fine pointe de l’âme, au-delà de l’orgueil, en deçà de l’indifférence, dans cette région à la fois très basse et très élevée qui reçut autrefois le nom d’humilité. Admettant son impuissance à consoler Flaubert sans pour autant se désintéresser de son sort, elle suspend un instant la rédaction des Contes d’une grand-mère et pense à lui ; humblement, activement, dans sa chambre bleue de Nohant, elle se demande ce qui lui serait bénéfique. Marcher davantage, se marier, employer son existence au service des autres : non, ces réponses-là viennent encore d’elle. Peu à peu, à force d’attention, elle se déprend de ses opinions, de sa personne.
Elle essaie de se mettre à la place de Flaubert. Elle s’imagine dans le corps de cet homme plus grand et plus gros que les autres. Elle s’absorbe dans ses humeurs. Elle ferme les yeux, les rouvre ; c’est l’heure où les cèdres du parc ont des reflets bleus. Une idée lui vient. Elle écrit aussitôt à son ami pour lui en faire part : il devrait fréquenter davantage le père Hugo.
À son entrée dans Concarneau, Flaubert crève de sommeil et de faim.
La veille, il était à Deauville afin de conclure devant notaire la vente de sa ferme. De Deauville, il s’est rendu à la gare de Trouville où il a pris le train pour Lisieux ; à Lisieux, il monte à bord d’un tortillard qui descend vers Le Mans. Arrivé au Mans, il attend jusqu’à une heure du matin le passage du rapide de Brest ; mais Flaubert ne va pas à Brest, il descend à Rennes et bifurque vers le sud ; en gare de Redon il rejoint la ligne qui, longeant la côte, remonte vers le Finistère en passant par Auray, Vannes, Lorient, Rosporden ; Rosporden où, après une nuit passée à regarder par la fenêtre du wagon la lune filer derrière les arbres, il descend à dix heures du matin, le jeudi 16 septembre 1875.
Il ne lui reste plus qu’à patienter quatre heures en attendant le départ de la voiture pour Concarneau.
*
À demi éveillé durant ces heures mortes, il se souvient de son précédent passage à Rosporden, presque trente ans plus tôt. Le chemin de fer ne traversait pas encore ces régions ; Du Camp et lui allaient le plus souvent à pied, longeant les cours d’eau et les haies, s’arrêtant dans les églises et les auberges ; ils s’amusaient d’un visage, songeaient devant les tombeaux, contemplaient les clématites en fleur, les vieilles pierres recouvertes de lierre, la forme d’une colline éloignée dans la brume. Rosporden leur avait fait l’impression d’un bourg austère où, même en plein marché, on n’entendait pas un bruit, pas un rire, pas un cri : le silence enveloppait ces transactions de pauvres et tout, jusqu’aux longs cheveux qui semblaient couler sous les chapeaux de feutre, dégageait une tristesse de chien mouillé. Des mendiants harcelaient les voyageurs en marmonnant des prières ; la flèche de pierre de l’église se dressait, grisâtre, dans le ciel gris.
Flaubert avait alors vingt-cinq ans. L’année précédente, à quelques semaines d’intervalle, il avait perdu son père puis sa sœur cadette, emportée par une fièvre puerpérale. Respirer, voilà ce qu’il attendait de cette errance par les champs et par les grèves ; humer à pleine poitrine un air plus vif et plus puissant ; se libérer pour quelques semaines de la tristesse de sa mère et du navrant spectacle de sa nièce, la petite orpheline dont les Flaubert ont obtenu la garde.
Cette vie nouvelle dont il était parti puiser les influx dans le déferlement des vagues, la profondeur des forêts et la monotonie des landes, il songe, en ruminant ses souvenirs dans Rosporden retrouvée, qu’elle est à son tour révolue. Il a cinquante-trois ans : sa deuxième vie a duré exactement aussi longtemps que la première. À présent une autre vie doit commencer, ou plutôt une survie – en attendant la fin qui ne saurait tarder.
*
Autour de lui tout meurt. Son ami Bouilhet, le poète-professeur assez savant pour comprendre ses projets, assez rigoureux pour les éplucher sans pitié, trop délicat pour avoir produit lui-même autre chose que des œuvrettes sans importance ; sa pauvre mère dont il s’est aperçu, mais trop tard, qu’elle était l’être qu’il a le plus aimé ; et puis les autres, Jules de Goncourt, Gautier, le petit Duplan qui comprenait si bien Sade, Ernest Feydeau, tous ces lettrés dont la fréquentation rendait la vie moins ennuyeuse et qui tombent comme des mouches.
Il se sent seul ; souvent il se plaint de vivre dans un cimetière ou, ce qui revient au même, sur le radeau de la Méduse ; il est à la fois le désert, le voyageur et le chameau. Il n’a personne à qui parler de ce qui importe : non pas des lois constitutionnelles et du président Mac Mahon, ni des crues de la Garonne, ni des expéditions africaines de Savorgnan de Brazza, ni de la définition du mètre étalon, mais de ce qui l’attriste et plus encore de ce qui le réjouit, Homère, Goethe, Rabelais, Shakespeare.
Il y aurait bien Tourgueniev, mais le Moscove est toujours par monts et par vaux, tantôt en Russie, tantôt à Bade, tantôt à Bougival, si bien qu’on a les pires peines du monde à le faire venir jusqu’à Croisset pour une bonne causerie. Et puis Tourgueniev, en homme soumis aux volontés de la femme qu’il aime, ne se livre à l’amitié que par saccades : c’est agaçant.
George Sand ? Cette femme est la bonté même ; sa tendresse, sa générosité n’ont pas de bornes. Elle invite sans relâche Flaubert à Nohant où il lui est arrivé de passer quelques jours heureux en compagnie de la tribu qu’elle s’est créée, enfants, petits-enfants, voisins, rassemblés autour d’un spectacle de marionnettes. Mais la mère Sand le fatigue avec ses idées sur le suffrage universel et l’éducation des masses ; elle ignore ce que c’est que la haine.
Quand Flaubert lui avoue qu’il broie du noir et voudrait être mort, elle lui recommande de bien dormir, de bien manger, et surtout de faire de l’exercice : sage conseil à n’en pas douter, très sage conseil, qui ne peut émaner que d’un esprit lucide, calme et borné – borné par choix, mûrement, profondément borné, à la façon de ces médecins de campagne dont on se demande, tant leur face exprime de simplicité, de confiance et de sérénité, si ce sont de parfaits imbéciles ou s’ils détiennent sur la santé, le bonheur et la vie, un savoir inaccessible aux âmes compliquées. George Sand est de cette étoffe-là ; cela ne peut combler les aspirations de Flaubert et elle le sait.
Plus orgueilleuse, elle en aurait pris offense ; plus indifférente, elle se serait contentée de déplorer, entre deux romans champêtres, l’infortune de son ami. Mais George Sand se tient sur la fine pointe de l’âme, au-delà de l’orgueil, en deçà de l’indifférence, dans cette région à la fois très basse et très élevée qui reçut autrefois le nom d’humilité. Admettant son impuissance à consoler Flaubert sans pour autant se désintéresser de son sort, elle suspend un instant la rédaction des Contes d’une grand-mère et pense à lui ; humblement, activement, dans sa chambre bleue de Nohant, elle se demande ce qui lui serait bénéfique. Marcher davantage, se marier, employer son existence au service des autres : non, ces réponses-là viennent encore d’elle. Peu à peu, à force d’attention, elle se déprend de ses opinions, de sa personne.
Elle essaie de se mettre à la place de Flaubert. Elle s’imagine dans le corps de cet homme plus grand et plus gros que les autres. Elle s’absorbe dans ses humeurs. Elle ferme les yeux, les rouvre ; c’est l’heure où les cèdres du parc ont des reflets bleus. Une idée lui vient. Elle écrit aussitôt à son ami pour lui en faire part : il devrait fréquenter davantage le père Hugo.
Profitant d’une accalmie dans les tirades sadisantes de Flaubert, il prend congé en invoquant des travaux à terminer à l’Aquarium.
« À l’Aquarium ! s’exclame l’autre, hilare ; filez donc, ô grand déchireur des voiles de la nature, retournez parmi vos poissons, ô Bandole ! Mais jurez-moi de bien gamahucher votre harem de raies ! De foutre sans pitié les encornets ! Et de sodomiser une huître, pour l’amour de la science ! »
« À l’Aquarium ! s’exclame l’autre, hilare ; filez donc, ô grand déchireur des voiles de la nature, retournez parmi vos poissons, ô Bandole ! Mais jurez-moi de bien gamahucher votre harem de raies ! De foutre sans pitié les encornets ! Et de sodomiser une huître, pour l’amour de la science ! »
Mais c’est justement parce qu’elle est tolérable que la situation de Flaubert est atroce. Un malheur intolérable, on ne le tolère pas : au-delà d’un certain degré d’affliction, l’esprit s’éclipse dans la sidération, le délire ou le déni. Et puis, comme le désert a ses oasis, les grandes douleurs ont parfois d’étranges adoucissements – à commencer par cela même qu’elles sont, précisément, de « Grandes Douleurs ».
Rien de tel ici. Le malheur de Flaubert est tout à fait tolérable, en effet : usant, mesquin, et vaguement ridicule.
Rien de tel ici. Le malheur de Flaubert est tout à fait tolérable, en effet : usant, mesquin, et vaguement ridicule.
Quoique de vingt ans son aîné, l’homme qui vient de broyer sous ses yeux une carapace de homard n’a perdu à ce jour que trois dents ; on le sait, car il tient le registre exact des vicissitudes de sa denture. Hugo a donc perdu à peu près autant de dents que n’en compte la mâchoire supérieure de Flaubert.
Flaubert s’est toujours senti latin ; jeune, il se plaisait à croire qu’il avait, dans une existence antérieure, dirigé une troupe de comédiens ambulants sous le principat de Domitien. La guerre et la défaite de 1870 ont ancré plus profondément en lui la conscience de son appartenance à ce monde latin dont la victoire de la Prusse a précipité l’agonie. La Prusse : abominable combinaison de l’économie, du militarisme et de l’utilitarisme. Il n’y a plus de place pour les Latins dans un monde dominé par la Prusse, car être un Latin, c’est penser que la vie nécessite de grands allègements. C’est connaître la valeur de l’inutile.
Ce pays lui donne envie de peindre : le ciel ne ressemble pas, comme en Normandie, à un pot de chambre mal rincé, il est plus bleu, plus fin, plus vibrant; les couchers de soleil ont la douceur lumineuse des toiles de Claude Lorrain, et cette côte accidentée, plantée de pins noueux au travers desquels on devine la mer parsemée de rochers à fleur d'eau, rappelle les estampes japonaises que collectionne Goncourt. (p. 71)
Les Dernières Actualités
Voir plus

Tournée d'automne !...
fanfanouche24
19 livres

"L'idiot de la famille"
Alzie
29 livres
Autres livres de Alexandre Postel (4)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (2 - littérature francophone )
Françoise Sagan : "Le miroir ***"
brisé
fendu
égaré
perdu
20 questions
3667 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, littérature française
, littérature francophoneCréer un quiz sur ce livre3667 lecteurs ont répondu