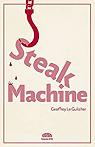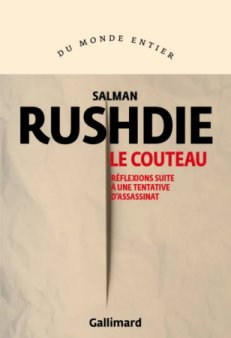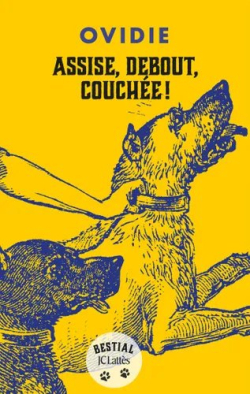Pascale-Dominique Russo/5
8 notes
Résumé :
Face à la toute-puissance du marché, l’économie sociale et solidaire jouit d’une aura précieuse et attire de nombreux talents. Or, ce secteur est à son tour affecté par une précarité croissante. Une pression démesurée s’exerce sur les salariés dont certains font des burn-out.
La fonction d’employeur est souvent un impensé de ces structures qui se vivent avant tout comme militantes. Très investis, les salariés peuvent avoir du mal à distinguer vie prof... >Voir plus
La fonction d’employeur est souvent un impensé de ces structures qui se vivent avant tout comme militantes. Très investis, les salariés peuvent avoir du mal à distinguer vie prof... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Souffrance en milieu engagéVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (6)
Voir plus
Ajouter une critique
MACIF, Emmaüs, Chorum, SOS, France Terre d'Asile… Certains noms, sigles, nous sont familiers, d'autres non. Tous sont les noms, sigles, d'entreprises ou d'associations relevant de l'économie sociale et solidaire.
Il est permis d'espérer que, pour être en accord avec les valeurs qu'elles défendent, ces entreprises ou associations soient "de bons patrons" attentifs aux conditions de travail, niveau de rémunération et droits de ses salariés.
Mais, selon ce vieil adage qui fait des cordonniers les plus mal chaussés, l'auteur qui a travaillé pour et écrit sur l'économie sociale et solidaire depuis plus de vingt ans, comme le rappelle la quatrième de couverture, Pascale-Dominique Russo, donc, nous dit que non.
Pour appuyer son propos, elle nous montre le revers de la médaille, l'envers du décor, les coulisses du salariat en milieu engagé.
Par une succession d'exemples, de témoignages et de situations concrètes au sein des entreprises et associations sus-mentionnées mais aussi de quelques autres, elle met en évidence les contradictions de cette économie qui veut être rentable pour rester sociale et solidaire mais, ce faisant, bascule dans une logique de rendement à tout prix qui ne déparerait pas dans une entreprise "classique" avec actionnaires et dividendes.
Et c'est le grand écart entre une volonté forte de porter des projets de réinsertion, d'accueil des migrants, de protection sociale complémentaire qui aient un sens et les conditions dans lesquelles ces projets sont montés puis mis en oeuvre.
Il y a déjà, dans les associations dont les conseils d'administration ne sont composés que de bénévoles, la difficulté pour ces derniers d'endosser le rôle de DRH.
Il y a également, comme une évidence, cette injonction pour le salarié à avoir un engagement équivalent à celui d'un bénévole, alors qu'ils ne peuvent évidemment s'investir dans leur travail de la même façon.
Avec l'entrée des associations dans le champ des appels d'offres qu'il faut décrocher à tout prix pour survivre, c'est la grande bascule vers une souffrance qui ne devrait pas y avoir sa place, des salariés payés au minimum, qui ne comptent pas leurs heures, font des burn-out et sont parfois licenciés au lance-pierre, quand ils ne partent pas en courant.
Ajoutons enfin que, pour obéir au diktat "too big to fail" bien connu des marchés boursiers, les associations, les mutuelles, se regroupent de gré ou de force en structures énormes, y perdant de leur âme et nombre de collaborateurs au passage.
Le milieu associatif n'est pas plus sanctuarisé que le milieu hospitalier et c'est bien dommage parce que dans un cas comme dans l'autre on finit toujours par s'en mordre les doigts.
Souvent trop tard.
Ne voir l'organisation, les fonctions, les missions, les services, les personnels qu'à travers le prisme de l'économie et du rendement est dévastateur pour les êtres et pour les mandats qui leur sont donnés par notre société aveugle.
Pascale-Dominique Russo dresse là le portrait d'un système qui ne fonctionne pas comme il le devrait.
Le constat est amer.
Travaillant moi-même depuis le siècle dernier ( !) dans la protection sociale, ayant vu cette régression des droits des salariés et de leurs conditions de travail au fil du temps, cette contradiction entre le message porté à l'extérieur et la politique de rendement dans les différents services, travailler plus au moindre coût, s'adapter aux réductions de budget et de personnel, toutes choses qui ont engendré une grande souffrance pour certains, de nombreuses difficultés pour tous autour de moi, j'ai reconnu bien des situations décrites par l'auteur ou par les intervenants auxquels elle donne la parole.
C'est un témoignage pris sur le vif, à l'instant T, qui pourrait servir de base à une vraie réflexion sur ce que nous voulons faire de nos bons sentiments, de nos convictions, et de la façon dont ils sont traduits en actions par le canal associatif et social.
Je remercie infiniment Pascale-Dominique Russo et les éditions du Faubourg pour leur confiance, et Babélio pour m'avoir permis cette lecture.
Il est permis d'espérer que, pour être en accord avec les valeurs qu'elles défendent, ces entreprises ou associations soient "de bons patrons" attentifs aux conditions de travail, niveau de rémunération et droits de ses salariés.
Mais, selon ce vieil adage qui fait des cordonniers les plus mal chaussés, l'auteur qui a travaillé pour et écrit sur l'économie sociale et solidaire depuis plus de vingt ans, comme le rappelle la quatrième de couverture, Pascale-Dominique Russo, donc, nous dit que non.
Pour appuyer son propos, elle nous montre le revers de la médaille, l'envers du décor, les coulisses du salariat en milieu engagé.
Par une succession d'exemples, de témoignages et de situations concrètes au sein des entreprises et associations sus-mentionnées mais aussi de quelques autres, elle met en évidence les contradictions de cette économie qui veut être rentable pour rester sociale et solidaire mais, ce faisant, bascule dans une logique de rendement à tout prix qui ne déparerait pas dans une entreprise "classique" avec actionnaires et dividendes.
Et c'est le grand écart entre une volonté forte de porter des projets de réinsertion, d'accueil des migrants, de protection sociale complémentaire qui aient un sens et les conditions dans lesquelles ces projets sont montés puis mis en oeuvre.
Il y a déjà, dans les associations dont les conseils d'administration ne sont composés que de bénévoles, la difficulté pour ces derniers d'endosser le rôle de DRH.
Il y a également, comme une évidence, cette injonction pour le salarié à avoir un engagement équivalent à celui d'un bénévole, alors qu'ils ne peuvent évidemment s'investir dans leur travail de la même façon.
Avec l'entrée des associations dans le champ des appels d'offres qu'il faut décrocher à tout prix pour survivre, c'est la grande bascule vers une souffrance qui ne devrait pas y avoir sa place, des salariés payés au minimum, qui ne comptent pas leurs heures, font des burn-out et sont parfois licenciés au lance-pierre, quand ils ne partent pas en courant.
Ajoutons enfin que, pour obéir au diktat "too big to fail" bien connu des marchés boursiers, les associations, les mutuelles, se regroupent de gré ou de force en structures énormes, y perdant de leur âme et nombre de collaborateurs au passage.
Le milieu associatif n'est pas plus sanctuarisé que le milieu hospitalier et c'est bien dommage parce que dans un cas comme dans l'autre on finit toujours par s'en mordre les doigts.
Souvent trop tard.
Ne voir l'organisation, les fonctions, les missions, les services, les personnels qu'à travers le prisme de l'économie et du rendement est dévastateur pour les êtres et pour les mandats qui leur sont donnés par notre société aveugle.
Pascale-Dominique Russo dresse là le portrait d'un système qui ne fonctionne pas comme il le devrait.
Le constat est amer.
Travaillant moi-même depuis le siècle dernier ( !) dans la protection sociale, ayant vu cette régression des droits des salariés et de leurs conditions de travail au fil du temps, cette contradiction entre le message porté à l'extérieur et la politique de rendement dans les différents services, travailler plus au moindre coût, s'adapter aux réductions de budget et de personnel, toutes choses qui ont engendré une grande souffrance pour certains, de nombreuses difficultés pour tous autour de moi, j'ai reconnu bien des situations décrites par l'auteur ou par les intervenants auxquels elle donne la parole.
C'est un témoignage pris sur le vif, à l'instant T, qui pourrait servir de base à une vraie réflexion sur ce que nous voulons faire de nos bons sentiments, de nos convictions, et de la façon dont ils sont traduits en actions par le canal associatif et social.
Je remercie infiniment Pascale-Dominique Russo et les éditions du Faubourg pour leur confiance, et Babélio pour m'avoir permis cette lecture.
Avec l'augmentation du nombre de salariés, les conditions de travail et d'emploi dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont désormais devenues un enjeu central pour l'identité de ce mouvement. En effet, les entreprises « ordinaires » à but lucratif se sont adaptées aux préoccupations de la société et entendent désormais, comme le dit l'article 1833 du Code civil révisé par la loi dite « PACTE » de 2019 : « prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux » de leur activité. Certaines vont même jusqu'à définir leur « raison d'être » dans leurs statuts. le temps où l'économiste Milton Friedman pouvait écrire que la seule responsabilité sociale de l'entreprise est de faire du profit relève clairement d'une autre configuration historique du capitalisme . de fait, les frontières entre le périmètre des entreprises consacrées par la loi de 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et les entreprises capitalistes s'érodent dangereusement en dépit des dénégations des forces historiques de l'économie sociale . Autrement dit, le temps où l'ESS se contentait d'invoquer ses valeurs fondatrices pour se différencier de l'économie de marché est révolu. Il lui faut désormais démontrer ses spécificités par les pratiques qu'elle organise. Ce n'est en effet pas le moindre des paradoxes de l'ESS que de se poser en alternative au tout marché quand, dans le même temps, la principale confédération patronale, l'union des employeurs de l'ESS, a apporté son soutien à toutes les réformes néolibérales du marché du travail : de la loi travail de 2016 à celle des retraites à point de 2020. Dans un contexte que certains qualifient de « guerre sociale » , l'ESS aurait-elle fini par se rallier au camp du capital ?
L'orée de la décennie 2010 avait été marquée par la création du syndicat ASSO (plusieurs syndiqué(e)s font d'ailleurs partie des personnes rencontrées par Pascale Dominique Russo), désormais affilié à l'Union syndicale Solidaires, qui entendait dénoncer la spécificité des conditions de travail à l'oeuvre dans le secteur associatif . La décennie 2020 s'ouvre avec la publication du livre rédigé par Pascale Dominique Russo. L'auteure est loin de découvrir l'ESS. Elle a en effet exercé pendant vingt ans le métier de journaliste spécialisé dans le secteur social et a été salariée de la mutuelle Chorum à partir de 2007 pour rédiger la newsletter du CIDES (Pôle de recherche ESS de la mutuelle) . Il s'agit donc d'un ouvrage documenté et s'appuyant sur de nombreux témoignages de salariés, syndiqués ou non, comme de représentants des directions des entreprises de l'ESS concernées. Seule la direction de la MACIF a refusé, par deux fois, les sollicitations de l'auteure. L'ouvrage Pascale Dominique Russo n'est donc pas un pamphlet à la manière d'un « livre noir de l'ESS » qui viendrait dénoncer des injustices. Comme elle l'indique en introduction, « l'origine du malaise que je cherche à mettre à jour ici est profonde et systémique » (p.21). Sans prétendre à l'exhaustivité, les situations décrites ne sont pas limitées aux seuls cas examinés. Certes, on pourrait reprocher à l'auteure de généraliser à partir d'organisations bien particulières. Compte tenu de l'ampleur du champ de l'ESS, l'auteure a en effet concentré son enquête auprès des mutuelles (Chorum et la MACIF) et du monde associatif (Groupe SOS, France Terre d'Asile, Emmaüs France, Emmaüs international et Emmaüs Solidarité). Ceci-dit, bien d'autres exemples, comme la Croix-Rouge, sanctionnée par l'inspection du travail en 2015 , ou la Sauvegarde du Nord, dont la fusion avec l'ADSSEAD (Association de Services Spécialisés pour Enfants et Adolescents en Difficulté) a engendré une dégradation des conditions de travail des travailleurs sociaux oeuvrant dans la protection de l'enfance , auraient ainsi pu être convoqués. En outre, Pascale Dominique Russo indique clairement son attachement aux organisations de l'ESS et elle ne souhaite pas les voir disparaître. Loin d'être un pamphlet sans nuance, son livre doit donc être compris comme un appel à renouer avec les valeurs originelles afin de « participer à un renouveau de la démocratie en entreprise » (p.23).
L'ouvrage est organisé en trois parties : les dérives hiérarchiques et autoritaires y sont tout d'abord évoquées en contrepoint de l'idéal démocratique revendiqué par l'ESS. On y apprend ainsi que le délégué général de France Terre d'Asile est en poste depuis vingt-trois ans et que le conseil d'administration est soigneusement mis à l'écart des négociations sur l'organisation du travail puisqu'il n'a pas « à se substituer évidemment à la partie opérationnelle » comme l'indique la direction générale. L'ouvrage rappelle que l'association France Terre d'Asile a été condamnée en juillet 2017 par les prud'hommes de Paris à verser à son ancienne directrice de l'accompagnement et de l'hébergement des demandeurs d'asile : 15 000 euros de dommages et intérêts pour « harcèlement moral » et 38 000 euros pour « licenciement nul ». L'institution a ainsi pointé « des pratiques managériales humiliantes, une mise à l'écart, des attitudes persécutrices ayant eu pour conséquence d'altérer la santé physique et mentale de la salariée » (p.44-45). Dans un autre registre, le Groupe SOS, composé de trois associations fondatrices : SOS Drogue international (1984), SOS Habitat et soins (1985) et SOS Insertion et alternatives (1995), se singularise par une stratégie de concentration organisationnelle qui pratique l'évitement des « effets de seuil » imposés par la législation des institutions représentatives du personnel. Bien que la cellule « commerce et services » comprenne 400 salariés, elle est organisée en entités de 50 salariés afin qu'il n'y ait pas délégué syndical selon l'un des anciens salariés interrogés. Par ailleurs, en dépit de son discours humaniste, le groupe SOS se conforme aux pratiques managériales ordinaires et son organisation verticale est « finalement d'une facture très classique » (p.52).
Le second chapitre, intitulé « au nom de la concurrence, tout semble permis », met en lumière les logiques de concentration à l'oeuvre dans le domaine des mutuelles et les nouvelles formes de financement du monde associatif qui se rapprochent davantage du marché public que de la subvention. Cette intensification des logiques concurrentielles a des effets manifestes sur la manière dont les entreprises de l'ESS organisent leurs relations sociales. Dans le cas de la MACIF , Pascale Dominique Russo note que la transformation managériale, engendrée par le projet de fusion avec AESIO (une mutuelle dédiée à la santé et à la prévoyance), a été réalisée « à la hussarde » : « le tournant a été mal préparé et le rythme des changements est trop soutenu, comme l'indiquent les auteur [d'une étude réalisée à la demande du CHSCT] : les plans se sont succédés pendant cinq ans, la demande de rentabilité commerciale devenant l'alpha et l'oméga des directions. le conseil d'administration dans sa presque totalité y ayant donné son aval » (p.74). Comme le note Pascale Dominique Russo, la MACIF n'est pas un cas isolé. La plupart des mutuelles sont concernées par ce processus de concentration comme l'indique l'auteure : en 2006, on recensait 1 200 mutuelles dans le domaine de la protection sociale complémentaire contre 400 en 2019. D'où cette interrogation formulée par l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF) : « le passage du code de la mutualité au code de l'assurance n'a-t-il pas jeté aux oubliettes le principe fondateur des mutuelles, un homme égale une voix, et n'a-t-il pas renforcé par la même l'hégémonie des grosses mutuelles ? » (p.84). Dans le monde associatif, la concentration est également un processus à l'oeuvre. le cas de deux associations de la Gironde, MANA et ALEMA (Accueil loisir enfant de Martignas-sur-Jalle), toutes deux absorbées par le Groupe SOS, est exemplaire. Pour ces deux associations, l'intégration au sein du groupe s'est traduite par une reprise en main de la gouvernance, avec la constitution d'un nouveau C.A dont les membres ont été nommés par le groupe SOS, et une rigidification des rapports hiérarchiques avec une standardisation des procédures de travail. Pascale Dominique Russo ne s'étant pas limitée aux témoignages critiques à l'encontre de SOS, les justifications données par le service de communication s'avèrent tout à fait instructives. Selon ce dernier, ce sont les directions des organisations qui font appel à eux “pour pouvoir s'adosser à une organisation outillée afin de leur permettre de pallier les difficultés qu'elles rencontrent ou pour maximiser leur développement”. le contrat serait d'emblée clair, “La décision est prise en toute connaissance de cause. L'association est informée des conséquences d'une intégration et du mode de fonctionnement de notre groupe” » (p.107). Les cas de France Terre d'Asile, d'Emmaüs Solidarité et des Missions locales montrent ensuite que la concurrence organisée par la puissance publique peut prendre des formes plus ou moins radicales selon les secteurs et l'identité des groupements qui disposent de plus ou de moins de ressources pour en limiter les effets. Néanmoins, tout se passe comme si le modèle associatif, disposant de ressources publiques stables par la subvention et contribuant à l'extension des missions de l'État social, était derrière nous.
Enfin, le troisième chapitre pointe les écarts entre les discours de promotion de l'ESS, qui insistent sur le registre du « sens » et de « l'accord avec ses valeurs », et la réalité des conditions de travail. le récit des déconvenues salariales est ainsi tout à fait révélateur de l'enrôlement au travail par les valeurs. A cet égard, le témoignage d'une ex-chargée de communication du Groupe SOS est exemplaire : « la pratique la plus courante est la rémunération au SMIC, quelque soit le niveau d'études du candidat. Nos interlocuteurs invoquent l'éthique de l'entreprise. L'économie sociale et solidaire a bon dos ! À SOS, en 2014, on est passés de 19 000 € bruts annuels pour les “petits salariés” dont je faisais partie, à 40 000 euros et plus pour les responsables nous dépendions. Il n'y a pas de grille de salaires et aucune négociation n'est possible. » (p.135). La réponse du service communication, rapportée par l'auteure, balaie l'objection : « sur 18 000 collaborateurs, il est normal que certains ne trouve pas leur bonheur, d'autant plus que dans le champ de l'intérêt général, on observe une surreprésentation de candidats qui idéalisent le secteur et peuvent être déçu par les contraintes et l'exigence de nos organisations, alors même que nous avons une responsabilité de bonne gestion, d'efficience et d'impact, auprès de nos partenaires et surtout de nos usagers bénéficiaire » SOS affirme faire évoluer « ces jeunes collaborateurs et responsabiliser très tôt l'expertise des jeunes cadres » (p.136). Or, la question salariale est loin d'être anecdotique. Et de nombreux travaux académiques ont mis en évidence le différentiel significatif existant dans les rémunérations entre individus partageant des caractéristiques identiques en termes d'expériences, de qualifications et de postes de travail . Or, comment l'ESS pourrait-elle envisager convertir le capitalisme à ses « bonnes pratiques » sans aborder sérieusement l'enjeu de la rémunération. En renonçant à interroger sérieusement les fondements de la valeur économique et en reprenant, à bon compte, la morale sacrificielle du « don de soi », l'ESS se condamne elle-même à demeurer une « économie dominée dans une économie dominante » comme nous l'avions écrit avec Pascale Moulévrier .
Dans sa conclusion, Pascale Dominique Russo n'adopte pas une posture dénonciatrice qui aurait consisté à stigmatiser les pratiques de telle ou telle organisation. En effet, au-delà de l'amélioration des formes d'organisation du travail, c'est bien le « contexte » concurrentiel dans lequel évoluent les organisations de l'ESS qui conduit aux pratiques décrites avec rigueur dans l'ouvrage. Faute de remettre en cause ce cadre, des alternatives existent pour mieux réguler les conflits comme donner une voix délibérative dans les conseils d'administration aux représentations des institutions représentatives du personnel ou développer des outils de prévention des risques. A cet égard, des initiatives existent, comme le recours à la médiation en cas de conflits , autant de pratiques qui, si elles étaient mises en oeuvre, favoriseraient une mise en conformité des entreprises de l'ESS avec les valeurs qu'elles proclament. Ce qui, à l'heure de la loi PACTE et de la promotion des « sociétés à mission », constituerait une voie de sortie par le haut à la crise d'identité que traverse l'ESS. Quoiqu'il en soit, l'ouvrage de Pascale Dominique Russo aura contribué, en proposant de regarder sans fard l'ESS telle qu'elle est, à poser les bases d'une prise de conscience lucide des contradictions à l'oeuvre et à pointer quelques solutions pour les résoudre. Les institutions de l'ESS, et en particulier les organisations patronales, pourront choisir de l'ignorer. Mais ce serait alors au prix d'une dissolution des « spécificités » de l'ESS dans les eaux glacées du néolibéralisme.
Lien : https://institut-isbl.fr/sou..
L'orée de la décennie 2010 avait été marquée par la création du syndicat ASSO (plusieurs syndiqué(e)s font d'ailleurs partie des personnes rencontrées par Pascale Dominique Russo), désormais affilié à l'Union syndicale Solidaires, qui entendait dénoncer la spécificité des conditions de travail à l'oeuvre dans le secteur associatif . La décennie 2020 s'ouvre avec la publication du livre rédigé par Pascale Dominique Russo. L'auteure est loin de découvrir l'ESS. Elle a en effet exercé pendant vingt ans le métier de journaliste spécialisé dans le secteur social et a été salariée de la mutuelle Chorum à partir de 2007 pour rédiger la newsletter du CIDES (Pôle de recherche ESS de la mutuelle) . Il s'agit donc d'un ouvrage documenté et s'appuyant sur de nombreux témoignages de salariés, syndiqués ou non, comme de représentants des directions des entreprises de l'ESS concernées. Seule la direction de la MACIF a refusé, par deux fois, les sollicitations de l'auteure. L'ouvrage Pascale Dominique Russo n'est donc pas un pamphlet à la manière d'un « livre noir de l'ESS » qui viendrait dénoncer des injustices. Comme elle l'indique en introduction, « l'origine du malaise que je cherche à mettre à jour ici est profonde et systémique » (p.21). Sans prétendre à l'exhaustivité, les situations décrites ne sont pas limitées aux seuls cas examinés. Certes, on pourrait reprocher à l'auteure de généraliser à partir d'organisations bien particulières. Compte tenu de l'ampleur du champ de l'ESS, l'auteure a en effet concentré son enquête auprès des mutuelles (Chorum et la MACIF) et du monde associatif (Groupe SOS, France Terre d'Asile, Emmaüs France, Emmaüs international et Emmaüs Solidarité). Ceci-dit, bien d'autres exemples, comme la Croix-Rouge, sanctionnée par l'inspection du travail en 2015 , ou la Sauvegarde du Nord, dont la fusion avec l'ADSSEAD (Association de Services Spécialisés pour Enfants et Adolescents en Difficulté) a engendré une dégradation des conditions de travail des travailleurs sociaux oeuvrant dans la protection de l'enfance , auraient ainsi pu être convoqués. En outre, Pascale Dominique Russo indique clairement son attachement aux organisations de l'ESS et elle ne souhaite pas les voir disparaître. Loin d'être un pamphlet sans nuance, son livre doit donc être compris comme un appel à renouer avec les valeurs originelles afin de « participer à un renouveau de la démocratie en entreprise » (p.23).
L'ouvrage est organisé en trois parties : les dérives hiérarchiques et autoritaires y sont tout d'abord évoquées en contrepoint de l'idéal démocratique revendiqué par l'ESS. On y apprend ainsi que le délégué général de France Terre d'Asile est en poste depuis vingt-trois ans et que le conseil d'administration est soigneusement mis à l'écart des négociations sur l'organisation du travail puisqu'il n'a pas « à se substituer évidemment à la partie opérationnelle » comme l'indique la direction générale. L'ouvrage rappelle que l'association France Terre d'Asile a été condamnée en juillet 2017 par les prud'hommes de Paris à verser à son ancienne directrice de l'accompagnement et de l'hébergement des demandeurs d'asile : 15 000 euros de dommages et intérêts pour « harcèlement moral » et 38 000 euros pour « licenciement nul ». L'institution a ainsi pointé « des pratiques managériales humiliantes, une mise à l'écart, des attitudes persécutrices ayant eu pour conséquence d'altérer la santé physique et mentale de la salariée » (p.44-45). Dans un autre registre, le Groupe SOS, composé de trois associations fondatrices : SOS Drogue international (1984), SOS Habitat et soins (1985) et SOS Insertion et alternatives (1995), se singularise par une stratégie de concentration organisationnelle qui pratique l'évitement des « effets de seuil » imposés par la législation des institutions représentatives du personnel. Bien que la cellule « commerce et services » comprenne 400 salariés, elle est organisée en entités de 50 salariés afin qu'il n'y ait pas délégué syndical selon l'un des anciens salariés interrogés. Par ailleurs, en dépit de son discours humaniste, le groupe SOS se conforme aux pratiques managériales ordinaires et son organisation verticale est « finalement d'une facture très classique » (p.52).
Le second chapitre, intitulé « au nom de la concurrence, tout semble permis », met en lumière les logiques de concentration à l'oeuvre dans le domaine des mutuelles et les nouvelles formes de financement du monde associatif qui se rapprochent davantage du marché public que de la subvention. Cette intensification des logiques concurrentielles a des effets manifestes sur la manière dont les entreprises de l'ESS organisent leurs relations sociales. Dans le cas de la MACIF , Pascale Dominique Russo note que la transformation managériale, engendrée par le projet de fusion avec AESIO (une mutuelle dédiée à la santé et à la prévoyance), a été réalisée « à la hussarde » : « le tournant a été mal préparé et le rythme des changements est trop soutenu, comme l'indiquent les auteur [d'une étude réalisée à la demande du CHSCT] : les plans se sont succédés pendant cinq ans, la demande de rentabilité commerciale devenant l'alpha et l'oméga des directions. le conseil d'administration dans sa presque totalité y ayant donné son aval » (p.74). Comme le note Pascale Dominique Russo, la MACIF n'est pas un cas isolé. La plupart des mutuelles sont concernées par ce processus de concentration comme l'indique l'auteure : en 2006, on recensait 1 200 mutuelles dans le domaine de la protection sociale complémentaire contre 400 en 2019. D'où cette interrogation formulée par l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF) : « le passage du code de la mutualité au code de l'assurance n'a-t-il pas jeté aux oubliettes le principe fondateur des mutuelles, un homme égale une voix, et n'a-t-il pas renforcé par la même l'hégémonie des grosses mutuelles ? » (p.84). Dans le monde associatif, la concentration est également un processus à l'oeuvre. le cas de deux associations de la Gironde, MANA et ALEMA (Accueil loisir enfant de Martignas-sur-Jalle), toutes deux absorbées par le Groupe SOS, est exemplaire. Pour ces deux associations, l'intégration au sein du groupe s'est traduite par une reprise en main de la gouvernance, avec la constitution d'un nouveau C.A dont les membres ont été nommés par le groupe SOS, et une rigidification des rapports hiérarchiques avec une standardisation des procédures de travail. Pascale Dominique Russo ne s'étant pas limitée aux témoignages critiques à l'encontre de SOS, les justifications données par le service de communication s'avèrent tout à fait instructives. Selon ce dernier, ce sont les directions des organisations qui font appel à eux “pour pouvoir s'adosser à une organisation outillée afin de leur permettre de pallier les difficultés qu'elles rencontrent ou pour maximiser leur développement”. le contrat serait d'emblée clair, “La décision est prise en toute connaissance de cause. L'association est informée des conséquences d'une intégration et du mode de fonctionnement de notre groupe” » (p.107). Les cas de France Terre d'Asile, d'Emmaüs Solidarité et des Missions locales montrent ensuite que la concurrence organisée par la puissance publique peut prendre des formes plus ou moins radicales selon les secteurs et l'identité des groupements qui disposent de plus ou de moins de ressources pour en limiter les effets. Néanmoins, tout se passe comme si le modèle associatif, disposant de ressources publiques stables par la subvention et contribuant à l'extension des missions de l'État social, était derrière nous.
Enfin, le troisième chapitre pointe les écarts entre les discours de promotion de l'ESS, qui insistent sur le registre du « sens » et de « l'accord avec ses valeurs », et la réalité des conditions de travail. le récit des déconvenues salariales est ainsi tout à fait révélateur de l'enrôlement au travail par les valeurs. A cet égard, le témoignage d'une ex-chargée de communication du Groupe SOS est exemplaire : « la pratique la plus courante est la rémunération au SMIC, quelque soit le niveau d'études du candidat. Nos interlocuteurs invoquent l'éthique de l'entreprise. L'économie sociale et solidaire a bon dos ! À SOS, en 2014, on est passés de 19 000 € bruts annuels pour les “petits salariés” dont je faisais partie, à 40 000 euros et plus pour les responsables nous dépendions. Il n'y a pas de grille de salaires et aucune négociation n'est possible. » (p.135). La réponse du service communication, rapportée par l'auteure, balaie l'objection : « sur 18 000 collaborateurs, il est normal que certains ne trouve pas leur bonheur, d'autant plus que dans le champ de l'intérêt général, on observe une surreprésentation de candidats qui idéalisent le secteur et peuvent être déçu par les contraintes et l'exigence de nos organisations, alors même que nous avons une responsabilité de bonne gestion, d'efficience et d'impact, auprès de nos partenaires et surtout de nos usagers bénéficiaire » SOS affirme faire évoluer « ces jeunes collaborateurs et responsabiliser très tôt l'expertise des jeunes cadres » (p.136). Or, la question salariale est loin d'être anecdotique. Et de nombreux travaux académiques ont mis en évidence le différentiel significatif existant dans les rémunérations entre individus partageant des caractéristiques identiques en termes d'expériences, de qualifications et de postes de travail . Or, comment l'ESS pourrait-elle envisager convertir le capitalisme à ses « bonnes pratiques » sans aborder sérieusement l'enjeu de la rémunération. En renonçant à interroger sérieusement les fondements de la valeur économique et en reprenant, à bon compte, la morale sacrificielle du « don de soi », l'ESS se condamne elle-même à demeurer une « économie dominée dans une économie dominante » comme nous l'avions écrit avec Pascale Moulévrier .
Dans sa conclusion, Pascale Dominique Russo n'adopte pas une posture dénonciatrice qui aurait consisté à stigmatiser les pratiques de telle ou telle organisation. En effet, au-delà de l'amélioration des formes d'organisation du travail, c'est bien le « contexte » concurrentiel dans lequel évoluent les organisations de l'ESS qui conduit aux pratiques décrites avec rigueur dans l'ouvrage. Faute de remettre en cause ce cadre, des alternatives existent pour mieux réguler les conflits comme donner une voix délibérative dans les conseils d'administration aux représentations des institutions représentatives du personnel ou développer des outils de prévention des risques. A cet égard, des initiatives existent, comme le recours à la médiation en cas de conflits , autant de pratiques qui, si elles étaient mises en oeuvre, favoriseraient une mise en conformité des entreprises de l'ESS avec les valeurs qu'elles proclament. Ce qui, à l'heure de la loi PACTE et de la promotion des « sociétés à mission », constituerait une voie de sortie par le haut à la crise d'identité que traverse l'ESS. Quoiqu'il en soit, l'ouvrage de Pascale Dominique Russo aura contribué, en proposant de regarder sans fard l'ESS telle qu'elle est, à poser les bases d'une prise de conscience lucide des contradictions à l'oeuvre et à pointer quelques solutions pour les résoudre. Les institutions de l'ESS, et en particulier les organisations patronales, pourront choisir de l'ignorer. Mais ce serait alors au prix d'une dissolution des « spécificités » de l'ESS dans les eaux glacées du néolibéralisme.
Lien : https://institut-isbl.fr/sou..
Livre de la collection Documents reçu des éditions du faubourg dans le cadre d'une opération masse critique de Babelio, merci à Sophie Caillat qui me l'a fait parvenir. Ce livre est le résultat d'une enquête journalistique de Pascale-Dominique Russo sur des entreprises de l'ESS (Économie Sociale et Solidaire) qui en 2016 employaient 2,4 millions de salariés.
Cette enquête est très bien documentée sur trois grandes associations que sont : France terre d'asile, Emmaüs, le groupe SOS et des groupements mutualistes.
Elle nous montrent à l'appui de nombreux témoignages la complexité du positionnement de leurs salariés. La description de leur souffrance au travail qui est fortement accentuée par les contradictions fortes entre les valeurs affichées, les formes statutaires (associatives ou mutualistes) et l'objet à caractère social de leurs employeurs.
l'enquête nous introduit progressivement dans les évolutions respectives de ses organisations.
Leurs similitudes sont de croître continuellement en s'alimentant des appels d'offres des pouvoirs publics. Leurs dissemblances tiennent à leurs histoires, à leurs gouvernances et à leurs choix politiques que l'auteure nous décrit pour chacune d'elles.
Leur adaptation achoppe plus ou moins laborieusement à respecter des valeurs de l'économie sociale et solidaire. C'est à cet endroit que je trouve l'ouvrage fragile dans sa description trop légère de l'économie sociale.
Cet aspect regrettablement succinct de l'ouvrage élude les différences profondes entre l'économie sociale et l' entrepreneuriat social par exemple. L'une se situant dans une réelle alternative au capitalisme (« groupement de personnes,double qualité, mouvement social, économie a-capitaliste, émancipation ») tandis que l'autre est régie par une logique de marché. Une conception ayant manifestement pris le pas sur l'autre comme nous le montre dans ce livre, l'exemple du groupe SOS dont le dirigeant a présidé au Mouves (Mouvement des entrepreneurs sociaux).
Cet aspect fondamental des postures théoriques qui pré-existent à une démarche de l'économie sociale et solidaire est trop souvent supprimé des analyses sur le sujet.
Sans être le sujet de l'ouvrage, l'auteure affleure aussi de manière intéressante, la multiplication des emplois avec une dimension sociale et une faible qualification. Aussi, une lecture en creux permet de réaliser que le travail social est un véritable métier. En effet, une formation à la relation d'aide permet de travailler le positionnement des salariés et une meilleure distanciation entre l'engagement et sa fonction. Mieux préparés aux affres que rencontrent les salariés embauchés par les structures de l'ESS, les travailleurs sociaux sont assez absents de l'ouvrage. Sur le contexte politique de l'évolution des structures de l'ESS, cette lecture dépolitise regrettablement le sujet. l'ouvrage note néanmoins que les organismes de l'ESS sont devenus des prestataires des politiques publiques et non plus des partenaires de la construction des politiques sociales.
Ainsi, j'apprécie que l'auteure puisse porter la parole des salariés et de leurs souffrances au travail. Les témoignages à l'appui de la recherche documentaire véhiculent un discours qui mérite de réinterroger l'économie sociale de manière générale et le travail social.
Cette enquête est très bien documentée sur trois grandes associations que sont : France terre d'asile, Emmaüs, le groupe SOS et des groupements mutualistes.
Elle nous montrent à l'appui de nombreux témoignages la complexité du positionnement de leurs salariés. La description de leur souffrance au travail qui est fortement accentuée par les contradictions fortes entre les valeurs affichées, les formes statutaires (associatives ou mutualistes) et l'objet à caractère social de leurs employeurs.
l'enquête nous introduit progressivement dans les évolutions respectives de ses organisations.
Leurs similitudes sont de croître continuellement en s'alimentant des appels d'offres des pouvoirs publics. Leurs dissemblances tiennent à leurs histoires, à leurs gouvernances et à leurs choix politiques que l'auteure nous décrit pour chacune d'elles.
Leur adaptation achoppe plus ou moins laborieusement à respecter des valeurs de l'économie sociale et solidaire. C'est à cet endroit que je trouve l'ouvrage fragile dans sa description trop légère de l'économie sociale.
Cet aspect regrettablement succinct de l'ouvrage élude les différences profondes entre l'économie sociale et l' entrepreneuriat social par exemple. L'une se situant dans une réelle alternative au capitalisme (« groupement de personnes,double qualité, mouvement social, économie a-capitaliste, émancipation ») tandis que l'autre est régie par une logique de marché. Une conception ayant manifestement pris le pas sur l'autre comme nous le montre dans ce livre, l'exemple du groupe SOS dont le dirigeant a présidé au Mouves (Mouvement des entrepreneurs sociaux).
Cet aspect fondamental des postures théoriques qui pré-existent à une démarche de l'économie sociale et solidaire est trop souvent supprimé des analyses sur le sujet.
Sans être le sujet de l'ouvrage, l'auteure affleure aussi de manière intéressante, la multiplication des emplois avec une dimension sociale et une faible qualification. Aussi, une lecture en creux permet de réaliser que le travail social est un véritable métier. En effet, une formation à la relation d'aide permet de travailler le positionnement des salariés et une meilleure distanciation entre l'engagement et sa fonction. Mieux préparés aux affres que rencontrent les salariés embauchés par les structures de l'ESS, les travailleurs sociaux sont assez absents de l'ouvrage. Sur le contexte politique de l'évolution des structures de l'ESS, cette lecture dépolitise regrettablement le sujet. l'ouvrage note néanmoins que les organismes de l'ESS sont devenus des prestataires des politiques publiques et non plus des partenaires de la construction des politiques sociales.
Ainsi, j'apprécie que l'auteure puisse porter la parole des salariés et de leurs souffrances au travail. Les témoignages à l'appui de la recherche documentaire véhiculent un discours qui mérite de réinterroger l'économie sociale de manière générale et le travail social.
Je remercie @Babelio et les @Editions du Faubourg Documents de m'avoir permis, dans le cadre de Masse critique Non fiction de lire l'enquête très fouillée de @Pascale-Dominique Russo intitulée "Souffrance en milieu engagé".
A première vue, le titre du livre peut sembler contradictoire. Comment les salariés d'entreprises sociales pourraient être "maltraités" au travail? Entre autres parce qu'avec le temps, leur mode de fonctionnement a évolué vers une organisation répondant davantage à l'économie de marché, à la rentabilité, parfois au détriment de sa mission première, celle pour laquelle ses salariés se sont engagés, corps et âme...
C'est ce système déviant que décrit le livre, riche d'exemples pris dans différents type de structures.
Très technique, ce livre aurait peut-être eu utilement un petit glossaire et quelques schémas expliquant les organigrammes, ce qui en aurait facilité la lecture.
Il n'en reste pas moins intéressant et révélateur d'une situation que beaucoup n'imaginent pas... Espérons qu'il sera lu par celles et ceux qui permettront d'améliorer la situation de ces salariés sincèrement investis dans les causes qu'ils défendent au détriment de leur propre santé.
A première vue, le titre du livre peut sembler contradictoire. Comment les salariés d'entreprises sociales pourraient être "maltraités" au travail? Entre autres parce qu'avec le temps, leur mode de fonctionnement a évolué vers une organisation répondant davantage à l'économie de marché, à la rentabilité, parfois au détriment de sa mission première, celle pour laquelle ses salariés se sont engagés, corps et âme...
C'est ce système déviant que décrit le livre, riche d'exemples pris dans différents type de structures.
Très technique, ce livre aurait peut-être eu utilement un petit glossaire et quelques schémas expliquant les organigrammes, ce qui en aurait facilité la lecture.
Il n'en reste pas moins intéressant et révélateur d'une situation que beaucoup n'imaginent pas... Espérons qu'il sera lu par celles et ceux qui permettront d'améliorer la situation de ces salariés sincèrement investis dans les causes qu'ils défendent au détriment de leur propre santé.
Pascale-Dominique Russo connait bien les rouages galvanisés de l'économie sociale et solidaire (ESS). Après avoir écrit pendant plus de vingt ans pour des organisations dites engagées, elle a ressenti le besoin de tirer la sonnette d'alarme et de lever le voile sur des pratiques managériales à mille lieux des engagements portés à bout de bras ; sur des directions abusives qui imposent des rythmes de travail harassants, aux antipodes des valeurs qu'elles se targuent d'incarner. Il est vrai que l''ESS tient le beau rôle face aux multinationales et à leurs pratiques salariales désastreuses. En apparence démocratiques, les entreprises et organisations solidaires sont pourtant en proie aux mêmes démons : précarité, exploitation et harcèlement des salariés sont monnaie courante dans le milieu. Outrée par le gouffre qui sépare les grands discours des agissements de l'ombre, l'autrice a collecté de nombreux témoignages, multipliant les exemples pour démontrer que les abus ne sont pas isolés mais bien systémiques. Emmaüs, France Terre d'Asile ou la MACIF par exemple sont pointés du doigt pour leurs politiques internes qui engendrent une souffrance salariale méconnue, maintenant les travailleurs sous une chape silencieuse, bien loin des Conseils d'Administration réservés à une petite élite.
Malgré une première partie un peu trop pointue et obscure à mon sens, ainsi qu'une technicité qui peut rebuter, l'ouvrage de Pascale-Dominique Russo reflète un travail d'investigation minutieux qui ouvre le débat sur la crédibilité et la pertinence des institutions sensées oeuvrer pour le bien, qui broient silencieusement leurs salariés sur l'autel de la productivité. En révélant ces conditions de travail catastrophiques, l'autrice se fait la voix de tous ces étouffés d'un système aux 2.5 millions de travailleurs, système en apparence vertueux et idyllique vraisemblablement infiltré par les vers de la corruption et du profit.
Malgré une première partie un peu trop pointue et obscure à mon sens, ainsi qu'une technicité qui peut rebuter, l'ouvrage de Pascale-Dominique Russo reflète un travail d'investigation minutieux qui ouvre le débat sur la crédibilité et la pertinence des institutions sensées oeuvrer pour le bien, qui broient silencieusement leurs salariés sur l'autel de la productivité. En révélant ces conditions de travail catastrophiques, l'autrice se fait la voix de tous ces étouffés d'un système aux 2.5 millions de travailleurs, système en apparence vertueux et idyllique vraisemblablement infiltré par les vers de la corruption et du profit.
Citations et extraits (7)
Voir plus
Ajouter une citation
Sandra Diaz, à Emmaüs Solidarité, a perçu un penchant similaire dans les années 2010 : "Les élus comme la direction se disaient militants, contrairement aux salariés lambda. C'était très violent car cela revient à une appropriation symbolique de l'association et de ses combats par ceux qui ont le pouvoir et c'est une négation de la valeur et du sens du travail des collaborateurs".
Mélanie Olivier dit avoir entendu des arguments équivalents à Emmnaüs international. « Lorsque nous demandions des jours de récupération pour avoir travaillé un week-end, on se les voyait parfois refuser. Si on essayait d'appliquer les règles de récupération prévues, nous sentions une remise en cause de notre engagement qui nous déstabilisait. On nous rappelait qu'on travaillait pour des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'ont pas accès à l'eau potable... En réalité, je pense qu'on est en plein délire quand on fait ce type de comparaison. » Dans ce contexte, plusieurs collaborateurs d'Emmaüs international ont voulu fonder une section syndicale. Ils ont contacté d'autres syndicats du groupe qui les avaient soutenus, notamment en diffusant un tract sur la situation du personnel de l'association. "Finalement nous y avons renoncé par peur des représailles", conclut Mélanie Olivier qui ne comprend toujours pas "pourquoi Emmaüs, qui défend l'accès aux droits fondamentaux, ne défend pas de la même manière le droit du travail".
Mélanie Olivier dit avoir entendu des arguments équivalents à Emmnaüs international. « Lorsque nous demandions des jours de récupération pour avoir travaillé un week-end, on se les voyait parfois refuser. Si on essayait d'appliquer les règles de récupération prévues, nous sentions une remise en cause de notre engagement qui nous déstabilisait. On nous rappelait qu'on travaillait pour des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'ont pas accès à l'eau potable... En réalité, je pense qu'on est en plein délire quand on fait ce type de comparaison. » Dans ce contexte, plusieurs collaborateurs d'Emmaüs international ont voulu fonder une section syndicale. Ils ont contacté d'autres syndicats du groupe qui les avaient soutenus, notamment en diffusant un tract sur la situation du personnel de l'association. "Finalement nous y avons renoncé par peur des représailles", conclut Mélanie Olivier qui ne comprend toujours pas "pourquoi Emmaüs, qui défend l'accès aux droits fondamentaux, ne défend pas de la même manière le droit du travail".
Les paramètres ne sont évidemment pas les mêmes entre l'univers de la solidarité d'Emmaüs et I'environnement social business du groupe SOS. Partout, cependant, des salariés croient pouvoir modifier le cours des choses, comme le raconte Sarah Meyer: "II arrive que des jeunes soient propulsés rapidement à des postes à responsabilité et qu'ils se sentent pousser des ailes. Cette confance les motive et ils ont envie de se battre pour les valeurs mises en avant par la direction de SOS. C'est gratifiant."
Isabelle Motto-Ros se souvient comment, par son attitude, elle a contribué à son propre épuisement professionnel: « Ce qui nous intéresse avant tout, c'est de faire bouger les lignes. La pression, on se la met tout seul. On bosse pour un monde meilleur. Notre pire ennemi, c'est notre envie de changer le monde. On s'évertue à porter sur notre dos cette aspiration alors que ce n'est pas nous qui changeons le monde, c'est lui qui nous change!"
Amel Crisci décrit une atmosphère détendue mais qui, à ses yeux, peut être facilement brisée: "On nous laisse croire que l'on est tous copains, c'est la grande famille. Et du jour au lendemain, quand on demande par exemple à avoir une évolution dans son poste, on peut s'entendre dire " Oui, je suis d'accord pour te faire évoluer si tu baisses ton salaire de 30%. Il y a d'autres personnes qui gagnent 1300€ avec un bac +5, alors tu n'as qu'à aller voir ailleurs". Beaucoup de collègues ont entendu ce propos et, n'arrivant plus à joindre les deux bouts, ont quitté le groupe ".
Isabelle Motto-Ros se souvient comment, par son attitude, elle a contribué à son propre épuisement professionnel: « Ce qui nous intéresse avant tout, c'est de faire bouger les lignes. La pression, on se la met tout seul. On bosse pour un monde meilleur. Notre pire ennemi, c'est notre envie de changer le monde. On s'évertue à porter sur notre dos cette aspiration alors que ce n'est pas nous qui changeons le monde, c'est lui qui nous change!"
Amel Crisci décrit une atmosphère détendue mais qui, à ses yeux, peut être facilement brisée: "On nous laisse croire que l'on est tous copains, c'est la grande famille. Et du jour au lendemain, quand on demande par exemple à avoir une évolution dans son poste, on peut s'entendre dire " Oui, je suis d'accord pour te faire évoluer si tu baisses ton salaire de 30%. Il y a d'autres personnes qui gagnent 1300€ avec un bac +5, alors tu n'as qu'à aller voir ailleurs". Beaucoup de collègues ont entendu ce propos et, n'arrivant plus à joindre les deux bouts, ont quitté le groupe ".
Alain Pellé confirme la situation complexe dans laquelle se pense et se meut le collaborateur-type du monde associatif: «Il se vit dans le registre de l'engagement et du bénévolat et non pas en tant quexpert. Il est dans l'affect. Il
adhère aux valeurs, il accepte beaucoup en raison du chantage affectif sur la noblesse de la cause que les directions savent faire passer.» L'idée même d'une représentation des salariés n'est pas nécessairement bienvenue, considérée comme un sujet hors champ. Du côté des employeurs, analyse le secrétaire général du SMA-CFDT, «il est difficile de concéder des lieux pour le dialogue social, d'accepter la constitution d'institutions représentatives du personnel chargées de veiller au respect du droit du travail, que ce soit dans les grandes ou petites associations ».
Ce refus sous-jacent a été perceptible lors de mon entretien avec le directeur de France terre d'asile, qui a dès le départ invoqué un taux de participation de 27 % en 2019 aux récentes élections professionnelles au sein de l'association. Une manière de remettre en cause la légitimité des syndicalistes et de leurs témoignages pour ce livre. Le tout en se disant "favorable au dialogue social avec les syndicats"
adhère aux valeurs, il accepte beaucoup en raison du chantage affectif sur la noblesse de la cause que les directions savent faire passer.» L'idée même d'une représentation des salariés n'est pas nécessairement bienvenue, considérée comme un sujet hors champ. Du côté des employeurs, analyse le secrétaire général du SMA-CFDT, «il est difficile de concéder des lieux pour le dialogue social, d'accepter la constitution d'institutions représentatives du personnel chargées de veiller au respect du droit du travail, que ce soit dans les grandes ou petites associations ».
Ce refus sous-jacent a été perceptible lors de mon entretien avec le directeur de France terre d'asile, qui a dès le départ invoqué un taux de participation de 27 % en 2019 aux récentes élections professionnelles au sein de l'association. Une manière de remettre en cause la légitimité des syndicalistes et de leurs témoignages pour ce livre. Le tout en se disant "favorable au dialogue social avec les syndicats"
[...] les managers, surtout ceux formés dans les écoles de commerce, parlaient de cette manière aux nouvelles recrues : « Ici tu travailles pour quelque chose qui a du sens, on ne peut pas tout avoir. »
« Contrairement à ma précédente expérience où l'on travaillait à partir d'une feuille de route stratégique actée, où l'organisation était clairement définie, où nous faisions appel à des ressources externes et où nous avions des réunions de bilan à date avec nos supérieurs, à SOS, cela changeait tout le temps. Dans notre service, nous courions après le temps, naviguions à vue et n'avions pas toujours I'information stratégique et une vision du business à moyen ou long terme. Dans le groupe, la culture se veut agile, on change de cap rapidement, on doit s'adapter en permanence. Ainsi, on recevait des demandes de toutes parts, en même temps, nous devions mieux nous organiser et améliorer la structuration du travail. Le management ne se rendait pas compte des effets psychiques sur l'équipe. »
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Quiz
Voir plus
Qui suis-je ? Les auteurs en C
Né en Algérie, j'ai publié La Peste et La Chute. J'appartiens au mouvement littéraire de l'Absurde. Qui suis-je ?
Couteline
Char
Céline
Camus
9 questions
66 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur ce livre66 lecteurs ont répondu