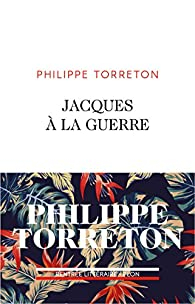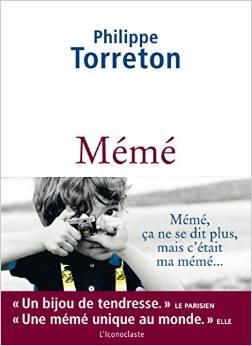Citations sur Jacques à la guerre (62)
-Tu vois, qu'y m'dit : à l'armée faut gueuler. Mais le coup des pompes, c'est pas bête je retiens.
À quatre pattes toujours, ça commence à me lancer dans la main. En fait, elle me rassure un peu cette douleur qui s'éveille ; le calme blanc m'inquiétait, là on dirait que le normal reprend ses droits. La douleur qui monte veut dire qu'il reste encore suffisamment de circuits qui fonctionnent pour faire ressentir la mouise dans laquelle tu te traînes ; ça veut dire que ton cerveau a jugé qu'il valait le coup de pousser encore un peu la bécane, trop amoché, il te fout dans les vapes, débranche tout ce qu'il peut pour te laisser tranquille et pour que tu ne te rendes pas compte du foutoir que t'es devenu. C'est bien fait le corps humain. La douleur est bon signe - et là je commence à jongler.
Toute cette mauvaise herbe qui se tient à distance lorsque la vie normale suit son cours mais qui prend ses aises quand la guerre laisse l'homme en friche, j'en pouvais plus. La guerre, c'était comme voir l'arrière-cuisine d'un restaurant négligé, ça ne donnait plus envie d'y prendre ses repas. Elle avait soulevé les jupes de la grande populace et les dessous n'étaient pas rutilants. Je ne supportais plus d'être là, les pieds dans les flaques de cette eau de conflit qui suintait de partout. Comment se remettre d'aplomb après un tel déballage ?
Alors, au bout du compte, le militaire, avec son grand système, ses règles, ses ordres, ça m'allait bien. Chacun s'y retrouve logé à la même enseigne ; t'es grand, t'es p'tit, enfile ça, marche droit et après on verra. Je n'y voyais pas un avenir, juste une pause, une sieste après un repas indigeste de quatre ans. Comme un boxeur fatigué, les jambes en guimauve, les gants trop lourds pour ses petits bras, je me suis accroché au cou de la guerre pour éviter ses directs du droit. C'était bel et bien ça, pour moi, le service : reprendre mon souffle.
Alors, au bout du compte, le militaire, avec son grand système, ses règles, ses ordres, ça m'allait bien. Chacun s'y retrouve logé à la même enseigne ; t'es grand, t'es p'tit, enfile ça, marche droit et après on verra. Je n'y voyais pas un avenir, juste une pause, une sieste après un repas indigeste de quatre ans. Comme un boxeur fatigué, les jambes en guimauve, les gants trop lourds pour ses petits bras, je me suis accroché au cou de la guerre pour éviter ses directs du droit. C'était bel et bien ça, pour moi, le service : reprendre mon souffle.
Les tickets de rationnement sévissaient encore et on n'en pouvait plus de cette survie organisée. Si certains, comme toujours, savaient y faire pour trouver leur mangeaille, le marché noir continuait de fonctionner à plein et chacun se doutaient que certains BOF, grâce à quatre années d'Occupation et cette vacherie de Libération qui tardait à nous faire sourire, continuaient à prospérer, mais nous on en avait marre d'avoir le ventre vide et la tête pleine de rancoeurs.
C'est aussi pour cela que, dans le fond, je n'étais pas plus mal entre ces murs militaires : quitter le monde commerçant de la débrouille et de la magouille, ces pas de porte de la honte, [...] relevait de la question de survie. L'écoeurement et la gamberge y poussaient.
Bien sûr, à Rouen, comme partout, on avait arrêté les polichinelles de la collaboration, mais c'était surtout les voyants, les illuminés qui se seraient rendus si on ne les avait pas interpellés. Les lâches, eux, s'étaient évanouis dans la nature. Quant à la grosse masse de foireux, la sale engeance du quotidien, les gagne-petit de la honte, pour eux aucun coup de trique ni de semonce, pas même de mise au pilori. RAS. La vie reprenait son cours. Comme avant, sur le même pas de porte. Des fois même ils osaient se pavaner. On avait quand même rattrapé par le col un inspecteur particulièrement vachard, un certain Louis Alie, zélé de la cause collabo qui avait arrêté plein de pauvres types ; il était parti se réfugier en Allemagne avec ses dossiers sous le bras puis était revenu espérant négocier ; il a été fusillé très vite, en décembre, mais comment oublier ? Comment oublier le reste ? Les fourbes, les délateurs, les profiteurs ? Comment ? Fallait faire comme si ? Mêmes poignées de main et mêmes sourires ? Personnellement j'aurais bien poussé le ménage plus loin, je ne me serais pas contenté de deux ou trois coups de balai. Des gens avaient disparu, évaporés comme des ombres, qui, trois ans plus tard, n'étaient pas revenues, preuves que ce qui circulait, à voix basse, pendant la guerre, les rumeurs sur ces familles qui s'en allaient entourées de miliciens, de policiers et de soldats allemands étaient terriblement vraies, ils n'allaient pas travailler en Allemagne mais y étaient poussés par convois pour mourir en masse. Comprendre qu'il y avait eu des camps pensés comme des usines dont la matière première était de l'être humain juif exterminé par le gaz et brûlé dans les fours et commencer sa vie de jeune homme comme ça. Pas grand monde ne voulait s'attarder sur le sujet. Les informations là-dessus, aux lendemains de l'horreur, se distillaient comme une liqueur interdite. Parce que l'heure était à la reconstruction, parce qu'il fallait s'organiser, revivre, le pays des morts ne restait pas longtemps en une des journaux. Comment avancer avec cette ombre immense ? J'aurais volontiers gratté un peu plus les fonds de casserole de notre pays pour raviver la mémoire de ces hommes et femmes que l'on ne reverrait plus, pour cet élève que j'avais vu traverser la cour entouré de miliciens, pour ce directeur qui arrachait les étoiles fraîchement cousues à l'entrée de l'école en martelant, les mâchoires serrées "Ici, c'est l'école de la République" et qui lui aussi devait quelques jours plus tard traverser cette même cour, cerné des mêmes miliciens, sous nos regards déchirés à jamais, pour ce marchand de tissu qui arborait son étoile jaune droit comme un i devant son pas de porte, même que si le gouvernement de Vichy avait prévu plusieurs tailles il aurait choisi la plus grande, fier de la montrer aux passants, gênés, en leur jetant à la figure : "Regardez-moi, je suis juif, vous avez vu mon étoile ?", fiérot doigt d'honneur à la résignation. Son rideau de fer tombera quelques jours plus tard. Dans notre famille, il n'y avait pas de juifs, mais un monsieur que je ne connaissais pas, beau-frère du mari de Charlotte, la soeur de mon père, fut arrêté une nuit de juillet par la Sipo-SD, la police de sûreté allemande, parce qu'il était en train d'ouvrir un wagon. Condamné à mort, il avait été fusillé au petit matin, un jour du mois de mars suivant, au Madrillet ; on avait seulement su plus tard qu'il était résistant. J'aurais bien hurlé tout ça. Mais je ne savais pas parler.
Pour quelques héros et braves gens par-ci par-là il y a eu de la sale engeance un peu partout ; pas des criminels, juste du merdeux qui profite, du salopard qui abuse, qui parle mal à la misère, qui envoyait promener la femme épuisée, alourdie d'enfants efflanqués, en éructant : "Qu'est-ce qu'elle nous vient quémander encore celle-là ?"
C'est aussi pour cela que, dans le fond, je n'étais pas plus mal entre ces murs militaires : quitter le monde commerçant de la débrouille et de la magouille, ces pas de porte de la honte, [...] relevait de la question de survie. L'écoeurement et la gamberge y poussaient.
Bien sûr, à Rouen, comme partout, on avait arrêté les polichinelles de la collaboration, mais c'était surtout les voyants, les illuminés qui se seraient rendus si on ne les avait pas interpellés. Les lâches, eux, s'étaient évanouis dans la nature. Quant à la grosse masse de foireux, la sale engeance du quotidien, les gagne-petit de la honte, pour eux aucun coup de trique ni de semonce, pas même de mise au pilori. RAS. La vie reprenait son cours. Comme avant, sur le même pas de porte. Des fois même ils osaient se pavaner. On avait quand même rattrapé par le col un inspecteur particulièrement vachard, un certain Louis Alie, zélé de la cause collabo qui avait arrêté plein de pauvres types ; il était parti se réfugier en Allemagne avec ses dossiers sous le bras puis était revenu espérant négocier ; il a été fusillé très vite, en décembre, mais comment oublier ? Comment oublier le reste ? Les fourbes, les délateurs, les profiteurs ? Comment ? Fallait faire comme si ? Mêmes poignées de main et mêmes sourires ? Personnellement j'aurais bien poussé le ménage plus loin, je ne me serais pas contenté de deux ou trois coups de balai. Des gens avaient disparu, évaporés comme des ombres, qui, trois ans plus tard, n'étaient pas revenues, preuves que ce qui circulait, à voix basse, pendant la guerre, les rumeurs sur ces familles qui s'en allaient entourées de miliciens, de policiers et de soldats allemands étaient terriblement vraies, ils n'allaient pas travailler en Allemagne mais y étaient poussés par convois pour mourir en masse. Comprendre qu'il y avait eu des camps pensés comme des usines dont la matière première était de l'être humain juif exterminé par le gaz et brûlé dans les fours et commencer sa vie de jeune homme comme ça. Pas grand monde ne voulait s'attarder sur le sujet. Les informations là-dessus, aux lendemains de l'horreur, se distillaient comme une liqueur interdite. Parce que l'heure était à la reconstruction, parce qu'il fallait s'organiser, revivre, le pays des morts ne restait pas longtemps en une des journaux. Comment avancer avec cette ombre immense ? J'aurais volontiers gratté un peu plus les fonds de casserole de notre pays pour raviver la mémoire de ces hommes et femmes que l'on ne reverrait plus, pour cet élève que j'avais vu traverser la cour entouré de miliciens, pour ce directeur qui arrachait les étoiles fraîchement cousues à l'entrée de l'école en martelant, les mâchoires serrées "Ici, c'est l'école de la République" et qui lui aussi devait quelques jours plus tard traverser cette même cour, cerné des mêmes miliciens, sous nos regards déchirés à jamais, pour ce marchand de tissu qui arborait son étoile jaune droit comme un i devant son pas de porte, même que si le gouvernement de Vichy avait prévu plusieurs tailles il aurait choisi la plus grande, fier de la montrer aux passants, gênés, en leur jetant à la figure : "Regardez-moi, je suis juif, vous avez vu mon étoile ?", fiérot doigt d'honneur à la résignation. Son rideau de fer tombera quelques jours plus tard. Dans notre famille, il n'y avait pas de juifs, mais un monsieur que je ne connaissais pas, beau-frère du mari de Charlotte, la soeur de mon père, fut arrêté une nuit de juillet par la Sipo-SD, la police de sûreté allemande, parce qu'il était en train d'ouvrir un wagon. Condamné à mort, il avait été fusillé au petit matin, un jour du mois de mars suivant, au Madrillet ; on avait seulement su plus tard qu'il était résistant. J'aurais bien hurlé tout ça. Mais je ne savais pas parler.
Pour quelques héros et braves gens par-ci par-là il y a eu de la sale engeance un peu partout ; pas des criminels, juste du merdeux qui profite, du salopard qui abuse, qui parle mal à la misère, qui envoyait promener la femme épuisée, alourdie d'enfants efflanqués, en éructant : "Qu'est-ce qu'elle nous vient quémander encore celle-là ?"
Mon frère - et son cirque permanent - me distrayait lui aussi, mais ce n'était ni la même scène, ni les mêmes rires, ni la même magie, ni le même parfum d'évasion. Comme lui se dirigeait vers les plantes, on m'a poussé à le suivre sur ce chemin vert. [...] Et il avait raison mon frère, pour moi qui rêvais de partir, de m'évader autrement, les plantes c'était un bon ticket d'embarquement. Avec elles, rien qu'à travers les noms et provenances, tu voyages. Elles nous apprennent qu'on peut s'acclimater ailleurs, étaler ses branches sous d'autres latitudes, que le soleil est toujours au-dessus, et que c'est ça qui compte. Elles nous font réaliser qu'un arbre n'est ni de droite ni de gauche, qu'il regarde les hommes se bouffer la rate et s'en fout. Moi, sur le boulevard, j'ai vu défiler tout le monde, même le Front populaire - j'avais sept ans -, avec plein d'oncles Damerval qui portaient des pancartes, de moustaches à chapeau accrochées aux arbres, de poings levés partout, de poitrails médaillés, j'ai vu la garde mobile, postée sur la rampe Saint-Hilaire, soudainement attaquer à cheval les manifestants qui s'éparpillaient dans tous les sens ; ça criait, on se battait dans nos rues, des visages sanguinolents filaient devant nos fenêtres, des bruits sourds de corps s'abritant quelques instants contre notre porte fermée à double tour nous faisaient sursauter. Et puis j'ai vu les Allemands faire tomber les ridelles de leurs camions bâchés et descendre à coup de crosse des tirailleurs sénégalais qui, sitôt passé le porche du lycée en face de nos fenêtres, se faisaient mitrailler... J'ai vu tout ça Ivo, et aussi que les arbres, eux, n'avaient pas bougé et que certains avaient même échappé aux bombardements. Que l'homme pouvait commettre le pire, que le bonheur ne dure jamais longtemps.
Autour de nous, ça partait. Des voisins nous quittaient sans savoir où aller ; n'importe où plutôt que vivre ici ; personne ne conseillait plus personne car personne ne savait quoi faire et aucune solution n'était mieux que les autres : on se regardait partir, on se regardait rester, on se regardait attendre que tout cesse dans un grand fracas de bombes.
Dans ma ville en ruine, on annonçait l'arrivée des Canadiens. Deux divisions, paraît-il. Alors on les attendait, reclus, perclus et affamés, anxieux, persuadés que notre tour viendrait. La libération paraissait en marche mais d'ici là on vivait encore dans la peur. Une peur qui s'était installée, d'abord brutale et désordonnée, qui avait fini par faire sa vie chez nous, par prendre ses aises, quitter sa solitude farouche et recroquevillée pour nous rejoindre jusqu'à la table et durant nos prières. Mais à l'aube d'une imminente libération, elle revêtait d'autres habits, ceux d'une folle ; on ne voulait pas qu'il nous arrive quelque chose
En revenant vers moi, il poussa un soupir ; je m'attendais à une remontrance [...] mais curieusement, il me confia, après un silence anormalement long, que les couleurs étaient de moins en moins demandées, que la mode revenait au sombre. Ses yeux s'en allèrent quelque part, et, de ce quelque part, arriva la suite :
- On va vers le terne, le marron, le gris, pas d'exubérance, du sérieux, du basique, ça m'inquiète, conclut-il.
- On va vers le terne, le marron, le gris, pas d'exubérance, du sérieux, du basique, ça m'inquiète, conclut-il.
Face à moi, il mangeait mécaniquement, une bouchée chassant l'autre, sans plaisir, métronomiquement, la cadence de ses pelletées ne s'interrompant que pour tourner une page de son immense journal malmené par d'épaisses mains brillantes ; de temps en temps ses doigts gourds et graisseux - vaguement essuyés sur une serviette coincée dans le col de sa chemise - saisissaient un verre de vin rouge qui tombait littéralement dans son gosier comme un seau d'eau tombe dans un puits.
La vie s'est mise sur son trente et un. Tout me plaît, tout est intéressant et pourtant je garde le silence, je n'ose pas parler, je me contente de répondre lorsque mon père termine une phrase par un point d'interrogation, je me répète des propos dans ma tête, j'essaie d'organiser ma pensée, je n'ai pas envie de lui poser une question idiote, ni de le mettre dans l'embarras s'il n'a pas la réponse, le silence est préférable, mon père est intimidant.
Il m'a montré la ville en voiture, on n'a rien visité à pied, il me l'aurait proposé que j'aurais refusé tellement j'étais bien dans la Renault, devant, à côté de lui.
Il m'a montré la ville en voiture, on n'a rien visité à pied, il me l'aurait proposé que j'aurais refusé tellement j'étais bien dans la Renault, devant, à côté de lui.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Philippe Torreton (11)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1719 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1719 lecteurs ont répondu