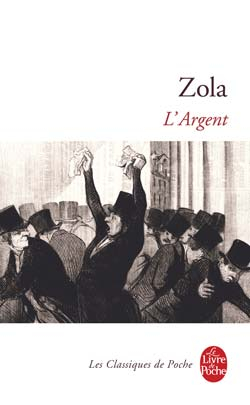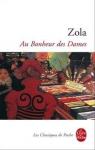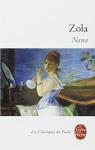Nous retrouvons Aristide Saccard qui avait brassé tant de millions dans La curée, largement cocu et en passe d'être ruiné à la fin du roman. Nous voici 12 ans plus tard : après de sérieux revers de fortune, Saccard a tout perdu et il a dû vendre son superbe hôtel de la rue Monceau pour payer ses créanciers. Mais la rage de réussir tenaille toujours l'ancien spéculateur immobilier et c'est vers la Bourse qu'il tourne des regards avides. Hélas, il se chuchote que l'Empire court à sa fin : de prochaines élections pourraient le renverser et la guerre menace. « Est-ce que cet empire qui l'avait fait, allait comme lui culbuter, croulant tout d'un coup de la destinée la plus haute à la plus misérable ? » (p. 12) Et la Bourse est très sensible au climat politique : y entrer demande des nerfs d'acier, une solide connaissance de l'actualité, mais aussi un goût pour le jeu et le pari, surtout s'il est fou, hors normes.
Sachant ne pouvoir compter que sur lui-même, et certainement pas sur Eugène Rougon, son ministre de frère, Saccard fait fi des menaces qui planent : il lance ses dernières économies et toute son énergie dans la création de la Banque universelle, société de crédit destinée à financer de grands projets en Orient. « Rien n'était possible sans l'argent, l'argent liquide qui coule, qui pénètre partout. » (p. 154) Pour constituer le capital, Aristide Saccard attire de pauvres gens aux maigres économies, des nobles déchus rêvant de gloire retrouvée et toute une traîne de profiteurs qui espèrent d'enrichir dans la juteuse affaire.
L'homme est convaincu de sa haute intelligence financière et persuadé de faire fortune, pour une fois de façon durable. Aux quelques amis qui lui recommandent la prudence, notamment parce qu'il joue avec l'argent des autres, il répond plein de morgue qu'il connaît son métier. « Non, vous pouvez être tranquille, la spéculation ne dévore que les maladroits. » (p. 166) Et les premiers temps, la Bourse semble lui donner raison : la valeur des actions de la Banque universelle ne cesse de monter et Saccard savoure sa victoire et sa domination retrouvée sur les autres financiers parisiens. Mais la fièvre le gagne : voulant sans cesse augmenter la valeur de ses actions, il achète ses propres titres en catimini pour faire croire à une demande incessante. La manipulation est habile, mais risquée puisque l'édifice bancaire risque alors de s'effondrer sur lui-même. À cela s'ajoute une sordide histoire d'enfant naturel qui ressurgir après des années de silence.
Après La curée qui dénonçait les pratiques frauduleuses des spéculateurs immobilières et La terre qui peignait un tableau sans concession de l'avarice paysanne, L'argent est le point d'orgue d'une fièvre de possession. Nullement échaudé ou guéri après ses premiers échecs, Saccard se laisse dominer par une obsession de richesse sans mesure. « L'argent, l'argent roi, l'argent Dieu, au-dessus du sang, au-dessus des larmes, adoré plus haut que les vains scrupules humains, dans l'infini de sa présence. » (p. 274) Dans le milieu boursier où l'argent ne se compte qu'à millions, rares sont ceux qui semblent capables de se maîtriser. Parmi eux, il y a les juifs qui, tout au long du roman, sont accusés des pires malversations et à qui l'on prête les pires desseins. Voilà hélas un cliché qui a la vie dure.
J'avais un peu peiné sur Son excellence Eugène Rougon et les longues considérations politiques sur le clientélisme. Ma lecture de L'argent a été encore plus difficile. Il faut tout de même relativiser puisque j'ai lu les 500 pages de ce volume en 3 jours, mais les descriptions de la Bourse et autres mécanismes financiers m'ont parfaitement barbée ! Heureusement, toujours aussi puissante et aiguisée, la plume d'Émile Zola sait emmener son lecteur dans une histoire où le sordide se dissimule souvent derrière les rideaux. Je ne suis pas déçue de cette lecture, mais j'en sors soulagée. Émile, mon chéri, entre amis, il ne faudrait jamais parler d'argent.
Sachant ne pouvoir compter que sur lui-même, et certainement pas sur Eugène Rougon, son ministre de frère, Saccard fait fi des menaces qui planent : il lance ses dernières économies et toute son énergie dans la création de la Banque universelle, société de crédit destinée à financer de grands projets en Orient. « Rien n'était possible sans l'argent, l'argent liquide qui coule, qui pénètre partout. » (p. 154) Pour constituer le capital, Aristide Saccard attire de pauvres gens aux maigres économies, des nobles déchus rêvant de gloire retrouvée et toute une traîne de profiteurs qui espèrent d'enrichir dans la juteuse affaire.
L'homme est convaincu de sa haute intelligence financière et persuadé de faire fortune, pour une fois de façon durable. Aux quelques amis qui lui recommandent la prudence, notamment parce qu'il joue avec l'argent des autres, il répond plein de morgue qu'il connaît son métier. « Non, vous pouvez être tranquille, la spéculation ne dévore que les maladroits. » (p. 166) Et les premiers temps, la Bourse semble lui donner raison : la valeur des actions de la Banque universelle ne cesse de monter et Saccard savoure sa victoire et sa domination retrouvée sur les autres financiers parisiens. Mais la fièvre le gagne : voulant sans cesse augmenter la valeur de ses actions, il achète ses propres titres en catimini pour faire croire à une demande incessante. La manipulation est habile, mais risquée puisque l'édifice bancaire risque alors de s'effondrer sur lui-même. À cela s'ajoute une sordide histoire d'enfant naturel qui ressurgir après des années de silence.
Après La curée qui dénonçait les pratiques frauduleuses des spéculateurs immobilières et La terre qui peignait un tableau sans concession de l'avarice paysanne, L'argent est le point d'orgue d'une fièvre de possession. Nullement échaudé ou guéri après ses premiers échecs, Saccard se laisse dominer par une obsession de richesse sans mesure. « L'argent, l'argent roi, l'argent Dieu, au-dessus du sang, au-dessus des larmes, adoré plus haut que les vains scrupules humains, dans l'infini de sa présence. » (p. 274) Dans le milieu boursier où l'argent ne se compte qu'à millions, rares sont ceux qui semblent capables de se maîtriser. Parmi eux, il y a les juifs qui, tout au long du roman, sont accusés des pires malversations et à qui l'on prête les pires desseins. Voilà hélas un cliché qui a la vie dure.
J'avais un peu peiné sur Son excellence Eugène Rougon et les longues considérations politiques sur le clientélisme. Ma lecture de L'argent a été encore plus difficile. Il faut tout de même relativiser puisque j'ai lu les 500 pages de ce volume en 3 jours, mais les descriptions de la Bourse et autres mécanismes financiers m'ont parfaitement barbée ! Heureusement, toujours aussi puissante et aiguisée, la plume d'Émile Zola sait emmener son lecteur dans une histoire où le sordide se dissimule souvent derrière les rideaux. Je ne suis pas déçue de cette lecture, mais j'en sors soulagée. Émile, mon chéri, entre amis, il ne faudrait jamais parler d'argent.
Publié en 1891, 18ème roman de la série des Rougon-Macquart, L'Argent aurait pu s'intituler La Bourse. Zola y dépeint le capitalisme triomphant en même temps que les prémices financiers de l'écroulement du Second Empire et se livre à l'étude des mécanismes spéculatifs. Mais il réussit à ne pas rebuter son lecteur par des considérations techniques parfois arides, il parvient à dramatiser cette fiction qu'il fait débuter en 1864, en la transformant en un combat épique.
La description de la dernière séance de bourse de l'année 1868, au chapitre 10, est absolument époustouflante.
Ce roman est remarquable car le thème reste actuel avec les risques de la financiarisation de l'economie, la collusion entre l'argent et le pouvoir...même si le monde économique et financier a évolué.
La description de la dernière séance de bourse de l'année 1868, au chapitre 10, est absolument époustouflante.
Ce roman est remarquable car le thème reste actuel avec les risques de la financiarisation de l'economie, la collusion entre l'argent et le pouvoir...même si le monde économique et financier a évolué.
Que d'émotions comme à chaque fois à la lecture de Zola......
Ecriture magistrale comme toujours avec Emile Zola. Cependant, léger bémol personnel sur ce tome extrêmement ardu à lire pour une personne comme moi dont le cerveau rejette obstinément toutes les notions se rapportant à la Bourse, au monde de la Finance ou tout simplement aux Mathématiques.
Difficile, dans ces conditions, de saisir dans toute son intensité l'enjeu du récit qui est centré, comme son titre l'indique, sur l'argent. Je me souviens néanmoins avoir lu ce roman en 2008, juste après la Crise économique et je me rappelle avoir été douloureusement frappée par l'actualité du texte de Zola qui se calquait alors parfaitement à l'actualité mondiale.
Cependant, j'ai eu toujours autant de plaisir à découvrir les personnages, toujours aussi émouvants.
Difficile, dans ces conditions, de saisir dans toute son intensité l'enjeu du récit qui est centré, comme son titre l'indique, sur l'argent. Je me souviens néanmoins avoir lu ce roman en 2008, juste après la Crise économique et je me rappelle avoir été douloureusement frappée par l'actualité du texte de Zola qui se calquait alors parfaitement à l'actualité mondiale.
Cependant, j'ai eu toujours autant de plaisir à découvrir les personnages, toujours aussi émouvants.
Je m'étais fixé pour objectif de terminer les Rougon-Macquart avant la fin de mes études universitaires. En effet, j'avais tellement aimé "Germinal" que je voulais tout connaître de cette fresque familiale du XIXe. J'ai commencé par les plus connus ( L'assommoir, Nana, la bête humaine), puis je me suis frottée à des tomes moins médiatisés (une page d'amour, la curée, l'oeuvre). Ensuite, j'ai voulu lire "l'argent"...
Je suis restée quatre mois sur ce roman, sans jamais parvenir à dépasser les quinze premières pages. Je pense que "L'argent" demeurera à jamais un trou dans ma lecture des vingt tomes des Rougon-Macquart.... D'abord déçue, j'ai voulu m'obstiner à poursuivre, mais cette fois c'est fini: je vais me résoudre à reposer "L'argent" au fond de mon étagère et passer au suivant de ma liste, "le docteur Pascal". Si vous avez quant à vous eu le courage de le lire jusqu'au bout, veuillez recevoir mes plus grands applaudissements...
Je suis restée quatre mois sur ce roman, sans jamais parvenir à dépasser les quinze premières pages. Je pense que "L'argent" demeurera à jamais un trou dans ma lecture des vingt tomes des Rougon-Macquart.... D'abord déçue, j'ai voulu m'obstiner à poursuivre, mais cette fois c'est fini: je vais me résoudre à reposer "L'argent" au fond de mon étagère et passer au suivant de ma liste, "le docteur Pascal". Si vous avez quant à vous eu le courage de le lire jusqu'au bout, veuillez recevoir mes plus grands applaudissements...
"Après la débâcle qui, en octobre, l'avait forcé une fois de plus à liquider sa situation, à vendre son hôtel du Parc Monceau pour louer un appartement"...Aristide Saccard (personnage balzacien indélicat déjà croisé dans La curée et frère du ministre Rougon), malgré les têtes qui se détournent sur son passage, ambitieux et revanchard, réunit un "syndicat d'amis, de banquiers,d'industriels" pour établir une ligne de chemin de fer près de Beyrouth et monter une "banque universelle".
"Ah! l'argent, cet argent pourisseur,empoisonneur qui desséchait les âmes" affirme Emile Zola à travers ses personnages.
Ecrit, suite à des faits historiques véridiques:le krach de l'Union générale catholique en 1882 (qui a provoqué une crise du crédit et de nombreuses faillites) ce roman, sociologique et psychologique, analyse, dépeint,décortique le capitalisme, tout en montrant la banque comme une ogresse qui se développe comme un énorme piège qui n'en finit pas.
Outre ses réflexions sur l'univers manichéen de cette société capitaliste du XIX° siècle, L'argent, roman naturaliste de Zola, 18° volume des Rougon-Macquart, brosse un fort portrait d'homme: celui de Saccard: passionné,jouisseur,intuitif,cynique,violent,impatient,roublard, prêt à tout pour réussir même s'il lui faut contourner les lois en dépouillant les plus crédules, en évinçant les "Juifs féroces" ses ennemis ou en abandonnant son propre enfant né d'amours adultérines.
Autour de lui gravitent l'économe qui s'engraisse,le boursier aux dents aiguisées,le spéculateur délicat,le panier percé,le rancunier malchanceux,le casse-cou,le grippe-sous,le joueur enfiévré.....et l'honnête, paisible,intelligente M° Caroline, sa gouvernante et tendre amante qui l'admire et jalouse en secret ses multiples rivales.
Sur fond de duplicité et de trahison,les grandes fortunes s'amassent, mais en un jour tout peut s'écrouler entrainant ruine,arrestation, procès et suicides pour les ruinés par trop dépressifs.
A l'époque où Karl Marx, de son côté écrit le capital, Emile Zola annonce les débuts du socialisme mais voulant rester objectif affirme:
"Je n'attaque ni ne défends l'argent, je le montre comme une force nécessaire jusqu'à ce jour,comme un facteur de progrès".
Ainsi, Saccard, l'indomptable remettra sa belle énergie dans d'autres entreprises d'envergure!
Quel talent ce Zola!
"Ah! l'argent, cet argent pourisseur,empoisonneur qui desséchait les âmes" affirme Emile Zola à travers ses personnages.
Ecrit, suite à des faits historiques véridiques:le krach de l'Union générale catholique en 1882 (qui a provoqué une crise du crédit et de nombreuses faillites) ce roman, sociologique et psychologique, analyse, dépeint,décortique le capitalisme, tout en montrant la banque comme une ogresse qui se développe comme un énorme piège qui n'en finit pas.
Outre ses réflexions sur l'univers manichéen de cette société capitaliste du XIX° siècle, L'argent, roman naturaliste de Zola, 18° volume des Rougon-Macquart, brosse un fort portrait d'homme: celui de Saccard: passionné,jouisseur,intuitif,cynique,violent,impatient,roublard, prêt à tout pour réussir même s'il lui faut contourner les lois en dépouillant les plus crédules, en évinçant les "Juifs féroces" ses ennemis ou en abandonnant son propre enfant né d'amours adultérines.
Autour de lui gravitent l'économe qui s'engraisse,le boursier aux dents aiguisées,le spéculateur délicat,le panier percé,le rancunier malchanceux,le casse-cou,le grippe-sous,le joueur enfiévré.....et l'honnête, paisible,intelligente M° Caroline, sa gouvernante et tendre amante qui l'admire et jalouse en secret ses multiples rivales.
Sur fond de duplicité et de trahison,les grandes fortunes s'amassent, mais en un jour tout peut s'écrouler entrainant ruine,arrestation, procès et suicides pour les ruinés par trop dépressifs.
A l'époque où Karl Marx, de son côté écrit le capital, Emile Zola annonce les débuts du socialisme mais voulant rester objectif affirme:
"Je n'attaque ni ne défends l'argent, je le montre comme une force nécessaire jusqu'à ce jour,comme un facteur de progrès".
Ainsi, Saccard, l'indomptable remettra sa belle énergie dans d'autres entreprises d'envergure!
Quel talent ce Zola!
Aristide Saccard, un des membres de la famille des Rougon-Macquart que l'on retrouve dans La Curée, a perdu tout son argent à la bourse. Il s'allie donc à Hamelin pour fonder une banque qui aura pour but ultime de mettre le pape sur le trône de Jérusalem. Cependant, Saccard est un assoiffé d'argent. Il est prêt à toute sorte de magouille pour faire monter artificiellement la valeur des actions de l'entreprise.
Dans ce roman, Zola s'attaque cette fois-ci au monde des spéculateurs boursiers qu'il compare à des gamblers. Pour lui, il n'y a aucune différence entre la bourse et le jeu. Il s'attaque aussi aux magouilleurs qui sont prêts à n'importe quelles manoeuvres pour faire hausser la valeur des titres artificiellement et qui créent des bulles qui font perdre beaucoup d'argent aux investisseurs lorsqu'elles éclatent. Il parle aussi de ces journaux qui sont à la solde de ces entreprises et qui moussent les actions. C'est de la convergence avant le temps.
Ce roman de Zola est excellent, comme la plupart des autres. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'économie vacillante des dernières années, ce roman est toujours d'actualité. C'est comme si l'être humain n'apprenait jamais de ses erreurs. C'est donc un bon livre en cette période d'instabilité économique.
Dans ce roman, Zola s'attaque cette fois-ci au monde des spéculateurs boursiers qu'il compare à des gamblers. Pour lui, il n'y a aucune différence entre la bourse et le jeu. Il s'attaque aussi aux magouilleurs qui sont prêts à n'importe quelles manoeuvres pour faire hausser la valeur des titres artificiellement et qui créent des bulles qui font perdre beaucoup d'argent aux investisseurs lorsqu'elles éclatent. Il parle aussi de ces journaux qui sont à la solde de ces entreprises et qui moussent les actions. C'est de la convergence avant le temps.
Ce roman de Zola est excellent, comme la plupart des autres. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'économie vacillante des dernières années, ce roman est toujours d'actualité. C'est comme si l'être humain n'apprenait jamais de ses erreurs. C'est donc un bon livre en cette période d'instabilité économique.
Un roman bien actuel malgré une parution en 1891. Dans la série des Rougon-Macquart, le roman retrace bien les turpitudes de la bourse. L'écriture est digne de Zola, il y a beaucoup de lenteur due aux nombreuses descriptions détaillées des lieux mais aussi des états psychiques des personnages. Il n'y a aucune place pour les sentiments ou pour la romance dans cet univers d'hommes des finances. Les hauts et bas que peuvent connaître le coeur d'un homme sont ici impulsés par les aléas de la bourse.
J'étais sur ma lancée Zola, et j'ai lu que L'argent était la suite de la Curée, mon tout premier Zola dont je garde un bon souvenir. Je me suis donc jetée dessus et j'ai commencé à le lire au boulot (oui oui, moi j'ai le droit de lire, hahahaha). Mais malheur, je m'endors à chaque page et donc je ne me souviens même plus de qui parle ou du lieu où se trouve Saccard. Je pensais pouvoir avaler tout l'aspect économique du livre, vu que l'histoire ressemble beaucoup à ce qui s'est passé dernièrement. Mais il semble que ce ne soit pas le cas.
Je réserve donc mon jugement pour plus tard, quand je le reprendrai. J'ai lu 4 chapitres mais je me suis ennuyée. Soit je ne peux vraiment faire qu'un Zola par an, soit je choisis mal mes lectures chez lui.
Je réserve donc mon jugement pour plus tard, quand je le reprendrai. J'ai lu 4 chapitres mais je me suis ennuyée. Soit je ne peux vraiment faire qu'un Zola par an, soit je choisis mal mes lectures chez lui.
L'Argent est le dix-huitième épisode de la saga des Rougon-Macquart, paru en 1891.
Emile Zola y décrit par le menu les mécanismes de la spéculation boursière, à partir d'un fait historique survenu entre 1878 et 1882, le krach de L'Union Générale, banque catholique appuyée par les conservateurs qui connut une faillite retentissant sur toutes les places financières européennes et favorisa grandement l'expansion de l'antisémitisme en France.
Emile Zola replace cet épisode à la fin du Second Empire : La Banque Universelle se donne l'objectif de développer des investissements immenses au Moyen-Orient (Compagnie de Paquebots, Mine d'argent, Banque Nationale Turque) et a en ligne de mire secret la remise des Lieux-Saints de Jérusalem au Pape. le personnage principal est Aristide Saccard, frère d'Eugène Rougon, ministre de Napoléon III, avec lequel il est brouillé. Saccard rencontre l'ingénieur polytechnicien naïf Hamelin, qui vit avec sa soeur, madame Caroline, belle femme de 36 ans, qui refuse le malheur et irradie le roman de sa sage bonté. Saccard est un aventurier de la finance, il s'est déjà effondré une première fois, il veut une revanche éclatante sur la haute banque juive, personnifiée par Gundermann.
Quelques bobards organisés en fuite, une information dévoilée par fraude, des ordres répartis entre des hommes de paille, puis l'engouement des petits épargnants vont porter l'Universelle aux sommets les plus fous, au mépris de la valeur intrinsèque de la société qui rachète à tout va ses propres actions pour soutenir son cours. La bataille sera épique, laissant sur le carreau des milliers de ruinés : des aristocrates, des petits bourgeois, des pauvres même qui restent criblés des dettes contractées pour acheter des actions au prix fort juste avant l'effondrement. Un carnage. Comme dans le cas de L'union générale, les directeurs feront quelques mois de prison puis s'enfuiront à l'étranger …pour recommencer !
Le roman est très long, mais l'intérêt ne faiblit pas, tant à travers des scènes de Bourse admirablement décrites que des personnages secondaires foisonnants et passionnants. A la fin, il y aura des déchéances, des suicides, des triomphes placides, des hommes qui ne rêvent que de remettre ça pour retrouver les sensations de puissance inabordables autrement.
Rien finalement ne change : souvenons-nous de l'éclatement de la bulle internet, de la crise des sub-primes, de Jean-Marie Messier surnommé « Moi, Maître du Monde », de l'affaire Madoff, du scandale Enron….Les techniques s'affinent, mais la soif du gain spéculatif, la passion du jeu l'emporte. Les krach boursiers jalonnent la marche inexorable du progrès technique.
Ce qui met vraiment mal à l'aise cependant, c'est la cruauté de Zola. Si l'on ne savait pas le rôle éminent qu'il a joué, au mépris de sa liberté – et certains disent de sa propre vie – dans la défense du Capitaine Dreyfus "J'accuse", publié par l'Aurore, on pourrait se poser la question : Zola pourrait-il être antisémite ? En effet, on rete surpris de la violence des propos "Est-ce qu'on a jamais vu un juif faisant oeuvre de ses dix doigts ? est-ce qu'il y a des juifs paysans, des juifs ouvriers ? Non, le travail déshonore, leur religion le défend presque, n'exalte que l'exploitation du travail d'autrui".
Cette violence atteint un sommet — difficilement supportable — lorsque Zola décrit les "pieds humides", qui est la petite bourse des valeurs déclassées : "Il y avait là, en un groupe tumultueux, toute une juiverie malpropre, de grasses faces luisantes, des profils desséchés d'oiseaux voraces, une extraordinaire réunion de nez typiques, rapprochés les uns des autres, ainsi que sur une proie, s'acharnant au milieu de cris gutturaux, et comme près de se dévorer entre eux.".
Pas de confusion. Zola est un grand romancier. Lorsqu'il décrit un antisémite, il en reprend tout le caractère avec la puissance d'un grand écrivain. le résultat fait froid dans le dos, c'est cela le talent. Zola a également publié dans le Figaro le 16 mai 1896 un article intitulé "Pour les Juifs" qui déclenche la fureur des antisémites. le texte est une condamnation ferme — et même violente — de l'antisémitisme : "Depuis quelques années, je suis la campagne qu'on essaye de faire en France contre les Juifs, avec une surprise et un dégoût croissants. Cela m'a l'air d'une monstruosité, j'entends une chose en dehors de tout bon sens, de toute vérité et de toute justice, une chose sotte et aveugle qui nous ramènerait à des siècles en arrière, une chose enfin qui aboutirait à la pire des abominations, une persécution religieuse, ensanglantant toutes les patries. Et je veux le dire."
Derrière l'Argent, il y a en effet des clés : Saccard, c'est Eugène Bontoux, le repreneur de la banque lyonnaise, Hamelin, l'ingénieur plein de rêves, est Feder, la Princesse d'Orviedo qui se ruine en fondations de bienfaisance et logements pour les pauvres est Madame Jules Lebaudy qui expie les manipulations de son défunt mari, et Gundermann est celui qui met à genoux à coup de millions la banque catholique, l'"ex-Prussien" Rotschild accusé de souhaiter la victoire du voisin belliqueux.
Au passage, tout de même, Zola souligne que des ces aventures financières désastreuses demeurent des investissements extraordinaires : chemins de fer, villes et voies nouvelles, assainissements de régions entières comme les Landes, ouverture de pays arriérés à la civilisation.
Il s'inscrit enfin en faux contre l'illusion marxiste, à travers les regrets du jeune Busch qui réalise au seuil de la mort l'impossibilité de son rêve de société sans argent et sans classes.
Lien : http://www.bigmammy.fr
Emile Zola y décrit par le menu les mécanismes de la spéculation boursière, à partir d'un fait historique survenu entre 1878 et 1882, le krach de L'Union Générale, banque catholique appuyée par les conservateurs qui connut une faillite retentissant sur toutes les places financières européennes et favorisa grandement l'expansion de l'antisémitisme en France.
Emile Zola replace cet épisode à la fin du Second Empire : La Banque Universelle se donne l'objectif de développer des investissements immenses au Moyen-Orient (Compagnie de Paquebots, Mine d'argent, Banque Nationale Turque) et a en ligne de mire secret la remise des Lieux-Saints de Jérusalem au Pape. le personnage principal est Aristide Saccard, frère d'Eugène Rougon, ministre de Napoléon III, avec lequel il est brouillé. Saccard rencontre l'ingénieur polytechnicien naïf Hamelin, qui vit avec sa soeur, madame Caroline, belle femme de 36 ans, qui refuse le malheur et irradie le roman de sa sage bonté. Saccard est un aventurier de la finance, il s'est déjà effondré une première fois, il veut une revanche éclatante sur la haute banque juive, personnifiée par Gundermann.
Quelques bobards organisés en fuite, une information dévoilée par fraude, des ordres répartis entre des hommes de paille, puis l'engouement des petits épargnants vont porter l'Universelle aux sommets les plus fous, au mépris de la valeur intrinsèque de la société qui rachète à tout va ses propres actions pour soutenir son cours. La bataille sera épique, laissant sur le carreau des milliers de ruinés : des aristocrates, des petits bourgeois, des pauvres même qui restent criblés des dettes contractées pour acheter des actions au prix fort juste avant l'effondrement. Un carnage. Comme dans le cas de L'union générale, les directeurs feront quelques mois de prison puis s'enfuiront à l'étranger …pour recommencer !
Le roman est très long, mais l'intérêt ne faiblit pas, tant à travers des scènes de Bourse admirablement décrites que des personnages secondaires foisonnants et passionnants. A la fin, il y aura des déchéances, des suicides, des triomphes placides, des hommes qui ne rêvent que de remettre ça pour retrouver les sensations de puissance inabordables autrement.
Rien finalement ne change : souvenons-nous de l'éclatement de la bulle internet, de la crise des sub-primes, de Jean-Marie Messier surnommé « Moi, Maître du Monde », de l'affaire Madoff, du scandale Enron….Les techniques s'affinent, mais la soif du gain spéculatif, la passion du jeu l'emporte. Les krach boursiers jalonnent la marche inexorable du progrès technique.
Ce qui met vraiment mal à l'aise cependant, c'est la cruauté de Zola. Si l'on ne savait pas le rôle éminent qu'il a joué, au mépris de sa liberté – et certains disent de sa propre vie – dans la défense du Capitaine Dreyfus "J'accuse", publié par l'Aurore, on pourrait se poser la question : Zola pourrait-il être antisémite ? En effet, on rete surpris de la violence des propos "Est-ce qu'on a jamais vu un juif faisant oeuvre de ses dix doigts ? est-ce qu'il y a des juifs paysans, des juifs ouvriers ? Non, le travail déshonore, leur religion le défend presque, n'exalte que l'exploitation du travail d'autrui".
Cette violence atteint un sommet — difficilement supportable — lorsque Zola décrit les "pieds humides", qui est la petite bourse des valeurs déclassées : "Il y avait là, en un groupe tumultueux, toute une juiverie malpropre, de grasses faces luisantes, des profils desséchés d'oiseaux voraces, une extraordinaire réunion de nez typiques, rapprochés les uns des autres, ainsi que sur une proie, s'acharnant au milieu de cris gutturaux, et comme près de se dévorer entre eux.".
Pas de confusion. Zola est un grand romancier. Lorsqu'il décrit un antisémite, il en reprend tout le caractère avec la puissance d'un grand écrivain. le résultat fait froid dans le dos, c'est cela le talent. Zola a également publié dans le Figaro le 16 mai 1896 un article intitulé "Pour les Juifs" qui déclenche la fureur des antisémites. le texte est une condamnation ferme — et même violente — de l'antisémitisme : "Depuis quelques années, je suis la campagne qu'on essaye de faire en France contre les Juifs, avec une surprise et un dégoût croissants. Cela m'a l'air d'une monstruosité, j'entends une chose en dehors de tout bon sens, de toute vérité et de toute justice, une chose sotte et aveugle qui nous ramènerait à des siècles en arrière, une chose enfin qui aboutirait à la pire des abominations, une persécution religieuse, ensanglantant toutes les patries. Et je veux le dire."
Derrière l'Argent, il y a en effet des clés : Saccard, c'est Eugène Bontoux, le repreneur de la banque lyonnaise, Hamelin, l'ingénieur plein de rêves, est Feder, la Princesse d'Orviedo qui se ruine en fondations de bienfaisance et logements pour les pauvres est Madame Jules Lebaudy qui expie les manipulations de son défunt mari, et Gundermann est celui qui met à genoux à coup de millions la banque catholique, l'"ex-Prussien" Rotschild accusé de souhaiter la victoire du voisin belliqueux.
Au passage, tout de même, Zola souligne que des ces aventures financières désastreuses demeurent des investissements extraordinaires : chemins de fer, villes et voies nouvelles, assainissements de régions entières comme les Landes, ouverture de pays arriérés à la civilisation.
Il s'inscrit enfin en faux contre l'illusion marxiste, à travers les regrets du jeune Busch qui réalise au seuil de la mort l'impossibilité de son rêve de société sans argent et sans classes.
Lien : http://www.bigmammy.fr
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Émile Zola (295)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les personnages des Rougon Macquart
Dans l'assommoir, quelle est l'infirmité qui touche Gervaise dès la naissance
Elle est alcoolique
Elle boîte
Elle est myope
Elle est dépensière
7 questions
594 lecteurs ont répondu
Thème :
Émile ZolaCréer un quiz sur ce livre594 lecteurs ont répondu