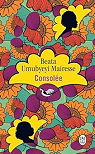Citations de Beata Umubyeyi Mairesse (289)
Cet après-midi le ciel rugissait sur nos têtes baissées et j’eusse
voulu te planter là pour aller fumer une cigarette sur la barza de la
maternité malgré l’orage, malgré les jambes flageolantes. Je rêvais
d’une bière fraîche, aussi, pour apaiser ma gorge asséchée par des
heures de cris et d’efforts. Il avait fallu m’ouvrir le ventre au scalpel
pour t’en extraire. J’avais entendu la sage-femme dire : « Celui-ci a
tout compris de ce qui se passe au-dehors, il préfère rester au
chaud » avant que l’anesthésie ne m’emporte vers un état comateux
d’où je ne sortis que quelques heures après, la bouche rêche et le
ventre suturé. L’instinct maternel, ceux qui l’ont inventé ne savent
pas ce qu’ils disent, ils n’ont pas la moindre idée, ne sauraient qu’en
faire s’il s’agissait d’eux. Forfanterie et escroquerie. À notre
désavantage, il va sans dire.
Nos hormones ne nous font pas don d’un amour infini, non, il faut
arrêter cette fable. Si les femmes tuent moins, ce n’est pas par un
trop-plein de tendresse, c’est par dégoût de la violence contenue,
celle qui réside là, au creux de leur corps fécondable, propriété de
toute la société.
Le pouvoir de donner la vie, qu’on le veuille ou non, cette farce
tragique. Et à quel saint puis-je me vouer si je ne le veux pas, si mes
entrailles refusent ?
J’avais envie d’uriner mais il n’y avait personne pour m’aider à me
relever, j’aurais pu t’échanger contre une bière fraîche, alors je
pleurais en attendant d’apprendre à t’aimer.
voulu te planter là pour aller fumer une cigarette sur la barza de la
maternité malgré l’orage, malgré les jambes flageolantes. Je rêvais
d’une bière fraîche, aussi, pour apaiser ma gorge asséchée par des
heures de cris et d’efforts. Il avait fallu m’ouvrir le ventre au scalpel
pour t’en extraire. J’avais entendu la sage-femme dire : « Celui-ci a
tout compris de ce qui se passe au-dehors, il préfère rester au
chaud » avant que l’anesthésie ne m’emporte vers un état comateux
d’où je ne sortis que quelques heures après, la bouche rêche et le
ventre suturé. L’instinct maternel, ceux qui l’ont inventé ne savent
pas ce qu’ils disent, ils n’ont pas la moindre idée, ne sauraient qu’en
faire s’il s’agissait d’eux. Forfanterie et escroquerie. À notre
désavantage, il va sans dire.
Nos hormones ne nous font pas don d’un amour infini, non, il faut
arrêter cette fable. Si les femmes tuent moins, ce n’est pas par un
trop-plein de tendresse, c’est par dégoût de la violence contenue,
celle qui réside là, au creux de leur corps fécondable, propriété de
toute la société.
Le pouvoir de donner la vie, qu’on le veuille ou non, cette farce
tragique. Et à quel saint puis-je me vouer si je ne le veux pas, si mes
entrailles refusent ?
J’avais envie d’uriner mais il n’y avait personne pour m’aider à me
relever, j’aurais pu t’échanger contre une bière fraîche, alors je
pleurais en attendant d’apprendre à t’aimer.
Le jour où tu naquis, Bosco, je pleurai toutes les larmes de mon
corps. Et ce n’est pas la douleur qui sourdait de mon ventre en
charpie, ni la solitude immense s’abattant sur moi qui étaient la
cause de mon état de délabrement. Non. Le ciel tambourinait sans
pitié sur le toit en tôles de la maternité, le bruit des torrents d’eau
débordant des rigoles recouvrait les pleurs des nourrissons que les
mères épuisées tardaient à mettre au sein. Tu dormais, impassible,
indifférent aux manifestations de la grande saison des pluies, à mon
chagrin de parturiente qui retardait ma montée de lait. Cette attitude
de calme apparent que tu as toujours eue, dès les premières heures
de la vie, que tu portais sur le visage comme un masque, sans doute
l’avais-tu adoptée déjà à l’intérieur de moi quand alors il t’avait fallu
t’accrocher à mon utérus malgré les cahots, malgré les coups et les
barreaux. Vous enfanterez dans la violence. Vous êtes la douceur,
vous donnez la vie. Que d’injonctions paradoxales accrochées
arbitrairement par d’autres à nos existences, que de mensonges
rapiécés depuis mille ans et que nous nous devons de porter
dignement, parce qu’il fut décidé un jour que ça devait être ainsi et
pas autrement. C’est sans doute pour cela que nous apprenons à
louvoyer très tôt. Mentir comme on respire, pour accepter, se couler
dans cette arrangeante affabulation. L’instinct maternel, la belle
affaire. Parce que nous donnons plus souvent la vie que nous ne la
prenons, nous nous devrions d’être la solution humaine à la violence
des hommes.
corps. Et ce n’est pas la douleur qui sourdait de mon ventre en
charpie, ni la solitude immense s’abattant sur moi qui étaient la
cause de mon état de délabrement. Non. Le ciel tambourinait sans
pitié sur le toit en tôles de la maternité, le bruit des torrents d’eau
débordant des rigoles recouvrait les pleurs des nourrissons que les
mères épuisées tardaient à mettre au sein. Tu dormais, impassible,
indifférent aux manifestations de la grande saison des pluies, à mon
chagrin de parturiente qui retardait ma montée de lait. Cette attitude
de calme apparent que tu as toujours eue, dès les premières heures
de la vie, que tu portais sur le visage comme un masque, sans doute
l’avais-tu adoptée déjà à l’intérieur de moi quand alors il t’avait fallu
t’accrocher à mon utérus malgré les cahots, malgré les coups et les
barreaux. Vous enfanterez dans la violence. Vous êtes la douceur,
vous donnez la vie. Que d’injonctions paradoxales accrochées
arbitrairement par d’autres à nos existences, que de mensonges
rapiécés depuis mille ans et que nous nous devons de porter
dignement, parce qu’il fut décidé un jour que ça devait être ainsi et
pas autrement. C’est sans doute pour cela que nous apprenons à
louvoyer très tôt. Mentir comme on respire, pour accepter, se couler
dans cette arrangeante affabulation. L’instinct maternel, la belle
affaire. Parce que nous donnons plus souvent la vie que nous ne la
prenons, nous nous devrions d’être la solution humaine à la violence
des hommes.
Je suis arrivée devant la maison que nous avions toujours appelée
« chez nous » avec une désinvolture dont la fausseté me frappe
aujourd’hui. Le premier « chez-soi » ne peut être pris à la légère,
c’est cette part d’intimité qui reste tout au fond de nous, quoi qu’il
arrive.
« chez nous » avec une désinvolture dont la fausseté me frappe
aujourd’hui. Le premier « chez-soi » ne peut être pris à la légère,
c’est cette part d’intimité qui reste tout au fond de nous, quoi qu’il
arrive.
Une fois descendue du minibus, j’ai marché lentement le long de
la grand-route, mon sac sur le dos, le regard curieux des badauds
sur ma peau. J’avais envie de tout prendre en photo, chaque mur,
chaque croisement, les grands jacarandas alignés à intervalles
réguliers, les ombres qu’ils projetaient sur le goudron, le stade, la
mairie, la haie de la maison de Sarah recouverte d’une luxuriante
bougainvillée, la poste et son vieux palmier rabougri, l’hôtel Faucon,
l’ancienne laiterie, les lampadaires partiellement déracinés, le ciel
délavé où s’accrochaient des nuages en traînée, tout me faisait
chavirer de mélancolie. Ma tête s’est remplie de conversations et de
visages que je croyais oubliés, qui se sont mis à virevolter et se
cogner les uns aux autres, des insectes fous se heurtant en dedans
de ma mémoire atrophiée comme à l’intérieur d’une calebasse
asséchée.
la grand-route, mon sac sur le dos, le regard curieux des badauds
sur ma peau. J’avais envie de tout prendre en photo, chaque mur,
chaque croisement, les grands jacarandas alignés à intervalles
réguliers, les ombres qu’ils projetaient sur le goudron, le stade, la
mairie, la haie de la maison de Sarah recouverte d’une luxuriante
bougainvillée, la poste et son vieux palmier rabougri, l’hôtel Faucon,
l’ancienne laiterie, les lampadaires partiellement déracinés, le ciel
délavé où s’accrochaient des nuages en traînée, tout me faisait
chavirer de mélancolie. Ma tête s’est remplie de conversations et de
visages que je croyais oubliés, qui se sont mis à virevolter et se
cogner les uns aux autres, des insectes fous se heurtant en dedans
de ma mémoire atrophiée comme à l’intérieur d’une calebasse
asséchée.
Qu’est-ce qui avait changé ici ?
Peut-être que les centaines de milliers d’anciens exilés tutsi qui
étaient rentrés après la guerre avaient importé d’autres façons de
vivre, qu’on ne se préoccupait plus tant d’égrener les généalogies, à
moins que je n’aie dramatisé à outrance le souvenir des interactions
avec mes compatriotes d’autrefois, ces moments de présentation où
je me liquéfiais, prise au piège de ma carnation. J’étais surprise de
voir que la conversation prenait un autre tour, plus sinueux. Il ne me
demanda pas de parler de ma mère, ni de son mari. Il dit : « Tu es
partie en 94 ? », je hochai la tête. Puis il laissa un silence presque
complice s’installer. Il avait respecté mon mutisme en poussant
l’accélérateur en même temps que le volume de la radio qui diffusait
une rumba congolaise identique à celle qui passait sur Radio
Rwanda, trois ans auparavant. J’avais redressé la tête, laissant mon
regard se perdre dans les méandres de la route en macadam.
C’était la grande saison sèche, les collines étaient moins
verdoyantes que sur les photos du National Geographic, trouvé chez
un bouquiniste de Bordeaux à mon arrivée, que j’avais longtemps
punaisées sur les murs des différentes chambres occupées ces
dernières années. Le ciel était très clair, presque laiteux, on aurait dit
qu’il avait épuisé tout le bleu qu’il pouvait offrir aux hommes. Sur les
bas-côtés défilaient quelques pauvres maisons aux murs ocre,
flanquées d’une unique porte laissée cadenassée par des paysans
partis aux champs. Peu de passants, des enfants, un cerceau de
bois entre les mains, le dos cambré, le nombril pointant sous des
vêtements trop grands ou élimés, regardaient passer le minibus
avec circonspection et quand, au moment où nous allions les
dépasser, ils réalisaient qu’il y avait une Blanche à l’avant,
sursautaient, pris de court, trop tard pour la signaler au copain aux
pieds également nus qui arrivait sur le sentier derrière. Juste le
temps d’hésiter entre un salut frénétique à moi seule destiné et le
doigt tendu pour me désigner au camarade en même temps que le
mot « muzungu » sortait de leur bouche arrondie, lâchant un petit cri
qui pénétrait, déformé, par la fenêtre abaissée du véhicule, juste
avant que nous le dépassions.
Qu’est-ce qui avait changé ici ? Il y avait encore des enfants,
vivants et curieux.
Nous avons dépassé Gitarama, Ruhango, Ruhashya, Nyanza, où
tu avais fait ton lycée, Mama. Et quand le minibus s’est arrêté à
Rubona pour déposer quelques passagers, mon cœur a fait une
embardée vers le souvenir confus de ce lieu où je savais que mon
père et toi vous étiez connus.
Lorsque, enfant, nous approchions en voiture de la grande
bambouseraie qui marque le virage vers l’Institut de recherche
agronomique de Rubona où tu travaillais au commencement de la
décennie 70, ton visage se fermait brusquement et ta voix perdait
toute inflexion.
Peut-être que les centaines de milliers d’anciens exilés tutsi qui
étaient rentrés après la guerre avaient importé d’autres façons de
vivre, qu’on ne se préoccupait plus tant d’égrener les généalogies, à
moins que je n’aie dramatisé à outrance le souvenir des interactions
avec mes compatriotes d’autrefois, ces moments de présentation où
je me liquéfiais, prise au piège de ma carnation. J’étais surprise de
voir que la conversation prenait un autre tour, plus sinueux. Il ne me
demanda pas de parler de ma mère, ni de son mari. Il dit : « Tu es
partie en 94 ? », je hochai la tête. Puis il laissa un silence presque
complice s’installer. Il avait respecté mon mutisme en poussant
l’accélérateur en même temps que le volume de la radio qui diffusait
une rumba congolaise identique à celle qui passait sur Radio
Rwanda, trois ans auparavant. J’avais redressé la tête, laissant mon
regard se perdre dans les méandres de la route en macadam.
C’était la grande saison sèche, les collines étaient moins
verdoyantes que sur les photos du National Geographic, trouvé chez
un bouquiniste de Bordeaux à mon arrivée, que j’avais longtemps
punaisées sur les murs des différentes chambres occupées ces
dernières années. Le ciel était très clair, presque laiteux, on aurait dit
qu’il avait épuisé tout le bleu qu’il pouvait offrir aux hommes. Sur les
bas-côtés défilaient quelques pauvres maisons aux murs ocre,
flanquées d’une unique porte laissée cadenassée par des paysans
partis aux champs. Peu de passants, des enfants, un cerceau de
bois entre les mains, le dos cambré, le nombril pointant sous des
vêtements trop grands ou élimés, regardaient passer le minibus
avec circonspection et quand, au moment où nous allions les
dépasser, ils réalisaient qu’il y avait une Blanche à l’avant,
sursautaient, pris de court, trop tard pour la signaler au copain aux
pieds également nus qui arrivait sur le sentier derrière. Juste le
temps d’hésiter entre un salut frénétique à moi seule destiné et le
doigt tendu pour me désigner au camarade en même temps que le
mot « muzungu » sortait de leur bouche arrondie, lâchant un petit cri
qui pénétrait, déformé, par la fenêtre abaissée du véhicule, juste
avant que nous le dépassions.
Qu’est-ce qui avait changé ici ? Il y avait encore des enfants,
vivants et curieux.
Nous avons dépassé Gitarama, Ruhango, Ruhashya, Nyanza, où
tu avais fait ton lycée, Mama. Et quand le minibus s’est arrêté à
Rubona pour déposer quelques passagers, mon cœur a fait une
embardée vers le souvenir confus de ce lieu où je savais que mon
père et toi vous étiez connus.
Lorsque, enfant, nous approchions en voiture de la grande
bambouseraie qui marque le virage vers l’Institut de recherche
agronomique de Rubona où tu travaillais au commencement de la
décennie 70, ton visage se fermait brusquement et ta voix perdait
toute inflexion.
Qu’est-ce qui avait changé ici ? Moi. Le regard nostalgique et
amer que je posais sur toute chose. Ce qui avait été déchiqueté. Je
n’étais pas sûre d’avoir la force de reconstituer la relation avec toi
après trois longues années de silence entrecoupées de
conversations téléphoniques maladroites et de courtes lettres
sibyllines.
Retrouvailles de cœurs en lambeaux.
amer que je posais sur toute chose. Ce qui avait été déchiqueté. Je
n’étais pas sûre d’avoir la force de reconstituer la relation avec toi
après trois longues années de silence entrecoupées de
conversations téléphoniques maladroites et de courtes lettres
sibyllines.
Retrouvailles de cœurs en lambeaux.
Il y avait encore des places libres dans notre minibus et mon
voisin de droite aurait très bien pu aller s’asseoir derrière plutôt que
de rester à mes côtés, mais il espérait sans doute ainsi glaner
quelques informations sur cette étrange passagère du jour levant. Il
fixait la route, les oreilles dressées, jetant parfois un œil sur le sac à
dos entrouvert que j’avais posé à nos pieds. L’étiquette « voyage
cabine » de la compagnie avec laquelle j’avais voyagé, Brussels
Airlines, devait lui faire croire que j’étais belge. Savait-il qu’Air
France ne venait plus ici depuis 1994 ?
Une fois quittée la cuvette de Nyabugogo qui commençait à
s’animer, forçant le conducteur à faire preuve d’une extrême
vigilance pour ne pas écraser les piétons qui longeaient, nombreux,
imprudents, la route goudronnée, il s’était tourné vers moi pour
poser la première question, simple mais déjà trop impudique pour
nos codes ancestraux, où toute marque de curiosité est malséante :
« Alors, tu es d’ici ?
— Bien sûr que je suis d’ici, t’imagines-tu que j’aurais pu
apprendre aussi bien notre langue ailleurs ? Je suis née et j’ai grandi
ici. » J’avais été surprise par le ton étonnamment grave que je
venais de prendre pour dire cela, ma voix résonnant en moi, au
ralenti, comme si je m’entendais dans un combiné de téléphone par
temps d’orage. Et j’avais baissé la tête, regardant mes mains posées
le plus sagement du monde sur mes cuisses. Je savais, parce que je
l’avais si souvent attendue, cette question gênante, que suivrait
l’injonction à révéler mon origine, non pas ma race comme certains
disaient encore, parce qu’il aurait fallu être sot pour ignorer ma peau
exactement entre le noir et le blanc, mes cheveux clairs, légèrement
crépus, pour savoir où me situer, à la frontière entre l’Europe et
l’Afrique. Non, celle que l’on pose innocemment à tant d’enfants :
« Qui sont tes parents ? » J’attendais cette question avec la même
anxiété qu’au temps d’avant et dans ma tête mes pensées
chiffonnées étaient semblables à un drap blanc fatigué de la longue
nuit de mon absence, dans les replis duquel je cherchais une aiguille
pour reprendre mon ouvrage de mémoire. Mais n’est-ce pas pour
cela que j’étais revenue ici, pour tisser une virgule entre hier et
demain et retrouver le fil de ma vie ? J’attendais. Le taximan ne me
posa pas la question.
voisin de droite aurait très bien pu aller s’asseoir derrière plutôt que
de rester à mes côtés, mais il espérait sans doute ainsi glaner
quelques informations sur cette étrange passagère du jour levant. Il
fixait la route, les oreilles dressées, jetant parfois un œil sur le sac à
dos entrouvert que j’avais posé à nos pieds. L’étiquette « voyage
cabine » de la compagnie avec laquelle j’avais voyagé, Brussels
Airlines, devait lui faire croire que j’étais belge. Savait-il qu’Air
France ne venait plus ici depuis 1994 ?
Une fois quittée la cuvette de Nyabugogo qui commençait à
s’animer, forçant le conducteur à faire preuve d’une extrême
vigilance pour ne pas écraser les piétons qui longeaient, nombreux,
imprudents, la route goudronnée, il s’était tourné vers moi pour
poser la première question, simple mais déjà trop impudique pour
nos codes ancestraux, où toute marque de curiosité est malséante :
« Alors, tu es d’ici ?
— Bien sûr que je suis d’ici, t’imagines-tu que j’aurais pu
apprendre aussi bien notre langue ailleurs ? Je suis née et j’ai grandi
ici. » J’avais été surprise par le ton étonnamment grave que je
venais de prendre pour dire cela, ma voix résonnant en moi, au
ralenti, comme si je m’entendais dans un combiné de téléphone par
temps d’orage. Et j’avais baissé la tête, regardant mes mains posées
le plus sagement du monde sur mes cuisses. Je savais, parce que je
l’avais si souvent attendue, cette question gênante, que suivrait
l’injonction à révéler mon origine, non pas ma race comme certains
disaient encore, parce qu’il aurait fallu être sot pour ignorer ma peau
exactement entre le noir et le blanc, mes cheveux clairs, légèrement
crépus, pour savoir où me situer, à la frontière entre l’Europe et
l’Afrique. Non, celle que l’on pose innocemment à tant d’enfants :
« Qui sont tes parents ? » J’attendais cette question avec la même
anxiété qu’au temps d’avant et dans ma tête mes pensées
chiffonnées étaient semblables à un drap blanc fatigué de la longue
nuit de mon absence, dans les replis duquel je cherchais une aiguille
pour reprendre mon ouvrage de mémoire. Mais n’est-ce pas pour
cela que j’étais revenue ici, pour tisser une virgule entre hier et
demain et retrouver le fil de ma vie ? J’attendais. Le taximan ne me
posa pas la question.
Le lendemain, je m’étais réveillée aux aurores. Je m’étais assise
sur la terrasse de la maison, emmitouflée dans une couverture, pour
regarder la ville en contrebas, encore prise dans la brume montant
de la vallée, s’éveiller. Qu’est-ce qui avait changé ici ? Je n’aurais su
le dire, je connaissais à peine Kigali. Mais je retrouvais les sons,
ceux des tourterelles qui chantent « sogokulu gugu ! Nyogokuru
gugu ! », les battements d’ailes des colibris qui volaient déjà au-
dessus de la haie d’hibiscus roses entourant le jardin de mon amie.
Une odeur de feu de bois toute proche, une moto qui pétarade
quelque part, la voix portée par le petit vent des plus matinaux, déjà
sur la route, qui se saluaient « Ese mwaramukanye amahoro ?,
Vous êtes-vous réveillés en paix ? »
Ainsi, on parlait de nouveau de paix avec désinvolture, dès le
lever du jour, ici.
Je m’étais remplie de chaque bribe de beauté qu’offrait ce premier
petit matin au parfum de souvenance.
sur la terrasse de la maison, emmitouflée dans une couverture, pour
regarder la ville en contrebas, encore prise dans la brume montant
de la vallée, s’éveiller. Qu’est-ce qui avait changé ici ? Je n’aurais su
le dire, je connaissais à peine Kigali. Mais je retrouvais les sons,
ceux des tourterelles qui chantent « sogokulu gugu ! Nyogokuru
gugu ! », les battements d’ailes des colibris qui volaient déjà au-
dessus de la haie d’hibiscus roses entourant le jardin de mon amie.
Une odeur de feu de bois toute proche, une moto qui pétarade
quelque part, la voix portée par le petit vent des plus matinaux, déjà
sur la route, qui se saluaient « Ese mwaramukanye amahoro ?,
Vous êtes-vous réveillés en paix ? »
Ainsi, on parlait de nouveau de paix avec désinvolture, dès le
lever du jour, ici.
Je m’étais remplie de chaque bribe de beauté qu’offrait ce premier
petit matin au parfum de souvenance.
J’avais atterri la veille au soir avec la résolution de ne pas passer
plus d’une nuit à Kigali et de demander dès le lendemain à ma
nouvelle amie Laura de me conduire à la gare routière pour
descendre vers le sud. C’était la seule que j’avais informée de mon
voyage, parce que j’avais besoin d’un point de chute dans le pays,
parce que je savais qu’elle garderait le secret le temps qu’il faudrait,
elle l’étrangère rencontrée quelques mois auparavant chez des amis
de Bordeaux. Quand elle avait dit, au détour d’une conversation à
peine audible, au milieu des rires et de la musique, qu’elle partait
travailler la semaine suivante au Rwanda, j’avais voulu y voir un
signe. Je m’étais décidée le jour même à acheter un billet d’avion
mais j’ignorais encore si j’allais avoir la détermination suffisante pour
l’utiliser. Laura avait dépassé la quarantaine, elle offrait le regard
taciturne de celle qui est allée sauver l’espoir des plus sombres
retranchements de l’âme humaine, et un sourire étonnamment
serein. Le lendemain, je prenais un café avec elle et je lui racontais
toute mon histoire, d’une traite, comme je ne l’avais jamais fait avec
personne. Pourquoi elle ? Je l’ignore. À Samora je n’avais lâché
qu’un à un mes lambeaux d’existence, avec une infime précaution,
craignant sans doute de le faire fuir ou, pire, de lui faire pitié. Laura
m’avait convaincue du bien-fondé de ce voyage. Je m’étais sentie
prête.
plus d’une nuit à Kigali et de demander dès le lendemain à ma
nouvelle amie Laura de me conduire à la gare routière pour
descendre vers le sud. C’était la seule que j’avais informée de mon
voyage, parce que j’avais besoin d’un point de chute dans le pays,
parce que je savais qu’elle garderait le secret le temps qu’il faudrait,
elle l’étrangère rencontrée quelques mois auparavant chez des amis
de Bordeaux. Quand elle avait dit, au détour d’une conversation à
peine audible, au milieu des rires et de la musique, qu’elle partait
travailler la semaine suivante au Rwanda, j’avais voulu y voir un
signe. Je m’étais décidée le jour même à acheter un billet d’avion
mais j’ignorais encore si j’allais avoir la détermination suffisante pour
l’utiliser. Laura avait dépassé la quarantaine, elle offrait le regard
taciturne de celle qui est allée sauver l’espoir des plus sombres
retranchements de l’âme humaine, et un sourire étonnamment
serein. Le lendemain, je prenais un café avec elle et je lui racontais
toute mon histoire, d’une traite, comme je ne l’avais jamais fait avec
personne. Pourquoi elle ? Je l’ignore. À Samora je n’avais lâché
qu’un à un mes lambeaux d’existence, avec une infime précaution,
craignant sans doute de le faire fuir ou, pire, de lui faire pitié. Laura
m’avait convaincue du bien-fondé de ce voyage. Je m’étais sentie
prête.
Je suis allée me coucher dans ma chambre. Pouvais-je encore la
désigner ainsi, cette pièce que j’avais occupée pendant plus de vingt
ans ? Lorsque j’étais apparue sur le seuil de notre maison, j’avais
éprouvé cette sensation délicate d’être une étrangère chez soi.
désigner ainsi, cette pièce que j’avais occupée pendant plus de vingt
ans ? Lorsque j’étais apparue sur le seuil de notre maison, j’avais
éprouvé cette sensation délicate d’être une étrangère chez soi.
Mon voyage de retour.
Je croyais l’avoir accompli en venant dans cette maison de la
grand-rue de Butare où j’ai grandi à tes côtés. Pour toi, désormais,
j’étais de là-bas. Ton fils était un revenant, moi je n’étais plus qu’une
passante, une plante exotique importée, qui aurait mal supporté la
vie sous tes latitudes et qui avait enfin été rempotée dans son
terreau d’origine. Une Française.
Je croyais l’avoir accompli en venant dans cette maison de la
grand-rue de Butare où j’ai grandi à tes côtés. Pour toi, désormais,
j’étais de là-bas. Ton fils était un revenant, moi je n’étais plus qu’une
passante, une plante exotique importée, qui aurait mal supporté la
vie sous tes latitudes et qui avait enfin été rempotée dans son
terreau d’origine. Une Française.
Le désenchantement m’était tombé dessus avec d’autant plus de force. Depuis mon grand effondrement, je voyais les choses avec une acuité exacerbée, j’avais cessé de viser le sommet, de vouloir conquérir le monde avec mon esprit et m’attardais à regarder plus bas, du côté des cœurs. Travailler avec des êtres rabougris me convenait parfaitement. Je voulais désormais arpenter ce territoire médian, me pencher sur ces têtes qui ne pouvaient plus me surplomber d’une quelconque autorité. J’allais plonger dans leurs regards fatigués avec l’espoir d’y trouver des explications aux questions apparues lorsque j’avais arraché mes œillères : le mépris, le rejet, le déni. Je pensais devoir aller chercher les réponses à leur racine, dans la génération qui avait façonné le monde actuel, au lendemain de la guerre mondiale, chez ceux qui avaient fait venir mes parents et ceux de mon mari en France, une main d’œuvre bon marché dont ils ne voulaient imaginer qu’elle allait planter sur leur terre des milliers de pousses rebelles.
Alors autant que, dès à présent, on se passe des faux semblants ; ils pensaient en me voyant que j’étais une négresse, il fallait que je le sache.
Ma main n’en serait que plus généreuse et ferme à leur égard. J’allais leur montrer toute l’étendue de mon humanité.
Alors autant que, dès à présent, on se passe des faux semblants ; ils pensaient en me voyant que j’étais une négresse, il fallait que je le sache.
Ma main n’en serait que plus généreuse et ferme à leur égard. J’allais leur montrer toute l’étendue de mon humanité.
Ceux qui disent que nous sommes bavardes ignorent tout des fleuves de mots que nous taisons. (Immaculata, p. 41)
Ce que l'exil a fait d'eux. Le médecin devenu aide-soignant, le mathématicien conduisant un taxi, le mécanicien faisant la plonge, et la silence devenait la loi. Sauf au bar-pays où on buvait sa chiche paye le samedi en refaisant la révolution pour une capitale où on ne retournerait sans doute jamais même si on se l'était promis, à la retraite on irait. En attendant ici profil bas les enfants iront à l'école de "Lafrance", on les voyait peu, le travail pour les gens comme eux c'était trop tôt ou trop tard, et à force de labeur, envoyer aussi de l'argent au pays, le temps passait, les enfants avaient grandi, le corps était fourbu, les rêves enterrés. Pour la nouvelle génération, ça n'était plus le contremaître, mais le flic, qui faisit trembler, et souvent au bout se trouvait la prison. une honte qui n'avait pas de nom.
(pp.356-357)
(pp.356-357)
Plus tard, j'apprendrais que de nombreux Hutu avaient à la fois caché des proches et tué des inconnus, emportés par l'impératif de l'extermination, pour ne pas éveiller les soupçons, parce qu'il leur fut difficile d'être courageux plus d'une semaine ou d'un mois.
Langue trop pendue finit par toucher le sol.
... dans ma tête, mes pensées chiffonnées étaient semblables à un drap fatigué de la longue nuit de mon absence, dans lesquels je recherchais une aiguille pour reprendre mon ouvrage de mémoire.
Les puissances étrangères....ne firent rien contre notre extermination. Nous entendions les discours haineux à la radio et nous restâmes longtemps accrochés à l'espoir qu'ils ne mettraient jamais leurs menaces à exécution. Dieu et le monde assistérent à notre élimination les yeux fermés.
A quoi cela nous a-t-il menés, tous ces sentiments camouflés ?Si nous avions accepté de regarder en face la gêne qui montait dans les regards, peut-être aurions-nous fui à temps. Ce sont les autres qui ont écrit notre récit national pétri de clichés et de mythes éculés.
Je songeais à ce qu'aurait été la vie de mes parents s'ils avaient la maîtrise du sens dj progrès qu'on leur avait imposé sans leur demandet leur avis, ni même prendre la peine de leur dévoiler lestermes du contrat.
Ces arbres symbolisaient quelquechose de fondamental, ce qu'ils avaient été autrefois à trois, avant et après que la famille tombe en lambeaux.
A quoi cela nous a-t-il menés, tous ces sentiments camouflés ?Si nous avions accepté de regarder en face la gêne qui montait dans les regards, peut-être aurions-nous fui à temps. Ce sont les autres qui ont écrit notre récit national pétri de clichés et de mythes éculés.
Je songeais à ce qu'aurait été la vie de mes parents s'ils avaient la maîtrise du sens dj progrès qu'on leur avait imposé sans leur demandet leur avis, ni même prendre la peine de leur dévoiler lestermes du contrat.
Ces arbres symbolisaient quelquechose de fondamental, ce qu'ils avaient été autrefois à trois, avant et après que la famille tombe en lambeaux.
Revenir en arrière pour en découdre avec ses erreurs et reprendre en main la trame de son histoire.
Tant de choses étranges se sont passées dans ce pays, l'humanité s'est dévoyée dans une proportion telle que, pour certains, rester debout, se saluer, être encore capable de croire aux capacités communicatives d'une accolade relève d'un miracle.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Beata Umubyeyi Mairesse
Lecteurs de Beata Umubyeyi Mairesse (684)Voir plus
Quiz
Voir plus
Politique et littérature
Les Romantiques français, dans leur jeunesse, étaient plutôt réactionnaires et monarchistes. Quel est celui qui a connu une évolution qui l’a conduit à être élu sénateur siégeant plutôt à gauche ?
Stendhal
Chateaubriand
Hugo
Mérimée
11 questions
298 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur298 lecteurs ont répondu