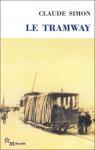Critiques de Claude Simon (123)
A la recherche des temps perdus…
L'Herbe fait partie de ces livres, vous savez ces livres que nous qualifions peu à peu de chef d'oeuvre au fur et à mesure de notre lecture tant nous sommes émerveillés, conscients de la plume magnifique et singulière qui se déploie sous nos yeux, qui nous enveloppe, cette plume d'ailleurs qui ne veut jamais s'arrêter de voler avec Claude Simon, de précisément énoncer, de préciser, cette plume qui ne cesse de vouloir épingler l'indicible, qui arrive à étirer le temps, l'allonger, l'accélérer, à coups de parenthèses enchâssées en autant de tableaux fragmentés et sensibles.
Je ne remercierais jamais assez Anna (@Annacan) qui, en me mettant sur le chemin de l'acacia, m'a d'abord fait faire un détour dans L'Herbe sur laquelle je me suis en premier lieu assise prudemment, puis couchée avec confiance, pour finir par me rouler dedans, avec délectation. Je viens de découvrir un auteur incroyable. Claude Simon, Prix Nobel de littérature en 1985. Je n'ai aucune base de comparaison avec ses autres livres, celui-ci étant le premier de cet auteur que je lis, et sa plume fait partie sans conteste des expériences de littérature dont je raffole tant.
« Louise, maintenant étendue dans l'herbe, inerte, sans un mouvement, comme morte, pouvant voir au-dessus d'elle le ciel devenu semblable à une plaque de verre devant laquelle ou plutôt sur laquelle semblaient peintes les petites feuilles en forme de coeur, d'un vert presque noir maintenant, dessinées avec précision, avec leurs fines et délicates nervures ton sur ton, et, à présent, parfaitement immobiles elles aussi, les branches parfaitement immobiles, l'air immobile, tandis que s'apaisait en elle par degrés ce tumulte, cette rumeur : éprouvant cette sensation du nageur qui remonte à la surface, traversant l'une après l'autre les couches successives, de plus en plus lumineuses, reprenant conscience de son poids, comme si la terre sous elle se reconstituait, reprenait peu à peu sa rude et dure consistance, pouvant percevoir, incrustés dans son dos, chacun des brins d'herbe écrasés, comme si elle pouvait voir (aux saillies de son corps, aux omoplates, aux reins) les taches jaune-vert sur sa robe claire, sentant l'odeur, la senteur végétale, humide, la pénétrant, comme si ce n'était pas de l'herbe foulées qu'elle s'exhalait mais des profondeurs, du sein même de la terre, pensant : Voilà. Je suis morte -, pensant : C'est bien. J'étais tellement fatiguée, tellement… ».
L'histoire pourtant semble banale de prime abord : Louise souhaite quitter son mari, Georges, et a d'ailleurs un amant. La vieille tante de Georges, Marie, vit ses derniers jours et pour cette raison la famille se réunit autour d'elle. Il y son frère Pierre et sa femme Sabine, leur fils Georges et donc leur belle fille Louise. Huit-clos d'une dizaine de jours.
Marie, ancienne institutrice issue d'une famille rurale du début du XXème siècle, a tout sacrifié avec sa soeur Eugénie, pour élever le petit frère Pierre, de quinze ans son cadet, et en faire un professeur.
Louise traverse ainsi une double crise : celle de la mort d'un être cher, qui l'aime sans rien demander en retour, et qui l'a toujours interpellée et celle d'une décision à prendre. Louise, en partant, pourra-t-elle se libérer de l'emprise d'une belle-famille provinciale bourgeoise et décadente ? Marie, en lui léguant, à elle, elle "qui ne lui est rien", une vieille boite à berlingots rouillée dans laquelle il y a quelques bijoux et des carnets de compte, ne l'oblige-t-elle pas ?
Voilà donc le drame provincial bien anodin qui constitue la trame de ce livre. de ce drame, Claude Simon va faire un chef d'oeuvre.
La jeune femme est secouée par des émotions contraires et, en se plaçant de son point de vue, Claude Simon va restituer à la perfection l'expérience de la jeune femme en nous donnant à vivre ses émotions à l'aune des sens : sons, odeurs, vue…
Des odeurs de roses fanées, l'entêtante senteur des poires pourrissantes, donnent une ambiance surannée à ce livre, un charme indéfinissable, la nostalgie des campagnes provinciales. Dans lesquelles il y a « Rien que cet entêtant et sans doute imaginaire parfum de fraîcheur, de virginité et de temps accumulé ».
Les sons d'insectes, de train, de monologues absurdes (les monologues pathétiques de Sabine m'ont fait penser aux tropismes de Nathalie Sarraute) et d'échanges mouvementés rythment ce récit, parenthèse hors du temps.
La vue enfin, comme ceux des visages : la vue du visage de Marie comme momifié, de celui de Sabine, masqué par le lourd maquillage et les bijoux, de celui de Pierre, enflé par l'embonpoint, permet de voir les effets ravageurs du temps et de la vieillesse, ou plutôt l'essence de chaque être qui se dévoilerait précisément en vieillissant.
Avec la mise en valeur des sens, Claude Simon nous donne à contempler des tableaux fragmentés immersifs comme cette scène où chacune des femmes, Louise et Sabine, sont dans leurs salles de bain respectives séparées par une mince paroi (nous avons l'impression d'assister à une scène de théâtre avec un plan en coupe de la maison, les deux femmes parallèles l'une et l'autre par rapport aux éviers). Louise, tout en fixant son propre regard dans le miroir, figée, entend la scène de jalousie pathétique de Sabine envers Pierre qui se joue de l'autre côté du miroir, imaginant sa belle-mère sur le déclin, aux cheveux teints en rouge, outrageusement maquillés, aux nombreux énormes bijoux cliquetants, dans un décor rococo avec des meubles délicats et précieux, sur un tapis aux roses délicat, vêtue de son peignoir sur lequel sont peints des fleurs, des lianes, tandis qu'elle, jeune et belle, est dans la quasi-obscurité, contraste saisissant entre les deux lieus. Tableau sombre et fixe d'un côté, tableau clair et en mouvement de l'autre…Le décor rococo qu'imagine Louise s'abat sur elle lorsque le couple à côté vient à tomber suite à une dispute, et la projette en même temps dans ses souvenirs, dehors, sur l'herbe avec son amant, allongés par terre…c'est une scène inoubliable où se mélangent différents tableaux de longueurs inégales, des tableaux sombres et des tableaux clairs, et où le temps est mélangé entre le présent, le passé, le réel et les souvenirs, où le passage de l'un à l'autre des tableaux se fait par des correspondances que met en place l'auteur grâce à la magie de son écriture. du grand grand art !
Avec cette exemple de scène, nous touchons ici à l'un des piliers du roman à savoir le temps qui passe, non linéaire car différent de ce que nous percevons, avançant plutôt en spirales dans nos têtes, en allers-retours incessants entre le présent, le passé et le futur, entre le réel, les souvenirs et les fantasmes. Mais en même temps, cette perception du temps non linéaire vient se fracasser au temps tel qu'il s'écoule dans la réalité, inexorable et bien linéaire, comme le montre par exemple le rayon de soleil, la poudroyante lumière de l'été s'immisçant dans une fente, en forme de T, qui traverse chaque jour les volets de la chambre de Marie à l'agonie se déplaçant d'un mur à l'autre, comme le prouve également le train qui passe, s'arrête et s'éloigne chaque jour à heures fixes ou encore comme le démontrent les carnets de Marie qui, jour après jour, inexorablement, donnent toutes les dépenses, les menues dépenses comme les plus grandes. le temps s'inscrit dans une « terrifiante répétition, une terrifiante suite de jours ».
A noter que la construction du roman même n'est pas linéaire. Nous ne voyons pas ces dix jours de réunion familiale, nous découvrons un entrelacement de temps présent, laissant place tout à coup, alors qu'un sens est mis en branle, au temps passé (soit un souvenir de Louise, soit une scène du passé de Marie que tente d'imaginer Louise, soit encore un reproche obsessionnelle de Sabine envers son mari qui date de quarante ans), laissant ensuite place d'un coup à une scène d'amour dans l'herbe fantasmée, imaginée ou déjà vécue, nous ne savons pas. C'est bien toute l'originalité de ce roman que de parler de la différence de perception entre temps vécu et temps objectif en se basant sur une construction elle-même éclatée…
Autre pilier du roman, l'antagonisme entre la vie et la mort, entre le végétal et le minéral, omniprésent. Alors que Marie vit une agonie de plusieurs jours, la vie semble cependant bruisser de partout. Déjà, malgré son état, la mort ne vient pas, le coeur ne cède pas, comme la syntaxe de l'auteur d'ailleurs, vivante, jaillissante…Ensuite, les insectes et les oiseaux dont les chants sont sans cesse décrits, sont symboles de vie ainsi que la nature, envahissante, cyclique, « l'inconsciente et folle végétation des hélianthes, leurs longues tiges s'entrecroisant, se bousculant, s'emmêlant, se détachant en clair sur le fond noir du fourré de rondes dans le bourdonnement des insectes », la nature indifférente aux petites histoires des humains. Ce que voudrait fuir Louise pour garder le contrôle de sa vie, soit par la petite mort de l'orgasme, soit en s'imaginant mourir alors qu'elle est allongée dans l'herbe, comme pétrifiée, heureuse de se confondre avec l'herbe…
Je ressors admirative et émue de cette lecture exigeante. Je suis certaine que chaque relecture de ce livre donnerait à comprendre des éléments non appréhendés auparavant. Ceci est la force des chefs-d'oeuvre. En plus de l'écriture somptueuse avec laquelle il faut savoir se laisser porter, se laisser bercer, et qui demande parfois une lecture à voix haute pour en savourer toute la beauté, les thèmes du temps et de la mort sont omniprésents et sources de multiples messages de la part de l'auteur. Oui, il fait partie de ses livres, énigmatiques, le mystère se nichant derrière les très longues phrases, qui nous hantent une fois terminés et que nous relirons, assurément…
Énorme coup de coeur, de ceux qui marquent la vie d'un lecteur.
L'Herbe fait partie de ces livres, vous savez ces livres que nous qualifions peu à peu de chef d'oeuvre au fur et à mesure de notre lecture tant nous sommes émerveillés, conscients de la plume magnifique et singulière qui se déploie sous nos yeux, qui nous enveloppe, cette plume d'ailleurs qui ne veut jamais s'arrêter de voler avec Claude Simon, de précisément énoncer, de préciser, cette plume qui ne cesse de vouloir épingler l'indicible, qui arrive à étirer le temps, l'allonger, l'accélérer, à coups de parenthèses enchâssées en autant de tableaux fragmentés et sensibles.
Je ne remercierais jamais assez Anna (@Annacan) qui, en me mettant sur le chemin de l'acacia, m'a d'abord fait faire un détour dans L'Herbe sur laquelle je me suis en premier lieu assise prudemment, puis couchée avec confiance, pour finir par me rouler dedans, avec délectation. Je viens de découvrir un auteur incroyable. Claude Simon, Prix Nobel de littérature en 1985. Je n'ai aucune base de comparaison avec ses autres livres, celui-ci étant le premier de cet auteur que je lis, et sa plume fait partie sans conteste des expériences de littérature dont je raffole tant.
« Louise, maintenant étendue dans l'herbe, inerte, sans un mouvement, comme morte, pouvant voir au-dessus d'elle le ciel devenu semblable à une plaque de verre devant laquelle ou plutôt sur laquelle semblaient peintes les petites feuilles en forme de coeur, d'un vert presque noir maintenant, dessinées avec précision, avec leurs fines et délicates nervures ton sur ton, et, à présent, parfaitement immobiles elles aussi, les branches parfaitement immobiles, l'air immobile, tandis que s'apaisait en elle par degrés ce tumulte, cette rumeur : éprouvant cette sensation du nageur qui remonte à la surface, traversant l'une après l'autre les couches successives, de plus en plus lumineuses, reprenant conscience de son poids, comme si la terre sous elle se reconstituait, reprenait peu à peu sa rude et dure consistance, pouvant percevoir, incrustés dans son dos, chacun des brins d'herbe écrasés, comme si elle pouvait voir (aux saillies de son corps, aux omoplates, aux reins) les taches jaune-vert sur sa robe claire, sentant l'odeur, la senteur végétale, humide, la pénétrant, comme si ce n'était pas de l'herbe foulées qu'elle s'exhalait mais des profondeurs, du sein même de la terre, pensant : Voilà. Je suis morte -, pensant : C'est bien. J'étais tellement fatiguée, tellement… ».
L'histoire pourtant semble banale de prime abord : Louise souhaite quitter son mari, Georges, et a d'ailleurs un amant. La vieille tante de Georges, Marie, vit ses derniers jours et pour cette raison la famille se réunit autour d'elle. Il y son frère Pierre et sa femme Sabine, leur fils Georges et donc leur belle fille Louise. Huit-clos d'une dizaine de jours.
Marie, ancienne institutrice issue d'une famille rurale du début du XXème siècle, a tout sacrifié avec sa soeur Eugénie, pour élever le petit frère Pierre, de quinze ans son cadet, et en faire un professeur.
Louise traverse ainsi une double crise : celle de la mort d'un être cher, qui l'aime sans rien demander en retour, et qui l'a toujours interpellée et celle d'une décision à prendre. Louise, en partant, pourra-t-elle se libérer de l'emprise d'une belle-famille provinciale bourgeoise et décadente ? Marie, en lui léguant, à elle, elle "qui ne lui est rien", une vieille boite à berlingots rouillée dans laquelle il y a quelques bijoux et des carnets de compte, ne l'oblige-t-elle pas ?
Voilà donc le drame provincial bien anodin qui constitue la trame de ce livre. de ce drame, Claude Simon va faire un chef d'oeuvre.
La jeune femme est secouée par des émotions contraires et, en se plaçant de son point de vue, Claude Simon va restituer à la perfection l'expérience de la jeune femme en nous donnant à vivre ses émotions à l'aune des sens : sons, odeurs, vue…
Des odeurs de roses fanées, l'entêtante senteur des poires pourrissantes, donnent une ambiance surannée à ce livre, un charme indéfinissable, la nostalgie des campagnes provinciales. Dans lesquelles il y a « Rien que cet entêtant et sans doute imaginaire parfum de fraîcheur, de virginité et de temps accumulé ».
Les sons d'insectes, de train, de monologues absurdes (les monologues pathétiques de Sabine m'ont fait penser aux tropismes de Nathalie Sarraute) et d'échanges mouvementés rythment ce récit, parenthèse hors du temps.
La vue enfin, comme ceux des visages : la vue du visage de Marie comme momifié, de celui de Sabine, masqué par le lourd maquillage et les bijoux, de celui de Pierre, enflé par l'embonpoint, permet de voir les effets ravageurs du temps et de la vieillesse, ou plutôt l'essence de chaque être qui se dévoilerait précisément en vieillissant.
Avec la mise en valeur des sens, Claude Simon nous donne à contempler des tableaux fragmentés immersifs comme cette scène où chacune des femmes, Louise et Sabine, sont dans leurs salles de bain respectives séparées par une mince paroi (nous avons l'impression d'assister à une scène de théâtre avec un plan en coupe de la maison, les deux femmes parallèles l'une et l'autre par rapport aux éviers). Louise, tout en fixant son propre regard dans le miroir, figée, entend la scène de jalousie pathétique de Sabine envers Pierre qui se joue de l'autre côté du miroir, imaginant sa belle-mère sur le déclin, aux cheveux teints en rouge, outrageusement maquillés, aux nombreux énormes bijoux cliquetants, dans un décor rococo avec des meubles délicats et précieux, sur un tapis aux roses délicat, vêtue de son peignoir sur lequel sont peints des fleurs, des lianes, tandis qu'elle, jeune et belle, est dans la quasi-obscurité, contraste saisissant entre les deux lieus. Tableau sombre et fixe d'un côté, tableau clair et en mouvement de l'autre…Le décor rococo qu'imagine Louise s'abat sur elle lorsque le couple à côté vient à tomber suite à une dispute, et la projette en même temps dans ses souvenirs, dehors, sur l'herbe avec son amant, allongés par terre…c'est une scène inoubliable où se mélangent différents tableaux de longueurs inégales, des tableaux sombres et des tableaux clairs, et où le temps est mélangé entre le présent, le passé, le réel et les souvenirs, où le passage de l'un à l'autre des tableaux se fait par des correspondances que met en place l'auteur grâce à la magie de son écriture. du grand grand art !
Avec cette exemple de scène, nous touchons ici à l'un des piliers du roman à savoir le temps qui passe, non linéaire car différent de ce que nous percevons, avançant plutôt en spirales dans nos têtes, en allers-retours incessants entre le présent, le passé et le futur, entre le réel, les souvenirs et les fantasmes. Mais en même temps, cette perception du temps non linéaire vient se fracasser au temps tel qu'il s'écoule dans la réalité, inexorable et bien linéaire, comme le montre par exemple le rayon de soleil, la poudroyante lumière de l'été s'immisçant dans une fente, en forme de T, qui traverse chaque jour les volets de la chambre de Marie à l'agonie se déplaçant d'un mur à l'autre, comme le prouve également le train qui passe, s'arrête et s'éloigne chaque jour à heures fixes ou encore comme le démontrent les carnets de Marie qui, jour après jour, inexorablement, donnent toutes les dépenses, les menues dépenses comme les plus grandes. le temps s'inscrit dans une « terrifiante répétition, une terrifiante suite de jours ».
A noter que la construction du roman même n'est pas linéaire. Nous ne voyons pas ces dix jours de réunion familiale, nous découvrons un entrelacement de temps présent, laissant place tout à coup, alors qu'un sens est mis en branle, au temps passé (soit un souvenir de Louise, soit une scène du passé de Marie que tente d'imaginer Louise, soit encore un reproche obsessionnelle de Sabine envers son mari qui date de quarante ans), laissant ensuite place d'un coup à une scène d'amour dans l'herbe fantasmée, imaginée ou déjà vécue, nous ne savons pas. C'est bien toute l'originalité de ce roman que de parler de la différence de perception entre temps vécu et temps objectif en se basant sur une construction elle-même éclatée…
Autre pilier du roman, l'antagonisme entre la vie et la mort, entre le végétal et le minéral, omniprésent. Alors que Marie vit une agonie de plusieurs jours, la vie semble cependant bruisser de partout. Déjà, malgré son état, la mort ne vient pas, le coeur ne cède pas, comme la syntaxe de l'auteur d'ailleurs, vivante, jaillissante…Ensuite, les insectes et les oiseaux dont les chants sont sans cesse décrits, sont symboles de vie ainsi que la nature, envahissante, cyclique, « l'inconsciente et folle végétation des hélianthes, leurs longues tiges s'entrecroisant, se bousculant, s'emmêlant, se détachant en clair sur le fond noir du fourré de rondes dans le bourdonnement des insectes », la nature indifférente aux petites histoires des humains. Ce que voudrait fuir Louise pour garder le contrôle de sa vie, soit par la petite mort de l'orgasme, soit en s'imaginant mourir alors qu'elle est allongée dans l'herbe, comme pétrifiée, heureuse de se confondre avec l'herbe…
Je ressors admirative et émue de cette lecture exigeante. Je suis certaine que chaque relecture de ce livre donnerait à comprendre des éléments non appréhendés auparavant. Ceci est la force des chefs-d'oeuvre. En plus de l'écriture somptueuse avec laquelle il faut savoir se laisser porter, se laisser bercer, et qui demande parfois une lecture à voix haute pour en savourer toute la beauté, les thèmes du temps et de la mort sont omniprésents et sources de multiples messages de la part de l'auteur. Oui, il fait partie de ses livres, énigmatiques, le mystère se nichant derrière les très longues phrases, qui nous hantent une fois terminés et que nous relirons, assurément…
Énorme coup de coeur, de ceux qui marquent la vie d'un lecteur.
Ouvrir l’Acacia de Claude Simon pour en entamer la lecture, c’est vivre une expérience inédite de lectrice dès les premières lignes et ce fut mon cas.
Au fur et à mesure que j’avançais dans ma lecture, je percevais, malgré mon état de stupéfaction, qu’il se passait quelque chose sous mes yeux d’inhabituel. La qualité de l’écriture, son réalisme, les longues phrases, suscitaient en moi de nombreuses images sans que je puisse maîtriser les scènes qui se déroulaient sous mes yeux. Je restais médusée devant ces femmes qui parcouraient les sentiers dévastés par la Grande Guerre. Je comprenais bien qu’elles étaient à la recherche d’une tombe, d’un lieu, dans ce paysage apocalyptique. L’une d’entre elles devait être la veuve mais je restais médusée, j’étais aux portes de l’ Hadès. Je lisais, totalement fascinée, ces longues phrases sans fin qui me projetaient en 1919.
La première idée qui me vint fut d’associer cette écriture aux phrases sans fin de Marcel Proust. Mais leur point commun s’arrêtait là bien que tous les deux fussent des auteurs du temps qui passe, de la mémoire.
L’écriture de Marcel Proust dégage une sensibilité, une musicalité, une grande délicatesse d’où émane la beauté dans le souci du détail qui se veut gardien du temps qui passe. L’écriture de Claude Simon est visuelle, époustouflante, impétueuse, rude, indéfinissable devant toutes les sensations qu’elle provoque.
Autant avec Marcel Proust, je suis dans mon élément. Au fil du temps, il est devenu un ami. Autant avec Claude Simon, je me sens démunie pour définir cette écriture. Je lis, je m’arrête devant cette écriture inhabituelle. Je suis bousculée dans cet ordre chronologique qui n’est pas respecté. Je passe de 1919 pour repartir en URSS, pour revenir en 1939, puis en 1914, et un détour en 1982, rien de conventionnel mais les chapitres sont datés. Si là aussi il s’agit de réminiscences, l’auteur excelle à perdre son lecteur comme parfois, notre mémoire ricoche d’un souvenir à un autre, sans que l’ordre chronologique intervienne, juste par association d’idées.
Mais je suis comme envoûtée, admirative. Il faut imaginer deux pages rédigées de main de maître, sans point, ponctuées de virgules et de quelques parenthèses, où défilent avec une minutie de « dentellière » les personnages, le paysage, les qualificatifs, les qualités ou les comportements des personnages, des animaux, des comparaisons qui inspirent imagination et réflexion..
Claude Simon fut aussi photographe. Est-ce l’œil exercé du professionnel qui provoque cette symbiose entre la lecture de toutes ces descriptions, ces périphrases et notre intellect ?
L’auteur nous prend en otage afin de nous faire appréhender la réalité de la guerre qu’elle soit Grande ou Drôle. Je retiendrai dans l’Acacia son réquisitoire sous jacent contre la guerre, l'armée et ses officiers, comme son regard incisif, teinté d’ironie, qui transperce l’être humain sans aucune concession. Il interroge ce dernier sur sa tendance à la guerre en mettant en scène le destin d’une famille au travers des épreuves du XXème siècle.
Cette écriture tient du prodige. Il y a des scènes inoubliables comme celles de la déclaration de guerre de 1939 et le départ de tous ces hommes délaissant leurs épouses, leurs fiancés, leurs parents ou leurs enfants. Je me suis trouvée projetée sur ce quai de gare, je pouvais entendre les bruits, les paroles, les pleurs, j’aurais pu agiter mon mouchoir. Impressionnant !
Prix Nobel 1985, j’ai pu lire quelques extraits de son discours de Stockholm où il relate les évènements auxquels il a assisté. On retrouve ainsi la justification de ses écrits.
Son père, militaire, est mort très jeune, en 1914, près de Verdun alors qu’il n’a que quelque mois. Sa mère est décédée, quelques années après, en 1925, d’un cancer. L’auteur étant né en 1913, il est mobilisé en 1939. Il expérimente l’armée et se retrouve prisonnier des Allemands. Auparavant, il avait rejoint les républicains espagnols.
Le titre de ce livre m’a interpellée. L’Acacia dont le bois est imputrescible, symbolise la régénération, l’immortalité. A la toute dernière page, il est écrit :
« Un soir, il s’assit à sa table devant une feuille de papier blanc. C’était le printemps maintenant. La fenêtre de la chambre était ouverte sur la nuit tiède. L’une des branches du grand acacia qui poussait dans le jardin touchait presque le mur, et il pouvait voir les plus proches rameaux éclairés par la lampe, avec leurs feuilles semblables à des plumes palpitant faiblement sur le fond des ténèbres, les folioles ovales teintées d’un vert cru par la lumière électrique remuant par moment des aigrettes, comme animées soudain d’un mouvement propre, comme si l’arbre tout entier se réveillait, s’ébrouait, se secouait, après quoi tout s’apaisait et elles reprenaient leur immobilité ».
Je tiens à remercier Anna dont le retour de lecture a retenu toute mon attention. Sans elle, l’Acacia dormirait encore sur mon étagère, tant j’étais persuadée de l’avoir lu !
Au fur et à mesure que j’avançais dans ma lecture, je percevais, malgré mon état de stupéfaction, qu’il se passait quelque chose sous mes yeux d’inhabituel. La qualité de l’écriture, son réalisme, les longues phrases, suscitaient en moi de nombreuses images sans que je puisse maîtriser les scènes qui se déroulaient sous mes yeux. Je restais médusée devant ces femmes qui parcouraient les sentiers dévastés par la Grande Guerre. Je comprenais bien qu’elles étaient à la recherche d’une tombe, d’un lieu, dans ce paysage apocalyptique. L’une d’entre elles devait être la veuve mais je restais médusée, j’étais aux portes de l’ Hadès. Je lisais, totalement fascinée, ces longues phrases sans fin qui me projetaient en 1919.
La première idée qui me vint fut d’associer cette écriture aux phrases sans fin de Marcel Proust. Mais leur point commun s’arrêtait là bien que tous les deux fussent des auteurs du temps qui passe, de la mémoire.
L’écriture de Marcel Proust dégage une sensibilité, une musicalité, une grande délicatesse d’où émane la beauté dans le souci du détail qui se veut gardien du temps qui passe. L’écriture de Claude Simon est visuelle, époustouflante, impétueuse, rude, indéfinissable devant toutes les sensations qu’elle provoque.
Autant avec Marcel Proust, je suis dans mon élément. Au fil du temps, il est devenu un ami. Autant avec Claude Simon, je me sens démunie pour définir cette écriture. Je lis, je m’arrête devant cette écriture inhabituelle. Je suis bousculée dans cet ordre chronologique qui n’est pas respecté. Je passe de 1919 pour repartir en URSS, pour revenir en 1939, puis en 1914, et un détour en 1982, rien de conventionnel mais les chapitres sont datés. Si là aussi il s’agit de réminiscences, l’auteur excelle à perdre son lecteur comme parfois, notre mémoire ricoche d’un souvenir à un autre, sans que l’ordre chronologique intervienne, juste par association d’idées.
Mais je suis comme envoûtée, admirative. Il faut imaginer deux pages rédigées de main de maître, sans point, ponctuées de virgules et de quelques parenthèses, où défilent avec une minutie de « dentellière » les personnages, le paysage, les qualificatifs, les qualités ou les comportements des personnages, des animaux, des comparaisons qui inspirent imagination et réflexion..
Claude Simon fut aussi photographe. Est-ce l’œil exercé du professionnel qui provoque cette symbiose entre la lecture de toutes ces descriptions, ces périphrases et notre intellect ?
L’auteur nous prend en otage afin de nous faire appréhender la réalité de la guerre qu’elle soit Grande ou Drôle. Je retiendrai dans l’Acacia son réquisitoire sous jacent contre la guerre, l'armée et ses officiers, comme son regard incisif, teinté d’ironie, qui transperce l’être humain sans aucune concession. Il interroge ce dernier sur sa tendance à la guerre en mettant en scène le destin d’une famille au travers des épreuves du XXème siècle.
Cette écriture tient du prodige. Il y a des scènes inoubliables comme celles de la déclaration de guerre de 1939 et le départ de tous ces hommes délaissant leurs épouses, leurs fiancés, leurs parents ou leurs enfants. Je me suis trouvée projetée sur ce quai de gare, je pouvais entendre les bruits, les paroles, les pleurs, j’aurais pu agiter mon mouchoir. Impressionnant !
Prix Nobel 1985, j’ai pu lire quelques extraits de son discours de Stockholm où il relate les évènements auxquels il a assisté. On retrouve ainsi la justification de ses écrits.
Son père, militaire, est mort très jeune, en 1914, près de Verdun alors qu’il n’a que quelque mois. Sa mère est décédée, quelques années après, en 1925, d’un cancer. L’auteur étant né en 1913, il est mobilisé en 1939. Il expérimente l’armée et se retrouve prisonnier des Allemands. Auparavant, il avait rejoint les républicains espagnols.
Le titre de ce livre m’a interpellée. L’Acacia dont le bois est imputrescible, symbolise la régénération, l’immortalité. A la toute dernière page, il est écrit :
« Un soir, il s’assit à sa table devant une feuille de papier blanc. C’était le printemps maintenant. La fenêtre de la chambre était ouverte sur la nuit tiède. L’une des branches du grand acacia qui poussait dans le jardin touchait presque le mur, et il pouvait voir les plus proches rameaux éclairés par la lampe, avec leurs feuilles semblables à des plumes palpitant faiblement sur le fond des ténèbres, les folioles ovales teintées d’un vert cru par la lumière électrique remuant par moment des aigrettes, comme animées soudain d’un mouvement propre, comme si l’arbre tout entier se réveillait, s’ébrouait, se secouait, après quoi tout s’apaisait et elles reprenaient leur immobilité ».
Je tiens à remercier Anna dont le retour de lecture a retenu toute mon attention. Sans elle, l’Acacia dormirait encore sur mon étagère, tant j’étais persuadée de l’avoir lu !
Le Tramway... Est-ce un tramway nommé désir ? Je vous avouerai que j'allais ici pour mes premiers pas dans l'univers littéraire de Claude Simon avec autant d'appréhension que d'une curiosité totalement débridée.
J'ai aimé emprunter ce tramway au ton mélancolique, dans ces allers-retours quotidiens entre le centre d'une ville de bord de mer et les abords d'une plage mondaine. Cette ville en bord de mer est sans doute Perpignan, qui fut la ville d'enfance de Claude Simon.
À cette lecture envoûtante, j'ai aimé devenir ce petit garçon qui empruntait autrefois ce tramway pour aller le matin à l'école et en revenir le soir.
Sur un texte dont la première approche n'est pas toujours aisée, j'ai aimé son rythme singulier, au gré d'un trajet quotidien qui devient vite un voyage, j'ai aimé entrer peu à peu dans la sensation du texte, dans la phrase qui s'enroule et se déroule, presque ensorcelante, le devenant sans doute totalement à la fin de ma lecture, l'enchantement continuant de se poursuivre quelques temps après aussi.
La forme narrative peut dérouter, puis finit par rassurer, pour finir par envoûter...
En 2001, Claude Simon publie son dernier roman, le Tramway, c'est un cheminement, son dernier cheminement. Peut-être faut-il voir dans ce dernier récit un signe prophétique de sa part, sentant la mort qui approchait ?
C'est un regard d'indulgence et de lucidité porté vers l'humanité, celle que Claude Simon a traversé durant son existence.
C'est un récit que j'ai trouvé intelligent, à facettes, tantôt à hauteur d'un enfant, tantôt à hauteur d'un vieillard malade, hospitalisé, presque moribond, ce vieil homme qui se souvient qu'enfant, dans la période entre deux guerres, il empruntait ce tramway pour aller à l'école, il se souvient du cinéma tout près de la première station, des villas des quartiers très riches que longeait la ligne venant s'épuiser sur les derniers rails recouverts de sable, presque jusque devant la mer...
Ce vieil homme qui se souvient, c'est peut-être lui Claude Simon, mais ce sont tant d'autres personnes, peut-être nous, qui sait ?
Ce sont des allers-retours incessants où le paysage physique pourrait finir par devenir immuable, s'il ne finissait par ressembler peu à peu au paysage de la vie...
Cela ressemble à un parcours initiatique où le petit garçon s'apprête à faire ses pas dans un monde plus grand que lui, un monde encore étranger à lui, qui le restera à jamais peut-être tant ce monde est semé d'embûches, tant ce monde est chaotique, un monde sans pitié et déjà en déclin, la guerre va venir qui va broyer des vies, la maladie plus tard aussi, celle qui va emporter sa mère si chère à son coeur, un monde où la mort est sans cesse omniprésente... Et pourtant...
Pourtant, dans son esthétique réaliste, ce texte a quelque chose de radieux, de solaire, de chaleureux... Ce récit devient vivant, animé comme des scènes filmées, des personnages montent, descendent du tramway, certains vont au plus près du conducteur comme ces gosses aux rires potaches qui chahutent dans la cabine, d'autres personnages continuent d'exister dans la rue, marchant, se dépêchant vers leur travail, traînant un peu, parfois amoureux, enlacés, forment presque un mouvement cinématographique à la façon d'un travelling, tandis que le tramway continue son trajet.
Il se détache ici un besoin d'altérité infini pour dire la manière d'affronter ce monde en proie au malheur.
Est-ce ce chaos apparent de l'écriture de Claude Simon qui permet de se raccorder au monde chaotique qu'il nous décrit dans ces flux de conscience qui viennent et reviennent comme le trajet d'un tramway entre un cinéma et une plage d'une ville de bord de mer ?
Il faut alors se laisser porter par la phrase, qui s'ouvre parfois sur des parenthèses comme si brusquement un endroit secret surgissait d'un chemin qu'on emprunte, il faut ne pas hésiter à aller plus loin, ressortir du trou percé par la parenthèse dans laquelle nous sommes tombé, en ressortir un peu sonné, continuer, lire à haute voix, il faut embrasser la phrase de Claude Simon à pleine bouche, façon french kiss. La façon d'écrire de Claude Simon m'a donné à voir qu'il revenait sur ses pas pour visiter cette phrase, l'ouvrir, la tailler puis la sculpter, y jeter d'autres mots, revenir comme un vieillard qui va mourir revient vers son enfance, l'école, le cinéma, sa mère qui le prenait dans ses bras, la plage au loin et le sable qui roulait sur les rails, notre vie est souvent cela, on ne sait jamais comment refermer la parenthèse qu'on a nous-mêmes ouvert dans nos propres existences avec ses failles, ses blessures et ses béances, on aime revenir à bord de ce tramway vers la plage de nos enfances, revenir en arrière, voir tous ses morts qui s'agglutinent sur le bas-côté, pour peu le tramway roulerait presque sur eux. Mais ils sont loin heureusement... Enfin, pas si loin que cela finalement...
Il y a quelque chose ici qui tient de l'entrelacement, de la dilatation du temps, de l'oscillation entre deux versants...
C'est un plaisir sensoriel, celui de la réminiscence, celui de la vision d'un paysage qui passe, que traverse un tramway parcourant nos vies.
Le temps qui passe, c'est aussi le temps qui reste, qu'il nous reste à vivre. le tramway n'en finit pas d'aller et venir entre cette ville et cette plage.
Le temps qu'il nous reste, c'est aussi le temps qu'il nous manque...
Jouir de cette littérature, exigeante oui, qui oblige forcément, pourquoi pas n'est-ce pas ? Sensuelle presque, puisqu'il s'agit de nous laisser entraîner par cette lecture et qu'il nous reste quelque chose après... Se laisser prendre, s'immerger dedans, c'est un texte qui parle plus à nos sens qu'à l'intelligence, je précise bien aux sens, tous les sens, les sensations qui nous permettent d'étreindre ce monde si impalpable à première vue.
Ces phrases longues qui succèdent à des phrases courtes, avec parfois des points de rupture, parfois juste avant la fin de la phrase, juste au bord du vide, cassant presque la syntaxe, ces phrases ne figurent rien d'autre que le tourment de l'existence... Bien sûr, cette langue particulière m'a rappelé l'écriture de William Faulkner, celle aussi d' António Lobo Antunes.
Cela oblige, cela déroute, cela peut agacer, cela embrase et ensorcèle.
Me prêtant à lire un ou deux extraits de ce récit à haute voix dans mon jardin, mais oui..., - j'ai quand même vérifié si les chats n'étaient pas aux alentours on ne sait jamais à propos de leurs réactions parfois imprévisibles -, j'ai découvert une mélodie de la phrase, une attention aux images aussi, au sens tactile, aux odeurs...
Ce tramway stoppé par le buttoir devant l'océan m'a donné une vision presque irréelle, magique, d'un tramway qui aurait pu un jour continuer son trajet sans jamais s'arrêter, aller s'engloutir dans les flots, continuer le voyage sous la forme d'un parcours en submersion, englouti, oubliant ce qui existait à la surface, peut-être offrir à cet enfant qui allait grandir la découverte d'autres mondes, s'échappant pour quelques instants ou pour toujours de celui qui déjà s'apprêtait à le happer, inexorablement.
La force de ce récit de Claude Simon me fait dire tout cela... Dans ce tramway nommé désir...
J'ai aimé emprunter ce tramway au ton mélancolique, dans ces allers-retours quotidiens entre le centre d'une ville de bord de mer et les abords d'une plage mondaine. Cette ville en bord de mer est sans doute Perpignan, qui fut la ville d'enfance de Claude Simon.
À cette lecture envoûtante, j'ai aimé devenir ce petit garçon qui empruntait autrefois ce tramway pour aller le matin à l'école et en revenir le soir.
Sur un texte dont la première approche n'est pas toujours aisée, j'ai aimé son rythme singulier, au gré d'un trajet quotidien qui devient vite un voyage, j'ai aimé entrer peu à peu dans la sensation du texte, dans la phrase qui s'enroule et se déroule, presque ensorcelante, le devenant sans doute totalement à la fin de ma lecture, l'enchantement continuant de se poursuivre quelques temps après aussi.
La forme narrative peut dérouter, puis finit par rassurer, pour finir par envoûter...
En 2001, Claude Simon publie son dernier roman, le Tramway, c'est un cheminement, son dernier cheminement. Peut-être faut-il voir dans ce dernier récit un signe prophétique de sa part, sentant la mort qui approchait ?
C'est un regard d'indulgence et de lucidité porté vers l'humanité, celle que Claude Simon a traversé durant son existence.
C'est un récit que j'ai trouvé intelligent, à facettes, tantôt à hauteur d'un enfant, tantôt à hauteur d'un vieillard malade, hospitalisé, presque moribond, ce vieil homme qui se souvient qu'enfant, dans la période entre deux guerres, il empruntait ce tramway pour aller à l'école, il se souvient du cinéma tout près de la première station, des villas des quartiers très riches que longeait la ligne venant s'épuiser sur les derniers rails recouverts de sable, presque jusque devant la mer...
Ce vieil homme qui se souvient, c'est peut-être lui Claude Simon, mais ce sont tant d'autres personnes, peut-être nous, qui sait ?
Ce sont des allers-retours incessants où le paysage physique pourrait finir par devenir immuable, s'il ne finissait par ressembler peu à peu au paysage de la vie...
Cela ressemble à un parcours initiatique où le petit garçon s'apprête à faire ses pas dans un monde plus grand que lui, un monde encore étranger à lui, qui le restera à jamais peut-être tant ce monde est semé d'embûches, tant ce monde est chaotique, un monde sans pitié et déjà en déclin, la guerre va venir qui va broyer des vies, la maladie plus tard aussi, celle qui va emporter sa mère si chère à son coeur, un monde où la mort est sans cesse omniprésente... Et pourtant...
Pourtant, dans son esthétique réaliste, ce texte a quelque chose de radieux, de solaire, de chaleureux... Ce récit devient vivant, animé comme des scènes filmées, des personnages montent, descendent du tramway, certains vont au plus près du conducteur comme ces gosses aux rires potaches qui chahutent dans la cabine, d'autres personnages continuent d'exister dans la rue, marchant, se dépêchant vers leur travail, traînant un peu, parfois amoureux, enlacés, forment presque un mouvement cinématographique à la façon d'un travelling, tandis que le tramway continue son trajet.
Il se détache ici un besoin d'altérité infini pour dire la manière d'affronter ce monde en proie au malheur.
Est-ce ce chaos apparent de l'écriture de Claude Simon qui permet de se raccorder au monde chaotique qu'il nous décrit dans ces flux de conscience qui viennent et reviennent comme le trajet d'un tramway entre un cinéma et une plage d'une ville de bord de mer ?
Il faut alors se laisser porter par la phrase, qui s'ouvre parfois sur des parenthèses comme si brusquement un endroit secret surgissait d'un chemin qu'on emprunte, il faut ne pas hésiter à aller plus loin, ressortir du trou percé par la parenthèse dans laquelle nous sommes tombé, en ressortir un peu sonné, continuer, lire à haute voix, il faut embrasser la phrase de Claude Simon à pleine bouche, façon french kiss. La façon d'écrire de Claude Simon m'a donné à voir qu'il revenait sur ses pas pour visiter cette phrase, l'ouvrir, la tailler puis la sculpter, y jeter d'autres mots, revenir comme un vieillard qui va mourir revient vers son enfance, l'école, le cinéma, sa mère qui le prenait dans ses bras, la plage au loin et le sable qui roulait sur les rails, notre vie est souvent cela, on ne sait jamais comment refermer la parenthèse qu'on a nous-mêmes ouvert dans nos propres existences avec ses failles, ses blessures et ses béances, on aime revenir à bord de ce tramway vers la plage de nos enfances, revenir en arrière, voir tous ses morts qui s'agglutinent sur le bas-côté, pour peu le tramway roulerait presque sur eux. Mais ils sont loin heureusement... Enfin, pas si loin que cela finalement...
Il y a quelque chose ici qui tient de l'entrelacement, de la dilatation du temps, de l'oscillation entre deux versants...
C'est un plaisir sensoriel, celui de la réminiscence, celui de la vision d'un paysage qui passe, que traverse un tramway parcourant nos vies.
Le temps qui passe, c'est aussi le temps qui reste, qu'il nous reste à vivre. le tramway n'en finit pas d'aller et venir entre cette ville et cette plage.
Le temps qu'il nous reste, c'est aussi le temps qu'il nous manque...
Jouir de cette littérature, exigeante oui, qui oblige forcément, pourquoi pas n'est-ce pas ? Sensuelle presque, puisqu'il s'agit de nous laisser entraîner par cette lecture et qu'il nous reste quelque chose après... Se laisser prendre, s'immerger dedans, c'est un texte qui parle plus à nos sens qu'à l'intelligence, je précise bien aux sens, tous les sens, les sensations qui nous permettent d'étreindre ce monde si impalpable à première vue.
Ces phrases longues qui succèdent à des phrases courtes, avec parfois des points de rupture, parfois juste avant la fin de la phrase, juste au bord du vide, cassant presque la syntaxe, ces phrases ne figurent rien d'autre que le tourment de l'existence... Bien sûr, cette langue particulière m'a rappelé l'écriture de William Faulkner, celle aussi d' António Lobo Antunes.
Cela oblige, cela déroute, cela peut agacer, cela embrase et ensorcèle.
Me prêtant à lire un ou deux extraits de ce récit à haute voix dans mon jardin, mais oui..., - j'ai quand même vérifié si les chats n'étaient pas aux alentours on ne sait jamais à propos de leurs réactions parfois imprévisibles -, j'ai découvert une mélodie de la phrase, une attention aux images aussi, au sens tactile, aux odeurs...
Ce tramway stoppé par le buttoir devant l'océan m'a donné une vision presque irréelle, magique, d'un tramway qui aurait pu un jour continuer son trajet sans jamais s'arrêter, aller s'engloutir dans les flots, continuer le voyage sous la forme d'un parcours en submersion, englouti, oubliant ce qui existait à la surface, peut-être offrir à cet enfant qui allait grandir la découverte d'autres mondes, s'échappant pour quelques instants ou pour toujours de celui qui déjà s'apprêtait à le happer, inexorablement.
La force de ce récit de Claude Simon me fait dire tout cela... Dans ce tramway nommé désir...
J'ai découvert Claude Simon à la Fac... pas forcément dans de bonnes conditions. Je m'explique : à cette époque, je passais ma maîtrise de Lettres... 20 ans déjà... Entre autres réjouissances, venant s'ajouter au Mémoire, je devais faire un dossier intitulé "Montages et collages dans Triptyque de Claude Simon". Bon... Rien que le titre me filait déjà la nausée. C'était sans compter sur la lecture du livre... que je ne comprenais pas. Mais comment dire, à Perpignan, alors que le sieur Simon n'habitait qu'à quelques kilomètres, que je n'aimais pas, mais alors pas du tout son style ? Eh bien, on ne le dit pas, on se tait, on fait des recherches et on tente de comprendre !
Il y a quelques jours, j'ai retenté, après 20 ans, donc, de relire certains textes de cet auteur. Je me suis dit que quelque chose de court pourrait être judicieux ; allons-y doucement quand même ! Archipel et Nord se prêtaient justement à cela. Mais ces poèmes en prose sur le thème du voyage sont dénués - ou presque - de ponctuation. Aïe ! Voilà qui commençait mal ! Alors, certes, je reconnais la puissance des images, le ton évocateur des paysages vus de haut, la description picturale par petites touches... Mais cela ne me touche pas, malheureusement. Je crois que je ne comprendrai jamais cet auteur, et ce ne fut pas par faute d'essayer.
Que voulez-vous ? Certains auteurs restent incompris aux yeux de profanes ! Paul Claudel me fait exactement le même effet... Que les admirateurs de Claude Simon ne m'en veuillent pas, je ne suis qu'une pauvre petite goutte d'eau perdue dans l'océan de sa poésie...
Lien : http://www.lydiabonnaventure..
Il y a quelques jours, j'ai retenté, après 20 ans, donc, de relire certains textes de cet auteur. Je me suis dit que quelque chose de court pourrait être judicieux ; allons-y doucement quand même ! Archipel et Nord se prêtaient justement à cela. Mais ces poèmes en prose sur le thème du voyage sont dénués - ou presque - de ponctuation. Aïe ! Voilà qui commençait mal ! Alors, certes, je reconnais la puissance des images, le ton évocateur des paysages vus de haut, la description picturale par petites touches... Mais cela ne me touche pas, malheureusement. Je crois que je ne comprendrai jamais cet auteur, et ce ne fut pas par faute d'essayer.
Que voulez-vous ? Certains auteurs restent incompris aux yeux de profanes ! Paul Claudel me fait exactement le même effet... Que les admirateurs de Claude Simon ne m'en veuillent pas, je ne suis qu'une pauvre petite goutte d'eau perdue dans l'océan de sa poésie...
Lien : http://www.lydiabonnaventure..
Quand j’ai lu L’Acacia pour la première fois, c’est à peine si j’avais entendu parler de son auteur. Je ne savais pas s’il était vivant ou mort, j’ignorais complètement qu’il avait reçu le Nobel. En revanche, j’avais appris, je ne sais trop comment, qu’il vouait une grande admiration à l’oeuvre de Proust. Et c’est ça qui m’a donné envie de le lire.
Subjuguée dès les toutes premières lignes, je me souviens m’être dit : ‘Je n’ai jamais rien lu de pareil’. Je faisais l’expérience d’une immersion totale, j’étais dans la boue au milieu d’un paysage détrempé, ravagé par la guerre, en compagnie de deux femmes et d’un enfant dont je ne savais rien sinon que le malheur les avait frappés. Et ce que j’ai compris ou plutôt senti, c’est que l’auteur avait réussi là quelque chose d’inouï : restituer en quelques lignes et en une unique phrase une simultanéité de sensations, de perceptions, d’émotions et de souvenirs. Je pense que d’une façon ou d’une autre, tout auteur court après ce rêve : nous faire sentir et ressentir et voir et percevoir dans un condensé d’écriture la vie même… mais infiniment peu y parviennent avec tant de grâce et, j’ose le mot, avec tant d’efficacité.
Le chapitre I (1919) s’ouvre sur cette phrase :
« Elles allaient d’un village à l’autre, et dans chacun (ou du moins ce qu’il en restait) d’une maison à l’autre, parfois une ferme en plein champ qu’on leur indiquait, qu’elles gagnaient en se tordant les pieds dans les mauvais chemins, leurs chaussures de ville souillées d’une boue jaune que l’une des deux soeurs parfois essuyait maladroitement à l’aide d’une touffe d’herbe, tenant de l’autre main son gant noir, penchée comme une servante, parlant d’une voix grondeuse à la veuve qui posait avec impatience son pied sur une pierre ou une borne, la laissant faire tandis qu’elle continuait à scruter avidement des yeux le paysage, les prés détrempés, les champs que depuis cinq ans aucune charrue n’avait retournés, les bois où subsistait ici et là une tache de vert, parfois un arbre seul, parfois seulement une branche sur laquelle avaient repoussé quelques rameaux crevant l’écorce déchiquetée. »
Claude Simon était, paraît-il, un grand amateur de musique. Il a puisé dans son histoire familiale et dans celle des deux guerres mondiales les éléments d’une symphonie en douze chapitres qui bousculent la chronologie et notre rapport au temps. Parfois concentrés sur une seule journée (27 août 1914), une année (1940) ou s’étirant au contraire sur plusieurs décennies (1914-1982), nous y empruntons le cours sinueux d’un récit au croisement de l’intime et de l’Histoire, un récit fragmenté comme la mémoire qui le sous-tend, avec ses focales et ses ellipses.
L’auteur reste constamment à hauteur d’homme, il ne surplombe pas les choses, mais les donne à voir dans toute leur fragilité et dans toute leur absurdité. La guerre n’est pas une chose désincarnée ou abstraite, un événement édifiant ou tragique, la guerre c’est ça :
« (...) tous, les uns après les autres, déversés, engloutis, disparus sans laisser de traces, rayés des tableaux d’effectifs sans même que ce qui se passait (ce qu’ils (les cavaliers) étaient en train de vivre) ressemblât de près ou de loin à quelque chose comme une guerre, ou du moins à ce qu’ils s’imaginaient confusément que devait être la guerre : même pas un décor, le minimum de mise en scène, de solennité (ou même de sérieux) qui leur eût tout au moins permis de croire qu’on les avait envoyés là pour se battre et non pas simplement pour être tués (...) »
De même, l’amour, le désir, le sexe sont-ils restitués dans leur réalité la plus intime et la plus sensible, sans voyeurisme ni fausse pudeur :
« (...) elle dont probablement aucun homme n’avait jamais baisé ni même effleuré les lèvres, tout à coup arrachée à sa bienséante et végétale existence, projetée ou plutôt catapultée, précipitée au plein de sa vorace trentaine dans une sorte de vertigineux maelström qui avait pour centre le bas de son ventre d’où déferlait en vagues sauvages quelque chose qui était aux plaisirs qu’elle avait connus jusque-là comme un verre d’alcool à du sirop d’orgeat, ne s’arrêtait même pas aux limites de son corps, se prolongeait encore au-dehors, si tant est qu’elle fût encore capable de distinguer entre dedans et dehors lorsque, abritée de son ombrelle, encore pantelante et moite, de nouveau appuyée à ce bras dont à travers le léger tissu de toile elle pouvait sentir les muscles, épuisée (ou plutôt rassasiée, repue, hébétée), elle descendait la passerelle, allait flâner aux escales (ou plutôt mollement flotter, comme dans un état second, somnambulique) le long des étalages de souks ou de marchés indigènes, percevant comme dans un permanent orgasme ces ports, ces villes, ces pyramides, ces chameaux, ces foules barbares et loqueteuses (…) »
Je dirais pour finir que le ton de Claude Simon est à la fois lyrique et âpre, bienveillant et ironique, que son regard à la fois exalte le monde et le transperce comme une lame. Et si, dans sa quête effrénée de restituer en quelques pages la vie même, il perd parfois son lecteur, c’est pour mieux le rattraper par la suite, le prendre dans les rets de ses phrases enchanteresses.
Subjuguée dès les toutes premières lignes, je me souviens m’être dit : ‘Je n’ai jamais rien lu de pareil’. Je faisais l’expérience d’une immersion totale, j’étais dans la boue au milieu d’un paysage détrempé, ravagé par la guerre, en compagnie de deux femmes et d’un enfant dont je ne savais rien sinon que le malheur les avait frappés. Et ce que j’ai compris ou plutôt senti, c’est que l’auteur avait réussi là quelque chose d’inouï : restituer en quelques lignes et en une unique phrase une simultanéité de sensations, de perceptions, d’émotions et de souvenirs. Je pense que d’une façon ou d’une autre, tout auteur court après ce rêve : nous faire sentir et ressentir et voir et percevoir dans un condensé d’écriture la vie même… mais infiniment peu y parviennent avec tant de grâce et, j’ose le mot, avec tant d’efficacité.
Le chapitre I (1919) s’ouvre sur cette phrase :
« Elles allaient d’un village à l’autre, et dans chacun (ou du moins ce qu’il en restait) d’une maison à l’autre, parfois une ferme en plein champ qu’on leur indiquait, qu’elles gagnaient en se tordant les pieds dans les mauvais chemins, leurs chaussures de ville souillées d’une boue jaune que l’une des deux soeurs parfois essuyait maladroitement à l’aide d’une touffe d’herbe, tenant de l’autre main son gant noir, penchée comme une servante, parlant d’une voix grondeuse à la veuve qui posait avec impatience son pied sur une pierre ou une borne, la laissant faire tandis qu’elle continuait à scruter avidement des yeux le paysage, les prés détrempés, les champs que depuis cinq ans aucune charrue n’avait retournés, les bois où subsistait ici et là une tache de vert, parfois un arbre seul, parfois seulement une branche sur laquelle avaient repoussé quelques rameaux crevant l’écorce déchiquetée. »
Claude Simon était, paraît-il, un grand amateur de musique. Il a puisé dans son histoire familiale et dans celle des deux guerres mondiales les éléments d’une symphonie en douze chapitres qui bousculent la chronologie et notre rapport au temps. Parfois concentrés sur une seule journée (27 août 1914), une année (1940) ou s’étirant au contraire sur plusieurs décennies (1914-1982), nous y empruntons le cours sinueux d’un récit au croisement de l’intime et de l’Histoire, un récit fragmenté comme la mémoire qui le sous-tend, avec ses focales et ses ellipses.
L’auteur reste constamment à hauteur d’homme, il ne surplombe pas les choses, mais les donne à voir dans toute leur fragilité et dans toute leur absurdité. La guerre n’est pas une chose désincarnée ou abstraite, un événement édifiant ou tragique, la guerre c’est ça :
« (...) tous, les uns après les autres, déversés, engloutis, disparus sans laisser de traces, rayés des tableaux d’effectifs sans même que ce qui se passait (ce qu’ils (les cavaliers) étaient en train de vivre) ressemblât de près ou de loin à quelque chose comme une guerre, ou du moins à ce qu’ils s’imaginaient confusément que devait être la guerre : même pas un décor, le minimum de mise en scène, de solennité (ou même de sérieux) qui leur eût tout au moins permis de croire qu’on les avait envoyés là pour se battre et non pas simplement pour être tués (...) »
De même, l’amour, le désir, le sexe sont-ils restitués dans leur réalité la plus intime et la plus sensible, sans voyeurisme ni fausse pudeur :
« (...) elle dont probablement aucun homme n’avait jamais baisé ni même effleuré les lèvres, tout à coup arrachée à sa bienséante et végétale existence, projetée ou plutôt catapultée, précipitée au plein de sa vorace trentaine dans une sorte de vertigineux maelström qui avait pour centre le bas de son ventre d’où déferlait en vagues sauvages quelque chose qui était aux plaisirs qu’elle avait connus jusque-là comme un verre d’alcool à du sirop d’orgeat, ne s’arrêtait même pas aux limites de son corps, se prolongeait encore au-dehors, si tant est qu’elle fût encore capable de distinguer entre dedans et dehors lorsque, abritée de son ombrelle, encore pantelante et moite, de nouveau appuyée à ce bras dont à travers le léger tissu de toile elle pouvait sentir les muscles, épuisée (ou plutôt rassasiée, repue, hébétée), elle descendait la passerelle, allait flâner aux escales (ou plutôt mollement flotter, comme dans un état second, somnambulique) le long des étalages de souks ou de marchés indigènes, percevant comme dans un permanent orgasme ces ports, ces villes, ces pyramides, ces chameaux, ces foules barbares et loqueteuses (…) »
Je dirais pour finir que le ton de Claude Simon est à la fois lyrique et âpre, bienveillant et ironique, que son regard à la fois exalte le monde et le transperce comme une lame. Et si, dans sa quête effrénée de restituer en quelques pages la vie même, il perd parfois son lecteur, c’est pour mieux le rattraper par la suite, le prendre dans les rets de ses phrases enchanteresses.
Crier au "chef-d'oeuvre", invoquer les "monuments littéraires", le "patrimoine", c'est ne pas lire les livres valables et intimider ceux qui voudraient s'y frotter. Ce langage et ces idées de journaliste nous condamnent aux produits frelatés et aux fausses nourritures spirituelles et intellectuelles. "Les Géorgiques", roman de 1981, joue d'ailleurs avec l'intimidation (ou avec la lassitude des études classiques) en invoquant Virgile, à qui il emprunte son titre. Entre 37 et 30, à la fin des guerres civiles, Virgile composa le poème des Géorgiques, qu'il consacra au travail de la terre, et inséra au livre IV l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. Le personnage principal de Claude Simon, qu'on ne connaît que par ses initiales, LSM, et par son prénom, passe sa vie sur les champs de bataille de la Révolution et de l'Empire, et écrit inlassablement chez lui pour recommander en détail, saison après saison, tous les travaux des champs et de l'élevage des chevaux qu'il estime nécessaires. Parallèlement, un de ses descendants, cavalier de seconde classe, passé par la guerre d'Espagne et futur narrateur, subit la "Drôle de Guerre" et la débâcle de juin 40, racontées avec un sens poétique unique de la nature et de la guerre. Enfin, un intellectuel anglais anonyme de gauche ("O.", en qui l'on reconnaît George Orwell) participe à la guerre civile espagnole dans le camp des anarchistes et échappe de peu à l'élimination aux mains des communistes. Enfin, LSM a eu deux femmes dans sa vie : l'une qu'il perd, selon le mode orphique, l'autre qui le dépouille de ses biens après sa mort (son corps, comme celui d'Orphée, étant dépecé).
Ces éléments mettent en évidence l'art de Claude Simon, qui consiste à ménager des "rimes", des effets d'échos et de répétitions, d'analogies, entre les éléments de Virgile et ceux de son roman. Mais ce n'est pas un jeu érudit, pour lequel l'auteur, en bon écrivain des années 50, n'aurait eu que mépris. C'est une vision de la littérature : la littérature n'est pas une représentation du réel, mais un jeu de reflets et d'échos entre textes littéraires. Les auteurs du Nouveau Roman rappelaient aux consommateurs de romans de gare (donc à nous aujourd'hui) que les livres dont ils ont l'habitude ne sont pas composés "naturellement", mais dépendent d'une convention aussi artificielle que tous les autres livres. A nous de faire l'effort d'accepter des conventions romanesques différentes : au prix de cet effort on gagnera un bonheur de lecture inégalé, qu'aucun polar nordique ou conte moral bien-pensant, fait à la chaîne, ne fourniront jamais. Quitter "sa zone de confort" et faire confiance au romancier est peut-être beaucoup demander.
Enfin, ces rimes narratives nous font comprendre que ce qu'on appelle Histoire, révolutions, guerres, empires, est la répétition des mêmes boucheries. La génération de Claude Simon a cru à un idéal politique. O., au milieu du roman, croit au communisme, comme LSM croit aux principes de 1789. L'un échappe de peu aux tueurs communistes, et l'autre laisse fusiller son propre frère émigré (ce qui nous renvoie à Caïn et Abel, à Romulus et Rémus). L'auteur nous balade imperturbablement des rigueurs de l'hiver 39 face aux nazis, à celles de l'hiver 37 en Aragon face aux franquistes, et à bien d'autres automnes, hivers, printemps, étés guerriers admirablement décrits, et fait voir que les cycles historiques ressemblent aux cycles naturels, tout aussi répétitifs et dépourvus de sens. Claude Simon a beau émarger à tous les grands récits de la mythologie de gauche, Révolution, Guerre d'Espagne etc, il est romancier, à savoir un destructeur d'illusions.
Il faut finir par ce qui donnera au lecteur le plus grand des bonheurs (à ne pas confondre avec le plaisir) : son art de la prose. Elle est rythmée, sensuelle, attachée aux sensations les plus physiques. Le monde y est intensément présent, non comme spectacle mais comme expérience immédiate des choses. Nulle part on ne rencontrera le commentaire moral et abstrait, dont le soin est laissé au lecteur.
Ces éléments mettent en évidence l'art de Claude Simon, qui consiste à ménager des "rimes", des effets d'échos et de répétitions, d'analogies, entre les éléments de Virgile et ceux de son roman. Mais ce n'est pas un jeu érudit, pour lequel l'auteur, en bon écrivain des années 50, n'aurait eu que mépris. C'est une vision de la littérature : la littérature n'est pas une représentation du réel, mais un jeu de reflets et d'échos entre textes littéraires. Les auteurs du Nouveau Roman rappelaient aux consommateurs de romans de gare (donc à nous aujourd'hui) que les livres dont ils ont l'habitude ne sont pas composés "naturellement", mais dépendent d'une convention aussi artificielle que tous les autres livres. A nous de faire l'effort d'accepter des conventions romanesques différentes : au prix de cet effort on gagnera un bonheur de lecture inégalé, qu'aucun polar nordique ou conte moral bien-pensant, fait à la chaîne, ne fourniront jamais. Quitter "sa zone de confort" et faire confiance au romancier est peut-être beaucoup demander.
Enfin, ces rimes narratives nous font comprendre que ce qu'on appelle Histoire, révolutions, guerres, empires, est la répétition des mêmes boucheries. La génération de Claude Simon a cru à un idéal politique. O., au milieu du roman, croit au communisme, comme LSM croit aux principes de 1789. L'un échappe de peu aux tueurs communistes, et l'autre laisse fusiller son propre frère émigré (ce qui nous renvoie à Caïn et Abel, à Romulus et Rémus). L'auteur nous balade imperturbablement des rigueurs de l'hiver 39 face aux nazis, à celles de l'hiver 37 en Aragon face aux franquistes, et à bien d'autres automnes, hivers, printemps, étés guerriers admirablement décrits, et fait voir que les cycles historiques ressemblent aux cycles naturels, tout aussi répétitifs et dépourvus de sens. Claude Simon a beau émarger à tous les grands récits de la mythologie de gauche, Révolution, Guerre d'Espagne etc, il est romancier, à savoir un destructeur d'illusions.
Il faut finir par ce qui donnera au lecteur le plus grand des bonheurs (à ne pas confondre avec le plaisir) : son art de la prose. Elle est rythmée, sensuelle, attachée aux sensations les plus physiques. Le monde y est intensément présent, non comme spectacle mais comme expérience immédiate des choses. Nulle part on ne rencontrera le commentaire moral et abstrait, dont le soin est laissé au lecteur.
"L'Acacia" appartient à la seconde époque de la création romanesque de Claude Simon : après une période expérimentale, "formaliste", à l'école du Nouveau Roman, son oeuvre assume et dépasse les théories pour voler de ses propres ailes et manifester le génie de l'auteur par delà colloques et manifestes, pour lesquels il avait peu de goût. En même temps, l'auteur d'avant-garde qu'il est s'autorise une relation pacifiée avec la tradition, comme on le voyait déjà aux "Géorgiques" de 1981. "L'Acacia" rappelle "A la Recherche du Temps Perdu", car dans les deux romans un écrivain émerge dans le temps absurde et cyclique de l'Histoire et de la Nature (à savoir naissance, maturité, déclin et mort). Si le temps perdu proustien était celui des mondanités, des amours et des amitiés stériles, le temps perdu dans "L'Acacia" est celui des grands cataclysmes du XX°s inscrits dans l'histoire familiale du romancier, cataclysmes décrits avec la minutie artisanale, le sens merveilleux du détail et de la couleur de Brueghel ou de Jérôme Bosch. Ce temps perdu et destructeur devient la matière de l'art littéraire : la guerre, dont on sait qu'elle est, dans sa réalité, le Mal même, est devenue le beau matériau littéraire des grands poèmes de Claude Simon dans "L'Acacia", aux échos d'Iliade et d'Enéide. On trouvera aussi une forme de chronique familiale et d'autobiographie (sans "je") dans "L'Acacia" : l'histoire des ancêtres, les sinuosités des alliances et des familles, font immanquablement penser au "Labyrinthe du Monde" de Marguerite Yourcenar, à ceci près que Claude Simon brouille les limites entre le fictif et le réel avec sa palette de grand peintre réaliste et social. En nos temps de misère littéraire, de haine ignorante et de ressentiment contre la belle langue et le beau style, la lecture des longues phrases de Claude Simon est une volupté de chaque instant. En temps de moralisme et de dictature des ratés vertueux, la jouissance innocente de lire et de voir, d'oublier le Bien et ses sermons, console de tous les chagrins que nous cause "l'actu".
Lire un roman de Claude Simon (1913-2005), c'est un peu comme gravir une montagne : à la fatigue et au découragement peuvent succéder de beaux moments de surprise, voire d'exaltation. Une fois le livre refermé, on a le sentiment, quoi qu'il arrive, d'avoir vécu une expérience hors du commun et d'être devenu meilleur lecteur.
Comme la plupart des romans de ce grand auteur, « Histoire » est une variation autour de son histoire familiale, ainsi qu'une exploration vertigineuse de toutes les significations possibles du mot histoire.
De retour dans la maison de son enfance, le narrateur y retrouve un acacia centenaire dont le bruissement fait renaître de très anciennes conversations, tandis que la découverte de vieilles cartes postales lui permet de reconstituer la brève idylle de ses parents, morts très jeunes. À partir de ce matériau poussiéreux, la mécanique de la mémoire se met en marche, faisant affluer les souvenirs, réels ou recomposés, authentiques ou imaginaires ; ce que Claude Simon décrit comme « le foisonnant et rigoureux désordre de la mémoire. »
Au début, ce déferlement de scènes et de dialogues qui s'entrecroisent, s'interrompant ici pour reprendre là, est un peu déroutant, et même étourdissant ; et puis, peu à peu, des fils se nouent, des motifs reviennent, et on finit par y voir plus clair.
Ceux qui connaissent un peu le monde de cet écrivain, retrouveront dans « Histoire » la plupart des grands thèmes simoniens.
D'abord la guerre, ou plutôt les guerres, car, comme les hommes de sa génération, C. Simon a été marqué dans sa chair par trois conflits majeurs, les deux guerres mondiales, et la guerre d'Espagne, qui tient une grande place dans ce livre-ci.
Autre thème important, la quête des origines : « Histoire » est en effet la tentative désespérée d'un homme qui cherche non seulement à retrouver la trace de ses parents, mais aussi à leur rendre, par l'écriture, l'existence dont ils ont été privés. D'où ces nombreux passages où, à partir de cartes postales ou de photographies jaunies, le narrateur imagine les circonstances dans lesquelles les personnages les ont prises ou écrites.
Enfin, plus encore que dans ses autres romans, Claude Simon se livre ici à une immense méditation sur le sens l'histoire, une histoire faite essentiellement de guerres et de destruction, dont l'aboutissement ultime serait selon lui la tuerie de Verdun.
On l'aura compris, « Histoire » est un livre sombre, pessimiste, violent, mais c'est aussi un brillant exercice de style entre fiction et autobiographie, entre prose et poésie.
À lire, si vous voulez découvrir d'autres manières d'écrire les romans.
Comme la plupart des romans de ce grand auteur, « Histoire » est une variation autour de son histoire familiale, ainsi qu'une exploration vertigineuse de toutes les significations possibles du mot histoire.
De retour dans la maison de son enfance, le narrateur y retrouve un acacia centenaire dont le bruissement fait renaître de très anciennes conversations, tandis que la découverte de vieilles cartes postales lui permet de reconstituer la brève idylle de ses parents, morts très jeunes. À partir de ce matériau poussiéreux, la mécanique de la mémoire se met en marche, faisant affluer les souvenirs, réels ou recomposés, authentiques ou imaginaires ; ce que Claude Simon décrit comme « le foisonnant et rigoureux désordre de la mémoire. »
Au début, ce déferlement de scènes et de dialogues qui s'entrecroisent, s'interrompant ici pour reprendre là, est un peu déroutant, et même étourdissant ; et puis, peu à peu, des fils se nouent, des motifs reviennent, et on finit par y voir plus clair.
Ceux qui connaissent un peu le monde de cet écrivain, retrouveront dans « Histoire » la plupart des grands thèmes simoniens.
D'abord la guerre, ou plutôt les guerres, car, comme les hommes de sa génération, C. Simon a été marqué dans sa chair par trois conflits majeurs, les deux guerres mondiales, et la guerre d'Espagne, qui tient une grande place dans ce livre-ci.
Autre thème important, la quête des origines : « Histoire » est en effet la tentative désespérée d'un homme qui cherche non seulement à retrouver la trace de ses parents, mais aussi à leur rendre, par l'écriture, l'existence dont ils ont été privés. D'où ces nombreux passages où, à partir de cartes postales ou de photographies jaunies, le narrateur imagine les circonstances dans lesquelles les personnages les ont prises ou écrites.
Enfin, plus encore que dans ses autres romans, Claude Simon se livre ici à une immense méditation sur le sens l'histoire, une histoire faite essentiellement de guerres et de destruction, dont l'aboutissement ultime serait selon lui la tuerie de Verdun.
On l'aura compris, « Histoire » est un livre sombre, pessimiste, violent, mais c'est aussi un brillant exercice de style entre fiction et autobiographie, entre prose et poésie.
À lire, si vous voulez découvrir d'autres manières d'écrire les romans.
Le Nouveau Roman a été un moment particulier où le désir d'expérimenter était devenu impératif comme pour exorciser les deux grandes guerres mondiales et leur cortège de souffrances enracinées dans les consciences. Claude Simon se situe dans ce tâtonnement des mots dans l'obscurité idéologique des années 1960, date de la première parution de ce roman.
Il me fallait revenir un jour à Claude Simon, avec L'herbe, et surtout La route des Flandres que j'avais lus en ressentant l'envoûtement sans comprendre la véritable portée du texte... La deuxième lecture me permet d'accéder à l'inouï d'une oeuvre tenant du chef-d'oeuvre. J'ai lu que des drogues peuvent créer des rêves parcourant des dizaines d'années, c'est ce qu'on expérimente ici par la lecture – d'une certaine manière – sans effet nuisible pour la santé, bien au contraire... Aucune fumée hallucinatoire mais des phrases qui se vaporisent dans la conscience (si on accepte le voyage quelquefois assez déstabilisant…) pour remonter le temps, s'immerger directement dans d'autres vies, d'autres époques. Jamais aucun livre ne m'a semblé si apte à approcher la tragique réalité des hommes embarqués dans la guerre et ses désastres, ici à travers les réminiscences de batailles contre les espagnols lors de la Convention (évocations de l'ancêtre de Reixach) et aussi à travers un de ses descendants, capitaine à cheval fuyant sur les chemins l'avance allemande victorieuse, de nuit sous la pluie, dans la retraite de mai 1940, aussi avec l'histoire d'amour vécue, rêvée ? avant et après la guerre, là où toutes les cartes sont rebattues.
A lire d'une traite ou avec le moins de coupures possibles car reprendre n'est pas simple. Qui parle ? Georges, Blum ou Iglésias ? de quel épisode ? Celui des cavaliers, où celui de la vie d'avant, où le capitaine de Reixach et sa jeune femme Corinne, leur jockey Iglésias (amant de Corinne – rival du mari dans le civil, aide de camp à la guerre), de leur passion commune pour les chevaux, ou bien du trajet de Georges, Blum dans le train vers un camp de prisonnier ? Il paraît que Claude Simon utilisait des fils de couleurs pour s'orienter dans les différents récits imbriqués de façon complexe…
La thématique du cheval est présente tout au long du roman, reliant chacun des récits particuliers : chevaux des soldats dans leur retraite, chevaux de courses du couple Corinne - de Reixach et de leur jockey Iglésias. J'inclus les pages de la course hippique, où de Reixach veut monter lui-même l'impétueuse jument alezane, dans les plus belles pages qu'il m'ait été donné de lire ! Arrêt sur image, ralenti interminable décomposant d'infimes mouvements qui ont pourtant lieu dans une course à pleine allure, couleurs, sons, réminiscences imbriquées, tout concours à une expérience hors du commun, musique de mots, virtuosité d'un auteur repoussant les limites littéraires.
Ce roman avait pour premier titre « Description fragmentaire d'un désastre ». Expression par l'écrivain de la guerre fractionnant la pensée. Véritable patchwork – frôlant l'abstraction parfois – d'éléments juxtaposés pour leurs qualités esthétiques. Une écriture en continu – à scander comme du rap ? – usant d'abondance de participes passés, de métaphores, du je au il, de phrases laissées en suspend, de passages mystérieux... dans un repos impossible, une quête de sens sans issue : le capitaine s'est-il laissé abattre à cause d'un amour trahi par Corinne ? Georges retrouvera à son retour Corinne pour tenter de faire coïncider les fantasmes avec une réalité fuyante. Peut-il y parvenir et l'écrivain à travers lui ?
Ma deuxième lecture a été la bonne, celle où on goûte le pouvoir immense des mots même quand l'auteur prétend les disperser. Des thèmes d'une richesse inouïe, rapports de classe, trivialité des hommes dans la guerre et pas seulement... Un livre qui, par la richesse complexe de la langue – véritable claque au "Big Brother de 1984" et l'appauvrissement de sens souvent de mise actuellement –, est à lire et à relire, à savourer pour l'imaginaire offert et sa place particulière dans l'histoire de l'écrit.
Claude Simon est né en 1913 et mort en 2005. Son roman La route des Flandres contient des éléments autobiographiques. Son père était capitaine d'infanterie (figure du père dans ce capitaine de Reixach fantomatique?). La passion de Claude Simon pour la peinture se retrouve dans son écriture très particulière. Il a été prisonnier (comme Georges et Blum du roman) durant la seconde guerre mondiale avant de s'évader et de s'engager dans la Résistance. Il a participé à la rédaction du Manifeste du Nouveau Roman publié dans la revue Esprit en 1958. Prix Médicis en 1967 pour « Histoire », prix Nobel de littérature en 1985 pour l'ensemble de son oeuvre. Il est pour moi un de nos très grands écrivains, certainement trop méconnu… Savez-vous que son prix Nobel avait déclenché un tollé dans les milieux conservateurs ? Cela n'a pas beaucoup changé quand on voit les réactions hargneuses au prix Nobel de littérature décerné cette année à Annie Ernaux. On ne sort pas comme cela des schémas narratifs préconçus qui ont l'avantage d'être efficaces et rassurants, qui ne font pas de vagues trop importantes.
Quelle place occupe le nouveau roman dans vos souvenirs de lecture, dans vos lectures actuelles ?
******
Article complet avec illustrations sur Bibliofeel, lien ci-dessous
Lien : https://clesbibliofeel.blog/..
Il me fallait revenir un jour à Claude Simon, avec L'herbe, et surtout La route des Flandres que j'avais lus en ressentant l'envoûtement sans comprendre la véritable portée du texte... La deuxième lecture me permet d'accéder à l'inouï d'une oeuvre tenant du chef-d'oeuvre. J'ai lu que des drogues peuvent créer des rêves parcourant des dizaines d'années, c'est ce qu'on expérimente ici par la lecture – d'une certaine manière – sans effet nuisible pour la santé, bien au contraire... Aucune fumée hallucinatoire mais des phrases qui se vaporisent dans la conscience (si on accepte le voyage quelquefois assez déstabilisant…) pour remonter le temps, s'immerger directement dans d'autres vies, d'autres époques. Jamais aucun livre ne m'a semblé si apte à approcher la tragique réalité des hommes embarqués dans la guerre et ses désastres, ici à travers les réminiscences de batailles contre les espagnols lors de la Convention (évocations de l'ancêtre de Reixach) et aussi à travers un de ses descendants, capitaine à cheval fuyant sur les chemins l'avance allemande victorieuse, de nuit sous la pluie, dans la retraite de mai 1940, aussi avec l'histoire d'amour vécue, rêvée ? avant et après la guerre, là où toutes les cartes sont rebattues.
A lire d'une traite ou avec le moins de coupures possibles car reprendre n'est pas simple. Qui parle ? Georges, Blum ou Iglésias ? de quel épisode ? Celui des cavaliers, où celui de la vie d'avant, où le capitaine de Reixach et sa jeune femme Corinne, leur jockey Iglésias (amant de Corinne – rival du mari dans le civil, aide de camp à la guerre), de leur passion commune pour les chevaux, ou bien du trajet de Georges, Blum dans le train vers un camp de prisonnier ? Il paraît que Claude Simon utilisait des fils de couleurs pour s'orienter dans les différents récits imbriqués de façon complexe…
La thématique du cheval est présente tout au long du roman, reliant chacun des récits particuliers : chevaux des soldats dans leur retraite, chevaux de courses du couple Corinne - de Reixach et de leur jockey Iglésias. J'inclus les pages de la course hippique, où de Reixach veut monter lui-même l'impétueuse jument alezane, dans les plus belles pages qu'il m'ait été donné de lire ! Arrêt sur image, ralenti interminable décomposant d'infimes mouvements qui ont pourtant lieu dans une course à pleine allure, couleurs, sons, réminiscences imbriquées, tout concours à une expérience hors du commun, musique de mots, virtuosité d'un auteur repoussant les limites littéraires.
Ce roman avait pour premier titre « Description fragmentaire d'un désastre ». Expression par l'écrivain de la guerre fractionnant la pensée. Véritable patchwork – frôlant l'abstraction parfois – d'éléments juxtaposés pour leurs qualités esthétiques. Une écriture en continu – à scander comme du rap ? – usant d'abondance de participes passés, de métaphores, du je au il, de phrases laissées en suspend, de passages mystérieux... dans un repos impossible, une quête de sens sans issue : le capitaine s'est-il laissé abattre à cause d'un amour trahi par Corinne ? Georges retrouvera à son retour Corinne pour tenter de faire coïncider les fantasmes avec une réalité fuyante. Peut-il y parvenir et l'écrivain à travers lui ?
Ma deuxième lecture a été la bonne, celle où on goûte le pouvoir immense des mots même quand l'auteur prétend les disperser. Des thèmes d'une richesse inouïe, rapports de classe, trivialité des hommes dans la guerre et pas seulement... Un livre qui, par la richesse complexe de la langue – véritable claque au "Big Brother de 1984" et l'appauvrissement de sens souvent de mise actuellement –, est à lire et à relire, à savourer pour l'imaginaire offert et sa place particulière dans l'histoire de l'écrit.
Claude Simon est né en 1913 et mort en 2005. Son roman La route des Flandres contient des éléments autobiographiques. Son père était capitaine d'infanterie (figure du père dans ce capitaine de Reixach fantomatique?). La passion de Claude Simon pour la peinture se retrouve dans son écriture très particulière. Il a été prisonnier (comme Georges et Blum du roman) durant la seconde guerre mondiale avant de s'évader et de s'engager dans la Résistance. Il a participé à la rédaction du Manifeste du Nouveau Roman publié dans la revue Esprit en 1958. Prix Médicis en 1967 pour « Histoire », prix Nobel de littérature en 1985 pour l'ensemble de son oeuvre. Il est pour moi un de nos très grands écrivains, certainement trop méconnu… Savez-vous que son prix Nobel avait déclenché un tollé dans les milieux conservateurs ? Cela n'a pas beaucoup changé quand on voit les réactions hargneuses au prix Nobel de littérature décerné cette année à Annie Ernaux. On ne sort pas comme cela des schémas narratifs préconçus qui ont l'avantage d'être efficaces et rassurants, qui ne font pas de vagues trop importantes.
Quelle place occupe le nouveau roman dans vos souvenirs de lecture, dans vos lectures actuelles ?
******
Article complet avec illustrations sur Bibliofeel, lien ci-dessous
Lien : https://clesbibliofeel.blog/..
Une critique récente d'Henri l'Oiseleur avait attiré mon attention sur Claude Simon. Qu'il en soit remercié. J'avais eu le tort de passer à côté de Claude Simon. Comme - presque - tout le monde.
J'ai dévoré La route des Flandres sur deux après-midi. C'est probablement une bonne solution. Cette lecture plutôt ardue demande de l'attention mais elle devient nettement plus facile quand on s'immerge: une tension, un suspens, un hypnose s'installe. Une lecture plus fragmentée de ces trois longs chapitres qui se présentent à jet continu risque de perdre et de lasser. Avec La route des Flandres on goûte aux joies de l'apnée. Cela vous fait peur? Vous rebute? C'est assez naturel. Mais passons les préjugés. Déchirons les habitudes. Allons voir de l'autre côté de la montagne.
S'immerger dans quoi? Dans la fièvre. Le chaos de la fièvre. L'esprit à sauts et à gambades. La fièvre qui abolit les distances et le temps. La fièvre qui replie les dimensions. La fièvre.
Tout cela est servi par un style déconcertant, syntaxiquement éclaté, une narration kaléidoscopique et attentive à la sensation (une touffe d'herbe au pied d'un mur au premier plan sera bien mieux décrite qu'une sentinelle allemande entraperçue furtivement.) Pour cet ouvrage de 1960 j'ai oui dire que c'était alors la période formaliste et Nouveau Roman de Claude Simon. Je sens déjà le lecteur potentiel engager la procédure de secours, la main sur la poignée d'éjection. C'est normal. Mais attendez. La forme est omniprésente (il y a tellement de travail que le travail ne se voit pas), mais elle est efficace et emportera celui qui acceptera de se laisser glisser. Je ne décris pas plus cette forme. Voyez éventuellement quelques citations. Mais en gardant à l'esprit que ce roman est probablement à peu près incitable, dès lors que - s'éloignant radicalement des critères du bon goût ordinaire (sujet, verbe, complément, une situation, des personnages, un temps un lieu, une action) - il se présente comme un écheveau narratif qui pourrait presque faire passer Proust pour Gérard de Villiers et Jacques le fataliste pour un rapport circonstancié de gendarmerie. La mer toujours recommencée: rouleaux, lames, vagues, vaguelettes, toujours au moins clapot.
Notons également que si dans cette histoire de fièvre il y a du drame, du sexe, mais aussi de l'humour (une fois le récit bien lancé). Un vrai humour de roman avec une gourmandise pour la narration et même les racontars.
Se laisser glisser dans quelle histoire exactement? C'est en gros l'histoire de jeunes hommes, à cheval, perdus dans la débâcle de mai ou plutôt juin 1940, puis prisonniers en Saxe, puis perdus dans les méandres de leur mémoire individuelle et familiale. C'est surtout l'exploration des mille et une manières d'être cocu. Cocu réel ou cocu métaphorique. Éventuellement cocu par atavisme aristocratique.
Rendus à ce point il faut sans doute convenir que ce roman est assez masculin dans le sens où il comporte (sans être une autofiction à trois sous) une part non négligeable d'éléments autobiographiques, dont la captivité en Allemagne, et porte les traces des rêveries, frustrations et phantasmes d'un homme né en 1913. Ce roman n'est donc pas un manifeste de l'égalité femmes-hommes qui revisite les études de genre. Ce n'est pas non plus un plaidoyer nostalgique de la société ancienne. Mais très ordinairement la fièvre du personnage principal lui renvoit devant les yeux une liliale princesse. Du lait.
Roman de la mémoire et de la sensation. La route des Flandres peut sembler un roman très confus. La confusion est même dans les références et les allusions plus ou moins discrètes. La Liberté guidant le peuple: 1830? 1789? 2020? Le paon: animal d'Héra ou de Léda? Mais ce n'est pas réellement de la confusion, jamais. C'est la marque de la folle ambition d'embrasser toute l'épaisseur de la réalité. En ce sens il y a lieu de croire que l'ensemble est très maîtrisé dans un récit tendu, mais pas dans un espace euclidien.
Bref La route des Flandres est une nourriture riche. Ce roman est à la fois très maîtrisé et en même temps une bonne partie des interprétations possibles échappent certainement à l'intention de l'auteur qui a dessiné pour le lecteur cet espace fictif et dégagé de morale. Si j'ai bien compris la règle du jeu romanesque, formulée en particulier par Kundera, c'est ce à quoi on doit pouvoir distinguer un chef-d'oeuvre.
Restent en ce qui me concerne deux questions :
- Pourquoi autant d'utilisations de l'adjectif "grumeleux"?
- Que veut dire, en 1960, l'utilisation de ce que je croyais être un simple smiley issu de la culture SMS: " :) "? ( deux points suivis d'une parenthèse de fermeture).
J'ai dévoré La route des Flandres sur deux après-midi. C'est probablement une bonne solution. Cette lecture plutôt ardue demande de l'attention mais elle devient nettement plus facile quand on s'immerge: une tension, un suspens, un hypnose s'installe. Une lecture plus fragmentée de ces trois longs chapitres qui se présentent à jet continu risque de perdre et de lasser. Avec La route des Flandres on goûte aux joies de l'apnée. Cela vous fait peur? Vous rebute? C'est assez naturel. Mais passons les préjugés. Déchirons les habitudes. Allons voir de l'autre côté de la montagne.
S'immerger dans quoi? Dans la fièvre. Le chaos de la fièvre. L'esprit à sauts et à gambades. La fièvre qui abolit les distances et le temps. La fièvre qui replie les dimensions. La fièvre.
Tout cela est servi par un style déconcertant, syntaxiquement éclaté, une narration kaléidoscopique et attentive à la sensation (une touffe d'herbe au pied d'un mur au premier plan sera bien mieux décrite qu'une sentinelle allemande entraperçue furtivement.) Pour cet ouvrage de 1960 j'ai oui dire que c'était alors la période formaliste et Nouveau Roman de Claude Simon. Je sens déjà le lecteur potentiel engager la procédure de secours, la main sur la poignée d'éjection. C'est normal. Mais attendez. La forme est omniprésente (il y a tellement de travail que le travail ne se voit pas), mais elle est efficace et emportera celui qui acceptera de se laisser glisser. Je ne décris pas plus cette forme. Voyez éventuellement quelques citations. Mais en gardant à l'esprit que ce roman est probablement à peu près incitable, dès lors que - s'éloignant radicalement des critères du bon goût ordinaire (sujet, verbe, complément, une situation, des personnages, un temps un lieu, une action) - il se présente comme un écheveau narratif qui pourrait presque faire passer Proust pour Gérard de Villiers et Jacques le fataliste pour un rapport circonstancié de gendarmerie. La mer toujours recommencée: rouleaux, lames, vagues, vaguelettes, toujours au moins clapot.
Notons également que si dans cette histoire de fièvre il y a du drame, du sexe, mais aussi de l'humour (une fois le récit bien lancé). Un vrai humour de roman avec une gourmandise pour la narration et même les racontars.
Se laisser glisser dans quelle histoire exactement? C'est en gros l'histoire de jeunes hommes, à cheval, perdus dans la débâcle de mai ou plutôt juin 1940, puis prisonniers en Saxe, puis perdus dans les méandres de leur mémoire individuelle et familiale. C'est surtout l'exploration des mille et une manières d'être cocu. Cocu réel ou cocu métaphorique. Éventuellement cocu par atavisme aristocratique.
Rendus à ce point il faut sans doute convenir que ce roman est assez masculin dans le sens où il comporte (sans être une autofiction à trois sous) une part non négligeable d'éléments autobiographiques, dont la captivité en Allemagne, et porte les traces des rêveries, frustrations et phantasmes d'un homme né en 1913. Ce roman n'est donc pas un manifeste de l'égalité femmes-hommes qui revisite les études de genre. Ce n'est pas non plus un plaidoyer nostalgique de la société ancienne. Mais très ordinairement la fièvre du personnage principal lui renvoit devant les yeux une liliale princesse. Du lait.
Roman de la mémoire et de la sensation. La route des Flandres peut sembler un roman très confus. La confusion est même dans les références et les allusions plus ou moins discrètes. La Liberté guidant le peuple: 1830? 1789? 2020? Le paon: animal d'Héra ou de Léda? Mais ce n'est pas réellement de la confusion, jamais. C'est la marque de la folle ambition d'embrasser toute l'épaisseur de la réalité. En ce sens il y a lieu de croire que l'ensemble est très maîtrisé dans un récit tendu, mais pas dans un espace euclidien.
Bref La route des Flandres est une nourriture riche. Ce roman est à la fois très maîtrisé et en même temps une bonne partie des interprétations possibles échappent certainement à l'intention de l'auteur qui a dessiné pour le lecteur cet espace fictif et dégagé de morale. Si j'ai bien compris la règle du jeu romanesque, formulée en particulier par Kundera, c'est ce à quoi on doit pouvoir distinguer un chef-d'oeuvre.
Restent en ce qui me concerne deux questions :
- Pourquoi autant d'utilisations de l'adjectif "grumeleux"?
- Que veut dire, en 1960, l'utilisation de ce que je croyais être un simple smiley issu de la culture SMS: " :) "? ( deux points suivis d'une parenthèse de fermeture).
Sens aller : Un homme qui se meurt dans un hôpital se remémore ses années d'enfance après-guerre traversées par un tramway allant de la ville à la mer.
Sens retour: un enfant attrape chaque jour le tramway au pied e son école qui le dépose au pied de la maison familiale, pendant qu'ailleurs on agonise à la ville.
Tout autre sens est hautement souhaitable.
Une vraie belle surprise sur ma route de découverte des Nobel: contre toute attente, je pense être (un peu) arrivée à entrer dans l'univers littéraire très particulier, peut-être emprunté qui se dégage de l'écriture de Claude Simon.
Les commentaires des uns et des autres, tantôt admiratifs tantôt plus que tièdes m'ayant laissée à équidistance entre envie et répulsion, il m'a semblé sage de commencer par un roman court, ce qui est le cas de ce Tramway.
Par ailleurs ce titre m'attirait, imaginant un moyen de locomotion qui entraîne le lecteur dans le monde de l'auteur : bingo, c'est un tramway magique dont le trajet lent et répété aide à se plonger dans les phrases sans fin, oublier les points et passages à la ligne, entrer en apnées régulières au creux des innombrables parenthèses, et donc par une sorte d'hypnose laisser se créer les images convoquées et reliées entre elles dans un rapport au temps déconstruit.
Sensation au final assez agréable de se couler dans les visions d'un autre, perception de réalités coexistant à travers des images imprimées au fond de la mémoire : expérience de lecture vraiment intéressante au final. Reste à trouver le moment adéquat pour une lecture plus longue comme La route des Flandres.
Sens retour: un enfant attrape chaque jour le tramway au pied e son école qui le dépose au pied de la maison familiale, pendant qu'ailleurs on agonise à la ville.
Tout autre sens est hautement souhaitable.
Une vraie belle surprise sur ma route de découverte des Nobel: contre toute attente, je pense être (un peu) arrivée à entrer dans l'univers littéraire très particulier, peut-être emprunté qui se dégage de l'écriture de Claude Simon.
Les commentaires des uns et des autres, tantôt admiratifs tantôt plus que tièdes m'ayant laissée à équidistance entre envie et répulsion, il m'a semblé sage de commencer par un roman court, ce qui est le cas de ce Tramway.
Par ailleurs ce titre m'attirait, imaginant un moyen de locomotion qui entraîne le lecteur dans le monde de l'auteur : bingo, c'est un tramway magique dont le trajet lent et répété aide à se plonger dans les phrases sans fin, oublier les points et passages à la ligne, entrer en apnées régulières au creux des innombrables parenthèses, et donc par une sorte d'hypnose laisser se créer les images convoquées et reliées entre elles dans un rapport au temps déconstruit.
Sensation au final assez agréable de se couler dans les visions d'un autre, perception de réalités coexistant à travers des images imprimées au fond de la mémoire : expérience de lecture vraiment intéressante au final. Reste à trouver le moment adéquat pour une lecture plus longue comme La route des Flandres.
Pour ainsi dire... c’est-à-dire... comme si... de sorte que...
Claude Simon est un laboureur de l’écriture. Il la travaille, la retourne, l’émiette pour mieux la rassembler ensuite, l’emmène au bout de ses sillons après tours et détours.
Et ça marche ! On entre dans cette écriture qui malmène mais ne perd (presque) jamais le lecteur. On cherche un peu sa respiration, bénissant la ponctuation chiche, les rares virgules, qui offrent une pause rapide au souffle, mais on ne s’arrête pas : où cette diablesse d’écriture va-t-elle nous emmener ? Au jour de cette retraite de mai 1940 qui a vu la mort de Reixach ? au soir d’étape dans une grange où est apparue, à peine éclairée, éphémère, une femme fantasmée ? au stalag où plus tard, Georges, parfois narrateur, est prisonnier ? Dans la même phrase, les trois lieux, les trois temps, ce n’est pas rare. Et c’est fabuleux !
Ce n’est pas l’histoire qui se déroule dans le temps, ici ou ailleurs. Ce sont le temps, les lieux et les choses qui fabriquent l’histoire. Un nez « d’aigle ou de polichinelle », une robe « au-delà de l’indécence, c’est-à-dire supprimant, privant de sens toute idée de décence ou d’indécence », le portait d’un ancêtre (celui en couverture de mon édition), le cadavre d’un cheval au bord de la route, des uniformes qui ne ressemblent plus qu’à des haillons, une paire de jumelles devant les yeux du jockey... Ecrire la chose, les choses, pour que naisse l’histoire.
La chose décrite : sans cesse remise sur le métier, détaillée, reprise, affinée, remaniée. Jamais inerte ou indifférente. Elle participe pleinement de l’évolution du texte, elle en est le fondement, souvent l’origine active, l’impulsion.
Mais histoires, il y a pourtant. D’amours à deux siècles d’écart, de guerres, de morts violentes, d’emprisonnement.
Georges, prisonnier en Allemagne, se remémore son cousin, de Reixach, mésallié par amour avec Corinne. Corinne, éblouissante, frontale, amorale, qui trompait son mari avec Iglesia, le jockey au nez de polichinelle, engagé pour faire courir les chevaux de l’écurie de Reixach. Comme l’ancêtre commun à Reixach et Georges, portraituré sur la couverture de mon édition, qui s’est tué d’une balle dans la tête, Reixach, blessé à mort par l’infidélité de Corinne, a cherché et trouvé sa fin pendant la retraite de 1940.
Blum, prisonnier avec Georges, interprète l’histoire que celui-ci lui raconte. Appuyant là où ça fait mal, soulignant les faiblesses du récit officiel, et les vanités des personnages. C’est brillant, sans pitié, Georges a bien du mal à protester...
Un texte qui emporte, qui chahute, qui transporte, qui digresse sans cesse, à la limite d’une délicieuse asphyxie pour le lecteur, mais retrouve toujours le fil. Virtuose. Si c’est ça, le nouveau roman, alors je signe tout de suite pour une nouvelle expérience.
Merci à Martine @enjie77 qui m’a envoyée vers Claude Simon, en parlant de « L’Acacia ». Point d’acacia à la librairie, mais une route des Flandres. J’ai pris la route !
PS : La postface « Le tissu de mémoire » explique de façon savante le caractère très particulier de ce roman. Il me suffit, à moi, qu’elle constate « l’extraordinaire pouvoir d’envoûtement du texte ». Le reste, ou rappelle ce que j’y ai vu, ou, le plus souvent, parle de tout ce que je suis incapable d’y discerner... et dont je me passe très bien pour aimer le livre...
Claude Simon est un laboureur de l’écriture. Il la travaille, la retourne, l’émiette pour mieux la rassembler ensuite, l’emmène au bout de ses sillons après tours et détours.
Et ça marche ! On entre dans cette écriture qui malmène mais ne perd (presque) jamais le lecteur. On cherche un peu sa respiration, bénissant la ponctuation chiche, les rares virgules, qui offrent une pause rapide au souffle, mais on ne s’arrête pas : où cette diablesse d’écriture va-t-elle nous emmener ? Au jour de cette retraite de mai 1940 qui a vu la mort de Reixach ? au soir d’étape dans une grange où est apparue, à peine éclairée, éphémère, une femme fantasmée ? au stalag où plus tard, Georges, parfois narrateur, est prisonnier ? Dans la même phrase, les trois lieux, les trois temps, ce n’est pas rare. Et c’est fabuleux !
Ce n’est pas l’histoire qui se déroule dans le temps, ici ou ailleurs. Ce sont le temps, les lieux et les choses qui fabriquent l’histoire. Un nez « d’aigle ou de polichinelle », une robe « au-delà de l’indécence, c’est-à-dire supprimant, privant de sens toute idée de décence ou d’indécence », le portait d’un ancêtre (celui en couverture de mon édition), le cadavre d’un cheval au bord de la route, des uniformes qui ne ressemblent plus qu’à des haillons, une paire de jumelles devant les yeux du jockey... Ecrire la chose, les choses, pour que naisse l’histoire.
La chose décrite : sans cesse remise sur le métier, détaillée, reprise, affinée, remaniée. Jamais inerte ou indifférente. Elle participe pleinement de l’évolution du texte, elle en est le fondement, souvent l’origine active, l’impulsion.
Mais histoires, il y a pourtant. D’amours à deux siècles d’écart, de guerres, de morts violentes, d’emprisonnement.
Georges, prisonnier en Allemagne, se remémore son cousin, de Reixach, mésallié par amour avec Corinne. Corinne, éblouissante, frontale, amorale, qui trompait son mari avec Iglesia, le jockey au nez de polichinelle, engagé pour faire courir les chevaux de l’écurie de Reixach. Comme l’ancêtre commun à Reixach et Georges, portraituré sur la couverture de mon édition, qui s’est tué d’une balle dans la tête, Reixach, blessé à mort par l’infidélité de Corinne, a cherché et trouvé sa fin pendant la retraite de 1940.
Blum, prisonnier avec Georges, interprète l’histoire que celui-ci lui raconte. Appuyant là où ça fait mal, soulignant les faiblesses du récit officiel, et les vanités des personnages. C’est brillant, sans pitié, Georges a bien du mal à protester...
Un texte qui emporte, qui chahute, qui transporte, qui digresse sans cesse, à la limite d’une délicieuse asphyxie pour le lecteur, mais retrouve toujours le fil. Virtuose. Si c’est ça, le nouveau roman, alors je signe tout de suite pour une nouvelle expérience.
Merci à Martine @enjie77 qui m’a envoyée vers Claude Simon, en parlant de « L’Acacia ». Point d’acacia à la librairie, mais une route des Flandres. J’ai pris la route !
PS : La postface « Le tissu de mémoire » explique de façon savante le caractère très particulier de ce roman. Il me suffit, à moi, qu’elle constate « l’extraordinaire pouvoir d’envoûtement du texte ». Le reste, ou rappelle ce que j’y ai vu, ou, le plus souvent, parle de tout ce que je suis incapable d’y discerner... et dont je me passe très bien pour aimer le livre...
Heureusement que ce livre est court car sa lecture est du genre rébarbative. Des phrases aussi longues que chez Proust mais sans l’ampleur et la mélodie. Au contraire la lecture est freinée par le nombre de parenthèses, ainsi parfois que par leur place dans la phrase. La ponctuation est parfois soudainement absente. Cela ne dessert pas forcément le propos de l’auteur, plaçant le lecteur dans le même brouillard que le narrateur qui depuis son lit d’hôpital se souvient du tramway de son enfance, mais c’est désagréable à lire, même le lire à haute voix n’aide pas. C’est plutôt du genre casse-tête, avec la nécessité de rechercher le début de la phrase, puis d’en faire l’analyse grammaticale, pour arriver à comprendre le sens de ce qu’on vient de lire. Par contre pour le fond, ce récit autobiographique est très intéressant. Du fond de son lit d’hôpital un vieillard (l’auteur) légèrement désorienté se remémore son enfance à Perpignan (non nommée dans son récit), en particulier de ses trajets en tramway. Ce tramway dont la ligne allait du centre-ville où il allait à l’école jusqu’à la plage en passant par son domicile. Ce tramway sert de fil rouge entre les souvenirs d’enfance, et un portrait de la mère du narrateur qui ne s’en souvient pratiquement que triste voire dépressive (veuve de guerre) ou malade voire mourante. La façon dont l’auteur se sert aussi de ce tramway pour au passage dresser un portrait de la ville de Perpignan dans les années 20 est tout à fait remarquable. Mais malgré tout, une chose est à peu près sûre, je ne suis pas près de faire renter un autre livre de Claude Simon dans ma PAL !
Etrange comme tout s'efface... Les souvenirs anciens, les rêves et le passé récent... Ceci est le deuxième commentaire sur La route des Flandres. J'y écrirai la même chose et autre chose que dans le premier, disparu à jamais dans les profondeurs de mon ordinateur. J'y retrouverai la longueur haletante, sans répis, assommante et fascinante de la phrase simonienne (l'impression qu'il n'y a (je veux dire "qu'il n'existe") qu'une seule prase, sans commencement, sans fin, toute pleine du monde passé, présent, à venir, à songer). Je retrouverai les temps indécis des histoires racontés par on ne sait pas toujours qui à un autre ou à lui-même, le cheval mort, le jockey qui chevauche Corinne, quatre rosses égarées dans la boue d'une guerre qui n'en est même plus une, une débâcle à laquelle on s'habitue, dont on ne sait pas si elle est plus vraie que le suicide de l'ancêtre, sur le tableau, héroïque ou cocu, jockey ou chevalier. Je me reposerai les mêmes questions : qu'est-ce qui tient en haleine ? J'évoquerai encore un Proust qui échoue, un temps spacialisé en un no man's land. Je ne saurai toujours pas l'impact de ce livre, avalanche de mots, d'images horribles ou charnelles (horribles et charnelles, plutôt), tableau flou (ou fou) d'un monde qui en est plusieurs et aucun, et comme Georges (ou Blum, ou de Reixach), je serai perdu au milieu d'un monde peut-être même pas absurde.
La Route des Flandres est un admirable et foisonnant roman de guerre, qui a intimidé les lecteurs français à cause des relations de l'auteur avec le mouvement théoricien du Nouveau Roman. L'ouvrage a été inscrit au programme de l'agrégation de lettres, ce qui a suscité une masse d'études critiques s'ajoutant à toute la science linguistique du mouvement néo-romanesque.
*
Pourtant Claude Simon n'écrit pas son livre à partir de théories savantes, ni ne met vraiment ses pas dans ceux de Robbe-Grillet, Sarraute, Ricardou ou Butor. Il puise dans son expérience personnelle d'ancien combattant de la guerre de 40, de la débâcle et de la captivité. Certes, le récit qu'il en fait n'est pas simple à lire, car il s'efforce de créer une forme romanesque adéquate à l'expérience qu'il a vécue. Autrement dit, il fuit les généralités, les idées toutes faites, les grands discours, pour lesquels son personnage, Georges, n'a que mépris (voir les passages hilarants contre Rousseau). Et de même, il tente de restituer l'expérience sensorielle de la guerre, fatigue, ivresse, captivité, danger, et aussi odeurs, sons et couleurs, qui prennent le dessus dans le récit et en chassent les pensées rationnelles et verbales. Aussi le monde est-il perçu par la chair et le sang, non pas conçu par l'esprit ou le "coeur". La mauvaise littérature se contente de nommer paresseusement les choses et se consacre aux clichés et aux sentiments. Quand Claude Simon décrit un talus herbeux tel que le voit un soldat couché au sol, un visage, un cheval mort, un mur de briques, la présence sensorielle des choses est extrêmement puissante.
*
Ce choix littéraire de la présence du monde n'aurait pas été possible sans une critique radicale des grands discours traditionnels. Ce qui la rend possible, c'est la guerre et la débâcle, qui donnent au narrateur et peut-être à l'auteur une impression de fin d'un monde, voire de fin du monde. Les "quatre cavaliers" sur les routes de Flandres, évoquent bien ceux de l'Apocalypse. Certaines métaphores de la nuit donnent à la guerre la dimension d'une catastrophe cosmique. Pourtant, les personnages, pendant leur captivité dans un Stalag allemand, s'efforcent de passer le temps en reconstruisant par la mémoire, les récits, les discussions, des événements du passé familial de Georges, des courses de chevaux, le suicide de plusieurs officiers, des histoires d'adultères démultipliées. Les hommes ne peuvent se passer de la magie du langage, qui les console ou les distrait dans cet univers menacé de sombrer dans le néant. On osera dire que ces prisonniers bavards du Stalag ressemblent un peu aux lecteurs que nous sommes, et aussi, qui sait ? à cette "humanité dans les chaînes" qu'imaginait Pascal dans les Pensées, se divertissant comme elle peut en attendant la mort. On a beaucoup évoqué Faulkner, celui d'Absalon Absalon, pour ce roman. On pourrait aussi penser au Malraux de L'Espoir et de la Condition Humaine, du moins dans ses tableaux de guerre, à condition d'en ignorer les bavardages idéologiques.
*
J'ajouterai pour finir que je n'ai jamais rien lu d'aussi beau sur les chevaux et les cavaliers.
*
Pourtant Claude Simon n'écrit pas son livre à partir de théories savantes, ni ne met vraiment ses pas dans ceux de Robbe-Grillet, Sarraute, Ricardou ou Butor. Il puise dans son expérience personnelle d'ancien combattant de la guerre de 40, de la débâcle et de la captivité. Certes, le récit qu'il en fait n'est pas simple à lire, car il s'efforce de créer une forme romanesque adéquate à l'expérience qu'il a vécue. Autrement dit, il fuit les généralités, les idées toutes faites, les grands discours, pour lesquels son personnage, Georges, n'a que mépris (voir les passages hilarants contre Rousseau). Et de même, il tente de restituer l'expérience sensorielle de la guerre, fatigue, ivresse, captivité, danger, et aussi odeurs, sons et couleurs, qui prennent le dessus dans le récit et en chassent les pensées rationnelles et verbales. Aussi le monde est-il perçu par la chair et le sang, non pas conçu par l'esprit ou le "coeur". La mauvaise littérature se contente de nommer paresseusement les choses et se consacre aux clichés et aux sentiments. Quand Claude Simon décrit un talus herbeux tel que le voit un soldat couché au sol, un visage, un cheval mort, un mur de briques, la présence sensorielle des choses est extrêmement puissante.
*
Ce choix littéraire de la présence du monde n'aurait pas été possible sans une critique radicale des grands discours traditionnels. Ce qui la rend possible, c'est la guerre et la débâcle, qui donnent au narrateur et peut-être à l'auteur une impression de fin d'un monde, voire de fin du monde. Les "quatre cavaliers" sur les routes de Flandres, évoquent bien ceux de l'Apocalypse. Certaines métaphores de la nuit donnent à la guerre la dimension d'une catastrophe cosmique. Pourtant, les personnages, pendant leur captivité dans un Stalag allemand, s'efforcent de passer le temps en reconstruisant par la mémoire, les récits, les discussions, des événements du passé familial de Georges, des courses de chevaux, le suicide de plusieurs officiers, des histoires d'adultères démultipliées. Les hommes ne peuvent se passer de la magie du langage, qui les console ou les distrait dans cet univers menacé de sombrer dans le néant. On osera dire que ces prisonniers bavards du Stalag ressemblent un peu aux lecteurs que nous sommes, et aussi, qui sait ? à cette "humanité dans les chaînes" qu'imaginait Pascal dans les Pensées, se divertissant comme elle peut en attendant la mort. On a beaucoup évoqué Faulkner, celui d'Absalon Absalon, pour ce roman. On pourrait aussi penser au Malraux de L'Espoir et de la Condition Humaine, du moins dans ses tableaux de guerre, à condition d'en ignorer les bavardages idéologiques.
*
J'ajouterai pour finir que je n'ai jamais rien lu d'aussi beau sur les chevaux et les cavaliers.
Claude Simon est un écrivain emblématique des Editions de Minuit, une figure de proue du Nouveau Roman, le roman expérimental des années 1950 à 1970, avec Beckett, Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet, Robert Pinget, Michel Butor ou Marguerite Duras. A roman expérimental, nouvelle expérience de lecture, donc : si vous pouvez lire d’un trait 289 pages écrites presque sans pause, ni rupture, ni respiration, vous devriez aimer La Route des Flandres, publié en 1960. Mais n'est pas un lecteur de Claude Simon qui veut...
De quoi s’agit-il ? Le protocole exige pourtant que je vous apporte les réponses, au lieu de vous poser des questions, mais voilà : si je l’ai bien lu jusqu’au bout, je suis bien en peine de vous le résumer. Heureusement, la 4e de couverture peut suppléer à mes déficiences : « Le capitaine de Reixach [prononcer Reichac], abattu en mai 40 par un parachutiste allemand, a-t-il délibérément cherché cette mort ? Un de ses cousins. Georges, simple cavalier dans le même régiment, cherche à découvrir la vérité. Aidé de Blum, prisonnier dans le même camp, il interroge leur compagnon Iglésia qui fut jadis jockey de l'écurie Reixach. Après la guerre, il finit par retrouver Corinne, la jeune veuve du capitaine... »
L’auteur s’est orienté vers un long monologue intérieur qui cherche à reproduire les mécanismes de la mémoire (le « foisonnant et rigoureux désordre de la mémoire », disait Simon). La narration doit figurer le flux anarchique de nos pensées, ces images cérébrales qui nous animent. Elle se compose par collages, par associations d’idées, brossant un tableau confus où les époques et les évènements s’entrecroisent, s’entremêlent, se superposent et finissent par se confondre. On retrouve aussi ses influences majeures : ses lectures de Joyce et Faulkner, et l’impact de ses propres œuvres de peintre dans son écriture faite de juxtapositions, ajouts, interpositions et superpositions. Comme un fleuve sans digues, la plume coule sur le papier, déversant souvenirs et émotions. C’est un peu comme dans la vie : un va-et-vient incessant, des flash-back constants, rien n’est donné définitivement au lecteur qui doit rester attentif et rechercher des points de repère. Le procédé cherche pour ainsi dire à tutoyer l’essence même de l’homme : Je pense, donc je suis. Et Je suis ce que je pense.
A roman expérimental, nouvelle expérience de lecture : j’ai donc expérimenté le roman expérimental. Cette lecture fut tellement heurtée que je ne peux pas dire que j’ai aimé l’expérience. Mon attention s’est égarée cent fois et les incessantes interruptions dues aux contingences de la vie quotidienne compliquaient encore les choses : par où reprendre la lecture de ce récit sans début, ni fin ? Où cette histoire nous conduit-elle ? Il m’a bien fallu une centaine de pages de persévérance pour m’accoutumer un tant soit peu et entrer dans cette innovante sarabande langagière.
J’avoue quand même être impressionné, et même admiratif, devant une telle richesse de vocabulaire, devant un tel sommet de technicité littéraire et d’ingénierie stylistique où le temps s’efface sous la plume de l’auteur. Mais je n’ai pas eu de réel plaisir de lecture et n’ai guère réussi à me passionner pour cette histoire. Le fond ne m'a pas plu, la forme m'a gêné: un rendez-vous manqué, hélas...
De quoi s’agit-il ? Le protocole exige pourtant que je vous apporte les réponses, au lieu de vous poser des questions, mais voilà : si je l’ai bien lu jusqu’au bout, je suis bien en peine de vous le résumer. Heureusement, la 4e de couverture peut suppléer à mes déficiences : « Le capitaine de Reixach [prononcer Reichac], abattu en mai 40 par un parachutiste allemand, a-t-il délibérément cherché cette mort ? Un de ses cousins. Georges, simple cavalier dans le même régiment, cherche à découvrir la vérité. Aidé de Blum, prisonnier dans le même camp, il interroge leur compagnon Iglésia qui fut jadis jockey de l'écurie Reixach. Après la guerre, il finit par retrouver Corinne, la jeune veuve du capitaine... »
L’auteur s’est orienté vers un long monologue intérieur qui cherche à reproduire les mécanismes de la mémoire (le « foisonnant et rigoureux désordre de la mémoire », disait Simon). La narration doit figurer le flux anarchique de nos pensées, ces images cérébrales qui nous animent. Elle se compose par collages, par associations d’idées, brossant un tableau confus où les époques et les évènements s’entrecroisent, s’entremêlent, se superposent et finissent par se confondre. On retrouve aussi ses influences majeures : ses lectures de Joyce et Faulkner, et l’impact de ses propres œuvres de peintre dans son écriture faite de juxtapositions, ajouts, interpositions et superpositions. Comme un fleuve sans digues, la plume coule sur le papier, déversant souvenirs et émotions. C’est un peu comme dans la vie : un va-et-vient incessant, des flash-back constants, rien n’est donné définitivement au lecteur qui doit rester attentif et rechercher des points de repère. Le procédé cherche pour ainsi dire à tutoyer l’essence même de l’homme : Je pense, donc je suis. Et Je suis ce que je pense.
A roman expérimental, nouvelle expérience de lecture : j’ai donc expérimenté le roman expérimental. Cette lecture fut tellement heurtée que je ne peux pas dire que j’ai aimé l’expérience. Mon attention s’est égarée cent fois et les incessantes interruptions dues aux contingences de la vie quotidienne compliquaient encore les choses : par où reprendre la lecture de ce récit sans début, ni fin ? Où cette histoire nous conduit-elle ? Il m’a bien fallu une centaine de pages de persévérance pour m’accoutumer un tant soit peu et entrer dans cette innovante sarabande langagière.
J’avoue quand même être impressionné, et même admiratif, devant une telle richesse de vocabulaire, devant un tel sommet de technicité littéraire et d’ingénierie stylistique où le temps s’efface sous la plume de l’auteur. Mais je n’ai pas eu de réel plaisir de lecture et n’ai guère réussi à me passionner pour cette histoire. Le fond ne m'a pas plu, la forme m'a gêné: un rendez-vous manqué, hélas...
Un homme, un militaire issu de la paysannerie, a gravi les échelons pour enfin avoir "accès à l'inaccessible princesse", descendante d'un général d'Empire. Un enfant naît de ce mariage.
Ce roman ne cesse de monter et descendre l'échelle de la mémoire de cette famille : la première guerre mondiale, le communisme en URSS, le nazisme en Allemagne, la seconde guerre mondiale... il n'y a pas d'entre-deux-guerres dans L'acacia, mais un douloureux continuum de destins fracassés.
Claude Simon peut écrire un long paragraphe sur une chose aussi anodine qu'une carte postale, une boîte de cirage... sans un mot de trop. On pourrait parler d'écriture "minutieuse". Mais il raconte la mobilisation générale en 1939, au travers de l'instant du départ à la gare de Perpignan, et ces trois pages sont magistrales, exceptionnelles. De la même façon hallucinante, il relate la rencontre entre un cavalier ayant perdu son régiment, et un groupe de trois blindés, et ça vous laisse sans voix.
Challenge Nobel
Ce roman ne cesse de monter et descendre l'échelle de la mémoire de cette famille : la première guerre mondiale, le communisme en URSS, le nazisme en Allemagne, la seconde guerre mondiale... il n'y a pas d'entre-deux-guerres dans L'acacia, mais un douloureux continuum de destins fracassés.
Claude Simon peut écrire un long paragraphe sur une chose aussi anodine qu'une carte postale, une boîte de cirage... sans un mot de trop. On pourrait parler d'écriture "minutieuse". Mais il raconte la mobilisation générale en 1939, au travers de l'instant du départ à la gare de Perpignan, et ces trois pages sont magistrales, exceptionnelles. De la même façon hallucinante, il relate la rencontre entre un cavalier ayant perdu son régiment, et un groupe de trois blindés, et ça vous laisse sans voix.
Challenge Nobel
Claude Simon revient dans le Jardin des Plantes sur un épisode qu'il a vécu et fréquemment évoqué, de la débâcle de mai 1940. Mais il évite tout effet lassant de répétition, car le style et la qualité du regard de ce roman de 1997 renouvellent les événements, qui ne paraissent jamais les mêmes d'un livre à l'autre. La splendeur et la minutie des descriptions révèlent le monde concret, infiniment varié, toujours foisonnant et surabondant. Donc Mai 1940, les séquences de la guerre d'Espagne, les rappels de Paris sous l'Occupation, etc, ne sont jamais les mêmes car le romancier les aborde toujours sous un angle différent.
Cette écriture proche de la peinture repose sur un procédé simple et puissant, qui consiste à éviter les noms propres, et à les remplacer par des périphrases descriptives. C'est particulièrement frappant dans les descriptions de villes, New-York, Rome, Delhi, Stockholm, ou les portraits de personnages historiques comme Churchill ou Gorbatchev. Eviter le nom, c'est donner libre cours à la variété descriptive des périphrases concrètes, qui nous aide à voir la ville ou le personnage comme si c'était la première fois, sans le filtre d'une connaissance préalable. Car le nom propre remplace la perception, la forme, la couleur, par l'idée préconçue et souvent banale. Ainsi Claude Simon rend-il au regard du lecteur toute son innocence, à l'école de Proust.
La composition du roman est, elle aussi, proche de la sensation. On évite le commentaire, la référence commune, ce qui déroute le lecteur, surtout dans les premières pages. Puis il comprend les relations qui se tissent entre les diverses parties, les divers blocs de texte, par analogies, "rimes narratives", reprises et échos. Pour prendre, entre mille, deux exemples de "rimes narratives", on peut citer l'usage que fait le romancier du nom du peintre Poussin (p. 287), qui permet d'associer le récit d'une visite à l'Ermitage et une citation de Proust qui ne parle en fait que du Temps. Ou encore, la description des premières îles de l'archipel japonais vues d'avion (p. 305), associée à la forme particulière des huîtres que l'on sert dans ce pays, rappelle la forme des seins de femmes peints par Gastone Novelli, peintre fictif présent dans le roman, lequel se souvient des seins des femmes d'une tribu amazonienne qui l'avait accueilli. Et si l'on poursuit encore l'enquête, de rime en rime, on se rend compte que le texte romanesque est marqué par une unité profonde, sous son apparent désordre. L'unité est celle des formes, des couleurs, des sensations, non des idées. C'est pictural.
Le roman de ce très grand artiste se distingue par des traits que je n'ai pas rencontrés jusque-là dans les autres (mais je n'ai pas tout lu) : d'abord, l'élargissement du cadre à la planète entière, du Kazakhstan à l'Inde et aux Etats-Unis. La prise en compte, ensuite, du Prix Nobel et des honneurs décernés ensuite à l'auteur : de nombreux colloques, voyages, cérémonies, interviews, sont présents dans le roman, sous la forme toujours neuve que son regard de peintre, attentif au concret, ironique, leur confère. Une présence plus nette des femmes et de la sexualité. Enfin, le débat littéraire sur le Nouveau Roman et la référence, est inclus dans le roman, qui réfléchit sur lui-même. Ce n'est pas la seule dette de Claude Simon envers Proust.
Il n'est pas mauvais de se laisser dépasser un peu par un grand livre, dont le foisonnement se manifeste à la variété des études parues, qui n'en épuisent jamais la matière. Une littérature trop étroitement ciblée sur un public rare et culturellement pauvre, issu du désastre scolaire, se condamne au conformisme et à l'indigence. On s'habitue à ne trouver dans ces produits que ce qu'on attend, et l'on s'indigne d'être bousculé, dépassé, baladé vers d'autres horizons, par des livres plus grands, plus beaux et plus profonds, comme celui-ci.
Cette écriture proche de la peinture repose sur un procédé simple et puissant, qui consiste à éviter les noms propres, et à les remplacer par des périphrases descriptives. C'est particulièrement frappant dans les descriptions de villes, New-York, Rome, Delhi, Stockholm, ou les portraits de personnages historiques comme Churchill ou Gorbatchev. Eviter le nom, c'est donner libre cours à la variété descriptive des périphrases concrètes, qui nous aide à voir la ville ou le personnage comme si c'était la première fois, sans le filtre d'une connaissance préalable. Car le nom propre remplace la perception, la forme, la couleur, par l'idée préconçue et souvent banale. Ainsi Claude Simon rend-il au regard du lecteur toute son innocence, à l'école de Proust.
La composition du roman est, elle aussi, proche de la sensation. On évite le commentaire, la référence commune, ce qui déroute le lecteur, surtout dans les premières pages. Puis il comprend les relations qui se tissent entre les diverses parties, les divers blocs de texte, par analogies, "rimes narratives", reprises et échos. Pour prendre, entre mille, deux exemples de "rimes narratives", on peut citer l'usage que fait le romancier du nom du peintre Poussin (p. 287), qui permet d'associer le récit d'une visite à l'Ermitage et une citation de Proust qui ne parle en fait que du Temps. Ou encore, la description des premières îles de l'archipel japonais vues d'avion (p. 305), associée à la forme particulière des huîtres que l'on sert dans ce pays, rappelle la forme des seins de femmes peints par Gastone Novelli, peintre fictif présent dans le roman, lequel se souvient des seins des femmes d'une tribu amazonienne qui l'avait accueilli. Et si l'on poursuit encore l'enquête, de rime en rime, on se rend compte que le texte romanesque est marqué par une unité profonde, sous son apparent désordre. L'unité est celle des formes, des couleurs, des sensations, non des idées. C'est pictural.
Le roman de ce très grand artiste se distingue par des traits que je n'ai pas rencontrés jusque-là dans les autres (mais je n'ai pas tout lu) : d'abord, l'élargissement du cadre à la planète entière, du Kazakhstan à l'Inde et aux Etats-Unis. La prise en compte, ensuite, du Prix Nobel et des honneurs décernés ensuite à l'auteur : de nombreux colloques, voyages, cérémonies, interviews, sont présents dans le roman, sous la forme toujours neuve que son regard de peintre, attentif au concret, ironique, leur confère. Une présence plus nette des femmes et de la sexualité. Enfin, le débat littéraire sur le Nouveau Roman et la référence, est inclus dans le roman, qui réfléchit sur lui-même. Ce n'est pas la seule dette de Claude Simon envers Proust.
Il n'est pas mauvais de se laisser dépasser un peu par un grand livre, dont le foisonnement se manifeste à la variété des études parues, qui n'en épuisent jamais la matière. Une littérature trop étroitement ciblée sur un public rare et culturellement pauvre, issu du désastre scolaire, se condamne au conformisme et à l'indigence. On s'habitue à ne trouver dans ces produits que ce qu'on attend, et l'on s'indigne d'être bousculé, dépassé, baladé vers d'autres horizons, par des livres plus grands, plus beaux et plus profonds, comme celui-ci.
Comme toute l’œuvre de Claude Simon, « La Route des Flandres » s’écrit dans l’après-guerreS –les deux guerres mondiales, la guerre d’Espagne, les guerres de l’Empire et de la Révolution-, c'est-à-dire dans ce moment d’une coïncidence traumatisante et aliénante de la mémoire de soi et de la mémoire historique : pour la génération née en 1910, l’histoire individuelle et l’Histoire se confondent, alors qu’elle se découvre non seulement promise à mourir en 1940 mais aussi à voir mourir en elle une deuxième fois ses pères tués en 14-18.
Confrontée à la monstruosité d’une apocalypse sans cesse réitérée, l’humanité voit alors s’anéantir sa foi dans le progrès tandis que se trouvent dénoncées la vanité des constructions humaines en même temps que l’inutilité de la littérature. Et pourtant, face à la débâcle, subsiste la pulsion d’une parole conjuratrice ; mise en tension avec la terrible certitude de la vacuité de l’entreprise, cette pulsion rythme l’ensemble des dialogues, toujours au bord de la rupture ; la voix humaine en effet est la dernière possibilité de résistance, comme « un enfant siffle en traversant un bois dans le noir » : « deux voix faussement assurées, faussement sarcastiques, se haussant, se forçant, comme s’ils cherchaient à s’accrocher à elles espéraient grâce à elles conjurer cette espèce de sortilège, de liquéfaction, de débâcle, de désastre aveugle » (121)…
Et donc, pour survivre, il faut parler ; mais parler à qui ? A la putain de «L’Acacia» ? Au journaliste du «Jardin des Plantes» ? A Corinne ? « En tous cas pas à [elle] » (p.90) « La Route des Flandres » se heurte sans cesse à cette interrogation, au problème de la réception du discours. Cette indécision est aussi celle du lecteur, placé face à une énonciation infixable, labile et subversive, détruisant sans cesse les fragiles certitudes que l’on croyait acquises, soumise au surgissement anarchique des souvenirs ; perdu, malmené, asphyxié, happé par les flux du temps et de la mémoire, ce lecteur devient alors le double du narrateur et accède à l’expérience même qui lui est racontée.
Une lecture difficile mais indispensable et inoubliable ; une œuvre magistrale.
Confrontée à la monstruosité d’une apocalypse sans cesse réitérée, l’humanité voit alors s’anéantir sa foi dans le progrès tandis que se trouvent dénoncées la vanité des constructions humaines en même temps que l’inutilité de la littérature. Et pourtant, face à la débâcle, subsiste la pulsion d’une parole conjuratrice ; mise en tension avec la terrible certitude de la vacuité de l’entreprise, cette pulsion rythme l’ensemble des dialogues, toujours au bord de la rupture ; la voix humaine en effet est la dernière possibilité de résistance, comme « un enfant siffle en traversant un bois dans le noir » : « deux voix faussement assurées, faussement sarcastiques, se haussant, se forçant, comme s’ils cherchaient à s’accrocher à elles espéraient grâce à elles conjurer cette espèce de sortilège, de liquéfaction, de débâcle, de désastre aveugle » (121)…
Et donc, pour survivre, il faut parler ; mais parler à qui ? A la putain de «L’Acacia» ? Au journaliste du «Jardin des Plantes» ? A Corinne ? « En tous cas pas à [elle] » (p.90) « La Route des Flandres » se heurte sans cesse à cette interrogation, au problème de la réception du discours. Cette indécision est aussi celle du lecteur, placé face à une énonciation infixable, labile et subversive, détruisant sans cesse les fragiles certitudes que l’on croyait acquises, soumise au surgissement anarchique des souvenirs ; perdu, malmené, asphyxié, happé par les flux du temps et de la mémoire, ce lecteur devient alors le double du narrateur et accède à l’expérience même qui lui est racontée.
Une lecture difficile mais indispensable et inoubliable ; une œuvre magistrale.
Dire que ce roman est resté vingt bonnes années sur son rayonnage, sans que je l'ouvre une seule fois ! C'était de la grande littérature, frôlant de près le devoir scolaire, mais aussi l'impossibilité du devoir scolaire, quand je me rendis vite compte, au début de ma carrière, qu'il fallait abandonner tout espoir de faire lire à des élèves une page de Claude Simon. Et puis, le Prix Nobel de Littérature, mazette ! On le donne à des auteurs bien-pensants, vertueux et ennuyeux comme Le Clézio, Modiano et compagnie. Il y a bien eu Singer, mais l'amour scandinave pour le Bien est "une tendance lourde", comme disait J.L. Borges : "Ne pas me décerner le Prix Nobel de Littérature est une vieille tradition suédoise."
Donc, libéré de mes obligations professorales, j'ai ouvert "Le Vent" un peu par hasard et la splendeur de la phrase m'a sauté au visage. Splendeur, non pas faite de mots rares ni de recherches exagérées ou de maniérismes, mais l'ample respiration d'un homme, d'un récitant, d'un narrateur qui construit son récit à mesure qu'il en trouve les mots, hésite, se reprend, mais sans jamais haleter, ni rater un silence ou une croche, sachant aller de l'avant comme un récitant de Passion de Bach, sans flancher et jusqu'au bout. Alors que le sous-titre se réfère à la peinture ("retable baroque"), j'ai immédiatement pensé à la musique, et aussi au terme "tentative" de ce sous-titre, qui insiste sur le côté expérimental du récit des événements qui suivent. Je ne le résumerai pas, d'autres l'ont fait, mais je proposerais qu'on lise ces pages à haute voix, pour soi-même, pour en éprouver le rythme et respirer avec elles.
Parfois, on s'arrête de lire pour relire : soit parce que c'est beau, simplement, soit parce qu'on éprouve le besoin de mieux comprendre ce qui est raconté, "tenté", exprimé ou décrit. C'est alors que l'affinité avec la peinture se dévoile en plein : Simon varie l'exposition de l'objectif (la focale ?), va du plan d'ensemble au très gros plan, et donne à la réalité où les événements se déroulent toute sa présence. Le vent, la ville du midi, les gens, les objets, sont puissamment là, comme dans un film de Robert Bresson ou un poème de Ponge (mais sans l'ironie de Ponge). Ce pays venteux étant le mien, j'ai sans doute mieux "marché" que si le décor avait été différent. Le pays était là. La prose de Simon faisait renaître en moi les plus simples, les plus anciennes sensations de l'enfance, celles qu'on éprouve sans pensée, animalement.
Des émotions poétiques, plus que romanesques. On n'attendra pas du "Vent" ce qu'un roman doit faire : une critique de ce qui est. C'est de la poésie. Ce livre de Claude Simon date d'une époque où la critique de la bourgeoisie de province avait peut-être encore une saveur un peu transgressive, où l'on faisait preuve d'audace quand on était de gauche. D'où le Prix Nobel sans doute, et la canonisation de ce grand écrivain, statufié parmi ceux qu'on ne lit pas.
Donc, libéré de mes obligations professorales, j'ai ouvert "Le Vent" un peu par hasard et la splendeur de la phrase m'a sauté au visage. Splendeur, non pas faite de mots rares ni de recherches exagérées ou de maniérismes, mais l'ample respiration d'un homme, d'un récitant, d'un narrateur qui construit son récit à mesure qu'il en trouve les mots, hésite, se reprend, mais sans jamais haleter, ni rater un silence ou une croche, sachant aller de l'avant comme un récitant de Passion de Bach, sans flancher et jusqu'au bout. Alors que le sous-titre se réfère à la peinture ("retable baroque"), j'ai immédiatement pensé à la musique, et aussi au terme "tentative" de ce sous-titre, qui insiste sur le côté expérimental du récit des événements qui suivent. Je ne le résumerai pas, d'autres l'ont fait, mais je proposerais qu'on lise ces pages à haute voix, pour soi-même, pour en éprouver le rythme et respirer avec elles.
Parfois, on s'arrête de lire pour relire : soit parce que c'est beau, simplement, soit parce qu'on éprouve le besoin de mieux comprendre ce qui est raconté, "tenté", exprimé ou décrit. C'est alors que l'affinité avec la peinture se dévoile en plein : Simon varie l'exposition de l'objectif (la focale ?), va du plan d'ensemble au très gros plan, et donne à la réalité où les événements se déroulent toute sa présence. Le vent, la ville du midi, les gens, les objets, sont puissamment là, comme dans un film de Robert Bresson ou un poème de Ponge (mais sans l'ironie de Ponge). Ce pays venteux étant le mien, j'ai sans doute mieux "marché" que si le décor avait été différent. Le pays était là. La prose de Simon faisait renaître en moi les plus simples, les plus anciennes sensations de l'enfance, celles qu'on éprouve sans pensée, animalement.
Des émotions poétiques, plus que romanesques. On n'attendra pas du "Vent" ce qu'un roman doit faire : une critique de ce qui est. C'est de la poésie. Ce livre de Claude Simon date d'une époque où la critique de la bourgeoisie de province avait peut-être encore une saveur un peu transgressive, où l'on faisait preuve d'audace quand on était de gauche. D'où le Prix Nobel sans doute, et la canonisation de ce grand écrivain, statufié parmi ceux qu'on ne lit pas.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Prix Nobel de Littérature
NiGrivo
120 livres

Les 100 romans du Monde
Cronos
100 livres
Auteurs proches de Claude Simon
Quiz
Voir plus
Claude Simon
Quel prix littéraire Claude Simon a-t-il reçu en 1985 ?
Prix Nobel de littérature
Prix Goncourt
Prix Femina
Prix Victor-Rossel
10 questions
18 lecteurs ont répondu
Thème :
Claude SimonCréer un quiz sur cet auteur18 lecteurs ont répondu