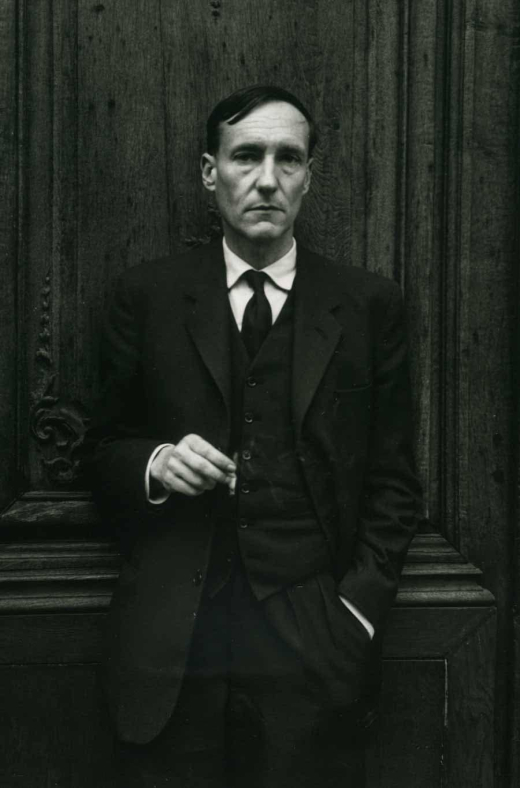Critiques de William S. Burroughs (155)
Il m’est tombé par hasard dans les mains c « livre-culte » et il a bien failli me tomber des mains au bout d’une centaine de pages ! C‘est un collage de visions sous drogues , et , si parfois , les images sont d’une réelle poésie trash leur accumulation exténue l’attention d’autant qu’elles sont amalgamées avec des pseudos théories délirantes et des fantasmes homosexuels répétitifs . A part l’aspect provocateur je ne vois pas ce qui justifie sa notoriété à part une forme courante de snobisme mondain . Sur « l’expérience » de la drogue je préfère et de loin « Substance Mort » de P.K.Dick.
"Junky" est le premier roman de William Burroughs, rédigé dans le contexte difficile de l'Amérique puritaine des années 50, surtout quand il s'agit de traiter du sujet de la drogue sous l'angle du consommateur. Dans la préface, Allen Ginsberg (agent littéraire improvisé de la Beat Generation) nous fait part d'ailleurs de la difficulté que fut de parvenir à publier ce texte controversé pour l'Amérique blanche bien-pensante.
Bill Lee, issu d'une famille aisé, décide un beau jour de s'essayer à la came pour une raison qui lui échappe totalement. Pour se faire, il essaie le vol de portefeuilles dans le métro mais abandonne très vite. Il tente alors de refourguer de la drogue, ce qui lui permet d'en garder pour sa propre consommation. On le suit dans cet enfer, où les junkies essaient d'obtenir de fausses ordonnances pour de la morphine auprès de médecins peu scrupuleux quant à l'éthique de leur profession et où la prison guette à chaque pas. L'aventure se poursuivant jusqu’à la Nouvelle Orléans puis au Mexique pour se terminer sur le projet de trouver du yage (l'ultime défonce selon lui), destination la Colombie, ce qu'il racontera dans d'autres livres.
Burroughs n'oublie pas aussi de digresser sur ce qu'il appelle un style de vie, sur cette fascination qu'il a pour l'univers de la came sans jamais se faire moralisateur, rédigeant finalement une chronique d'un accro à la drogue dans les Etats Unis des années 40 et 50.
Chose curieuse : sa femme est quasi inexistante, ses apparitions se faisant sporadiquement à quelques rares occasions, son nom n'étant jamais mentionné.
Dans un passage fameux où le "cold turkey" (manque) se fait sentir, Burroughs, sans le savoir, nous donne une des clés pour mieux comprendre ce qu'il fera ultérieurement (dans le "Festin nu" par exemple), décrivant un cauchemar ou une vision hallucinée proche du délirium tremens des alcooliques, des rues pleines de scolopendres géants et des scorpions énormes sortant des bars, des cafétérias et des drugstores de la 42e rue, dans un New-York apocalyptique. Il ne sait pas encore à ce moment à quoi cela aboutira par la suite.
La question qui nous vient aux lèvres, à la lecture de ce livre, est qu'est-ce qui pousse une personne venant de la bourgeoisie à se droguer ? La réponse est peu aisée d'autant plus que l'auteur ne le sait pas lui-même. Cette réponse est peut-être à chercher du côté du caractère névrosé du personnage que l'on sait peu doué pour les relations avec autrui, probablement la peur d’être aimé puis d’être abandonné ensuite ou une sorte de mal-être vécu depuis son adolescence, sans oublier son homosexualité inavouable dans un monde fortement homophobe. Ce sont toutes ces petites choses qui ont fait de William Burroughs, l'écrivain que l'on connait aujourd'hui.
C'est un roman, in fine, qui se fait clair, limpide, dans une écriture narrative agréable à lire; la première pierre déposée dans l'oeuvre de ce grand écrivain du XXe siècle.
Bill Lee, issu d'une famille aisé, décide un beau jour de s'essayer à la came pour une raison qui lui échappe totalement. Pour se faire, il essaie le vol de portefeuilles dans le métro mais abandonne très vite. Il tente alors de refourguer de la drogue, ce qui lui permet d'en garder pour sa propre consommation. On le suit dans cet enfer, où les junkies essaient d'obtenir de fausses ordonnances pour de la morphine auprès de médecins peu scrupuleux quant à l'éthique de leur profession et où la prison guette à chaque pas. L'aventure se poursuivant jusqu’à la Nouvelle Orléans puis au Mexique pour se terminer sur le projet de trouver du yage (l'ultime défonce selon lui), destination la Colombie, ce qu'il racontera dans d'autres livres.
Burroughs n'oublie pas aussi de digresser sur ce qu'il appelle un style de vie, sur cette fascination qu'il a pour l'univers de la came sans jamais se faire moralisateur, rédigeant finalement une chronique d'un accro à la drogue dans les Etats Unis des années 40 et 50.
Chose curieuse : sa femme est quasi inexistante, ses apparitions se faisant sporadiquement à quelques rares occasions, son nom n'étant jamais mentionné.
Dans un passage fameux où le "cold turkey" (manque) se fait sentir, Burroughs, sans le savoir, nous donne une des clés pour mieux comprendre ce qu'il fera ultérieurement (dans le "Festin nu" par exemple), décrivant un cauchemar ou une vision hallucinée proche du délirium tremens des alcooliques, des rues pleines de scolopendres géants et des scorpions énormes sortant des bars, des cafétérias et des drugstores de la 42e rue, dans un New-York apocalyptique. Il ne sait pas encore à ce moment à quoi cela aboutira par la suite.
La question qui nous vient aux lèvres, à la lecture de ce livre, est qu'est-ce qui pousse une personne venant de la bourgeoisie à se droguer ? La réponse est peu aisée d'autant plus que l'auteur ne le sait pas lui-même. Cette réponse est peut-être à chercher du côté du caractère névrosé du personnage que l'on sait peu doué pour les relations avec autrui, probablement la peur d’être aimé puis d’être abandonné ensuite ou une sorte de mal-être vécu depuis son adolescence, sans oublier son homosexualité inavouable dans un monde fortement homophobe. Ce sont toutes ces petites choses qui ont fait de William Burroughs, l'écrivain que l'on connait aujourd'hui.
C'est un roman, in fine, qui se fait clair, limpide, dans une écriture narrative agréable à lire; la première pierre déposée dans l'oeuvre de ce grand écrivain du XXe siècle.
Critique de Jean-Baptiste Harang pour le Magazine Littéraire
Et les hippopotames ont bouilli vifs dans leurs piscines a été écrit en 1945 par deux jeunes gens qui n’avaient encore rien publié et que personne hors de leur entourage ne connaissait : Jack Kerouac, 22 ans, William S. Burroughs, 30. Ils y racontent sous forme romanesque une histoire vraie, l’histoire d’un meurtre dont ils furent des protagonistes secondaires, ni victimes ni meurtriers, mais des témoins indirects placés un temps en arrestation. Pendant plus de soixante ans, le texte resta inédit, d’abord faute d’avoir trouvé un éditeur, puis « oublié sous les lames d’un parquet », comme le disait Kerouac. Il fut publié pour la première fois aux États-Unis en 2008 après un embargo que dans une postface passionnante James Grauerholz (qui accompagna Burroughs, de 1974 à sa mort en 1997) décrit avec minutie.
Puis Kerouac devint Kerouac, et Burroughs, Burroughs, et il faudrait que l’on soit capable de lire ces Hippopotames comme si on ne savait rien d’eux. Pas facile. À l’été 1944, Jack Kerouac a déjà pas mal roulé sa bosse, il a changé de langue à 6 ans, pratiqué divers sports de haut niveau, fréquenté l’université Columbia grâce au football, travaillé comme pigiste, bu, fumé, expérimenté diverses pratiques sexuelles, honoré deux engagements dans la marine marchande (l’un à destination de Mourmansk, l’autre de Liverpool), s’est fait révoquer de l’armée pour de feintes raisons psychiatriques et a écrit un roman, The Sea Is My Brother, qui n’a paru que l’an passé. Il vit à New York, en colocation avec William Burroughs et leurs futures épouses, Edie Parker et Joan Vollmer. Burroughs s’est lui aussi dégagé de ses obligations militaires au prix d’un séjour psy, il est juif, homosexuel, et commence à s’adonner à la morphine, il a étudié la médecine à Vienne, qu’il a quitté à l’orée du nazisme, et la littérature anglaise à Harvard. Son grand-père a inventé une machine à calculer et fondé la compagnie qui porte son nom et rapporte des sous.
À ce petit monde, un peu clochard, un poil céleste, il faut ajouter deux très proches pour compléter le casting d’ Et les hippopotames ont bouilli vifs dans leurs piscines : Lucien Carr et David Kammerer. Carr a 19 ans, il est beau comme un ange, et David Kammerer, 33 ans, est un grand amateur d’anges. Kammerer est un ami d’enfance de Burroughs, il est professeur de gymnastique et, depuis qu’il a eu Lucien Carr sous sa responsabilité lors d’un camp de jeunesse cinq ans plus tôt, il ne le perd ni de vue ni de désir, il le suit de ville en ville, d’école en lycée, de quartier en quartier, lui porte une affection assidue à la limite du harcèlement, sans qu’on sache si une relation sexuelle a été consommée. Tous sont un peu poètes, alcooliques, coureurs de bars et de champs de courses, la plupart à la recherche constante du dernier cent pour faire un dollar. Carr est le plus jeune, le plus provocant et peut-être le plus brillant.
À la veille de ce dimanche 13 août 1944 Kerouac et Carr courent depuis plusieurs semaines après un engagement sur un cargo pour gagner la France. Ont-ils dans l’idée d’y arriver pour la libération de Paris qui aura lieu dans deux semaines et dont ils ne savent rien ? En tous cas, de rester en France pour connaître le Quartier latin et pourquoi pas quelques ancêtres bretons. Kerouac - dont le français est la langue maternelle (avec un fort accent québécois) - se serait fait passer pour français et Carr pour sourd-muet. Ils s’engagent enfin pour Le Havre et, à peine montés à bord, se font débarquer par le second pour incompatibilité d’humeur. Carr et Kerouac trouvent dans le dépit une bonne raison de boire et se séparent au milieu de la nuit. Vers 3 heures du matin, Kerouac croise Kammerer qui cherche à rejoindre Carr. Ce projet de voyage le désespère puisqu’il n’en est pas. C’est la dernière fois qu’on le verra vivant.
Le lendemain Lucien Carr se rend chez Burroughs pour lui raconter que, cette nuit, il a poignardé David Kammerer à deux reprises avec son couteau de scout. Le tenant pour mort, il lui aurait lié les mains, rempli les poches de cailloux et l’aurait poussé dans l’Hudson. Pour preuve, il lui montre un paquet de cigarettes et les lunettes ensanglantées de Kammerer. Burroughs lui conseille de contacter un avocat et de se rendre, qu’il ne craint pas la chaise électrique s’il plaide la légitime défense contre une tentative de viol. Au lieu de quoi Carr rejoint Kerouac et ils vont ensemble passer la journée à boire, visiter des musées et peut-être même enterrer les lunettes de Kammerer dans un parc. Le jour suivant Carr raconte l’affaire à sa mère, qui lui trouve un avocat. Il se rend à la police le mardi 15 août. Le jeudi Jack Kerouac est arrêté et incarcéré comme témoin, faute de pouvoir payer la caution.
Burroughs, qui travaille alors pour une société de détectives privés, est en planque pour constater un supposé adultère. Également arrêté, il a le temps de contacter ses parents, qui lui trouvent l’avocat compétent et les dollars de la caution : il est libéré sur parole. Les parents d’Edie Parker acceptent de payer la caution de Kerouac à condition que celui-ci épouse leur fille. Ils se marient en prison. Il est libre. Le 15 septembre 1944 Lucien Carr est condamné à dix ans de prison. Il en fera deux. Voilà l’histoire.
Et voici le roman. Ginsberg n’y paraît pas, c’est pourtant lui, le plus jeune de la bande, 18 ans au moment des faits, qui s’y colle le premier. Il prend des notes en vue d’un livre qu’il appellerait « The Bloodsong », mais le doyen de l’université Columbia le dissuade de continuer. Dans sa postface James Grauerholz recense une bonne douzaine de fictions, sans compter les biographies des protagonistes, qui racontent ou s’inspirent du drame : James Baldwin, Truman Capote et Edie Parker elle-même en sont les auteurs. Et Kerouac, dans une version plus éloignée des faits en 1967 dans Vanity of Duluoz.
Mais revenons à nos duettistes de 1945. Grauerholz cite le témoignage de Burroughs à son premier biographe quarante ans après les faits, quinze ans après la mort de Kerouac : «Kerouac et moi, on avait évoqué la possibilité d’écrire un roman à quatre mains, et on a décidé de s’attaquer à la mort de Dave. On écrivait nos chapitres chacun à tour de rôle, et on se les lisait. On savait parfaitement qui écrirait quoi. On ne visait pas l’exactitude, mais seulement l’approximation. On a eu grand plaisir à le faire. Il va de soi que chacun écrivait ce à quoi il avait assisté : Jack savait ceci et moi cela. On a romancé. Dans la réalité, le meurtre a été commis avec un couteau, pas avec une hachette. Comme il ne fallait pas qu’on puisse reconnaître les personnages, j’ai fait de Lucien un Turc. Kerouac n’avait encore rien publié, on était de parfaits inconnus. Toujours est-il que personne n’a voulu de notre histoire. On est allés trouver une vague agente qui nous a dit : "Mais quel talent, vous êtes de vrais écrivains!"»
Certes, les circonstances de la mort de Kammerer ont été modifiées, les noms des protagonistes ont été changés, mais les principaux sont parfaitement reconnaissables et les spécialistes en identifient une bonne vingtaine. Jack Kerouac est Mike Ryko, et William Burroughs Will Dennison, sous ces deux noms ils se présentent comme les narrateurs du roman, dans une alternance presque parfaite des chapitres qui portent en titre le pseudonyme de leur auteur. Les deux écritures coulent en harmonie sans renier chaque personnalité. Le jugement de cette « vague agente » (Madeline Brennan) ne manquait pas de perspicacité : la vie de bohème à Greenwich Village au milieu des années 1940 y est décrite sans l’altération du recul et de la gloire promise aux auteurs. L’alcool, la poésie, la liberté et l’ambivalence sexuelle, l’absence inouïe de toute considération pour les femmes, la fantaisie, les provocations, le jazz, le partage, la lecture, l’invitation au voyage, composent la chair du roman et tendent vers son accomplissement dramatique, point d’orgue des toutes dernières pages.
On ne parlait pas encore de « Beat Generation », titre que Kerouac donne à cette pièce inédite qu’il écrivit en 1957 et qui paraît conjointement aux Hippopotames . On sait que Kerouac entendait le mot « beat » de son oreille francophone et l’associait à « béats », aux Béatitudes. La pièce met en scène une autre brigade de clochards célestes et ravis qui jouent aux courses et se piquent de conversation philosophique. Les amateurs inconditionnels de Kerouac y trouveront pain bénit.
À l’époque des Hippopotames, nos illustres inconnus ont encore une bonne douzaine d’années devant eux pour livrer leur meilleur : Howl de Ginsberg en 1956, Sur la route de Kerouac en 1957 et Le Festin nu de Burroughs en 1959. À sa sortie de prison, Lucien Carr entra comme pigiste à l’agence UPI, où il fit une brillante carrière pendant cinquante-sept ans. À l’opposé de son caractère fantasque, il se fit le chantre de la sobriété journalistique dont l’adage était : « Commencez plutôt directement par le deuxième paragraphe. » Il ne voulut plus entendre parler de la mort de Kammerer et fit beaucoup pour la notoriété de ses amis écrivains, qui tinrent leur promesse de ne pas laisser publier Et les hippopotames ont bouilli vifs dans leurs piscines de son vivant. Lucien Carr est mort le 28 janvier 2005.
Et les hippopotames ont bouilli vifs dans leurs piscines a été écrit en 1945 par deux jeunes gens qui n’avaient encore rien publié et que personne hors de leur entourage ne connaissait : Jack Kerouac, 22 ans, William S. Burroughs, 30. Ils y racontent sous forme romanesque une histoire vraie, l’histoire d’un meurtre dont ils furent des protagonistes secondaires, ni victimes ni meurtriers, mais des témoins indirects placés un temps en arrestation. Pendant plus de soixante ans, le texte resta inédit, d’abord faute d’avoir trouvé un éditeur, puis « oublié sous les lames d’un parquet », comme le disait Kerouac. Il fut publié pour la première fois aux États-Unis en 2008 après un embargo que dans une postface passionnante James Grauerholz (qui accompagna Burroughs, de 1974 à sa mort en 1997) décrit avec minutie.
Puis Kerouac devint Kerouac, et Burroughs, Burroughs, et il faudrait que l’on soit capable de lire ces Hippopotames comme si on ne savait rien d’eux. Pas facile. À l’été 1944, Jack Kerouac a déjà pas mal roulé sa bosse, il a changé de langue à 6 ans, pratiqué divers sports de haut niveau, fréquenté l’université Columbia grâce au football, travaillé comme pigiste, bu, fumé, expérimenté diverses pratiques sexuelles, honoré deux engagements dans la marine marchande (l’un à destination de Mourmansk, l’autre de Liverpool), s’est fait révoquer de l’armée pour de feintes raisons psychiatriques et a écrit un roman, The Sea Is My Brother, qui n’a paru que l’an passé. Il vit à New York, en colocation avec William Burroughs et leurs futures épouses, Edie Parker et Joan Vollmer. Burroughs s’est lui aussi dégagé de ses obligations militaires au prix d’un séjour psy, il est juif, homosexuel, et commence à s’adonner à la morphine, il a étudié la médecine à Vienne, qu’il a quitté à l’orée du nazisme, et la littérature anglaise à Harvard. Son grand-père a inventé une machine à calculer et fondé la compagnie qui porte son nom et rapporte des sous.
À ce petit monde, un peu clochard, un poil céleste, il faut ajouter deux très proches pour compléter le casting d’ Et les hippopotames ont bouilli vifs dans leurs piscines : Lucien Carr et David Kammerer. Carr a 19 ans, il est beau comme un ange, et David Kammerer, 33 ans, est un grand amateur d’anges. Kammerer est un ami d’enfance de Burroughs, il est professeur de gymnastique et, depuis qu’il a eu Lucien Carr sous sa responsabilité lors d’un camp de jeunesse cinq ans plus tôt, il ne le perd ni de vue ni de désir, il le suit de ville en ville, d’école en lycée, de quartier en quartier, lui porte une affection assidue à la limite du harcèlement, sans qu’on sache si une relation sexuelle a été consommée. Tous sont un peu poètes, alcooliques, coureurs de bars et de champs de courses, la plupart à la recherche constante du dernier cent pour faire un dollar. Carr est le plus jeune, le plus provocant et peut-être le plus brillant.
À la veille de ce dimanche 13 août 1944 Kerouac et Carr courent depuis plusieurs semaines après un engagement sur un cargo pour gagner la France. Ont-ils dans l’idée d’y arriver pour la libération de Paris qui aura lieu dans deux semaines et dont ils ne savent rien ? En tous cas, de rester en France pour connaître le Quartier latin et pourquoi pas quelques ancêtres bretons. Kerouac - dont le français est la langue maternelle (avec un fort accent québécois) - se serait fait passer pour français et Carr pour sourd-muet. Ils s’engagent enfin pour Le Havre et, à peine montés à bord, se font débarquer par le second pour incompatibilité d’humeur. Carr et Kerouac trouvent dans le dépit une bonne raison de boire et se séparent au milieu de la nuit. Vers 3 heures du matin, Kerouac croise Kammerer qui cherche à rejoindre Carr. Ce projet de voyage le désespère puisqu’il n’en est pas. C’est la dernière fois qu’on le verra vivant.
Le lendemain Lucien Carr se rend chez Burroughs pour lui raconter que, cette nuit, il a poignardé David Kammerer à deux reprises avec son couteau de scout. Le tenant pour mort, il lui aurait lié les mains, rempli les poches de cailloux et l’aurait poussé dans l’Hudson. Pour preuve, il lui montre un paquet de cigarettes et les lunettes ensanglantées de Kammerer. Burroughs lui conseille de contacter un avocat et de se rendre, qu’il ne craint pas la chaise électrique s’il plaide la légitime défense contre une tentative de viol. Au lieu de quoi Carr rejoint Kerouac et ils vont ensemble passer la journée à boire, visiter des musées et peut-être même enterrer les lunettes de Kammerer dans un parc. Le jour suivant Carr raconte l’affaire à sa mère, qui lui trouve un avocat. Il se rend à la police le mardi 15 août. Le jeudi Jack Kerouac est arrêté et incarcéré comme témoin, faute de pouvoir payer la caution.
Burroughs, qui travaille alors pour une société de détectives privés, est en planque pour constater un supposé adultère. Également arrêté, il a le temps de contacter ses parents, qui lui trouvent l’avocat compétent et les dollars de la caution : il est libéré sur parole. Les parents d’Edie Parker acceptent de payer la caution de Kerouac à condition que celui-ci épouse leur fille. Ils se marient en prison. Il est libre. Le 15 septembre 1944 Lucien Carr est condamné à dix ans de prison. Il en fera deux. Voilà l’histoire.
Et voici le roman. Ginsberg n’y paraît pas, c’est pourtant lui, le plus jeune de la bande, 18 ans au moment des faits, qui s’y colle le premier. Il prend des notes en vue d’un livre qu’il appellerait « The Bloodsong », mais le doyen de l’université Columbia le dissuade de continuer. Dans sa postface James Grauerholz recense une bonne douzaine de fictions, sans compter les biographies des protagonistes, qui racontent ou s’inspirent du drame : James Baldwin, Truman Capote et Edie Parker elle-même en sont les auteurs. Et Kerouac, dans une version plus éloignée des faits en 1967 dans Vanity of Duluoz.
Mais revenons à nos duettistes de 1945. Grauerholz cite le témoignage de Burroughs à son premier biographe quarante ans après les faits, quinze ans après la mort de Kerouac : «Kerouac et moi, on avait évoqué la possibilité d’écrire un roman à quatre mains, et on a décidé de s’attaquer à la mort de Dave. On écrivait nos chapitres chacun à tour de rôle, et on se les lisait. On savait parfaitement qui écrirait quoi. On ne visait pas l’exactitude, mais seulement l’approximation. On a eu grand plaisir à le faire. Il va de soi que chacun écrivait ce à quoi il avait assisté : Jack savait ceci et moi cela. On a romancé. Dans la réalité, le meurtre a été commis avec un couteau, pas avec une hachette. Comme il ne fallait pas qu’on puisse reconnaître les personnages, j’ai fait de Lucien un Turc. Kerouac n’avait encore rien publié, on était de parfaits inconnus. Toujours est-il que personne n’a voulu de notre histoire. On est allés trouver une vague agente qui nous a dit : "Mais quel talent, vous êtes de vrais écrivains!"»
Certes, les circonstances de la mort de Kammerer ont été modifiées, les noms des protagonistes ont été changés, mais les principaux sont parfaitement reconnaissables et les spécialistes en identifient une bonne vingtaine. Jack Kerouac est Mike Ryko, et William Burroughs Will Dennison, sous ces deux noms ils se présentent comme les narrateurs du roman, dans une alternance presque parfaite des chapitres qui portent en titre le pseudonyme de leur auteur. Les deux écritures coulent en harmonie sans renier chaque personnalité. Le jugement de cette « vague agente » (Madeline Brennan) ne manquait pas de perspicacité : la vie de bohème à Greenwich Village au milieu des années 1940 y est décrite sans l’altération du recul et de la gloire promise aux auteurs. L’alcool, la poésie, la liberté et l’ambivalence sexuelle, l’absence inouïe de toute considération pour les femmes, la fantaisie, les provocations, le jazz, le partage, la lecture, l’invitation au voyage, composent la chair du roman et tendent vers son accomplissement dramatique, point d’orgue des toutes dernières pages.
On ne parlait pas encore de « Beat Generation », titre que Kerouac donne à cette pièce inédite qu’il écrivit en 1957 et qui paraît conjointement aux Hippopotames . On sait que Kerouac entendait le mot « beat » de son oreille francophone et l’associait à « béats », aux Béatitudes. La pièce met en scène une autre brigade de clochards célestes et ravis qui jouent aux courses et se piquent de conversation philosophique. Les amateurs inconditionnels de Kerouac y trouveront pain bénit.
À l’époque des Hippopotames, nos illustres inconnus ont encore une bonne douzaine d’années devant eux pour livrer leur meilleur : Howl de Ginsberg en 1956, Sur la route de Kerouac en 1957 et Le Festin nu de Burroughs en 1959. À sa sortie de prison, Lucien Carr entra comme pigiste à l’agence UPI, où il fit une brillante carrière pendant cinquante-sept ans. À l’opposé de son caractère fantasque, il se fit le chantre de la sobriété journalistique dont l’adage était : « Commencez plutôt directement par le deuxième paragraphe. » Il ne voulut plus entendre parler de la mort de Kammerer et fit beaucoup pour la notoriété de ses amis écrivains, qui tinrent leur promesse de ne pas laisser publier Et les hippopotames ont bouilli vifs dans leurs piscines de son vivant. Lucien Carr est mort le 28 janvier 2005.
Difficile de suivre ce roman à la narration éclatée, aux scènes qui viennent se téléscoper entre elles sans que l'on puisse parfois deviner quel(s) lien(s) les rapproche(nt). Le lecteur dispose parfois de bribes d'histoire qui se mettent à fonctionner "normalement" mais pour retomber rapidement dans une succession de faits embrouillés.
Burroughs nous entraîne dans un futur proche alternatif, où les "troupes" des garçons sauvages ont décidé de s'insurger contre l'ordre et les réactionnaires de tous bords.
Un récit halluciné et hallucinant, dans lequel drogue, sexe et violence tiennent une place prépondérante.
Les scènes homosexuelles sont nombreuses et semblent nécessaires à tous ces garçons pour pouvoir aller de l'avant, se resourcer.
Burroughs nous entraîne dans un futur proche alternatif, où les "troupes" des garçons sauvages ont décidé de s'insurger contre l'ordre et les réactionnaires de tous bords.
Un récit halluciné et hallucinant, dans lequel drogue, sexe et violence tiennent une place prépondérante.
Les scènes homosexuelles sont nombreuses et semblent nécessaires à tous ces garçons pour pouvoir aller de l'avant, se resourcer.
Du pur délire d’opiomane défoncé. Féroce et dérangeant, le Festin nu n’épargne personne : drogués, médecins, policiers… Même Jésus, Bouddha et Mahomet en prennent pour leur grade, comme ça pas de jaloux ! Ouvrez le livre, inspirez un grand coup, et plongez-vous dans cette lecture unique en son genre.
Burroughs, cet illustre architecte du chaos littéraire, qui tisse l'absurde et le sublime avec la grâce d'un trapéziste sous acide. Son oeuvre est un terrain de jeu pour l'esprit, un dédale où la logique a été bâillonnée et enfermée dans le placard du sous-sol. C'est un peu comme si Salvador Dali et Monty Python avaient décidé de co-écrire un livre. Vous êtes perdus ? Génial, c'est exactement là où il veut que vous soyez.
Chaque page est une descente vertigineuse dans les abysses d'une âme tourmentée, illuminée par les feux de la démence et de la dépendance. C'est moins un roman qu'un carnet de voyage dans les contrées inexplorées de l'esprit humain, un témoignage brut et non filtré d'une exploration intrépide dans les sombres recoins de la psyché.
Alors, amis lecteurs, si vous êtes prêts à délaisser le confort de la réalité pour plonger dans les eaux tumultueuses de l'absurde, "Le Festin Nu" vous attend. Ce n'est pas une lecture; c'est une expérience - chaotique, belle et déroutante.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Chaque page est une descente vertigineuse dans les abysses d'une âme tourmentée, illuminée par les feux de la démence et de la dépendance. C'est moins un roman qu'un carnet de voyage dans les contrées inexplorées de l'esprit humain, un témoignage brut et non filtré d'une exploration intrépide dans les sombres recoins de la psyché.
Alors, amis lecteurs, si vous êtes prêts à délaisser le confort de la réalité pour plonger dans les eaux tumultueuses de l'absurde, "Le Festin Nu" vous attend. Ce n'est pas une lecture; c'est une expérience - chaotique, belle et déroutante.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Je viens de finir < Les cités de la nuit écarlate > de W.Burroughs. Lecture sans fin, sans début, sans ordre, tout en vibrations spontanées et en situations aussi autonomes que sensiblement liées les unes aux autres.
Si la trame narrative est bien présente, se fondant sur l'Idée d'un cosmos bien particulier où pirates, pirates travestis notamment, insurgés,homosexuels, personnages atypiques, camés, tous brillants pour leur vivacité d'esprit, renverseraient non pas le monde mais l'ordre spatial, Burroughs régale ici pour son amour de l'imagerie et sa conquête des ressources pures du langage, déconnectées de toute intrigue.
Ce livre ne se résume pas. Il ne se lit pas non plus mais s'absorbe. C'est un voyage passionné et passionnant au coeur d'un imaginaire si cher à cet auteur que j'admire profondément, notamment pour ses audaces poétiques ( < Ces petits jeunes, ils veulent tous aller à Waghdas, à cette heure, pour trouver les réponses ! Je leur dis en vain que chaque fois qu'on trouve une réponse, on trouve six nouvelles questions en dessous, comme les lutins qu'on trouve sous les champignons > )
Je n'en dirai pas plus si ce n'est que j'ai osé imaginer Burroughs sous le coup d'une forte émotion au mot de la fin. Comme je l'ai été.
Ps : Heroin des Velvet est idéal pour s'imprégner de la substance quasi organique du livre dans son ensemble, en fin de lecture. ( < I dont know just where i'm going> : voyage spatio temporel non défini sur fond de sublimes dispersions )
A bon entendeur...
Si la trame narrative est bien présente, se fondant sur l'Idée d'un cosmos bien particulier où pirates, pirates travestis notamment, insurgés,homosexuels, personnages atypiques, camés, tous brillants pour leur vivacité d'esprit, renverseraient non pas le monde mais l'ordre spatial, Burroughs régale ici pour son amour de l'imagerie et sa conquête des ressources pures du langage, déconnectées de toute intrigue.
Ce livre ne se résume pas. Il ne se lit pas non plus mais s'absorbe. C'est un voyage passionné et passionnant au coeur d'un imaginaire si cher à cet auteur que j'admire profondément, notamment pour ses audaces poétiques ( < Ces petits jeunes, ils veulent tous aller à Waghdas, à cette heure, pour trouver les réponses ! Je leur dis en vain que chaque fois qu'on trouve une réponse, on trouve six nouvelles questions en dessous, comme les lutins qu'on trouve sous les champignons > )
Je n'en dirai pas plus si ce n'est que j'ai osé imaginer Burroughs sous le coup d'une forte émotion au mot de la fin. Comme je l'ai été.
Ps : Heroin des Velvet est idéal pour s'imprégner de la substance quasi organique du livre dans son ensemble, en fin de lecture. ( < I dont know just where i'm going> : voyage spatio temporel non défini sur fond de sublimes dispersions )
A bon entendeur...
Alors voila un roman (peut-être devrais-je dire récit?) surprenant. William Burroughs est allé au fond de lui, au fond de ses sensations hallucinées pour écrire Le festin nu.
Et quelle claque stylistique. Affranchi de toute logique narrative, ce qui est exposé dans ce roman, c’est un univers sensoriel extrême. Écrit sous l’effet de multiples drogues, William Burroughs nous donne un récit comme une expérience. Violent, drôle, choquant, il y a un peu de tout dans Le festin nu. De tout mais pas de logique. Vous pouvez lire le résumé, je vous mets au défi de trouver ce dont il est question dans le texte. Perso, j’ai rien vu.
À la limite, les parties les plus claires et les plus sérieuses sont le bréviaire des drogues et leur effets, un dico à l’usage des chimistes. On sent l’expert. Bizarrement, ce sont des explications très lucides. Doit-on cette forme de cohérence au relecture de ses illustres amitiés que sont Jack Kerouac et Allen Ginsberg.
La suite sur le blog…
Lien : http://livrepoche.fr/le-fest..
Et quelle claque stylistique. Affranchi de toute logique narrative, ce qui est exposé dans ce roman, c’est un univers sensoriel extrême. Écrit sous l’effet de multiples drogues, William Burroughs nous donne un récit comme une expérience. Violent, drôle, choquant, il y a un peu de tout dans Le festin nu. De tout mais pas de logique. Vous pouvez lire le résumé, je vous mets au défi de trouver ce dont il est question dans le texte. Perso, j’ai rien vu.
À la limite, les parties les plus claires et les plus sérieuses sont le bréviaire des drogues et leur effets, un dico à l’usage des chimistes. On sent l’expert. Bizarrement, ce sont des explications très lucides. Doit-on cette forme de cohérence au relecture de ses illustres amitiés que sont Jack Kerouac et Allen Ginsberg.
La suite sur le blog…
Lien : http://livrepoche.fr/le-fest..
On frise souvent le délire mais la lecture de cette "folie" à la Burroughs est plaisante et drôle.
William Lee tient le journal méthodique de ses années junky, dans les États-Unis de l'après guerre. À rebrousse poil des clichés misérabilistes, on y apprend que la drogue est un mode de vie. Qu'on n'accroche pas aussi facilement qu'on peut le croire mais qu'ensuite on reste camé toute sa vie, comme si les substances marquaient vos cellules d'un sceau indélébile. 200 pages de virée dans les bas-fonds de l'Amérique des marginaux et vagabonds, au tout début des années 50. C'est peu dire que nos grands-parents ont aussi bien déconné. Fascinant, mais le récit, laconique et factuel, manque d'âme... d'autant plus étonnant qu'il est largement autobiographique.
J'avoue à ma confusion que je n'ai pas tout suivi dans ce roman touffu, drôle, divers, même en m'accrochant désespérément au fil conducteur, qui est la migration vers "les Terres Occidentales", terme emprunté à la mythologie égyptienne pour désigner l'Au-Delà. L'auteur semble imaginer le passage sur le mode d'une frontière comparable à celle du Mexique et des USA, avec ses villes-frontière, ses passeurs, ses trafiquants de toute sorte, sa violence et ses trafics, dans une espèce de western délirant. Curieusement, en acceptant de laisser en veilleuse la compréhension globale de l'histoire et le suivi des personnages, j'ai éprouvé un vrai plaisir de lecture, un peu comme avec un grand poème d'Ezra Pound. Je n'en veux pas à l'auteur de m'avoir fait rencontrer ma limite de lecteur, car c'est toujours stimulant et cela donne l'envie de le relire et d'essayer de la dépasser.
Et les hippopotames ont bouilli vifs dans leur piscine est le premier roman de Kerouac, bien avant La Route, et de Burroughs, à qui l’on doit notamment Le Festin nu. Écrit à quatre mains, le livre alterne les chapitres racontés par Will Dennison (et écrits par William S. Burroughs) et ceux racontés par Mike Ryko (Jack Kerouac).
Nous sommes à Manhattan dans les années 1940. Will est serveur dans un bar, mais aussi employé dans une agence de détective. Mike est marin dans la Marchande. Ils sont entourés d’amis qui, comme eux, mènent une vie de bohème, successions de soirées, de petits boulots suffisants pour leur permettre de vivre au jour le jour. Philip et Al font partie de la bande : Phil a dix-sept ans et une beauté insolente ; Ramsay Allen, dit Al, est éperdument amoureux de lui et ne se décourage jamais de ses refus. Lassé de ses tentatives et souhaitant partir à l’aventure, Phil accepte la proposition de Mike d’embarquer le plus vite possible vers la France. Mais leur désinvolture ne cesse de retarder le voyage.
En réalité, l’essentiel de l’intrigue ne repose pas sur ce bref résumé, mais la suite sera à découvrir… C’est en tout cas dans ces conditions, avec la seule lecture de la quatrième de couverture, que j’ai abordé le roman. Les thèmes chers à ce qui deviendra par la suite la Beat Generation sont déjà présents : errance, rêve d’aventure, alcool, et surtout liberté. Mais l’écriture est jeune, moins travaillée qu’elle ne le sera par la suite, il ne se passe finalement pas grand-chose avant les toutes dernières pages. Les allers-retours incessants au port et les échecs dus à la légéreté des personnages finissent par être lassants.
La postface de James W. Grauerholz est tout à fait intéressante, voire indispensable à la compréhension de la genèse de ce roman et de sa réception. On en regretterait presque qu’il ne s’agisse pas d’une préface, car les éléments révélés placent l’intrigue dans un contexte, un lieu, une époque. On y apprend surtout que les faits sont issus d’une histoire vraie, vécue par les deux auteurs. L’amour que porte l’auteur de ce texte aux protagonistes de l’histoire et notamment à Burroughs se ressent fortement dans la postface. Une fois révélée l’histoire vraie dont est issu l’intrigue, le roman prend une toute nouvelle épaisseur.
Ce roman est un témoignage intéressant d’une époque et d’un courant dont les chefs de file seront Ginsberg, Kerouac et Burroughs, que l’on retrouve derrière des pseudonymes dans ce livre. À lire donc pour son aspect documentaire et sa postface riche en informations, plus que pour son intrigue ou sa qualité littéraire.
Nous sommes à Manhattan dans les années 1940. Will est serveur dans un bar, mais aussi employé dans une agence de détective. Mike est marin dans la Marchande. Ils sont entourés d’amis qui, comme eux, mènent une vie de bohème, successions de soirées, de petits boulots suffisants pour leur permettre de vivre au jour le jour. Philip et Al font partie de la bande : Phil a dix-sept ans et une beauté insolente ; Ramsay Allen, dit Al, est éperdument amoureux de lui et ne se décourage jamais de ses refus. Lassé de ses tentatives et souhaitant partir à l’aventure, Phil accepte la proposition de Mike d’embarquer le plus vite possible vers la France. Mais leur désinvolture ne cesse de retarder le voyage.
En réalité, l’essentiel de l’intrigue ne repose pas sur ce bref résumé, mais la suite sera à découvrir… C’est en tout cas dans ces conditions, avec la seule lecture de la quatrième de couverture, que j’ai abordé le roman. Les thèmes chers à ce qui deviendra par la suite la Beat Generation sont déjà présents : errance, rêve d’aventure, alcool, et surtout liberté. Mais l’écriture est jeune, moins travaillée qu’elle ne le sera par la suite, il ne se passe finalement pas grand-chose avant les toutes dernières pages. Les allers-retours incessants au port et les échecs dus à la légéreté des personnages finissent par être lassants.
La postface de James W. Grauerholz est tout à fait intéressante, voire indispensable à la compréhension de la genèse de ce roman et de sa réception. On en regretterait presque qu’il ne s’agisse pas d’une préface, car les éléments révélés placent l’intrigue dans un contexte, un lieu, une époque. On y apprend surtout que les faits sont issus d’une histoire vraie, vécue par les deux auteurs. L’amour que porte l’auteur de ce texte aux protagonistes de l’histoire et notamment à Burroughs se ressent fortement dans la postface. Une fois révélée l’histoire vraie dont est issu l’intrigue, le roman prend une toute nouvelle épaisseur.
Ce roman est un témoignage intéressant d’une époque et d’un courant dont les chefs de file seront Ginsberg, Kerouac et Burroughs, que l’on retrouve derrière des pseudonymes dans ce livre. À lire donc pour son aspect documentaire et sa postface riche en informations, plus que pour son intrigue ou sa qualité littéraire.
L’auteur du Festin nu, si magistralement adapté à l’écran par David Cronenberg, nous livre là un curieux texte dont il a le secret.
Ce porte-lame, ce Blade runner pour ne pas le nommer, est une référence directe à un autre auteur, Alan E. Nourse, très peu voir pas traduit en France, c’est à vérifier, qui a écrit avant lui The Bladerunner.
Le livre de Burroughs s’appelle en anglais Blade Runner (A Movie). D’ailleurs, son texte ce vœu un protodécoupage, comme s’il élaborait un scénario. Vous ne le lirez pas exactement comme un roman et il faudrait lire le livre de Nourse pour apprécier toutes les références. Références à quoi ? Sans doute à cette incroyable histoire de New-York dystopique où dans un Manhattan isolé par un mur le trafic de médicaments règne en maître.
Dans cette nouvelle jungle urbaine new-yorkaise, de jeunes hommes, les porte-lames, sont chargés du trafic. Alors, j’ignore si c’est le cas dans le livre de Nourse, mais dans l’univers de Burroughs, homosexualité, maladies, religion, drogues se mêlent allègrement. Et, sans surprise si j’ose dire, le court roman de Burroughs reste une expérience littéraire.
Rappelons juste que pour le film Bladerunner, hommage est rendu à Nourse et Burroughs pour avoir permis l’emprunt de leurs titres. Mais on ne saurait résumer l’histoire de ce livre qu’à cette référence a posteriori.
L’ouvrage de Burroughs pose de réelles questions sur la santé publique, la sécurité sociale et la puissance des lobbies de la santé ainsi que le choix de discriminer ou non tel ou tel patient. Qui détermine en définitive quelle maladie doit être soignée, et qui peut l’être ? Quand être un « métèque » est jugé incurable, pourquoi vous aider ?
Ne vous trompez pas, ce « Movie », est un film épique, avec des scènes à couper le souffle. Alors, prêt à explorer Lower Manhattan ?
Ce porte-lame, ce Blade runner pour ne pas le nommer, est une référence directe à un autre auteur, Alan E. Nourse, très peu voir pas traduit en France, c’est à vérifier, qui a écrit avant lui The Bladerunner.
Le livre de Burroughs s’appelle en anglais Blade Runner (A Movie). D’ailleurs, son texte ce vœu un protodécoupage, comme s’il élaborait un scénario. Vous ne le lirez pas exactement comme un roman et il faudrait lire le livre de Nourse pour apprécier toutes les références. Références à quoi ? Sans doute à cette incroyable histoire de New-York dystopique où dans un Manhattan isolé par un mur le trafic de médicaments règne en maître.
Dans cette nouvelle jungle urbaine new-yorkaise, de jeunes hommes, les porte-lames, sont chargés du trafic. Alors, j’ignore si c’est le cas dans le livre de Nourse, mais dans l’univers de Burroughs, homosexualité, maladies, religion, drogues se mêlent allègrement. Et, sans surprise si j’ose dire, le court roman de Burroughs reste une expérience littéraire.
Rappelons juste que pour le film Bladerunner, hommage est rendu à Nourse et Burroughs pour avoir permis l’emprunt de leurs titres. Mais on ne saurait résumer l’histoire de ce livre qu’à cette référence a posteriori.
L’ouvrage de Burroughs pose de réelles questions sur la santé publique, la sécurité sociale et la puissance des lobbies de la santé ainsi que le choix de discriminer ou non tel ou tel patient. Qui détermine en définitive quelle maladie doit être soignée, et qui peut l’être ? Quand être un « métèque » est jugé incurable, pourquoi vous aider ?
Ne vous trompez pas, ce « Movie », est un film épique, avec des scènes à couper le souffle. Alors, prêt à explorer Lower Manhattan ?
Ceci est l'un des très rares livres que je n'aurai pas terminé. Je l'ai trouvé intriguant les premières pages, avant de le trouver très chiant jusqu'à environ la moitié. C'est là que j'ai décidé de le refermer et de ne pas le terminer : chose très rare pour moi.
Il s'agit vraiment d'une déconvenue littéraire. Le format particulier du livre n'excuse rien : il existe une quantité d'auteur-es qui construisent leur roman de façon très particulière (je pense notamment à Sophie Podolski), quitte à détruire toutes règles académiques. Cela ne me gêne pas et la plupart du temps on se retrouve avec des oeuvres fortes et originales. Ici, William S. Burroughs semble se concentrer sur le ressenti et les sentiments, voire la rêverie, plutôt que la narration ou la construction de l'histoire. Louable initiative, si je ne m'étais pas senti comme envahi par toute la platitude de ce livre.
Néanmoins, si vous adorez les phallus et les rectums, je ne peux que vous conseiller "Les garçons sauvages". Vous en aurez votre content. Si vous appréciez l'univers "beat" ou que vous êtes curieux, faites-vous plaisir. Moi j'ai essayé, mais j'ai détesté !
Il s'agit vraiment d'une déconvenue littéraire. Le format particulier du livre n'excuse rien : il existe une quantité d'auteur-es qui construisent leur roman de façon très particulière (je pense notamment à Sophie Podolski), quitte à détruire toutes règles académiques. Cela ne me gêne pas et la plupart du temps on se retrouve avec des oeuvres fortes et originales. Ici, William S. Burroughs semble se concentrer sur le ressenti et les sentiments, voire la rêverie, plutôt que la narration ou la construction de l'histoire. Louable initiative, si je ne m'étais pas senti comme envahi par toute la platitude de ce livre.
Néanmoins, si vous adorez les phallus et les rectums, je ne peux que vous conseiller "Les garçons sauvages". Vous en aurez votre content. Si vous appréciez l'univers "beat" ou que vous êtes curieux, faites-vous plaisir. Moi j'ai essayé, mais j'ai détesté !
Complètement dingue, c’est le summum de la beat generation même si Burroughs a toujours refusé que son texte soit intégré à ce mouvement.
Burroughs a écrit ce livre sous drogues et d’ailleurs, ne parlons pas de livre mais plutôt de notes mises bout à bout. Ce sont Ginsberg et Kerouac qui ont aidé Burroughs à rendre ce texte publiable et il représente simplement les délires d’un drogué emprisonné dans sa dépendance sans fin.
Je n’ai pas adoré car la lecture est beaucoup trop difficile, brouillonne, incohérente… Mais j’ai surtout beaucoup admiré la prestation (spontanée) qui représente parfaitement une époque complètement folle des années 50/60 où rien n’était important.
Burroughs a écrit ce livre sous drogues et d’ailleurs, ne parlons pas de livre mais plutôt de notes mises bout à bout. Ce sont Ginsberg et Kerouac qui ont aidé Burroughs à rendre ce texte publiable et il représente simplement les délires d’un drogué emprisonné dans sa dépendance sans fin.
Je n’ai pas adoré car la lecture est beaucoup trop difficile, brouillonne, incohérente… Mais j’ai surtout beaucoup admiré la prestation (spontanée) qui représente parfaitement une époque complètement folle des années 50/60 où rien n’était important.
Le festin nu – William Burroughs en mal d'aurore ?
Tout d’abord, on peut s’étonner que ce livre soit classé par les éditions folio dans la rubrique « SF ». On est à mon avis plus proche du roman poétique ou surréaliste, mais enfin cela reste au final des étiquettes…
Lien : https://www.le-fab-lab.com/l..
Tout d’abord, on peut s’étonner que ce livre soit classé par les éditions folio dans la rubrique « SF ». On est à mon avis plus proche du roman poétique ou surréaliste, mais enfin cela reste au final des étiquettes…
Lien : https://www.le-fab-lab.com/l..
Burroughs abolit les distances avec ces camarades de la Beat Génération et installe une correspondance intensive couvrant une période d’une quinzaine d’années mouvementées. Des lettres adressées principalement à son ami de toujours, Allen Ginsberg, récipiendaire le plus important de ce matériau épistolaire. C’est dans cet espace intime que l’explorateur psychique documente son développement personnel et artistique avec la prescience de savoir qu’un jour ses lettres constitueront le véritable roman.
On y retrouve sans surprise le sujet le plus proche de lui, la drogue. Sans oublier l’éternel refrain, celui d’un renoncement ponctué de rechutes. Dans cette correspondance, Burroughs s’exprime également sur l’isolement de l’exil. Des années 1945 à la fin 1959, il n’aura de cesse de se déplacer - au Texas, à Mexico, Rome ou encore Tanger - par crainte d’actions judiciaires et par quête de liberté légale et culturelle. Ces lettres sont l’envers du décor, là où l’auteur nous confronte à sa solitude et aux états de crise provoqués par l’absence de réponse ou encore la peur de perdre son seul auditeur. Les lettres s’enchaînent, dans une frénésie thérapeutique. La comédie de l’écriture comme nourriture de soi.
La carapace est rompue et ses fragilités livrées sans résistance. C’est une longue descente, une succession d’échecs et de découragements jusqu’à aboutir - enfin - à la manière adéquate d’écrire son roman : l’anti-narration. À côté de cet abandon, cette production curieuse renferme une critique sociale très personnelle. Burroughs exprime, avec perspicacité et hallucination en simultanée, son mécontentement à l’égard des États-Unis. Critique envers l’ingérence croissante dans les affaires de chaque citoyen, lassé du conformisme bourgeois et de la pression de la censure, l’écrivain n’épargnent pas ces « répressifs et craintifs de la vie ».
L’on sait Burroughs apprécié pour sa plume incandescente, cette marge de l’écriture qui lui est propre et son goût pour les sujets brûlants. Mais c’est aussi une personnalité hautement problématique qui, au sein de cette correspondance, révèle sans détour ses obsessions névrosées et criminelles. Certains passages bavards écornent gravement le mythe et pourtant, il n’en est aucunement fait mention dans la préface. Si l'on s’intéresse à certaines de ces lettres écrites notamment à la période durant laquelle Burroughs s’est installé à Tanger - séduit par ce “ce sanctuaire où chacun est à l’abri de toute interférence” - l’on constate aisément le caractère pédophile de certaines scènes de prédation décrites avec délectation. De son propre aveu : “en train de faire des avances à un garçon indien de 13 ans devant son père, ses frères et ses oncles, en train de ramener à la maison deux morveux déguenillés. Tout ce que je me rappelle est qu’ils étaient jeunes. Me suis réveillé avec l’odeur de la jeunesse sur les mains et le corps” ou encore “si j’étais sage et que j’écoutais un psychanalyste, j'arrêterais de courir après les jeunes garçons”. On ne peut pas dire que le discours, qui n’est pas dans la forme romanesque, puisse se dédouaner ...
On y retrouve sans surprise le sujet le plus proche de lui, la drogue. Sans oublier l’éternel refrain, celui d’un renoncement ponctué de rechutes. Dans cette correspondance, Burroughs s’exprime également sur l’isolement de l’exil. Des années 1945 à la fin 1959, il n’aura de cesse de se déplacer - au Texas, à Mexico, Rome ou encore Tanger - par crainte d’actions judiciaires et par quête de liberté légale et culturelle. Ces lettres sont l’envers du décor, là où l’auteur nous confronte à sa solitude et aux états de crise provoqués par l’absence de réponse ou encore la peur de perdre son seul auditeur. Les lettres s’enchaînent, dans une frénésie thérapeutique. La comédie de l’écriture comme nourriture de soi.
La carapace est rompue et ses fragilités livrées sans résistance. C’est une longue descente, une succession d’échecs et de découragements jusqu’à aboutir - enfin - à la manière adéquate d’écrire son roman : l’anti-narration. À côté de cet abandon, cette production curieuse renferme une critique sociale très personnelle. Burroughs exprime, avec perspicacité et hallucination en simultanée, son mécontentement à l’égard des États-Unis. Critique envers l’ingérence croissante dans les affaires de chaque citoyen, lassé du conformisme bourgeois et de la pression de la censure, l’écrivain n’épargnent pas ces « répressifs et craintifs de la vie ».
L’on sait Burroughs apprécié pour sa plume incandescente, cette marge de l’écriture qui lui est propre et son goût pour les sujets brûlants. Mais c’est aussi une personnalité hautement problématique qui, au sein de cette correspondance, révèle sans détour ses obsessions névrosées et criminelles. Certains passages bavards écornent gravement le mythe et pourtant, il n’en est aucunement fait mention dans la préface. Si l'on s’intéresse à certaines de ces lettres écrites notamment à la période durant laquelle Burroughs s’est installé à Tanger - séduit par ce “ce sanctuaire où chacun est à l’abri de toute interférence” - l’on constate aisément le caractère pédophile de certaines scènes de prédation décrites avec délectation. De son propre aveu : “en train de faire des avances à un garçon indien de 13 ans devant son père, ses frères et ses oncles, en train de ramener à la maison deux morveux déguenillés. Tout ce que je me rappelle est qu’ils étaient jeunes. Me suis réveillé avec l’odeur de la jeunesse sur les mains et le corps” ou encore “si j’étais sage et que j’écoutais un psychanalyste, j'arrêterais de courir après les jeunes garçons”. On ne peut pas dire que le discours, qui n’est pas dans la forme romanesque, puisse se dédouaner ...
William S. Burroughs décrit le monde de la drogue sans tabou, sans prendre de gants.
Dans les années 50 au USA, pendant le phénomène Beat Generation. William Lee par curiosité "test" la came, et puis ensuite, c'est la défonce, le bad trip, la désintoxication, le manque où il décrira de façon réaliste cette expérience cauchemardesque, le mal-être.. Les rencontres avec les autres drogués, les sales coups, la police, tout un "mode" de vie..
Ne pas confondre avec "Junk" de Melvin Burgess
Dans les années 50 au USA, pendant le phénomène Beat Generation. William Lee par curiosité "test" la came, et puis ensuite, c'est la défonce, le bad trip, la désintoxication, le manque où il décrira de façon réaliste cette expérience cauchemardesque, le mal-être.. Les rencontres avec les autres drogués, les sales coups, la police, tout un "mode" de vie..
Ne pas confondre avec "Junk" de Melvin Burgess
« Pourquoi tout ce papier gâché à essayer d'emmener le Beau Monde d'un endroit à un autre ? Peut-être pour épargner au Lecteur la fatigue de randonnées à travers l'espace et lui permettre ainsi de mériter son épithète d'Aimable ? » (Page 250).
Je crois en effet mériter l'épithète en question qui est aussi mon nom, pour lui avoir fait l'honneur des 267 pages de l'édition L'Imaginaire de Gallimard – février-août 2014. Plus loin (cette postface est décidément intéressante), ce « grand écrivain » déclare : « je ne sais comment décrire cette horreur à mon lecteur de race blanche. » (Page 255).
J'ai lu les critiques de tous « ces lecteurs de race blanche » qui semblent avoir pris plaisir au voyage auquel ils ont été conviés, puisqu'ils en ont déduit, à la quasi-unanimité, qu'ils se sont retrouvés en compagnie d'un très grand écrivain. Mais alors, que doivent en penser les autres lecteurs, les non-caucasiens, les exotiques de tous cieux, comme moi, par exemple ?
Un Babélien enthousiaste déclare : « Ce qui était libertaire et subversif en 1959 s'est ossifié en lois et préjugés en 2016, non sans avoir été infecté d'une nouvelle moralité répressive qui ne dit pas son nom, et se cache sous le masque de la liberté et de la tolérance. Un tel livre aujourd'hui vaudrait la prison à son auteur. »
Au fond, le voilà regrettant qu'on ne puisse, de nos jours, traiter en littérature, avec une légèreté méprisante, (qu'excuserait, peut-être, la folie de la drogue ?) les Nègres qu'on peut s'autoriser à brûler dans le Sud, les Arabes affublés de tous les noms ; les Juifs, les Chinois, les sud Américains, les Pédés, etc., étant à peine mieux lotis.
A moins que des analystes n'y voient une dérisoire ironie à prendre au cent-millième degré et qui, d'ailleurs, n'épargnerait pas l'Amérique, les totalitarismes scientifiques ou autres capables de contrôler les âmes, les colonisateurs…Laissons lui le bénéfice du doute.
Si le corps médical et la police (peut-être) ont pu trouver dans cet écrit des éléments de connaissance des perceptions et des comportements d'un « camé », il se trouve, malheureusement, que peu de drogués ont dû se pencher sur une telle oeuvre. Si l'on me prouve le contraire, je suis prêt à admettre mon erreur.
En tout cas, je n'aime pas les mises à l'index et je prends cet écrit pour celui d'un halluciné, d'un dérangé mentalement, ou peut-être de quelqu'un qui a cherché à expier une faute originelle en s'infligeant cette terrible souffrance qu'est l'addiction à la drogue.
Que l'on se souvienne : Cet individu « de race blanche » issu d'un milieu honorable et bourgeois des Etats unis, s'amuse à jouer les Guillaume Tell, lors d'un séjour au Mexique avec sa femme, en étant complètement saoul.
Résultat, la pomme (ou l'autre objet, je ne sais plus), parfaitement ignorée du tir de son C. de mari, la pauvre femme se prendra une balle en pleine tête. Ledit C. de mari ne fera qu'un court séjour en prison.
Depuis : immersion, déjà amorcée, mais totale dans l'univers infernal de la drogue, souffrance sans nom que personne ne songe à nier et, rédemption par le sevrage à la méthadone, l'écriture et la peinture. Ainsi naît un écrivain « maudit », forcément grand. En effet, selon les postures intellectuelles modernes tout auteur maudit est grand. Mais, n'est pas Baudelaire qui veut.
Ma curiosité me conduit, en général, à aller voir de près ce que l'on me vend pour de la grande littérature ; j'achète, par conséquent, le texte dont le prix de vente ne me ruine pas ; mais je ne prends pas toujours l'emballage critique qui l'accompagne. En l'occurrence, je n'ai rien vu dans Le Festin nu qui ressemble, de près ou de loin, à de la littérature.
Bien sûr, l'esthétique ne se résume pas au beau. La violence, la noirceur de l'âme humaine, les souffrances les plus crues ont droit de cité dans l'art, la littérature, le cinéma, etc. Cependant, il faut un génie particulier pour les sublimer. Tout le monde n'y parvient pas, et la vulgarité qui est la manifestation la plus facile, la plus commune à l'esprit humain, tient lieu de génie. Henry Miller en est un autre exemple.
Ainsi donc, j'ai le sentiment que certains servent n'importe quelle bouillie aux critiques en mal d'originalité qui identifient d'emblée un grand artiste des lettres ou de la peinture ou du cinéma, ou de tout ce que vous voulez, sous l'imposture de la vulgarité et de l'obscurité.
Pat.
Un livre classique que je n'avais pas encore lu. Un livre qu'il faut prendre le temps de digérer! Il faut aussi du temps pour s'accommoder du mode d'écriture. Quelques fois drôles et quelques fois complètement fou. C'est un récit qui permet de nous rendre compte des ravages causé par la drogue. Quelques délire et hallucinations qu'il est parfois difficile de comprendre!
Un livre qu'il faut lire avec lenteur pour s'imprégner dans l'ambiance moite qui y règne.
Un livre qu'il faut lire avec lenteur pour s'imprégner dans l'ambiance moite qui y règne.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de William S. Burroughs
Lecteurs de William S. Burroughs Voir plus
Quiz
Voir plus
Karine Giebel ou Barbara Abel
Je sais pas ?
Karine Giebel
Barbara Abel
10 questions
54 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur54 lecteurs ont répondu