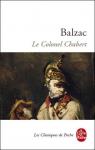Si je me faisais une petite pause Balzac?
C'est en lisant, il y a quelque temps, une belle critique de cette «nouvelle-hybride » par mon amie elitiatopia que l'idée m'en est venue.
J'avais oublié de faire un commentaire sur cette oeuvre vraiment mineure de mon cher Honoré, je répare donc cet oubli.
Comme souvent chez les grands auteurs, et les grandes auteures aussi, il peut leur arriver un coup de mou.
Cette nouvelle un peu bricolée en est l'exemple. Écrite en 1830 par un Balzac encore jeune, elle aurait été fusionnée en 1831 avec un autre texte intitulé l'Eglise.
C'est ce qui fait son caractère hétéroclite, biclite pourrait-on dire.
Et pourtant, la première partie, qui correspond au titre, est très belle. On croirait voir un tableau d'un Maître flamand. Voilà un homme mystérieux qui arrive en retard pour monter dans un bateau, plutôt une grosse barque. Les riches bien installés refusent de lui laisser la place, et ce sont les pauvres entassés à l'avant du bateau qui se serrent pour qu'il s'installe. Mais, lors de la traversée, la tempête gronde. Alors on s'aperçoit de la vraie nature de ce personnage divin. Et les humbles qui l'ont reconnu seront sauvés, tandis que les riches périront dans un naufrage.
La seconde partie est beaucoup moins convaincante, et reliée de façon artificielle à la première par le fait que c'est sur les lieux de ce miracle qu'a été construite une église. le narrateur y voit les pierres de l'église danser, puis une vieille prostituée apparaît auquel ce narrateur reproche d'avoir failli à sa mission jusqu'à ce que une Vierge resplendissante ne vienne et dise « Vois et crois ». Ces deux apparitions sont censées être les allégories d'abord de l'Eglise de France corrompue, car devenue une Église de riches, alors que l'Eglise doit redevenir rayonnante, comme veut le signifier la deuxième apparition. Cette partie correspond, je crois, à l'évolution de l'opinion De Balzac sur la religion catholique, et c'est sans doute pourquoi elle est là. Mais on se demande bien qu'est ce qu'elle vient faire et son écriture est, je trouve, pas au niveau de ce qui l'a précédée.
Cependant, quoi qu'on dise, Balzac, c'est toujours Balzac, sa façon de raconter est toujours par moments flamboyante, mais on l'a quand même connu dans des jours bien meilleurs.
C'est en lisant, il y a quelque temps, une belle critique de cette «nouvelle-hybride » par mon amie elitiatopia que l'idée m'en est venue.
J'avais oublié de faire un commentaire sur cette oeuvre vraiment mineure de mon cher Honoré, je répare donc cet oubli.
Comme souvent chez les grands auteurs, et les grandes auteures aussi, il peut leur arriver un coup de mou.
Cette nouvelle un peu bricolée en est l'exemple. Écrite en 1830 par un Balzac encore jeune, elle aurait été fusionnée en 1831 avec un autre texte intitulé l'Eglise.
C'est ce qui fait son caractère hétéroclite, biclite pourrait-on dire.
Et pourtant, la première partie, qui correspond au titre, est très belle. On croirait voir un tableau d'un Maître flamand. Voilà un homme mystérieux qui arrive en retard pour monter dans un bateau, plutôt une grosse barque. Les riches bien installés refusent de lui laisser la place, et ce sont les pauvres entassés à l'avant du bateau qui se serrent pour qu'il s'installe. Mais, lors de la traversée, la tempête gronde. Alors on s'aperçoit de la vraie nature de ce personnage divin. Et les humbles qui l'ont reconnu seront sauvés, tandis que les riches périront dans un naufrage.
La seconde partie est beaucoup moins convaincante, et reliée de façon artificielle à la première par le fait que c'est sur les lieux de ce miracle qu'a été construite une église. le narrateur y voit les pierres de l'église danser, puis une vieille prostituée apparaît auquel ce narrateur reproche d'avoir failli à sa mission jusqu'à ce que une Vierge resplendissante ne vienne et dise « Vois et crois ». Ces deux apparitions sont censées être les allégories d'abord de l'Eglise de France corrompue, car devenue une Église de riches, alors que l'Eglise doit redevenir rayonnante, comme veut le signifier la deuxième apparition. Cette partie correspond, je crois, à l'évolution de l'opinion De Balzac sur la religion catholique, et c'est sans doute pourquoi elle est là. Mais on se demande bien qu'est ce qu'elle vient faire et son écriture est, je trouve, pas au niveau de ce qui l'a précédée.
Cependant, quoi qu'on dise, Balzac, c'est toujours Balzac, sa façon de raconter est toujours par moments flamboyante, mais on l'a quand même connu dans des jours bien meilleurs.
Habitant cet endroit, me voilà sauvé ! :‐)))
D'après son éditeur, Alexandre Houssiaux, Charles Furne (1794-1859) de son vrai nom, Honoré de Balzac a décidé, en 1845, de mettre l'ensemble de ses écrits sous le titre : "La Comédie Humaine".
Lorsque ce géant de la littérature française et mondiale mourut soudainement le 18 août 1950 à Paris, à seulement 51 ans, il restait 3 de ses 91 oeuvres à préparer pour la superbe collection de 20 bandes en cuir magnifique. Et il restait encore une cinquantaine de projets inachevés.
Et parmi ces projets, "Jésus Christ en Flandre". Une nouvelle écrite probablement en 1831 et envoyée en 1846 à la poétesse Marceline Desbordes‐Valmore (1766-1859).
Pour être honnête, lorsque j'ai écrit, le 12 juin 2018, mon billet de la biographie De Balzac par Stefan Zweig "Balzac ; le roman de sa vie", j'ignorais totalement la visite du Christ au plat pays qui est mien que chantait un certain Brel.
Je n'entends pas résumer cette nouvelle de 40 pages bien sûr, mais je suis incapable de ne pas en distraire quelques éléments isolés.
Ainsi, j'apprends que la ville d'Ostende était "peuplée par quelques pêcheurs, par de pauvres négociants et par des corsaires impunis". Qui régnait vraiment la Belgique à cette époque est pour Balzac un mystère.
Maintenant, on a un Roi, une Constitution, 4 gouvernements (Fédéral, Flamand, Wallon et Bruxellois), toutes sortes d'assemblées et où réside le réel pouvoir reste toujours aussi mystérieux.
Ce qui est étrange, ce sont les circonstances dans lesquelles Balzac transforma en un panégyrique de l'Église une rêverie fantastique qui exprimait une conception très désenchantée de la religion, comme cette nouvelle a été parfaitement caractérisée sur le site "Balzac dans l'histoire".
À lire, pas pour la Belgique, mais pour Honoré de Balzac. Évidemment !
D'après son éditeur, Alexandre Houssiaux, Charles Furne (1794-1859) de son vrai nom, Honoré de Balzac a décidé, en 1845, de mettre l'ensemble de ses écrits sous le titre : "La Comédie Humaine".
Lorsque ce géant de la littérature française et mondiale mourut soudainement le 18 août 1950 à Paris, à seulement 51 ans, il restait 3 de ses 91 oeuvres à préparer pour la superbe collection de 20 bandes en cuir magnifique. Et il restait encore une cinquantaine de projets inachevés.
Et parmi ces projets, "Jésus Christ en Flandre". Une nouvelle écrite probablement en 1831 et envoyée en 1846 à la poétesse Marceline Desbordes‐Valmore (1766-1859).
Pour être honnête, lorsque j'ai écrit, le 12 juin 2018, mon billet de la biographie De Balzac par Stefan Zweig "Balzac ; le roman de sa vie", j'ignorais totalement la visite du Christ au plat pays qui est mien que chantait un certain Brel.
Je n'entends pas résumer cette nouvelle de 40 pages bien sûr, mais je suis incapable de ne pas en distraire quelques éléments isolés.
Ainsi, j'apprends que la ville d'Ostende était "peuplée par quelques pêcheurs, par de pauvres négociants et par des corsaires impunis". Qui régnait vraiment la Belgique à cette époque est pour Balzac un mystère.
Maintenant, on a un Roi, une Constitution, 4 gouvernements (Fédéral, Flamand, Wallon et Bruxellois), toutes sortes d'assemblées et où réside le réel pouvoir reste toujours aussi mystérieux.
Ce qui est étrange, ce sont les circonstances dans lesquelles Balzac transforma en un panégyrique de l'Église une rêverie fantastique qui exprimait une conception très désenchantée de la religion, comme cette nouvelle a été parfaitement caractérisée sur le site "Balzac dans l'histoire".
À lire, pas pour la Belgique, mais pour Honoré de Balzac. Évidemment !
Cette nouvelle assez brève est pour le moins déroutante, en ce qu'elle se compose de plusieurs fragments, assemblés les uns aux autres à différents moments entre 1830 et 1831, moyennant quelques phrases de transition.
La partie rapportant la légende flamande du Christ, embarqué incognito avec d'autres passagers pour passer le canal entre l'île de Cadzant et Ostende, est marquante. Nous sommes en présence d'un batelier, marin fier et chevronné, et de ses rameurs, à l'arrière se tiennent divers personnages nobles ou bourgeois, mais tous suffisants et égoïstes ; devant sont assis de pauvres gens, qui représentent les couches les plus laborieuses de la société. Avec eux s'assoit spontanément l'inconnu qui était en retard, lequel offre au départ une peu reluisante apparence. Lorsque le bateau s'avance sur les flots, Ostende n'est pas loin, mais une terrible tempête se lève…
Balzac nous permet par sa science de l'observation d'assister aux différentes réactions des personnes en présence face au danger, et peut-être à la mort. Seul le commandant du bateau reste imperturbable, habitué qu'il est à lutter contre les éléments. L'inconnu garde également un calme notable, encourage certains ou certaines. La scène est campée à grands traits, avec des effets de contrastes et de couleurs qui rappellent fortement la peinture flamande. le croirez-vous ? Un tableau de Jan Brueghel l'Ancien s'intitule justement le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, scène également représentée par Rembrandt. Ce n'est guère étonnant, on connaît la forte appétence De Balzac pour l'art pictural.
La suite du texte nous ramène à un narrateur fictif qui s'apparente peu ou prou à l'auteur, et dérive vers une fantasmagorie : tout d'abord, il entre dans une église au bord de la mer, et assiste à une « danse des pierres », c'est-à-dire que les colonnes et sculptures de l'église s'animent et le plongent dans un état second, au bord du délire. Puis une vieille femme l'entraîne dans une sombre soupente, où il conçoit une allégorie de l'Église pervertie par ses richesses, avec une morale toute chrétienne, qui en un sens, bien que cela soit fort décousu, donne une clé de lecture plus approfondie de la légende. Une idée couramment répandue, qui a inspiré L'Idiot de Féodor Dostoïevski, est que si Jésus-Christ revenait parmi les hommes nul ne le reconnaîtrait ; peut-être même le tuerions-nous une seconde fois. Idée à méditer…
La partie rapportant la légende flamande du Christ, embarqué incognito avec d'autres passagers pour passer le canal entre l'île de Cadzant et Ostende, est marquante. Nous sommes en présence d'un batelier, marin fier et chevronné, et de ses rameurs, à l'arrière se tiennent divers personnages nobles ou bourgeois, mais tous suffisants et égoïstes ; devant sont assis de pauvres gens, qui représentent les couches les plus laborieuses de la société. Avec eux s'assoit spontanément l'inconnu qui était en retard, lequel offre au départ une peu reluisante apparence. Lorsque le bateau s'avance sur les flots, Ostende n'est pas loin, mais une terrible tempête se lève…
Balzac nous permet par sa science de l'observation d'assister aux différentes réactions des personnes en présence face au danger, et peut-être à la mort. Seul le commandant du bateau reste imperturbable, habitué qu'il est à lutter contre les éléments. L'inconnu garde également un calme notable, encourage certains ou certaines. La scène est campée à grands traits, avec des effets de contrastes et de couleurs qui rappellent fortement la peinture flamande. le croirez-vous ? Un tableau de Jan Brueghel l'Ancien s'intitule justement le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, scène également représentée par Rembrandt. Ce n'est guère étonnant, on connaît la forte appétence De Balzac pour l'art pictural.
La suite du texte nous ramène à un narrateur fictif qui s'apparente peu ou prou à l'auteur, et dérive vers une fantasmagorie : tout d'abord, il entre dans une église au bord de la mer, et assiste à une « danse des pierres », c'est-à-dire que les colonnes et sculptures de l'église s'animent et le plongent dans un état second, au bord du délire. Puis une vieille femme l'entraîne dans une sombre soupente, où il conçoit une allégorie de l'Église pervertie par ses richesses, avec une morale toute chrétienne, qui en un sens, bien que cela soit fort décousu, donne une clé de lecture plus approfondie de la légende. Une idée couramment répandue, qui a inspiré L'Idiot de Féodor Dostoïevski, est que si Jésus-Christ revenait parmi les hommes nul ne le reconnaîtrait ; peut-être même le tuerions-nous une seconde fois. Idée à méditer…
En 1831, Balzac ne s'était pas remis de la chute du roi Charles X. le narrateur - mais c'est l'auteur lui-même qui se confie - est explicite sur ce point. Deux, voire trois brèves nouvelles fusionnées permettent ainsi au génie tourangeau de juxtaposer légende et surnaturel d'une part, allégorie à valeur politique et religieuse d'autre part. A l'issue de la Révolution de 1830, Balzac avait clairement choisi son camp, celui du Trône et de l'Autel.
La première partie de l'histoire se déroule dans la barque qui relie l'île de Cadzant à Ostende. Un homme y monte. Il représente le Christ et quand l'embarcation fera naufrage, seuls ceux qui croient en lui seront sauvés.
La seconde partie se déroule dans l'église qui fut construite sur les lieux du miracle de la barque. le narrateur y racontera une hallucination.
Curieusement Balzac qui semblait très circonspect envers l'Église semble s'adoucir avec cette petite fable.
PERSONNAGES
Curieusement ce texte ne comporte pas de nom, sauf les passagers et de l'équipage de la barque, deux reçoivent un nom, la vieille Mme de Rupelmonde, qui périra noyée, et surtout le rameur Thomas.
Viennent un homme à tête nue dans le rôle de Jésus marchant sur l'eau et une vieille dame qui pourrait représenter l'Eglise.
La seconde partie se déroule dans l'église qui fut construite sur les lieux du miracle de la barque. le narrateur y racontera une hallucination.
Curieusement Balzac qui semblait très circonspect envers l'Église semble s'adoucir avec cette petite fable.
PERSONNAGES
Curieusement ce texte ne comporte pas de nom, sauf les passagers et de l'équipage de la barque, deux reçoivent un nom, la vieille Mme de Rupelmonde, qui périra noyée, et surtout le rameur Thomas.
Viennent un homme à tête nue dans le rôle de Jésus marchant sur l'eau et une vieille dame qui pourrait représenter l'Eglise.
Jésus-Christ en Flandre, ce titre assez étonnant m'a attirée. Malheureusement, j'ai été, pour une fois, assez déçue de cette très courte nouvelle De Balzac découpée en 2 parties bien distinctes sans réel lien entre elles. Ce texte recèle plein d'idées, d'analyses, de réflexions, trop en fait et il m'a paru peu accessible. Enfin, aimant les récits bien encrés dans la réalité, le merveilleux et la fantasmagorie ont accentué mon ennui.
cette nouvelle appartient au genre de la parabole : une époque indéterminée , un miracle du Christ « en personne » , des personnages allégoriques . Balzac y laisse transparaître ses idées religieuses (avec même un soupçon d'anticléricalisme voir la citation)
Moi qui aime beaucoup, qui adore, devrais-je dire, Balzac, j'ai été déçu par cette nouvelle du grand écrivain…
Il y a énormément d'idées, de réflexions intéressantes, mais c'est là qu'est le problème, justement : il y a trop d'idées intéressantes qui n'ont pas pu être développées, au vu de l'extrême brièveté du texte…
La réflexion un peu spirituelle et mystique en est du coup entachée… En règle générale, je n'ai rien contre les textes brefs, mais là, ce texte est trop bref pour son contenu… Je regrette un manque à mes yeux certain de développement dans ce bref texte qui eut pu être plus intéressant…
Il y a énormément d'idées, de réflexions intéressantes, mais c'est là qu'est le problème, justement : il y a trop d'idées intéressantes qui n'ont pas pu être développées, au vu de l'extrême brièveté du texte…
La réflexion un peu spirituelle et mystique en est du coup entachée… En règle générale, je n'ai rien contre les textes brefs, mais là, ce texte est trop bref pour son contenu… Je regrette un manque à mes yeux certain de développement dans ce bref texte qui eut pu être plus intéressant…
Ce texte ne fonctionne guère du point de vue de l'intrigue, puisque c'est le groupement de deux récits, un regroupement qui ne fonctionne guère, ils ne sont pas vraiment liés entre eux - si ce n'est par la thématique. le premier reprend le genre du miracle médiéval, où les pauvres croyants sont sauvés, et les riches impies condamnés. de belles descriptions de tempête et de vision de mer déchaînée dans une veine romantique - j'ai pensé à Hugo notamment, poète ou romancier. Mais le texte n'est pas empreint de sensualité, l'évêque pense à sa maîtresse au bain plutôt qu'à sauver son âme et celle des autres, la jeune fille noble regrette de ne pas avoir eu le temps de coucher avec son amant.
Finalement, ce n'est pas que le thème de la spiritualité, de la croyance et de la mystique qui unit les deux parties du texte, c'est aussi celui de la sensualité. Car dans sa vision dans l'église, le Narrateur voit les voûtes de la cathédrale danser, les anges des statues s'animer comme dans un bal, les colonnes devenant des jeunes filles parées pour séduire. J'ai aimé ce rapprochement inattendu, plus que la fin sur la foi.
Finalement, ce n'est pas que le thème de la spiritualité, de la croyance et de la mystique qui unit les deux parties du texte, c'est aussi celui de la sensualité. Car dans sa vision dans l'église, le Narrateur voit les voûtes de la cathédrale danser, les anges des statues s'animer comme dans un bal, les colonnes devenant des jeunes filles parées pour séduire. J'ai aimé ce rapprochement inattendu, plus que la fin sur la foi.
Le diable et le bon dieu... tels pourraient être les termes pour désigner les deux pans nets, bien dessinés, clairement tranchés sous lesquels Honoré de Balzac nous donne sa vision de la chose.
De mon point de vue, ce n'est pas du grand Balzac, c'est même tout le contraire, mais Balzac est tellement Balzac que même lorsqu'il est dans un mauvais jour, même lorsque l'amadou est humide, il parvient à faire jaillir des étincelles par cette plume, par ce style qui lui est propre et que personnellement j'adore.
1°) Côté face : le Diable (Melmoth Réconcilié)
Dans ce court roman, Balzac revisite et se réapproprie à sa façon le thème du pacte avec le diable en réchauffant le mythe du Docteur Faust initié par Marlowe et fraîchement popularisé par Goethe. À la différence près qu'ici, après une entrée en matière tonitruante et corrosive à souhait, il fait récipiendaire de son pacte diabolique un obscur caissier de la banque de Nucingen.
Cet insignifiant caissier, Rodolphe Castanier, plongé dans les dettes jusqu'au cou pour les beaux yeux d'une apprentie prostituée repêchée in extremis sur le pavé de Paris, s'apprête à commettre sa plus savante malversation pour s'assurer le confort d'une nouvelle vie à l'étranger lorsqu'il voit apparaître un sinistre anglais du nom de John Melmoth.
Celui-ci voit tout, devine tout, domine tout et impose son fait. le caissier éberlué, au bord de l'abîme, déjà aspiré par les affres du gouffre, ne voit d'autre choix que d'accepter le pacte que lui soumet l'Anglais démoniaque.
Doué de ce don nouveau de vue extralucide, Castanier voit tout, les trahisons de sa maîtresse, les intentions fourbes des servantes, les soifs mesquines, les désirs fades, la grande comédie qu'est la vie. Un peu comme pour le Peter Schlemihl de Chamisso, la fortune de Castanier prend un goût très amer sitôt qu'elle s'offre à lui.
À l'étroit dans son omnipotence, rien n'est jamais aussi simple et beau qu'on se l'imagine vu d'en bas et c'est sur cette douloureuse réflexion que l'auteur nous place au travers de ce petit roman qui tient, à juste titre, sa place dans la section " études philosophiques " de la Comédie Humaine.
Le trait fantastique n'est pas ce que je préfère chez Balzac, mais ce petit volume se laisse lire sans aucun déplaisir et nous pose les questions : Que feriez-vous si vous disposiez d'un pouvoir illimité ? Qu'adviendrait-il de vous ? de vos désirs ? de vos espérances ?
2°) Côté pile : le Bon Dieu (Jésus-Christ en Flandre)
C'est un drôle de machin que ce truc. Un assemblage bancal et ad hoc pour la parution de l'intégrale de la Comédie Humaine en 1845 de deux nouvelles datant du début des années 1830 et déjà assez scabreuses l'une et l'autre, dans un registre où l'on ne connaît guère Honoré de Balzac.
Le première nouvelle portait elle-même le titre Jésus-Christ En Flandre et évoquait une nouvelle apparition du Christ marchant sur l'eau dans la tempête. La seconde témoignait du mystérieux pouvoir de transe et de délire qu'exercent sur un esprit prédisposé tant les détails que l'impression d'ensemble d'un monument tel qu'une cathédrale, en l'espèce, à l'origine la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Il reprendra d'ailleurs ce thème spécifique dans les rêveries de l'abbé Birotteau dans le Curé de Tours.
C'est donc une manière d'exercice de contorsionniste auquel s'astreint l'auteur pour faire tenir ces deux nouvelles isolées en un édifice tant soit peu d'aplomb. Et pour être sincère, il n'y parvient pas, soit par manque de temps pour refondre les deux en un, soit parce que le lien est trop vague et trop artificiel.
Le message qui semble s'en extraire cependant renvoie à Melmoth Réconcilié, à savoir que le luxe, l'argent, l'amour de façade et la luxure, bref, la vie mondaine, est oeuvre du diable tandis que l'humilité, la franchise et l'amour vrai sont l'oeuvre de Dieu.
Je ne vous le cache pas, ces thèmes sont pour moi sans intérêt. En revanche, l'écriture De Balzac est, reste et demeurera à mes yeux un délice tant j'y éprouve de plaisir. J'arrive à me sentir bien même dans du mauvais Balzac, c'est dire ce qu'il en est lorsqu'il est au sommet de son art...
En outre, ceci n'est bien sûr que mon avis, bien faiblement inspiré — inspiré par qui d'ailleurs ? on se le demande, le diable ? le bon dieu ? ou plus modestement par le simple flux de mes artères ? Allez savoir... mais assurément, ce n'est pas grand-chose.
De mon point de vue, ce n'est pas du grand Balzac, c'est même tout le contraire, mais Balzac est tellement Balzac que même lorsqu'il est dans un mauvais jour, même lorsque l'amadou est humide, il parvient à faire jaillir des étincelles par cette plume, par ce style qui lui est propre et que personnellement j'adore.
1°) Côté face : le Diable (Melmoth Réconcilié)
Dans ce court roman, Balzac revisite et se réapproprie à sa façon le thème du pacte avec le diable en réchauffant le mythe du Docteur Faust initié par Marlowe et fraîchement popularisé par Goethe. À la différence près qu'ici, après une entrée en matière tonitruante et corrosive à souhait, il fait récipiendaire de son pacte diabolique un obscur caissier de la banque de Nucingen.
Cet insignifiant caissier, Rodolphe Castanier, plongé dans les dettes jusqu'au cou pour les beaux yeux d'une apprentie prostituée repêchée in extremis sur le pavé de Paris, s'apprête à commettre sa plus savante malversation pour s'assurer le confort d'une nouvelle vie à l'étranger lorsqu'il voit apparaître un sinistre anglais du nom de John Melmoth.
Celui-ci voit tout, devine tout, domine tout et impose son fait. le caissier éberlué, au bord de l'abîme, déjà aspiré par les affres du gouffre, ne voit d'autre choix que d'accepter le pacte que lui soumet l'Anglais démoniaque.
Doué de ce don nouveau de vue extralucide, Castanier voit tout, les trahisons de sa maîtresse, les intentions fourbes des servantes, les soifs mesquines, les désirs fades, la grande comédie qu'est la vie. Un peu comme pour le Peter Schlemihl de Chamisso, la fortune de Castanier prend un goût très amer sitôt qu'elle s'offre à lui.
À l'étroit dans son omnipotence, rien n'est jamais aussi simple et beau qu'on se l'imagine vu d'en bas et c'est sur cette douloureuse réflexion que l'auteur nous place au travers de ce petit roman qui tient, à juste titre, sa place dans la section " études philosophiques " de la Comédie Humaine.
Le trait fantastique n'est pas ce que je préfère chez Balzac, mais ce petit volume se laisse lire sans aucun déplaisir et nous pose les questions : Que feriez-vous si vous disposiez d'un pouvoir illimité ? Qu'adviendrait-il de vous ? de vos désirs ? de vos espérances ?
2°) Côté pile : le Bon Dieu (Jésus-Christ en Flandre)
C'est un drôle de machin que ce truc. Un assemblage bancal et ad hoc pour la parution de l'intégrale de la Comédie Humaine en 1845 de deux nouvelles datant du début des années 1830 et déjà assez scabreuses l'une et l'autre, dans un registre où l'on ne connaît guère Honoré de Balzac.
Le première nouvelle portait elle-même le titre Jésus-Christ En Flandre et évoquait une nouvelle apparition du Christ marchant sur l'eau dans la tempête. La seconde témoignait du mystérieux pouvoir de transe et de délire qu'exercent sur un esprit prédisposé tant les détails que l'impression d'ensemble d'un monument tel qu'une cathédrale, en l'espèce, à l'origine la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Il reprendra d'ailleurs ce thème spécifique dans les rêveries de l'abbé Birotteau dans le Curé de Tours.
C'est donc une manière d'exercice de contorsionniste auquel s'astreint l'auteur pour faire tenir ces deux nouvelles isolées en un édifice tant soit peu d'aplomb. Et pour être sincère, il n'y parvient pas, soit par manque de temps pour refondre les deux en un, soit parce que le lien est trop vague et trop artificiel.
Le message qui semble s'en extraire cependant renvoie à Melmoth Réconcilié, à savoir que le luxe, l'argent, l'amour de façade et la luxure, bref, la vie mondaine, est oeuvre du diable tandis que l'humilité, la franchise et l'amour vrai sont l'oeuvre de Dieu.
Je ne vous le cache pas, ces thèmes sont pour moi sans intérêt. En revanche, l'écriture De Balzac est, reste et demeurera à mes yeux un délice tant j'y éprouve de plaisir. J'arrive à me sentir bien même dans du mauvais Balzac, c'est dire ce qu'il en est lorsqu'il est au sommet de son art...
En outre, ceci n'est bien sûr que mon avis, bien faiblement inspiré — inspiré par qui d'ailleurs ? on se le demande, le diable ? le bon dieu ? ou plus modestement par le simple flux de mes artères ? Allez savoir... mais assurément, ce n'est pas grand-chose.
Les Dernières Actualités
Voir plus

Les nouvelles de Balzac
Cer45Rt
35 livres
Autres livres de Honoré de Balzac (452)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Connaissez-vous La Peau de Chagrin de Balzac ?
Comment se comme le personnage principal du roman ?
Valentin de Lavallière
Raphaël de Valentin
Raphaël de Vautrin
Ferdinand de Lesseps
10 questions
1316 lecteurs ont répondu
Thème : La Peau de chagrin de
Honoré de BalzacCréer un quiz sur ce livre1316 lecteurs ont répondu