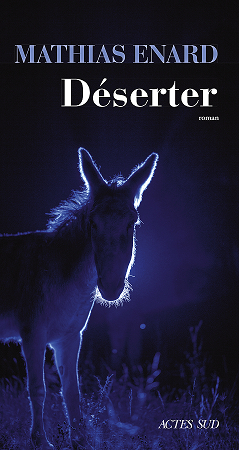Citations sur Déserter (68)
Je ne pensais pas à Paul, mais je poursuivais sa pensée mathématique si puissante, dans les bras de la femme qu’il aimait. Paul était un génie triste. Les rêveurs comme Paul, les constructeurs de rêves immenses sont toujours tristes. Notre monde n’est pas fait pour eux. (p. 200)
Maja mon amour nous vaincrons, nous avons la force du cercle, celle du triangle rectangle sans lequel il n’y a pas de cercle, solides comme deux anneaux l’un dans l’autre, l’invariance du domaine de la passion… (p. 150)
Je suis restée encore une bonne heure sur le pont, en essayant de ne pas penser à New-York, pour me défaire de l'impression d'horreur qu'avait provoquée en moi la répétition des images des attentats, ces nuées de poussière envahissant les rues qui poursuivaient la foule pour l'avaler, ces monstres informes de volutes épaisses et meurtrières – parmi les images les plus navrantes se trouvaient celles d'enfants se réjouissant en Palestine, de la catastrophe : bien que cela ne fût pas, malheureusement, étonnant en soi, cela rajoutait à la douloureuse tristesse mélancolique du moment.
Depuis quelques mois, depuis mon entrée dans la cinquantaine, je me débattais parmi les images de la mort. Je m'imaginais mourir bientôt. La fin si soudaine de mon père me hantait. Ma solitude, même si elle était tout à fait choisie et assumée, était une immense chambre d'écho pour ma tristesse, où le spleen résonnait, s'amplifiait jusqu'à devenir un profond malheur.
Maryamn Mirzakhani est morte d'un cancer du sein à l'age de quarante ans, trois ans seulement après avoir reçu la récompense qui fait rêver tout l'univers mathématique - une tristesse immense m'a prise, à ce moment-là, j'aurais volontiers donné des années de ma vie pour prolonger la sienne, dont j'ignorais presque tout.
Maja j'ai l'impression que la vie m'a donné tort, sur beaucoup de points : on a réfuté des théorèmes, infirmé certaines de mes conjonctures, oublié nombre de mes travaux; nous n'édifions plus le socialisme et on ne m'appellera plus camarade - nous payons le prix de notre intransigeance de nos erreurs, et de notre trop grande soumission aux va-t-en-guerre russes. J'ai eu le tort de croire, de conjecturer que l'humanité était faite pour la paix, la partage et la fraternité.
page 220.
page 220.
Je suis née en 1951, dans une clinique du secteur américain près du Jardin Botanique. Mes parents avaient alors trente-trois ans. Paul terminait la rédaction de sa thèse d’habilitation tout en enseignant l’algèbre à l’université Humboldt. Maja était toujours très engagée politiquement et travaillait auprès de Franz Dahlem, après que son parti, le Parti social-démocrate, avait fusionné avec le Parti communiste allemand pour former, dans la Zone d’occupation soviétique, le Parti socialiste unifié. La République démocratique d’Allemagne avait tout juste deux ans ; deux ans plus tard tout l’espoir de Maja, déjà ébréché par le blocus de Berlin, se fracassait contre les émeutes de juin 1953 ; elle se réinstalla sans mon père à l’ouest (ils n’ont jamais été mariés) et poursuivit sa carrière politique auprès de Willy Brandt.
Paul soutint son habilitation et obtint son premier poste à l’Académie des sciences de Berlin au moment même où les intellectuels commençaient à fuir la RDA. L’ouvrage Les Conjectures de l’Ettersberg, élégies mathématiques, fut un des premiers livres publiés par la maison d’édition de l’Académie fin 1947. Il s’agit des travaux de Paul Heudeber rédigés autour de sa détention au camp de Buchenwald entre 1940 et 1946. Aujourd’hui vénérées par les mondes scientifiques et littéraires comme un trésor, Les Conjectures ne furent rééditées qu’une seule fois en Allemagne de l’Est, en 1973 (dans une version purement mathématique, sans les poèmes, les corollaires, les commentaires à propos de la vie du camp), et ce n’est qu’en 1991 que l’Akademie Verlag réédita la version originale, augmentée par Paul des fragments qu’il avait lui-même écartés (principalement les poèmes d’amour à Maja écrits entre 1937 et 1947) lors de la première publication. C’est cette version, sous le titre Les Conjectures de Buchenwald, traduites en anglais par Robert Kant à Cambridge, qui fit le tour de la planète, seul ouvrage de mathématiques à avoir connu un relatif succès, à tel point que les éditeurs, qui imaginaient que ce succès puisse être encore plus grand, suggérèrent à Paul d’en autoriser une version exclusivement « littéraire », sans les développements mathématiques, ce qu’il refusa bien entendu jusqu’à sa disparition.
La contribution de Robert Kant au colloque de 2001 (contribution qu’il révisait en notre compagnie pendant le trajet fluvial à travers Berlin) portait précisément sur la première conjecture, sur les circonstances de la naissance, au cœur de l’extrême violence concentrationnaire, de ce projet hors du commun et sur la façon dont Paul Heudeber entama ce dialogue imaginaire, depuis son baraquement, avec les mathématiciens des générations précédentes : la première conjecture (et donc le premier chapitre) a trait aux problèmes de David Hilbert ; la seconde est consacrée à la célèbre démonstration de Paul de la conjecture des premiers jumeaux, et ainsi de suite.
Robert Kant soutenait que l’originalité du texte de Paul, outre son côté indiscutablement littéraire, ses considérations sur la Révolution, ses passages obscurs, sa poésie si sombre, provient de sa radicalité scientifique : de ce croisement, au fond du XXe siècle, du désespoir historique avec l’espérance mathématique.
Paul soutint son habilitation et obtint son premier poste à l’Académie des sciences de Berlin au moment même où les intellectuels commençaient à fuir la RDA. L’ouvrage Les Conjectures de l’Ettersberg, élégies mathématiques, fut un des premiers livres publiés par la maison d’édition de l’Académie fin 1947. Il s’agit des travaux de Paul Heudeber rédigés autour de sa détention au camp de Buchenwald entre 1940 et 1946. Aujourd’hui vénérées par les mondes scientifiques et littéraires comme un trésor, Les Conjectures ne furent rééditées qu’une seule fois en Allemagne de l’Est, en 1973 (dans une version purement mathématique, sans les poèmes, les corollaires, les commentaires à propos de la vie du camp), et ce n’est qu’en 1991 que l’Akademie Verlag réédita la version originale, augmentée par Paul des fragments qu’il avait lui-même écartés (principalement les poèmes d’amour à Maja écrits entre 1937 et 1947) lors de la première publication. C’est cette version, sous le titre Les Conjectures de Buchenwald, traduites en anglais par Robert Kant à Cambridge, qui fit le tour de la planète, seul ouvrage de mathématiques à avoir connu un relatif succès, à tel point que les éditeurs, qui imaginaient que ce succès puisse être encore plus grand, suggérèrent à Paul d’en autoriser une version exclusivement « littéraire », sans les développements mathématiques, ce qu’il refusa bien entendu jusqu’à sa disparition.
La contribution de Robert Kant au colloque de 2001 (contribution qu’il révisait en notre compagnie pendant le trajet fluvial à travers Berlin) portait précisément sur la première conjecture, sur les circonstances de la naissance, au cœur de l’extrême violence concentrationnaire, de ce projet hors du commun et sur la façon dont Paul Heudeber entama ce dialogue imaginaire, depuis son baraquement, avec les mathématiciens des générations précédentes : la première conjecture (et donc le premier chapitre) a trait aux problèmes de David Hilbert ; la seconde est consacrée à la célèbre démonstration de Paul de la conjecture des premiers jumeaux, et ainsi de suite.
Robert Kant soutenait que l’originalité du texte de Paul, outre son côté indiscutablement littéraire, ses considérations sur la Révolution, ses passages obscurs, sa poésie si sombre, provient de sa radicalité scientifique : de ce croisement, au fond du XXe siècle, du désespoir historique avec l’espérance mathématique.
(Les premières pages du livre)
Il a posé son arme et se débarrasse avec peine de ses galoches dont l’odeur (excréments, sueur moisie) ajoute encore à la fatigue. Les doigts sur les lacets effilochés sont des brandillons secs, légèrement brûlés par endroits ; les ongles ont la couleur des bottes, il faudra les gratter à la pointe du couteau pour en retirer la crasse, boue, sang séché, mais plus tard, il n’en a pas la force ; deux orteils, chair et terre, sortent de la
chaussette, ce sont de gros vers maculés qui rampent hors d’un tronc sombre, noueux à la cheville. Il se demande tout à coup, comme chaque matin, comme chaque soir, pourquoi ces godasses puent la merde, c’est inexplicable, tu as beau les rincer dans les flaques d’eau que tu croises, les frotter aux touffes herbeuses qui crissent, rien n’y fait, il n’y a pourtant pas tant de chiens ou de bêtes
sauvages, pas tant, dans ces hauteurs de cailloux saupoudrées de chênes verts, de pins et d’épineux où la pluie laisse une fine boue claire et un parfum de silex, pas de merde, et il lui serait facile de croire que c’est tout le pays qui remugle, depuis la mer, les
collines d’orangers puis d’oliviers jusqu’au fin fond des montagnes, de ces montagnes, voire lui-même, sa propre odeur, pas celle des chaussures, mais il ne peut s’y résoudre et balance les godillots contre le bord de la ravine qui le dissimule du sentier, un peu
plus haut dans la pente.
Il s’allonge sur le dos à même les graviers, soupire, le ciel est violacé, les lueurs du couchant éclairent par en dessous des nuages rapides, une toile, un écran pour un feu d’artifice. Le printemps est presque là et avec lui s’annoncent les pluies souvent torrentielles qui transforment les montagnes en bidons percés par des balles, dégorgeant
du moindre creux une source puissante, quand l’air sent le thym et les fleurs des fruitiers, flocons blancs répandus entre les murets par la violence de l’averse. Ce serait bien le diable qu’il se mette à pleuvoir maintenant. En même temps ça laverait les bottines. Les galoches, le treillis, les chaussettes, dont les deux paires qu’il possède sont tout aussi rigides, cartonnées, délabrées. La trahison commence par le corps, tu ne t’es pas lavé depuis quand ?
Quatre jours que tu marches près des crêtes pour éviter les villages, la dernière eau dont tu t’es aspergé sentait l’essence et laissait la peau grasse, tu es bien loin de la pureté, seul sous le ciel à lorgner les comètes.
La faim le force à se redresser et avaler sans plaisir trois biscuits militaires, les derniers, des plaques brunes et dures, sans doute un mélange de sciure et de colle de vieille jument ; il maudit un instant la guerre et les soldats, tu es encore l’un des leurs, tu portes toujours des armes, des munitions et des souvenirs de guerre, tu pourrais cacher le fusil et les cartouches dans un coin et devenir un mendiant, laisser le couteau
aussi, les mendiants n’ont pas de poignard,
les godillots à l’odeur de merde et aller pieds nus, la veste couleur de misère et aller torse nu, le repas achevé il boit le fond de sa gourde et joue à pisser le plus loin possible vers la vallée.
Il s’allonge à nouveau, cette fois tout contre la paroi, le bas du sac sous la tête ; il est invisible dans l’ombre, tant pis pour les bestioles (araignées rouges, scorpions minuscules, scolopendres aux dents aiguës
comme des remords) qui gambaderont sur son torse, glisseront sur son crâne presque rasé, se promèneront sur sa barbe aussi rêche qu’un roncier. Le fusil contre lui, la crosse sous l’épaule, le canon vers les
pieds. Enroulé dans le morceau de toile bitumée qui lui sert de couverture et de toit.
La montagne bruisse ; un peu de vent double les sommets, descend dans la combe et vibre entre les arbustes ; les cris des étoiles sont glaçants. Il n’y a plus de nuages, il ne pleuvra pas cette nuit.
Ange mon saint gardien, protecteur de mon âme et de mon corps, pardonne-moi tous les péchés commis en ce jour et délivre-moi des œuvres de l’ennemi, malgré la chaleur de la prière la nuit reste un fauve nourri d’angoisse, un fauve à l’haleine de sang, des villes aux ruines parcourues par des mères brandissant les cadavres mutilés de leurs enfants face à des hyènes débraillées qui les tortureront, ensuite, les laisseront nues, souillées, les mamelons arrachés à coups de dents sous les yeux de leurs frères violés à leur tour avec des matraques, l’effroi étendu sur le pays, la peste, la haine et la nuit, cette nuit qui vous
enveloppe toujours pour vous pousser à la lâcheté et la trahison. À la fuite et la désertion. Combien de temps va-t-il falloir marcher? La frontière est à quelques jours d’ici, au-delà des montagnes qui bientôt deviendront des collines à la terre rouge, plantées d’oliviers. Il sera difficile de se cacher. Beaucoup de villages, des villes, des paysans, des soldats, tu connais la région,
tu es chez toi ici, personne n’aidera un déserteur, tu atteindras demain la maison dans la montagne, la cabane, la masure, tu y prendras refuge quelque temps, la cabane te protégera par son enfance, tu y seras caressé par les souvenirs, parfois le sommeil vient par surprise comme la balle d’un tireur embusqué.
II
Il y a plus de vingt ans, le 11 septembre 2001, près de Potsdam sur la Havel, à bord de ce bateau de croisière, un petit paquebot fluvial baptisé du beau nom pompeux de Beethoven, l’été paraissait vaciller.
Les saules étaient toujours verts, les journées
encore chaudes mais une brume glaciale montait de la rivière avant l’aube et d’immenses nuages glissaient sur nous, depuis la lointaine mer Baltique.
Notre hôtel flottant avait quitté Köpenick à l’est de Berlin très tôt le matin, le lundi 10. Maja était toujours alerte, fringante. Elle montait sur le pont supérieur pour marcher, une promenade entre les averses, les transats et les jeux de pont. Les dômes
verts et la flèche dorée de la cathédrale de Berlin la captivèrent, de loin, à notre passage. Elle imaginait, disait-elle, tous ces petits anges dorés quitter leur prison de pierre pour s’envoler dans un nuage de feuilles d’acanthe soufflées par le soleil.
L’eau de la Spree fut tantôt d’un bleu sombre et mat, tantôt d’un vert rougeoyant. Les semaines précédentes, toute l’Allemagne avait été secouée d’orages dont les hoquets grossirent jusqu’à la Havel et la Spree d’habitude pourtant plutôt basses en cette fin d’été.
Nous naviguâmes au milieu des remous.
Je me rappelle la confluence de la Spree, les îlots boisés, la lumière de sel qui saupoudrait les hauts peupliers noirs et le flot boueux du canal que le sillage du navire mélangeait aux eaux cirées de la rivière.
Nous étions avec Maja chacune dans un fauteuil de toile, au soleil sur le pont, à l’arrière, à la poupe comme on doit dire, et nous regardions tout s’enfuir : le paysage s’élargissait comme si l’étrave du navire ouvrait grand la matière verte des feuillages.
Nous fêtions avec quelques mois de retard les dix ans de la refondation de l’Institut par Paul tout en rendant hommage au fondateur lui-même. Ou, plus précisément, nous célébrions les dix ans de “l’unification” de l’Institut, au printemps 1991, et les quarante ans de sa création en 1961. Mais il s’agissait avant tout d’une célébration des travaux de Paul. Je crois qu’il ne manquait personne
– parmi les historiques, ceux de l’Est, tous étaient là ; les nouveaux membres, les collègues de Berlin et d’ailleurs avaient presque tous répondu présent.
Quelques-uns, dont Linden Pawley, Robert Kant et quelques chercheurs français, venaient même de l’étranger. Ce congrès flottant s’intitulait Journées Paul Heudeber; deux séances par jour étaient prévues, théorie des nombres, topologie algébrique, et
une session d’histoire des mathématiques à laquelle je devais prendre part.
Le seul absent, c’était Paul lui-même.
Maja venait de fêter son quatre-vingt-troisième anniversaire.
Maja buvait des litres de thé.
Maja était gaie et triste et silencieuse et bavarde.
Nous savions tous qu’elle n’avait rien à faire là, à bord du Beethoven pour un colloque de mathématiques ; nous savions tous qu’elle y était indispensable.
Prof. Dr. Paul Heudeber
Elsa-Brändström-Str. 32
1100 Berlin Pankow
RDA
Maja Scharnhorst
Heussallee 33
5300 Bonn 1
Dimanche, 1er septembre 1968
Maja Maja Maja
Retirons le possessif : l’amour nu.
Il a grandi dans l’absence et la nuit : le manque de toi est une source. Un corps, un anneau – tu es sceau de toute chose, unique. Ton éloignement rapproche l’infini. Toi seule me permets de me dissimuler au temps, au mal, aux flux de la mélancolie.
Je me demande ce qu’il fut de ma jeunesse, quand j’entends ses cris.
Je me bouche les oreilles par de savants calculs.
Je dévale des surfaces que nul n’a jamais foulées. Je me rappelle septembre 1938. Le feu couvait dans le fer ; notre feu dans les fers. Nous nous tenions debout face aux ruines à venir.
Nous avons tenu, suspendus l’un à l’autre par la force du souvenir.
Comme nous tenons bon, aujourd’hui, dans la
peur et l’espoir face au monde devant nous.
Irina vient d’avoir dix-sept ans, à peine un battement de paupière pour une étoile.
J’ai hâte que vous reveniez par ici.
Je ferai des concessions ; je vous rendrai visite à l’Ouest.
J’ai lu ton beau texte, dans cet horrible journal, sur l’affaire de Prague.
Nos affrontements me manquent.
Je pars mardi pour Moscou, un Congrès.
Je me demande comment on pense ces temps dangereux, là-bas.
Moscou des tours épaisses et des camarades.
Écris-moi.
Dire que je t’embrasse est peu dire.
Paul
La plupart des voyageurs en train préfèrent être assis dans le sens de la marche.
Un historien est un voyageur qui choisit de ne pas s’asseoir dans le sens de la marche.
L’historien des sciences est un historien qui, assis dans le sens inverse de la marche, tourné vers l’arrière et contrairement à la plupart des historiens, ne regarde pas par la fenêtre.
L’historienne des mathématiques est une historienne des scie
Il a posé son arme et se débarrasse avec peine de ses galoches dont l’odeur (excréments, sueur moisie) ajoute encore à la fatigue. Les doigts sur les lacets effilochés sont des brandillons secs, légèrement brûlés par endroits ; les ongles ont la couleur des bottes, il faudra les gratter à la pointe du couteau pour en retirer la crasse, boue, sang séché, mais plus tard, il n’en a pas la force ; deux orteils, chair et terre, sortent de la
chaussette, ce sont de gros vers maculés qui rampent hors d’un tronc sombre, noueux à la cheville. Il se demande tout à coup, comme chaque matin, comme chaque soir, pourquoi ces godasses puent la merde, c’est inexplicable, tu as beau les rincer dans les flaques d’eau que tu croises, les frotter aux touffes herbeuses qui crissent, rien n’y fait, il n’y a pourtant pas tant de chiens ou de bêtes
sauvages, pas tant, dans ces hauteurs de cailloux saupoudrées de chênes verts, de pins et d’épineux où la pluie laisse une fine boue claire et un parfum de silex, pas de merde, et il lui serait facile de croire que c’est tout le pays qui remugle, depuis la mer, les
collines d’orangers puis d’oliviers jusqu’au fin fond des montagnes, de ces montagnes, voire lui-même, sa propre odeur, pas celle des chaussures, mais il ne peut s’y résoudre et balance les godillots contre le bord de la ravine qui le dissimule du sentier, un peu
plus haut dans la pente.
Il s’allonge sur le dos à même les graviers, soupire, le ciel est violacé, les lueurs du couchant éclairent par en dessous des nuages rapides, une toile, un écran pour un feu d’artifice. Le printemps est presque là et avec lui s’annoncent les pluies souvent torrentielles qui transforment les montagnes en bidons percés par des balles, dégorgeant
du moindre creux une source puissante, quand l’air sent le thym et les fleurs des fruitiers, flocons blancs répandus entre les murets par la violence de l’averse. Ce serait bien le diable qu’il se mette à pleuvoir maintenant. En même temps ça laverait les bottines. Les galoches, le treillis, les chaussettes, dont les deux paires qu’il possède sont tout aussi rigides, cartonnées, délabrées. La trahison commence par le corps, tu ne t’es pas lavé depuis quand ?
Quatre jours que tu marches près des crêtes pour éviter les villages, la dernière eau dont tu t’es aspergé sentait l’essence et laissait la peau grasse, tu es bien loin de la pureté, seul sous le ciel à lorgner les comètes.
La faim le force à se redresser et avaler sans plaisir trois biscuits militaires, les derniers, des plaques brunes et dures, sans doute un mélange de sciure et de colle de vieille jument ; il maudit un instant la guerre et les soldats, tu es encore l’un des leurs, tu portes toujours des armes, des munitions et des souvenirs de guerre, tu pourrais cacher le fusil et les cartouches dans un coin et devenir un mendiant, laisser le couteau
aussi, les mendiants n’ont pas de poignard,
les godillots à l’odeur de merde et aller pieds nus, la veste couleur de misère et aller torse nu, le repas achevé il boit le fond de sa gourde et joue à pisser le plus loin possible vers la vallée.
Il s’allonge à nouveau, cette fois tout contre la paroi, le bas du sac sous la tête ; il est invisible dans l’ombre, tant pis pour les bestioles (araignées rouges, scorpions minuscules, scolopendres aux dents aiguës
comme des remords) qui gambaderont sur son torse, glisseront sur son crâne presque rasé, se promèneront sur sa barbe aussi rêche qu’un roncier. Le fusil contre lui, la crosse sous l’épaule, le canon vers les
pieds. Enroulé dans le morceau de toile bitumée qui lui sert de couverture et de toit.
La montagne bruisse ; un peu de vent double les sommets, descend dans la combe et vibre entre les arbustes ; les cris des étoiles sont glaçants. Il n’y a plus de nuages, il ne pleuvra pas cette nuit.
Ange mon saint gardien, protecteur de mon âme et de mon corps, pardonne-moi tous les péchés commis en ce jour et délivre-moi des œuvres de l’ennemi, malgré la chaleur de la prière la nuit reste un fauve nourri d’angoisse, un fauve à l’haleine de sang, des villes aux ruines parcourues par des mères brandissant les cadavres mutilés de leurs enfants face à des hyènes débraillées qui les tortureront, ensuite, les laisseront nues, souillées, les mamelons arrachés à coups de dents sous les yeux de leurs frères violés à leur tour avec des matraques, l’effroi étendu sur le pays, la peste, la haine et la nuit, cette nuit qui vous
enveloppe toujours pour vous pousser à la lâcheté et la trahison. À la fuite et la désertion. Combien de temps va-t-il falloir marcher? La frontière est à quelques jours d’ici, au-delà des montagnes qui bientôt deviendront des collines à la terre rouge, plantées d’oliviers. Il sera difficile de se cacher. Beaucoup de villages, des villes, des paysans, des soldats, tu connais la région,
tu es chez toi ici, personne n’aidera un déserteur, tu atteindras demain la maison dans la montagne, la cabane, la masure, tu y prendras refuge quelque temps, la cabane te protégera par son enfance, tu y seras caressé par les souvenirs, parfois le sommeil vient par surprise comme la balle d’un tireur embusqué.
II
Il y a plus de vingt ans, le 11 septembre 2001, près de Potsdam sur la Havel, à bord de ce bateau de croisière, un petit paquebot fluvial baptisé du beau nom pompeux de Beethoven, l’été paraissait vaciller.
Les saules étaient toujours verts, les journées
encore chaudes mais une brume glaciale montait de la rivière avant l’aube et d’immenses nuages glissaient sur nous, depuis la lointaine mer Baltique.
Notre hôtel flottant avait quitté Köpenick à l’est de Berlin très tôt le matin, le lundi 10. Maja était toujours alerte, fringante. Elle montait sur le pont supérieur pour marcher, une promenade entre les averses, les transats et les jeux de pont. Les dômes
verts et la flèche dorée de la cathédrale de Berlin la captivèrent, de loin, à notre passage. Elle imaginait, disait-elle, tous ces petits anges dorés quitter leur prison de pierre pour s’envoler dans un nuage de feuilles d’acanthe soufflées par le soleil.
L’eau de la Spree fut tantôt d’un bleu sombre et mat, tantôt d’un vert rougeoyant. Les semaines précédentes, toute l’Allemagne avait été secouée d’orages dont les hoquets grossirent jusqu’à la Havel et la Spree d’habitude pourtant plutôt basses en cette fin d’été.
Nous naviguâmes au milieu des remous.
Je me rappelle la confluence de la Spree, les îlots boisés, la lumière de sel qui saupoudrait les hauts peupliers noirs et le flot boueux du canal que le sillage du navire mélangeait aux eaux cirées de la rivière.
Nous étions avec Maja chacune dans un fauteuil de toile, au soleil sur le pont, à l’arrière, à la poupe comme on doit dire, et nous regardions tout s’enfuir : le paysage s’élargissait comme si l’étrave du navire ouvrait grand la matière verte des feuillages.
Nous fêtions avec quelques mois de retard les dix ans de la refondation de l’Institut par Paul tout en rendant hommage au fondateur lui-même. Ou, plus précisément, nous célébrions les dix ans de “l’unification” de l’Institut, au printemps 1991, et les quarante ans de sa création en 1961. Mais il s’agissait avant tout d’une célébration des travaux de Paul. Je crois qu’il ne manquait personne
– parmi les historiques, ceux de l’Est, tous étaient là ; les nouveaux membres, les collègues de Berlin et d’ailleurs avaient presque tous répondu présent.
Quelques-uns, dont Linden Pawley, Robert Kant et quelques chercheurs français, venaient même de l’étranger. Ce congrès flottant s’intitulait Journées Paul Heudeber; deux séances par jour étaient prévues, théorie des nombres, topologie algébrique, et
une session d’histoire des mathématiques à laquelle je devais prendre part.
Le seul absent, c’était Paul lui-même.
Maja venait de fêter son quatre-vingt-troisième anniversaire.
Maja buvait des litres de thé.
Maja était gaie et triste et silencieuse et bavarde.
Nous savions tous qu’elle n’avait rien à faire là, à bord du Beethoven pour un colloque de mathématiques ; nous savions tous qu’elle y était indispensable.
Prof. Dr. Paul Heudeber
Elsa-Brändström-Str. 32
1100 Berlin Pankow
RDA
Maja Scharnhorst
Heussallee 33
5300 Bonn 1
Dimanche, 1er septembre 1968
Maja Maja Maja
Retirons le possessif : l’amour nu.
Il a grandi dans l’absence et la nuit : le manque de toi est une source. Un corps, un anneau – tu es sceau de toute chose, unique. Ton éloignement rapproche l’infini. Toi seule me permets de me dissimuler au temps, au mal, aux flux de la mélancolie.
Je me demande ce qu’il fut de ma jeunesse, quand j’entends ses cris.
Je me bouche les oreilles par de savants calculs.
Je dévale des surfaces que nul n’a jamais foulées. Je me rappelle septembre 1938. Le feu couvait dans le fer ; notre feu dans les fers. Nous nous tenions debout face aux ruines à venir.
Nous avons tenu, suspendus l’un à l’autre par la force du souvenir.
Comme nous tenons bon, aujourd’hui, dans la
peur et l’espoir face au monde devant nous.
Irina vient d’avoir dix-sept ans, à peine un battement de paupière pour une étoile.
J’ai hâte que vous reveniez par ici.
Je ferai des concessions ; je vous rendrai visite à l’Ouest.
J’ai lu ton beau texte, dans cet horrible journal, sur l’affaire de Prague.
Nos affrontements me manquent.
Je pars mardi pour Moscou, un Congrès.
Je me demande comment on pense ces temps dangereux, là-bas.
Moscou des tours épaisses et des camarades.
Écris-moi.
Dire que je t’embrasse est peu dire.
Paul
La plupart des voyageurs en train préfèrent être assis dans le sens de la marche.
Un historien est un voyageur qui choisit de ne pas s’asseoir dans le sens de la marche.
L’historien des sciences est un historien qui, assis dans le sens inverse de la marche, tourné vers l’arrière et contrairement à la plupart des historiens, ne regarde pas par la fenêtre.
L’historienne des mathématiques est une historienne des scie
Il continue à marcher,
Seigneur c’est bientôt le jour de la Passion,
tu as honte quand tu penses à Son Nom -le fusil contre toi tu traverses Sa nature,
toute chose chante Ses louanges et fleurit Sa gloire,
il traverse les buissons, écoute les ailes qui claquent les branches qui remuent.
Seigneur c’est bientôt le jour de la Passion,
tu as honte quand tu penses à Son Nom -le fusil contre toi tu traverses Sa nature,
toute chose chante Ses louanges et fleurit Sa gloire,
il traverse les buissons, écoute les ailes qui claquent les branches qui remuent.
Je supporterai en tout cas un mur entre vous et moi si c'est pour le socialisme. Je reconnais que c'est une contradiction, mais les contradictions, lorsqu'elles ne sont pas de mauvaise foi, sont les parties visibles de grands théorèmes qu'on n'a pas encore formulés.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Mathias Enard (17)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (2 - littérature francophone )
Françoise Sagan : "Le miroir ***"
brisé
fendu
égaré
perdu
20 questions
3709 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, littérature française
, littérature francophoneCréer un quiz sur ce livre3709 lecteurs ont répondu