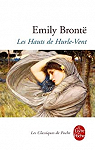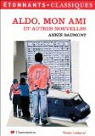Yves Guyot/5
2 notes
Résumé :
Publié en 1882 et ayant servi de source d'inspiration pour l'oeuvre de Zola, Germinal.
Ci-dessous un lien pour une étude comparative de ces deux oeuvres :
- https://www.institutcoppet.org/les-inspirations-liberales-demile-zola-dans-germinal/
- à télécharger sur le site Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5445490d.texteImage
-
Plan du roman :
-
Livre premier - Sous terre
-
I - La fosse du ... >Voir plus
Ci-dessous un lien pour une étude comparative de ces deux oeuvres :
- https://www.institutcoppet.org/les-inspirations-liberales-demile-zola-dans-germinal/
- à télécharger sur le site Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5445490d.texteImage
-
Plan du roman :
-
Livre premier - Sous terre
-
I - La fosse du ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La famille Pichot : scènes de l'enfer socialVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (2)
Ajouter une critique
« Carboville est une des cités disséminées dans le grand bassin minéral du centre de la France, où l'âpre et intelligent travail de l'homme produit la matière organique de l'industrie moderne : le fer ! et d'où il en extrait le véritable aliment : la houille ! »
« Partout la lutte acharnée de l'homme contre la nature a gravé sa sombre empreinte. L'eau est noire. Les maisons sont noires ; et au milieu des noirs visages, on ne voit étinceler que la blancheur des dents et les éclairs des yeux. »
Les fourmis descendent sous terre chaque jour sans un mot, dociles et creusant sans relâche… Ce rude labeur des mineurs est particulièrement périlleux. Chaque catastrophe minière plonge dans la désolation et le deuil la population ouvrière mais n'engendre qu'une outrancière indifférence du propriétaire de la mine ou de ses gestionnaires :
« L'accident du Puits du diable était prévu depuis plus d'un mois, annoncé, constaté par tous les hommes ayant l'habitude de la mine. Eh bien ! Non seulement la compagnie qui l'a provoqué par sa négligence n'a pas reconnu sa responsabilité, mais elle a encore arbitrairement réglé les pensions. »
Tandis que de braves employés creusent en une galerie voisine afin de rejoindre le « Puits du diable » un lieu de la mine frappé par un éboulement provoqué par un coup de grisou et où étaient ensevelis une centaine de miniers, M de Torgnac, directeur de la mine, s'insurge qu'on ait agit sans attendre ses ordres.
Il méprise ce zèle inutile et s'exprime sèchement, ôtant son cigare de la bouche : « mais il faudrait un mois ! (Pour rejoindre les rescapés) Vous n'êtes qu'un rêveur… C'est là un défaut dont vous feriez bien de vous corriger, si vous voulez faire votre chemin »
« Mais vous ne connaissez pas le dévouement des mineurs quand il s'agit de sauver leurs compagnons… »
« Des phrases ! Reprit M de Torgnac en haussant les épaules. Il n'y a rien à faire »
De ce courage outrepassant les ordres et persévérant même lorsque tout semble perdu, le miracle eut lieu et quelques mineurs ont été sauvés. Craignant pour son amour-propre, M de Torgnac s'accapare immédiatement les mérites : « Ah ! Je l'avais bien dit qu'il fallait avoir de l'espoir et tenter l'impossible ! »
Jérôme Pichot, l'un des héros de la catastrophe est reconnu par M. Onésime Macreux, propriétaire de la mine, non car il a contribué aux secours mais car sa fille, Fanny, fut adoptée par lui à l'âge de 6 ans afin d'en faire une maîtresse bien éduquée et serviable bien plus tard à l'âge adulte :
« - Tiens, c'est toi Jérôme Pichot ?
- Oui, répondit Jérôme Pichot, en baissant la tête.
- D'où viens-tu ?
- de chercher mon fils
- Il est au nombre des victimes ?
- Oui, la mine me l'a pris
- Que veux-tu, mon pauvre Pichot, le grisou est traître !
- C'est de sa faute ! Dit Jérôme Pichot, en montrant M. de Torgnac
- Qu'est-ce que tu veux dire ?
- Il a laissé s'amasser la poussière de houille, ça a pris feu.
- Voilà les contes que vous inventez (…) Vous aimez mieux mettre l'accident sur le compte de votre ingénieur que sur celui de votre imprudence. (…) »
Puis le raille de la façon la plus humiliante qui soit, en lui rappelant qu'il possède sa belle et jeune fille :
« - Tu ne demandes pas de nouvelles de ta fille (Fanny) » reprit M. Onésime Macreux en riant.
- Je sais bien qu'il est trop tard, dit Jérôme Pichot, d'une voix concentrée
- Tu es un niais, dit Onésime Macreux en donnant une grande tape de sa large main sur l'épaule de Jérôme Pichot, comme s'il avait voulu faire pénétrer en lui, de vive force, au besoin, ses excellentes raisons.
- Ne parlons pas de ça !
- Je suis sûr que tu es dans la misère, que tu meurs de faim avec tes six enfants, et puis tu aimes bien à lever le coude (…) Est-ce que tu crois que ta fille n'est pas plus heureuse que si elle était restée à travailler ici du matin au soir ? (…) Tu n'as pas envie de voir ta fille ? » (…) Ne voulant la montrer que pour l'écoeurer davantage…
Et concluant, en une hilarité méprisante : « Ces imbéciles, ça se plaint toujours, et si vous voulez faire leur bonheur, ça refuse. »
Et il haussa les épaules, en riant de son grand rire. Jérôme Pichot resta quelques instants immobile, regardant les deux ombres noires de M. de Torgnac et de M. Macreux qui disparaissaient en riant »
Abasourdi par les évènements, Jérôme Pichot s'assomme d'alcool et rentre en lourd ivrogne en son domicile, parle brutalement à voix haute sans se soucier de ses enfants qui sanglotent en l'écoutant :
« Pourquoi pleures-tu ?
Oh ! François !… François ! François ! » (son fils décédé dans la mine)
Et puis, au bout de quelques instants, il ajouta :
Eh bien ! Il est mort, tant mieux !… Au moins il ne souffrira pas comme Pierre, il ne souffrira pas comme nous autres… Est-ce qu'il ne faut pas bien mourir un jour ou l'autre ? Dans notre misère, à nous, depuis la naissance jusqu'à la mort, tout le bénéfice est pour ceux qui meurent. C'est autant de gagné sur la souffrance. »
Aucun éclaircissement n'émane des journaux, traitant des faits sans rechercher les causes du drame. Ils louangeront au contraire la dévotion de l'épouse du propriétaire et de ses amies, qui se sont empressées de s'afficher aux côtés des rescapés à l'hôpital : « Ces femmes dévouées affrontant les mauvais temps pour aller porter des secours aux malheureuses victimes de cet affreux accident (…) Ce ne sont point les femmes de ces mineurs qui donneraient un si généreux exemple, si Mme Macreux, Menèfle et de Nicarète avaient été culbutées au bois par leurs chevaux emportés. »
L'immense mascarade se met en oeuvre, on ne plaint à peine plus les mineurs tant l'on admire le discours du propriétaire tenant à démontrer toute sa bonté magnanime devant une assemblée de mineurs, forgerons et de journalistes, ayant même l'outrecuidance de remettre devant des yeux ébahis, des insignes et médailles à M. de Torgnac, l'exécrable directeur et ingénieur en chef de la mine.
La religion complète parfaitement l'ordre et la soumission : « il faut de la religion pour le peuple » devise du propriétaire.
Au lieu de paroles réconfortantes, les mineurs sont accablés de propos culpabilisants : « il (le prêtre) déclara que ce cataclysme était une punition du ciel, punition de leurs pensées rebelles et impies, punition de leurs fautes, punition de l'oubli de leurs devoirs religieux, un avertissement souverain de la colère du ciel contre eux, prête à se manifester d'une manière plus terrible encore, s'ils ne savaient pas mériter sa clémence »
Et quel navrant retour à la morne et dure réalité : non seulement les pensions attribuées aux rescapés et accidentés de la catastrophe sont dérisoires, les maladies sont amoindries par un médecin corrompu mais il faut encore passer par un épicier obligatoire pour s'alimenter : « Payer plus cher et avoir plus mauvais qu'ailleurs » et pour lequel nombre de petits crédits sont cumulés, les plus endettés étant chassés et humiliés : « Eh bien ! Avez-vous de l'argent, vous ? La malheureuse essuya ses yeux. « Non ? Eh bien ! Rien pour vous. Allons ! Débarrassez le plancher et vivement. » « Mais mes enfants ? Essaya de dire la malheureuse. « Allons ! Pas de tout ça ! Est-ce que nous sommes chargés de nourrir les enfants des soulards ? Ton mari était encore saoul hier ! Décampe, si tu ne veux pas que je t'y aide. »
L'une des clientes s'est laissée abuser par l'épicier pour quelques facilités de crédit mais eut le malheur prévisible de tomber enceinte. L'épicier lui demande impunément, devant ses clients, quand est-ce que cette fille perdue compte se débarrasser de ce gênant être à venir ? L'intéressée s'emporte, aucune autre cliente ne prend sa défense de crainte de se voir refuser à son tour des crédits ou rabais et voici comment se poursuit le drame :
« Il me met enceinte. Non seulement il m'abandonne, mais il m'insulte. Oh ! alors je lui dis toutes ses vérités. Il veut m'assommer. Je prends un litre d'eau-de-vie pour me défendre. Il m'accuse de l'avoir volé. Il n'ose pas cependant me poursuivre comme voleuse. Il y a un moyen bien simple. Je viens à Lyon (Car l'épicier l'avait obligé à s'y rendre : « Va à Lyon. Il y a là des maisons qui prennent des jeunes filles pour pensionnaires avec certificat de la police ») Il me fait arrêter. Qu'ai-je fait ? — Vous êtes enceinte ? Oui. — Avez-vous des moyens d'existence ? —Non. — C'est bien ! En prison. — C'est donc un crime de ne pas avoir des rentes ? — Allons ! assez discuté ! On me met en prison ; on m'y fait rester huit jours ; puis la police revient, me prend, me dit : — Vous êtes mineure ! Vous n'êtes pas dans vos meubles. — Non ! — C'est bon ! Nous allons vous inscrire sur le registre des prostituées et vous mettre dans une maison publique. — Mais je ne veux pas, moi ! — Eh bien ! Retournez chez vous ! — Mais je ne veux pas ! — Alors taisez vous. »
Des préliminaires à la grève ressortent de ce cumul entre le sinistre quotidien et la catastrophe minière. Les revendications sont insignifiantes : il s'agit principalement de laisser le plein contrôle aux employés d'un fonds alimenté par leurs salaires et destiné, en autres, à verser des pensions en cas d'accidents de travail. M. Onésime Macreux rejette tout fermement avec son habituel sarcasme, puis, capricieusement, accepte de faire voter les employés de sa mine, pensant que ce referendum populaire se transformerait en un vote d'approbation en sa faveur et qui écraserait toutes demandes des délégués. Mais il s'est surestimé, les mineurs ont voté pour la reprise de la caisse et le propriétaire persiste, refuse que les ouvriers aient entièrement la libre disposition sur ce fonds car il en détourne habituellement une partie pour subventionner le clergé local, lequel en contrepartie, prêche la résignation muette aux mineurs à leur misérable sort.
Une douce et paisible grève commence et n'inquiète nullement le propriétaire. Il prépare et soigne, depuis son fastueux salon parisien, en compagnie d'un journaliste, son image publique :
« - J'ai remis en place les prétentions des ouvriers. Demain tous les lecteurs de Lorettes-Journal connaîtront leur ingratitude »
- Je vous remercie -
- J'ai dit : "M. de Torgnac, leur sauveur, un homme auquel on devrait élever une statue (…) Un homme qui porte encore les traces des blessures qu'il a reçues en allant porter secours… "
- Diable ! Diable ! Dit M. de Torgnac, c'est un peu exagéré — Comment ! Vous êtes mauvais juge en pareille matière — Oui, mais je n'ai pas été blessé — Vous eussiez pu l'être — Sans doute — Eh bien ! C'est la même chose. J'ai montré toute l'insanité des ouvriers… J'ai montré que leurs grèves ruinaient la France… J'ai dit que les forges et les mines de Carboville perdaient plus d'un million par jour.
- Vous avez eu tort (rétorque un conseiller économique du propriétaire qui n'aime pas l'exagération sur la perte de millions, information fausse et qui exciterait au contraire la frénésie des grévistes)
- Ah ! C'est bien égal au patron ! Pourvu que je tape sur les ouvriers et que j'amuse ses lecteurs, c'est tout ce qu'il lui faut… Eh bien ! Tant mieux. Plus ça flambe, mieux ça vaut (…) Eh ! Parbleu, plus il y a d'accidents, de malheurs, d'inondations, d'incendies, de grèves ; plus la pauvre société a de plaies et de bosses, plus il y a de lignes, plus les reporters gagnent, plus les journaux se vendent, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, aux bureaux de rédaction de Lorettes-Journal. »
Avec la bénédiction de l'opinion publique, il semble tout à fait approprié qu'un général de l'armée intervienne brièvement pour « maintenir l'ordre » en un sens très extensif, signifiant : « Je lui ai alors demandé ce qu'il entendait par ordre (un meneur s'adressant au général) Il m'a répondu que, pour lui, l'ordre existait tant qu'il ne nous verrait pas et nous entendrait pas ».
On recherche et disperse tout regroupement en lieu clos, on enfonce les portes de maisons, emprisonne arbitrairement les meneurs.
Un affrontement idéologique divise les mineurs, les uns veulent négocier patiemment sans violence, les autres ne veulent communiquer que par la force :
« Ce n'est pas tout ça, citoyens, dit-il, en prenant la place de Pierre Ringard. Vous voyez bien que vous perdez votre temps avec toutes ces réclamations. le citoyen Ringard vient de parler de la loi ; mais, est-ce qu'il y a une loi pour nous ? Que nous soyons en dedans ou au dehors d'elle, c'est toujours la même chose ; nous sommes toujours sûrs d'être condamnés. Est-ce que c'est dans la loi que M. Onésime Macreux ait à sa disposition toute une armée ? Il a dit au ministre : envoyez-moi donc une armée, comme je te dirais : donne-moi une pipe de tabac. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que M. Onésime Macreux n'est pas de ceux qui font les lois ? Il en fera une exprès pour lui, si ça lui convient. Qu'avons nous à faire, sinon à répondre à la force par la force !
- Bravo ! bravo… !
- Ce qu'il faut, c'est l'abolition des compagnies, des actionnaires, des patrons. La terre au laboureur, l'outil à l'ouvrier, la mine au mineur.
- de l'action ! Mais une action sans but n'est que de la folie… C'est l'action de la machine, parce qu'une force étrangère la pousse. Avant d'agir, l'homme doit savoir ce qu'il fera.
- Il a vu le général, il s'est entendu avec lui.
- Traître ! Vendu !…
- Sauvez-vous - voici les soldats ! (…) »
Les arrestations arbitraires enflamment l'impatience des grévistes, un nouveau meneur anarchiste est substitué et tâche de rallier la cause de Jérôme Pichot, ce colosse, ce géant qui représente à lui seul l'âme héroïque de toute la population minière, afin de s'en servir de bras armé, en provoquant malignement son amour-propre : « Torgnac te doit ton fils - Eh bien ! Si tu ne le venges pas, moi je vais te dire : tu es un lâche ! Jérôme, tu affliges tes amis. Ils disent : Jérôme se déshonore (…) »
Il souffle la braise partout où il peut, fait vivre les flammes et laisse s'envoler les cendres en contemplant le spectacle en retrait d'un rire sardonique. le meneur est corrompu à cette fin par le direction : favoriser l'anarchie, le chaos pour justifier de lourdes représailles derrière réduisant au silence toutes revendications.
Les bestialités commises ne sont pas non plus entièrement excusables par cette manipulation. Il y a d'atroces lâchetés de sang et de chasse à l'homme : l'épicier est tué par un groupe de femmes, dont l'une brandit ses yeux crevés comme étendard, M. de Torgnac est encerclé, torturé, humilié, prié de se mettre à genoux… Jérôme Pichot le sauve et éparpille la foule car il ne veut pas : « qu'on dise que le peuple est aussi lâche que lui… »
Mais il ne fallait pas attendre la moindre reconnaissance de ce lâche : Jérôme Pichot sera emprisonné en tant que principal instigateur de cette foule haineuse qu'il a voulu tempéré en vain sans que M. de Torgnac n'évoque son acte héroïque qu'il renie entièrement.
La justice, ce dernier espoir de rétablir la vérité, est tout aussi dénaturée que les autres institutions : tout depuis l'interrogatoire à la cour d'assises est marqué d'une grossière et frappante partialité. Tout se déroule en une exécution brutale, vive et rapide. On déforme les propos à l'interrogatoire, on coupe la parole des accusés… Les avocats à la défense ne plaident que de timides circonstances atténuantes et réfutent la vérité de crainte d'attirer les châtiments du propriétaire et du gouvernement de Napoléon III qu'il représente indirectement.
Tout est perdu, on festoie l'écrasante victoire en portant un toast à l'empereur : « Vive l'empereur ! » tel est le nom du dernier chapitre.
Tout au long du roman se trouve des chapitres entiers consacrés à l'opulent et fastueux train de vie du propriétaire et l'on suit notamment la rébellion de Fanny, la fille adoptée et arrachée à la famille de Jérôme Pichot par M. Onésime Macreux.
Rongée d'inquiétude et de remords à la suite de la catastrophe minière, elle part à la rencontre de sa famille qu'elle n'avait plus vu depuis 10 ans mais son père, Jérôme Pichot, la repousse brutalement comme si elle était porteuse de la peste, lui reproche sa trahison d'une façon toute irrationnelle car elle avait 6 ans lorsqu'elle fut adoptée mais qu'importe, il est écoeuré de la luxueuse vie qu'elle mène.
En errant désespérément en dehors de la mine, sa mère qui la reconnait, pousse un cri, lui tend les bras mais les autres femmes crient vengeance : « Hors d'ici l'infâme ! Chassons-là ! — Elle ose venir ici ! — Ça s'engraisse de notre sueur — Ça se goberge avec ceux qui tuent et emprisonnent nos hommes ! »
Sa mère est obligée, elle aussi, de la renier :
« La Femme Pichot retomba agenouillée avec cet air de profonde résignation dont la misère.
Mais alors les femmes, se grisant de colère, s'enivrant de leurs propres menaces, en proie à l'effrayante obsession que produisent la douleur et l'impuissance de la vengeance contre celui qui l'a produite ; cherchant un bouc émissaire qui trompât leur fureur ; s'inquiétant peu de l'objet de leur haine pour ne songer qu'à l'assouvir ; trouvant dans Fanny le souvenir de la flétrissure que pouvaient imprimer à leurs filles la toute-puissance de M. Onésime Macreux ; voyant en elle, avec leurs sauvages préjugés catholiques sur la morale, une sorte d'emblème, d'image vivante du déshonneur d'une femme de leur plèbe ; y mêlant ce sentiment d'envie qui ferme au fond de tout coeur de femme contre une femme plus jeune, plus belle, mieux vêtue qu'elles ; la regardant comme la complice de M. Macreux dans l'oeuvre implacable dont elles pleuraient en ce moment-là même les victimes ; la considérant par une sorte d'étrange rapprochement hyperbolique, comme une partie de lui-même ; elles ne se contentèrent plus seulement de l'ordre d'expulsion qu'elles avaient formulé tout d'abord, et leurs cris de menace se transformèrent en un hurlement d'implacable vengeance (…) A mort ! A mort ! »
Fanny parvient à se réfugier à temps au château du propriétaire et se fait sermonner, menacer, abandonnée de tous côtés :
« Il rugissait de colère de voir ainsi un moucheron, un petit insecte assez gracieux qu'il aimait comme un petit meuble d'un usage agréable, refuser absolument de remplir les fonctions pour lesquelles il était fait, et fuir, et se dérober à lui sans qu'il pût même avoir la compensation de le briser.
Je t'ai fait élever depuis l'âge de cinq ou six ans, comme une demoiselle, disait ta mère.
Oui, pour faire de moi votre maîtresse.
Précisément. Or, j'ai eu de la patience, j'ai attendu que tu fusses bien formée. Tu as seize ans, et voilà cinq ou six mois seulement que tu commences à remplir le but que je m'étais proposé. Comprends-tu maintenant que tu as un capital à amortir et que six mois ne suffisent pas pour cela ? »
Il l'effraie encore en la menaçant de l'expédier en un « bureau des moeurs » séquestrant les filles perdues.
C'est finalement à l'issue d'une discussion avec une haute courtisane expérimentée que Fanny acceptera son sort : « Moi, je me prostituerais pour le plaisir de me prostituer ! En vérité ! C'est la plus grande sensation d'orgueil qu'une femme puisse goûter ! Mais, triple niais, tu m'adores et tu m'achètes en mettant ta fortune à mes pieds. C'est bien, tu as acheté ton esclavage. Tu te ruine pour être valet. Oh ! Tu me nommes bien : ta maîtresse ! Je le suis comme jamais maître n'a possédé esclave ! Je suis la maîtresse de chacune de tes sensations, de tes idées, de tes volontés ; je tiens ta vie entre mes mains, et, si je le veux, je la jetterai dans l'infamie, je la jetterai dans le déshonneur, je la jetterai dans la mort ! Il m'achète et c'est moi qui le possède ! »
(...)
(Suite en commentaire - dépassement du nombre de caractères)
« Partout la lutte acharnée de l'homme contre la nature a gravé sa sombre empreinte. L'eau est noire. Les maisons sont noires ; et au milieu des noirs visages, on ne voit étinceler que la blancheur des dents et les éclairs des yeux. »
Les fourmis descendent sous terre chaque jour sans un mot, dociles et creusant sans relâche… Ce rude labeur des mineurs est particulièrement périlleux. Chaque catastrophe minière plonge dans la désolation et le deuil la population ouvrière mais n'engendre qu'une outrancière indifférence du propriétaire de la mine ou de ses gestionnaires :
« L'accident du Puits du diable était prévu depuis plus d'un mois, annoncé, constaté par tous les hommes ayant l'habitude de la mine. Eh bien ! Non seulement la compagnie qui l'a provoqué par sa négligence n'a pas reconnu sa responsabilité, mais elle a encore arbitrairement réglé les pensions. »
Tandis que de braves employés creusent en une galerie voisine afin de rejoindre le « Puits du diable » un lieu de la mine frappé par un éboulement provoqué par un coup de grisou et où étaient ensevelis une centaine de miniers, M de Torgnac, directeur de la mine, s'insurge qu'on ait agit sans attendre ses ordres.
Il méprise ce zèle inutile et s'exprime sèchement, ôtant son cigare de la bouche : « mais il faudrait un mois ! (Pour rejoindre les rescapés) Vous n'êtes qu'un rêveur… C'est là un défaut dont vous feriez bien de vous corriger, si vous voulez faire votre chemin »
« Mais vous ne connaissez pas le dévouement des mineurs quand il s'agit de sauver leurs compagnons… »
« Des phrases ! Reprit M de Torgnac en haussant les épaules. Il n'y a rien à faire »
De ce courage outrepassant les ordres et persévérant même lorsque tout semble perdu, le miracle eut lieu et quelques mineurs ont été sauvés. Craignant pour son amour-propre, M de Torgnac s'accapare immédiatement les mérites : « Ah ! Je l'avais bien dit qu'il fallait avoir de l'espoir et tenter l'impossible ! »
Jérôme Pichot, l'un des héros de la catastrophe est reconnu par M. Onésime Macreux, propriétaire de la mine, non car il a contribué aux secours mais car sa fille, Fanny, fut adoptée par lui à l'âge de 6 ans afin d'en faire une maîtresse bien éduquée et serviable bien plus tard à l'âge adulte :
« - Tiens, c'est toi Jérôme Pichot ?
- Oui, répondit Jérôme Pichot, en baissant la tête.
- D'où viens-tu ?
- de chercher mon fils
- Il est au nombre des victimes ?
- Oui, la mine me l'a pris
- Que veux-tu, mon pauvre Pichot, le grisou est traître !
- C'est de sa faute ! Dit Jérôme Pichot, en montrant M. de Torgnac
- Qu'est-ce que tu veux dire ?
- Il a laissé s'amasser la poussière de houille, ça a pris feu.
- Voilà les contes que vous inventez (…) Vous aimez mieux mettre l'accident sur le compte de votre ingénieur que sur celui de votre imprudence. (…) »
Puis le raille de la façon la plus humiliante qui soit, en lui rappelant qu'il possède sa belle et jeune fille :
« - Tu ne demandes pas de nouvelles de ta fille (Fanny) » reprit M. Onésime Macreux en riant.
- Je sais bien qu'il est trop tard, dit Jérôme Pichot, d'une voix concentrée
- Tu es un niais, dit Onésime Macreux en donnant une grande tape de sa large main sur l'épaule de Jérôme Pichot, comme s'il avait voulu faire pénétrer en lui, de vive force, au besoin, ses excellentes raisons.
- Ne parlons pas de ça !
- Je suis sûr que tu es dans la misère, que tu meurs de faim avec tes six enfants, et puis tu aimes bien à lever le coude (…) Est-ce que tu crois que ta fille n'est pas plus heureuse que si elle était restée à travailler ici du matin au soir ? (…) Tu n'as pas envie de voir ta fille ? » (…) Ne voulant la montrer que pour l'écoeurer davantage…
Et concluant, en une hilarité méprisante : « Ces imbéciles, ça se plaint toujours, et si vous voulez faire leur bonheur, ça refuse. »
Et il haussa les épaules, en riant de son grand rire. Jérôme Pichot resta quelques instants immobile, regardant les deux ombres noires de M. de Torgnac et de M. Macreux qui disparaissaient en riant »
Abasourdi par les évènements, Jérôme Pichot s'assomme d'alcool et rentre en lourd ivrogne en son domicile, parle brutalement à voix haute sans se soucier de ses enfants qui sanglotent en l'écoutant :
« Pourquoi pleures-tu ?
Oh ! François !… François ! François ! » (son fils décédé dans la mine)
Et puis, au bout de quelques instants, il ajouta :
Eh bien ! Il est mort, tant mieux !… Au moins il ne souffrira pas comme Pierre, il ne souffrira pas comme nous autres… Est-ce qu'il ne faut pas bien mourir un jour ou l'autre ? Dans notre misère, à nous, depuis la naissance jusqu'à la mort, tout le bénéfice est pour ceux qui meurent. C'est autant de gagné sur la souffrance. »
Aucun éclaircissement n'émane des journaux, traitant des faits sans rechercher les causes du drame. Ils louangeront au contraire la dévotion de l'épouse du propriétaire et de ses amies, qui se sont empressées de s'afficher aux côtés des rescapés à l'hôpital : « Ces femmes dévouées affrontant les mauvais temps pour aller porter des secours aux malheureuses victimes de cet affreux accident (…) Ce ne sont point les femmes de ces mineurs qui donneraient un si généreux exemple, si Mme Macreux, Menèfle et de Nicarète avaient été culbutées au bois par leurs chevaux emportés. »
L'immense mascarade se met en oeuvre, on ne plaint à peine plus les mineurs tant l'on admire le discours du propriétaire tenant à démontrer toute sa bonté magnanime devant une assemblée de mineurs, forgerons et de journalistes, ayant même l'outrecuidance de remettre devant des yeux ébahis, des insignes et médailles à M. de Torgnac, l'exécrable directeur et ingénieur en chef de la mine.
La religion complète parfaitement l'ordre et la soumission : « il faut de la religion pour le peuple » devise du propriétaire.
Au lieu de paroles réconfortantes, les mineurs sont accablés de propos culpabilisants : « il (le prêtre) déclara que ce cataclysme était une punition du ciel, punition de leurs pensées rebelles et impies, punition de leurs fautes, punition de l'oubli de leurs devoirs religieux, un avertissement souverain de la colère du ciel contre eux, prête à se manifester d'une manière plus terrible encore, s'ils ne savaient pas mériter sa clémence »
Et quel navrant retour à la morne et dure réalité : non seulement les pensions attribuées aux rescapés et accidentés de la catastrophe sont dérisoires, les maladies sont amoindries par un médecin corrompu mais il faut encore passer par un épicier obligatoire pour s'alimenter : « Payer plus cher et avoir plus mauvais qu'ailleurs » et pour lequel nombre de petits crédits sont cumulés, les plus endettés étant chassés et humiliés : « Eh bien ! Avez-vous de l'argent, vous ? La malheureuse essuya ses yeux. « Non ? Eh bien ! Rien pour vous. Allons ! Débarrassez le plancher et vivement. » « Mais mes enfants ? Essaya de dire la malheureuse. « Allons ! Pas de tout ça ! Est-ce que nous sommes chargés de nourrir les enfants des soulards ? Ton mari était encore saoul hier ! Décampe, si tu ne veux pas que je t'y aide. »
L'une des clientes s'est laissée abuser par l'épicier pour quelques facilités de crédit mais eut le malheur prévisible de tomber enceinte. L'épicier lui demande impunément, devant ses clients, quand est-ce que cette fille perdue compte se débarrasser de ce gênant être à venir ? L'intéressée s'emporte, aucune autre cliente ne prend sa défense de crainte de se voir refuser à son tour des crédits ou rabais et voici comment se poursuit le drame :
« Il me met enceinte. Non seulement il m'abandonne, mais il m'insulte. Oh ! alors je lui dis toutes ses vérités. Il veut m'assommer. Je prends un litre d'eau-de-vie pour me défendre. Il m'accuse de l'avoir volé. Il n'ose pas cependant me poursuivre comme voleuse. Il y a un moyen bien simple. Je viens à Lyon (Car l'épicier l'avait obligé à s'y rendre : « Va à Lyon. Il y a là des maisons qui prennent des jeunes filles pour pensionnaires avec certificat de la police ») Il me fait arrêter. Qu'ai-je fait ? — Vous êtes enceinte ? Oui. — Avez-vous des moyens d'existence ? —Non. — C'est bien ! En prison. — C'est donc un crime de ne pas avoir des rentes ? — Allons ! assez discuté ! On me met en prison ; on m'y fait rester huit jours ; puis la police revient, me prend, me dit : — Vous êtes mineure ! Vous n'êtes pas dans vos meubles. — Non ! — C'est bon ! Nous allons vous inscrire sur le registre des prostituées et vous mettre dans une maison publique. — Mais je ne veux pas, moi ! — Eh bien ! Retournez chez vous ! — Mais je ne veux pas ! — Alors taisez vous. »
Des préliminaires à la grève ressortent de ce cumul entre le sinistre quotidien et la catastrophe minière. Les revendications sont insignifiantes : il s'agit principalement de laisser le plein contrôle aux employés d'un fonds alimenté par leurs salaires et destiné, en autres, à verser des pensions en cas d'accidents de travail. M. Onésime Macreux rejette tout fermement avec son habituel sarcasme, puis, capricieusement, accepte de faire voter les employés de sa mine, pensant que ce referendum populaire se transformerait en un vote d'approbation en sa faveur et qui écraserait toutes demandes des délégués. Mais il s'est surestimé, les mineurs ont voté pour la reprise de la caisse et le propriétaire persiste, refuse que les ouvriers aient entièrement la libre disposition sur ce fonds car il en détourne habituellement une partie pour subventionner le clergé local, lequel en contrepartie, prêche la résignation muette aux mineurs à leur misérable sort.
Une douce et paisible grève commence et n'inquiète nullement le propriétaire. Il prépare et soigne, depuis son fastueux salon parisien, en compagnie d'un journaliste, son image publique :
« - J'ai remis en place les prétentions des ouvriers. Demain tous les lecteurs de Lorettes-Journal connaîtront leur ingratitude »
- Je vous remercie -
- J'ai dit : "M. de Torgnac, leur sauveur, un homme auquel on devrait élever une statue (…) Un homme qui porte encore les traces des blessures qu'il a reçues en allant porter secours… "
- Diable ! Diable ! Dit M. de Torgnac, c'est un peu exagéré — Comment ! Vous êtes mauvais juge en pareille matière — Oui, mais je n'ai pas été blessé — Vous eussiez pu l'être — Sans doute — Eh bien ! C'est la même chose. J'ai montré toute l'insanité des ouvriers… J'ai montré que leurs grèves ruinaient la France… J'ai dit que les forges et les mines de Carboville perdaient plus d'un million par jour.
- Vous avez eu tort (rétorque un conseiller économique du propriétaire qui n'aime pas l'exagération sur la perte de millions, information fausse et qui exciterait au contraire la frénésie des grévistes)
- Ah ! C'est bien égal au patron ! Pourvu que je tape sur les ouvriers et que j'amuse ses lecteurs, c'est tout ce qu'il lui faut… Eh bien ! Tant mieux. Plus ça flambe, mieux ça vaut (…) Eh ! Parbleu, plus il y a d'accidents, de malheurs, d'inondations, d'incendies, de grèves ; plus la pauvre société a de plaies et de bosses, plus il y a de lignes, plus les reporters gagnent, plus les journaux se vendent, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, aux bureaux de rédaction de Lorettes-Journal. »
Avec la bénédiction de l'opinion publique, il semble tout à fait approprié qu'un général de l'armée intervienne brièvement pour « maintenir l'ordre » en un sens très extensif, signifiant : « Je lui ai alors demandé ce qu'il entendait par ordre (un meneur s'adressant au général) Il m'a répondu que, pour lui, l'ordre existait tant qu'il ne nous verrait pas et nous entendrait pas ».
On recherche et disperse tout regroupement en lieu clos, on enfonce les portes de maisons, emprisonne arbitrairement les meneurs.
Un affrontement idéologique divise les mineurs, les uns veulent négocier patiemment sans violence, les autres ne veulent communiquer que par la force :
« Ce n'est pas tout ça, citoyens, dit-il, en prenant la place de Pierre Ringard. Vous voyez bien que vous perdez votre temps avec toutes ces réclamations. le citoyen Ringard vient de parler de la loi ; mais, est-ce qu'il y a une loi pour nous ? Que nous soyons en dedans ou au dehors d'elle, c'est toujours la même chose ; nous sommes toujours sûrs d'être condamnés. Est-ce que c'est dans la loi que M. Onésime Macreux ait à sa disposition toute une armée ? Il a dit au ministre : envoyez-moi donc une armée, comme je te dirais : donne-moi une pipe de tabac. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que M. Onésime Macreux n'est pas de ceux qui font les lois ? Il en fera une exprès pour lui, si ça lui convient. Qu'avons nous à faire, sinon à répondre à la force par la force !
- Bravo ! bravo… !
- Ce qu'il faut, c'est l'abolition des compagnies, des actionnaires, des patrons. La terre au laboureur, l'outil à l'ouvrier, la mine au mineur.
- de l'action ! Mais une action sans but n'est que de la folie… C'est l'action de la machine, parce qu'une force étrangère la pousse. Avant d'agir, l'homme doit savoir ce qu'il fera.
- Il a vu le général, il s'est entendu avec lui.
- Traître ! Vendu !…
- Sauvez-vous - voici les soldats ! (…) »
Les arrestations arbitraires enflamment l'impatience des grévistes, un nouveau meneur anarchiste est substitué et tâche de rallier la cause de Jérôme Pichot, ce colosse, ce géant qui représente à lui seul l'âme héroïque de toute la population minière, afin de s'en servir de bras armé, en provoquant malignement son amour-propre : « Torgnac te doit ton fils - Eh bien ! Si tu ne le venges pas, moi je vais te dire : tu es un lâche ! Jérôme, tu affliges tes amis. Ils disent : Jérôme se déshonore (…) »
Il souffle la braise partout où il peut, fait vivre les flammes et laisse s'envoler les cendres en contemplant le spectacle en retrait d'un rire sardonique. le meneur est corrompu à cette fin par le direction : favoriser l'anarchie, le chaos pour justifier de lourdes représailles derrière réduisant au silence toutes revendications.
Les bestialités commises ne sont pas non plus entièrement excusables par cette manipulation. Il y a d'atroces lâchetés de sang et de chasse à l'homme : l'épicier est tué par un groupe de femmes, dont l'une brandit ses yeux crevés comme étendard, M. de Torgnac est encerclé, torturé, humilié, prié de se mettre à genoux… Jérôme Pichot le sauve et éparpille la foule car il ne veut pas : « qu'on dise que le peuple est aussi lâche que lui… »
Mais il ne fallait pas attendre la moindre reconnaissance de ce lâche : Jérôme Pichot sera emprisonné en tant que principal instigateur de cette foule haineuse qu'il a voulu tempéré en vain sans que M. de Torgnac n'évoque son acte héroïque qu'il renie entièrement.
La justice, ce dernier espoir de rétablir la vérité, est tout aussi dénaturée que les autres institutions : tout depuis l'interrogatoire à la cour d'assises est marqué d'une grossière et frappante partialité. Tout se déroule en une exécution brutale, vive et rapide. On déforme les propos à l'interrogatoire, on coupe la parole des accusés… Les avocats à la défense ne plaident que de timides circonstances atténuantes et réfutent la vérité de crainte d'attirer les châtiments du propriétaire et du gouvernement de Napoléon III qu'il représente indirectement.
Tout est perdu, on festoie l'écrasante victoire en portant un toast à l'empereur : « Vive l'empereur ! » tel est le nom du dernier chapitre.
Tout au long du roman se trouve des chapitres entiers consacrés à l'opulent et fastueux train de vie du propriétaire et l'on suit notamment la rébellion de Fanny, la fille adoptée et arrachée à la famille de Jérôme Pichot par M. Onésime Macreux.
Rongée d'inquiétude et de remords à la suite de la catastrophe minière, elle part à la rencontre de sa famille qu'elle n'avait plus vu depuis 10 ans mais son père, Jérôme Pichot, la repousse brutalement comme si elle était porteuse de la peste, lui reproche sa trahison d'une façon toute irrationnelle car elle avait 6 ans lorsqu'elle fut adoptée mais qu'importe, il est écoeuré de la luxueuse vie qu'elle mène.
En errant désespérément en dehors de la mine, sa mère qui la reconnait, pousse un cri, lui tend les bras mais les autres femmes crient vengeance : « Hors d'ici l'infâme ! Chassons-là ! — Elle ose venir ici ! — Ça s'engraisse de notre sueur — Ça se goberge avec ceux qui tuent et emprisonnent nos hommes ! »
Sa mère est obligée, elle aussi, de la renier :
« La Femme Pichot retomba agenouillée avec cet air de profonde résignation dont la misère.
Mais alors les femmes, se grisant de colère, s'enivrant de leurs propres menaces, en proie à l'effrayante obsession que produisent la douleur et l'impuissance de la vengeance contre celui qui l'a produite ; cherchant un bouc émissaire qui trompât leur fureur ; s'inquiétant peu de l'objet de leur haine pour ne songer qu'à l'assouvir ; trouvant dans Fanny le souvenir de la flétrissure que pouvaient imprimer à leurs filles la toute-puissance de M. Onésime Macreux ; voyant en elle, avec leurs sauvages préjugés catholiques sur la morale, une sorte d'emblème, d'image vivante du déshonneur d'une femme de leur plèbe ; y mêlant ce sentiment d'envie qui ferme au fond de tout coeur de femme contre une femme plus jeune, plus belle, mieux vêtue qu'elles ; la regardant comme la complice de M. Macreux dans l'oeuvre implacable dont elles pleuraient en ce moment-là même les victimes ; la considérant par une sorte d'étrange rapprochement hyperbolique, comme une partie de lui-même ; elles ne se contentèrent plus seulement de l'ordre d'expulsion qu'elles avaient formulé tout d'abord, et leurs cris de menace se transformèrent en un hurlement d'implacable vengeance (…) A mort ! A mort ! »
Fanny parvient à se réfugier à temps au château du propriétaire et se fait sermonner, menacer, abandonnée de tous côtés :
« Il rugissait de colère de voir ainsi un moucheron, un petit insecte assez gracieux qu'il aimait comme un petit meuble d'un usage agréable, refuser absolument de remplir les fonctions pour lesquelles il était fait, et fuir, et se dérober à lui sans qu'il pût même avoir la compensation de le briser.
Je t'ai fait élever depuis l'âge de cinq ou six ans, comme une demoiselle, disait ta mère.
Oui, pour faire de moi votre maîtresse.
Précisément. Or, j'ai eu de la patience, j'ai attendu que tu fusses bien formée. Tu as seize ans, et voilà cinq ou six mois seulement que tu commences à remplir le but que je m'étais proposé. Comprends-tu maintenant que tu as un capital à amortir et que six mois ne suffisent pas pour cela ? »
Il l'effraie encore en la menaçant de l'expédier en un « bureau des moeurs » séquestrant les filles perdues.
C'est finalement à l'issue d'une discussion avec une haute courtisane expérimentée que Fanny acceptera son sort : « Moi, je me prostituerais pour le plaisir de me prostituer ! En vérité ! C'est la plus grande sensation d'orgueil qu'une femme puisse goûter ! Mais, triple niais, tu m'adores et tu m'achètes en mettant ta fortune à mes pieds. C'est bien, tu as acheté ton esclavage. Tu te ruine pour être valet. Oh ! Tu me nommes bien : ta maîtresse ! Je le suis comme jamais maître n'a possédé esclave ! Je suis la maîtresse de chacune de tes sensations, de tes idées, de tes volontés ; je tiens ta vie entre mes mains, et, si je le veux, je la jetterai dans l'infamie, je la jetterai dans le déshonneur, je la jetterai dans la mort ! Il m'achète et c'est moi qui le possède ! »
(...)
(Suite en commentaire - dépassement du nombre de caractères)
Merci à mon ami Babelio etienneDuLoiret d'avoir chroniqué ce livre, et de m'avoir donné envie par sa longue et intéressante critique.
Un pays noir, une explosion de grisou, une grève, des mineurs désespérés et des exploitants riches et sûrs d'eux... Oui, on pense à Germinal - pourtant postérieur. C'est Germinal le chef-d'oeuvre, pas la famille Pichot, assez oublié je pense aujourd'hui.
Peut-être parce que ce n'est pas un roman de la mine ; le titre l'indique, ce sont des "scènes de l'enfer social" : seuls quelques chapitres ont lieu sous terre, et l'intrigue pourrait concerner des ouvriers de fabrique ou d'usine sidérurgique, cela ne changerait rien à leur rapport avec l'entrepreneur dans Germinal, le patron n'existe pas, il y a des "propriétaires" qui sont une figure lointaine, des actionnaires d'autant plus craints et puissants qu'on ne les connaît pas. Au contraire, ici, la mine a un patron, mais qui est la caricature d'un capitaliste du XIX ème siècle, du cigare au haut-de-forme.
Effectivement, Guyot ne fait pas le portrait de mineurs, mais celui du Second Empire. Il a une visée plus large, voulant décrire la société dans son ensemble. On croise ainsi des journalistes, des prêtres, des grandes dames et des lorettes, des magistrats... Son message est donc appuyé, très et trop appuyé même, son écriture n'a ni la subtilité, ni la poésie même de Zola. D'après le texte, on peut comprendre que c'est un socialiste - au sens fort du XIX ème siècle, athée et anticlérical. le "capitalisme, voila l'ennemi". Par conséquent, toutes les actions et tous les personnages doivent illustrer son idéologie.
Chez Zola, les personnages sont riches, subtils. Ainsi, on peut éprouver de l'empathie pour Hennebeau, le directeur de la mine, souffrant de l'adultère de sa femme. Ici, au contraire, les personnages sont donc tous monolithiques, illustrant un type, et n'évoluent pas depuis leur première apparition : le magistrat corrompu, le médecin hypocrite, le capitaliste présenté comme un ogre, la grande dame coquette, la prostituée... le roman illustre donc la fête impériale plutôt que les souffrances des mineurs, cette expression des historiens pour désigner cette alliance de débauche et d'enrichissement des entrepreneurs sous Napoléon III.
Cependant, malgré ce manque de subtilité, j'ai pris plaisir à ma lecture grâce aux effets pathétiques et mélodramatiques, je voulais savoir la suite. J'attendais d'ailleurs un coup de théâtre, un renversement inattendu - qui n'est pas venu. le roman se clôt sur une note pessimiste : on peut rêver de Grand soir, mais il ne peut être que lointain, les patrons vont continuer à s'enrichir et les pauvres à crever.
Un pays noir, une explosion de grisou, une grève, des mineurs désespérés et des exploitants riches et sûrs d'eux... Oui, on pense à Germinal - pourtant postérieur. C'est Germinal le chef-d'oeuvre, pas la famille Pichot, assez oublié je pense aujourd'hui.
Peut-être parce que ce n'est pas un roman de la mine ; le titre l'indique, ce sont des "scènes de l'enfer social" : seuls quelques chapitres ont lieu sous terre, et l'intrigue pourrait concerner des ouvriers de fabrique ou d'usine sidérurgique, cela ne changerait rien à leur rapport avec l'entrepreneur dans Germinal, le patron n'existe pas, il y a des "propriétaires" qui sont une figure lointaine, des actionnaires d'autant plus craints et puissants qu'on ne les connaît pas. Au contraire, ici, la mine a un patron, mais qui est la caricature d'un capitaliste du XIX ème siècle, du cigare au haut-de-forme.
Effectivement, Guyot ne fait pas le portrait de mineurs, mais celui du Second Empire. Il a une visée plus large, voulant décrire la société dans son ensemble. On croise ainsi des journalistes, des prêtres, des grandes dames et des lorettes, des magistrats... Son message est donc appuyé, très et trop appuyé même, son écriture n'a ni la subtilité, ni la poésie même de Zola. D'après le texte, on peut comprendre que c'est un socialiste - au sens fort du XIX ème siècle, athée et anticlérical. le "capitalisme, voila l'ennemi". Par conséquent, toutes les actions et tous les personnages doivent illustrer son idéologie.
Chez Zola, les personnages sont riches, subtils. Ainsi, on peut éprouver de l'empathie pour Hennebeau, le directeur de la mine, souffrant de l'adultère de sa femme. Ici, au contraire, les personnages sont donc tous monolithiques, illustrant un type, et n'évoluent pas depuis leur première apparition : le magistrat corrompu, le médecin hypocrite, le capitaliste présenté comme un ogre, la grande dame coquette, la prostituée... le roman illustre donc la fête impériale plutôt que les souffrances des mineurs, cette expression des historiens pour désigner cette alliance de débauche et d'enrichissement des entrepreneurs sous Napoléon III.
Cependant, malgré ce manque de subtilité, j'ai pris plaisir à ma lecture grâce aux effets pathétiques et mélodramatiques, je voulais savoir la suite. J'attendais d'ailleurs un coup de théâtre, un renversement inattendu - qui n'est pas venu. le roman se clôt sur une note pessimiste : on peut rêver de Grand soir, mais il ne peut être que lointain, les patrons vont continuer à s'enrichir et les pauvres à crever.
Citations et extraits (3)
Ajouter une citation
Puis le médecin entra dans son cabinet.
Une jeune jeune femme, traînant par le bras un petit garçon de sept à huit ans, le suivit.
— Eh bien, qu'est-ce qu'il a, le Durand ?
— Voilà le petit, il n'a que huit ans, et il ne porte pas son âge ; voyez-vous, c'est dur pour lui de passer huit heures par jour à traîner quatre pattes, avec une chaîne passée entre les jambes, des courriaux qui pèsent bien lourd et par des chemins raboteux... il a les reins a vif.
— Voyons ça !
La femme Durand enleva la chemise noire de l'enfant et découvrit autour des reins une plaie telle qu’en fait le collier aux épaules des chevaux.
— Allons ! allons ! Faudra du repos ! Ça ne sera rien, voyez-vous, il ne faut pas se plaindre.
(…)
Le défilé continua. Il y avait des jeunes filles qui s'étaient blessées en alimentant les gueulards des hauts-fourneau.
Le doux médecin leur démontra qu'elles étaient bien heureuses de travailler à la surface du sol et non dans les profondeurs des mines ; qu'en Angleterre et en Belgique des jeunes filles y travaillaient encore comme des hommes ; que leur travail, du reste, était une excellente gymnastique. Il fallait seulement avoir la force de le supporter, sinon il vous tuait ; voilà tout.
(…)
C’était ce jour là que devaient être réglées les pensions.
Le malheureux Jacques Brunehaut s’appuya sur le bras de sa femme, et en se traînant se rendit dans le cabinet où l’attendait M. De Torgnac comme délégué par M. Macreux à l’administration de la caisse de secours.
- Eh bien ! Votre situation est réglée. Voici : vous aurez encore pendant un mois un franc par jour : au bout de ce temps, vous n’aurez plus le droit qu’à votre pension.
Elle sera de soixante-seize francs par an.
- Mais, Monsieur, dit le malheureux Jacques Brunehaut, comment voulez-vous que je vive avec ça ? C’est la mort pour ma femme, pour mes trois petits enfants, pour moi ! Je ne pourrai plus jamais travailler à la mine. Voyez mes mains, elles sont toutes tordues, déchiquetées, je ne suis plus maître de mes doigts ; je n’ai plus de reins… Les jambes plies sous moi.
Le malheureux pleurait ; ces larmes sortant de ces yeux dont les paupières avaient été brûlées, ce visage tout couturé de cicatrices, ces mains difformes implorant pitié ; ces jambes tordues, près de s’agenouiller afin de demander la vie pour sa femme et ses petits enfants ; cette femme jeune qui sanglotait : ces trois petits enfants dont un sur les bras : M de Torgnac regarda et vit tout cela à travers son lorgnon d’or.
- C’est inutile de pleurer, c’est comme ça, dit-il, et rien ne pourrait y changer quelque chose. Vous avez quitté deux fois la mine pour voir si ailleurs vous seriez mieux. Vous avez perdu vos deux premières mises à la société de secours. Voilà trois ans seulement que vous êtes revenu. Nous avons même un peu forcé le prorata de votre mise. Vous n’avez rien à réclamer. Finissons-en.
(…)
- François Pichot disparu, pas de femme, pas d’enfants ; rien à donner, dit M de Torgnac en lisant un papier. Pierre Pichot ; aveugle, bien ; une jambe tordue, ne pouvant plus guère servir, dix-neuf ans ; mise à la caisse de secours depuis l’âge de quatorze ans : cela fait quatre ans ; incapacité absolue de travail, cela fait cent francs par an.
- Que voulez-vous qu’il fasse avec cent francs ? Dit Jérôme Pichot, laissant tomber ses bras de stupéfaction.
- Eh bien ! Ça le regarde, reprit M. De Torgnac, en fixant son lorgnon d’or impassible sur Jérôme Pichot.
- Mais pensez donc, Monsieur ; sur douze enfants, j’en ai quatre qui sont morts à la peine. Sauf l’aîné, malheureusement tous ressemblent à leur mère qui n’est point forte, au lieu de me ressembler à moi, ajouta Jérôme Pichot, en donnant sur sa large poitrine un coup de poing qui résonna profondément. La mine est trop dure pour eux.
- Eh bien ! Que voulez-vous dire ?
- Eh bien, je disais donc : il sait bien que nous le garderons, mais nous n’avons déjà point trop pour nous. Et quand nous serons morts, que voulez-vous qu’il devienne avec ses cent francs ?
- M de Torgnac haussa les épaules. Ça le regarde.
- François mort, Pierre aveugle, Mathurin malade, Julie Bossue, quatre morts à la peine, Joseph pris au sort à l’armée. Eh bien ! Je dirai : tant mieux pour ceux qui sont morts, tant mieux pour ceux qui meurent ; au moins c’est fini.
- C’est toujours une ressource qu’on a sous la main, dit M de Torgnac en allumant un cigare et en haussant les épaules.
(…)
- Charles Lebrun, dit M de Torgnac, âgé de vingt-deux ans. Une jambe perdue par suite d’imprudence, étant descendu sans ordre dans le puits du Diable. Indemnité de cent francs une fois donnée.
- Quoi ? Dit Charles Lebrun, se demandant s’il avait bien compris.
- Eh bien, quoi ? J’ai dit que l’administration de la société de secours veut bien vous donner cent francs. C’est pure gracieuseté de sa part, car elle ne vous doit rien. Pour qu’elle vous dût quelque chose, il faudrait que votre incapacité de travail résultât du travail lui-même. Or, elle résulte simplement de votre imprudence.
Mais c’était pour secourir les camarades, dit Charles Lebrun, continuant d’essayer de comprendre.
- Vous n’aviez pas d’ordres. (…)
- Mais, Monsieur, pensez donc, ma mère n’avait que moi. Elle n’a plus de forces. Elle ne peut plus travailler ! Que voulez-vous que nous devenions ?
Moi je ne veux rien du tout, devenez ce que vous voudrez.
La vieille mère de Charles Lebrun joignit les mains.
- Oh ! Mon dieu, je vous en prie…Allons, allons, la paix !
Une jeune jeune femme, traînant par le bras un petit garçon de sept à huit ans, le suivit.
— Eh bien, qu'est-ce qu'il a, le Durand ?
— Voilà le petit, il n'a que huit ans, et il ne porte pas son âge ; voyez-vous, c'est dur pour lui de passer huit heures par jour à traîner quatre pattes, avec une chaîne passée entre les jambes, des courriaux qui pèsent bien lourd et par des chemins raboteux... il a les reins a vif.
— Voyons ça !
La femme Durand enleva la chemise noire de l'enfant et découvrit autour des reins une plaie telle qu’en fait le collier aux épaules des chevaux.
— Allons ! allons ! Faudra du repos ! Ça ne sera rien, voyez-vous, il ne faut pas se plaindre.
(…)
Le défilé continua. Il y avait des jeunes filles qui s'étaient blessées en alimentant les gueulards des hauts-fourneau.
Le doux médecin leur démontra qu'elles étaient bien heureuses de travailler à la surface du sol et non dans les profondeurs des mines ; qu'en Angleterre et en Belgique des jeunes filles y travaillaient encore comme des hommes ; que leur travail, du reste, était une excellente gymnastique. Il fallait seulement avoir la force de le supporter, sinon il vous tuait ; voilà tout.
(…)
C’était ce jour là que devaient être réglées les pensions.
Le malheureux Jacques Brunehaut s’appuya sur le bras de sa femme, et en se traînant se rendit dans le cabinet où l’attendait M. De Torgnac comme délégué par M. Macreux à l’administration de la caisse de secours.
- Eh bien ! Votre situation est réglée. Voici : vous aurez encore pendant un mois un franc par jour : au bout de ce temps, vous n’aurez plus le droit qu’à votre pension.
Elle sera de soixante-seize francs par an.
- Mais, Monsieur, dit le malheureux Jacques Brunehaut, comment voulez-vous que je vive avec ça ? C’est la mort pour ma femme, pour mes trois petits enfants, pour moi ! Je ne pourrai plus jamais travailler à la mine. Voyez mes mains, elles sont toutes tordues, déchiquetées, je ne suis plus maître de mes doigts ; je n’ai plus de reins… Les jambes plies sous moi.
Le malheureux pleurait ; ces larmes sortant de ces yeux dont les paupières avaient été brûlées, ce visage tout couturé de cicatrices, ces mains difformes implorant pitié ; ces jambes tordues, près de s’agenouiller afin de demander la vie pour sa femme et ses petits enfants ; cette femme jeune qui sanglotait : ces trois petits enfants dont un sur les bras : M de Torgnac regarda et vit tout cela à travers son lorgnon d’or.
- C’est inutile de pleurer, c’est comme ça, dit-il, et rien ne pourrait y changer quelque chose. Vous avez quitté deux fois la mine pour voir si ailleurs vous seriez mieux. Vous avez perdu vos deux premières mises à la société de secours. Voilà trois ans seulement que vous êtes revenu. Nous avons même un peu forcé le prorata de votre mise. Vous n’avez rien à réclamer. Finissons-en.
(…)
- François Pichot disparu, pas de femme, pas d’enfants ; rien à donner, dit M de Torgnac en lisant un papier. Pierre Pichot ; aveugle, bien ; une jambe tordue, ne pouvant plus guère servir, dix-neuf ans ; mise à la caisse de secours depuis l’âge de quatorze ans : cela fait quatre ans ; incapacité absolue de travail, cela fait cent francs par an.
- Que voulez-vous qu’il fasse avec cent francs ? Dit Jérôme Pichot, laissant tomber ses bras de stupéfaction.
- Eh bien ! Ça le regarde, reprit M. De Torgnac, en fixant son lorgnon d’or impassible sur Jérôme Pichot.
- Mais pensez donc, Monsieur ; sur douze enfants, j’en ai quatre qui sont morts à la peine. Sauf l’aîné, malheureusement tous ressemblent à leur mère qui n’est point forte, au lieu de me ressembler à moi, ajouta Jérôme Pichot, en donnant sur sa large poitrine un coup de poing qui résonna profondément. La mine est trop dure pour eux.
- Eh bien ! Que voulez-vous dire ?
- Eh bien, je disais donc : il sait bien que nous le garderons, mais nous n’avons déjà point trop pour nous. Et quand nous serons morts, que voulez-vous qu’il devienne avec ses cent francs ?
- M de Torgnac haussa les épaules. Ça le regarde.
- François mort, Pierre aveugle, Mathurin malade, Julie Bossue, quatre morts à la peine, Joseph pris au sort à l’armée. Eh bien ! Je dirai : tant mieux pour ceux qui sont morts, tant mieux pour ceux qui meurent ; au moins c’est fini.
- C’est toujours une ressource qu’on a sous la main, dit M de Torgnac en allumant un cigare et en haussant les épaules.
(…)
- Charles Lebrun, dit M de Torgnac, âgé de vingt-deux ans. Une jambe perdue par suite d’imprudence, étant descendu sans ordre dans le puits du Diable. Indemnité de cent francs une fois donnée.
- Quoi ? Dit Charles Lebrun, se demandant s’il avait bien compris.
- Eh bien, quoi ? J’ai dit que l’administration de la société de secours veut bien vous donner cent francs. C’est pure gracieuseté de sa part, car elle ne vous doit rien. Pour qu’elle vous dût quelque chose, il faudrait que votre incapacité de travail résultât du travail lui-même. Or, elle résulte simplement de votre imprudence.
Mais c’était pour secourir les camarades, dit Charles Lebrun, continuant d’essayer de comprendre.
- Vous n’aviez pas d’ordres. (…)
- Mais, Monsieur, pensez donc, ma mère n’avait que moi. Elle n’a plus de forces. Elle ne peut plus travailler ! Que voulez-vous que nous devenions ?
Moi je ne veux rien du tout, devenez ce que vous voudrez.
La vieille mère de Charles Lebrun joignit les mains.
- Oh ! Mon dieu, je vous en prie…Allons, allons, la paix !
Juste cette après-midi-là, je travaillais, heureusement pour moi, dans une galerie latérale qui monte presque comme une échelle.
Tout d'un coup, je me sens renversé, roulé, emporté, heurté contre les parois de la galerie, comme par un tourbillon.
J'essaye de m'accrocher... il me semblait que je tombais au fond du grand puits... Non, que je me disais pourtant, et, au moment où je me disais cela, je vois passer devant moi une langue de feu, et puis toute la galerie devient feu, et c'est dans du feu que je tourbillonne maintenant… Est-ce que je serais tombé jusqu'en enfer, que je me dis, après être tombé dans le puits ? Puis j'entends un bruit un vacarme, un écroulement comme des myriades de coups de canon, de coups de tonnerre, et quelque chose encore de plus fort... On eût dit que la terre s'ouvrait...
Je continuais à rouler au milieu du feu, de la fumée qui m'aveuglait et m'asphyxiait.
J'entrevoyais les galeries qui se crevassaient, les pierres qui tombaient, qui se brisaient... Je me remis un peu ; Je vis bien ce que c'était ! Je dis : Je suis bien heureux d'en être quitte, mais ce sera pour plus tard ; et je pensais à ma femme et à mes trois petits enfants.
J'entends toujours les explosions du grisou, les éboulements, puis le clapotement de l’eau.
« Allons, me dis-je, les digues sont brisées ; je ne suis pas brûlé mais je serai noyé. » Comme j’essayais de reconnaître où j’étais après un pareil étourdissement, nos lampes étaient brisées et éteintes, cela va sans dire, je sens une jambe qui remue.
- Qui est là ? Dis-je.
- C’est moi, François Pichot.
- et moi, Jacques Brunehaut.
- Viens donc, l’eau arrive.
- Je ne peux pas, je n’ai plus de jambes ; il me semble que je suis scié en deux.
Je veux le toucher ; mais alors je m’aperçois que mes mains me brûlent comme du feu et aussi ma figure.
Allons, me dis-je, je dois être un joli garçon. Je m’enveloppe une main avec mon mouchoir. Je veux le prendre.
- Hola ! Là ! La ! Crie-t-il, non, laisse-moi.
Mais l’eau monte… Entends-tu son clapotement ?
Je suis sûr qu’elle est tout près.
- J’aime mieux mourir. Sauve-toi, laisse-moi.
Mais non, je ne laisserai pas comme ça un camarade.
Je me penche, je veux le tâter !… Je sens une poutre qui pesait sur lui en travers… C’était elle qui le coupait comme ça… je la soulève ! Mes mains me faisaient si grand mal que mes dents se serraient à se briser. Patatras, voilà un éboulée,nt ! Et la poutre retombe plus lourdement sur lui.
Et François Pichot qui crie :
- Laisse-moi ! Laisse-moi ! Oh ! Mon dieu !… Mon Dieu !… tue-moi ! … Tue-moi !… Mes reins, mes jambes, je suis scié ! Aoh !
Et il râlait.
L’eau montait. J’en avais jusqu’à mi-jambe ! Je ne pouvais plus rien pour lui, je tâchais de m’orienter et de m’éloigner… Au milieu des éboulements, des détonations du grisou et de l’air comprimé par l’eau, j’entendais encore sa voix qui criait.
Le frisson me passait à travers le corps ; et je me disais : « Tu vas peut-être bientôt en dire autant, et je voyais comme dans un rêve ma femme et mes trois petits enfants qui m’attendaient. Je heurte un autre homme ; celui-là ne remuait plus. Je le secoue, il ne dit rien. Je le prends par un bras et je le traine en le heurtant aux poutres, aux pierres, à l’angle des galeries… De temps en temps je roulais sur lui ; et il me semblait qu’il m’éteignait comme pour m’emporter avec lui dans la mort… Allons ! Je tombe une dernière fois.
- Hola ! Là ! Crie une voix.
- Qui est là ? C’est moi ! Pierre Pichot.
- Qu’as-tu, toi ?
- Moi, oh ! Je n’en sais rien ! J’ai une jambe qui plie sous moi et mon frère François ?
- As-tu vu mon frère ? Me dit-il.
- Viens toujours, allons, viens !
- Qui est-ce qui râle donc si fort ?
Je ne lui dis pas que c’était son frère.
Je lâche mon mort ou celui qui en faisait mine, et je prends Pierre Pichot dans mes bras. Il était lourd sans que ça parût… Et l’eau montait !… C’est qu’il fallait se presser… Puis je m’y reconnaissais plus. Aux angles des galeries, les cheveux m’en dressaient sur la tête ! Si j’allais me tromper !… heureusement que je connais bien la mine et que du premier coup je m’étais dit :
"Il faut tâcher d’aller au fond de la galerie Sainte-marie."
Je portais toujours le paquet… Glouglou ! Faisait l’eau. Et puis, il y avait des éboulements, des explosions… l’eau arrivait vite.. j’en avais déjà jusqu’à mi-jambe, de temps en temps je glissais sur quelque chose de mou.
Allons ! Que je me disais ! Voilà un camarade qui a son affaire finie…
Je tombais, je me relevais, je tombais encore, je me revenais, et chaque fois que je tombais, je pensais à ma femme et mes trois petits enfants. Me vois arrivé…. Bon ! Il y a un éboulement ! Ah ! Dame ! Là, je crus que c’était fini. Je n’avais plus la force de porter le camarade. Je tâte… Je tâte… L’eau montait… Je la sentais au ventre… Elle montait vite… Pas une minute à perdre, ou c’était fini… A force de tâter, je trouve un trou.
Allons ! Dis-je ! Faut espérer.
Je m’écorche la tête. Je sens des clous qui me raclent comme une herse, je m’enfonce, je pousse toujours ; j’étouffais, j’étais serré comme dans un étau et l’étau semblait se serrer toujours plus fort… Je pousse toujours, j’y laisse de ma peau, mes vêtements accrochés, ça ne fait rien… Quand je me sens dégagé, je dis :
Il faut sauver le camarade.
Il criait de l’autre côté :
- L’eau monte ! L’eau monte !… Je vais me noyer…
- Ne m’abandonne pas ! Oh ! Je t’en prie ! Emporte-moi.
- Oui ! Oui ! Sois tranquille.
Puis je me rengage, par la tête cette fois, dans le trou ; je sens les clous, les éclisses de bois… Est-ce que je sais, moi ! Et mes mains qui me causaient ! Celles là, par exemple, je ne les sentais plus. Je croyais avoir à la place deux charbons en feu. Je le tire par le bras, je tâche de le guider… C’est qu’il y avait sa mauvaise jambe… il n’était point commode… Je tire dessus, mais c’est bien une autre chanson maintenant !
"- Non ! Non ! Laisse-moi mourir !.. J’aime mieux mourir ! Holà ! Là ! Mais tu veux donc m’assassiner !"
Et j’étais obligé de tirer de toutes mes forces. A un moment il me semble que ma main droite s’est arrachée de mon poignet. Je sens comme un fer chaud me traverser… J’en grince des dents à les casser et je pousse un cri si lugubre qu’il me fait peur… C’était lui qui m’avait mordu pour se débarrasser de moi.
"- Ah ! Tu ne veux pas te sauver !" Que je lui dis. (…)
Il me sembla que le gouffre m’attirait, que tous les fantômes que je voyais se jetaient sur moi et pesaient sur mes épaules, et courbaient ma tête et saisissaient mes membres. Je fis un effort désespéré. Il s’accrocha à mon genou, puis à ma ceinture.
Mais ce qu’il y avait de plus terrible, c’est que nous n’étions pas seuls. Nous voyions partout des esprits. Vous savez, il y en a dans la mine, et qui sont jaloux. Dans le noir qui nous entourait, il nous semblait que les formes noires de spectres, des têtes de morts, des démons bien plus terribles que ceux qu’on voit dans les églises nous entouraient, s’asseyaient entre nous, nous pressaient entre leurs bras monstrueux et nous entraînaient. (…)
A un moment, une voix cria :
J’ai faim ! Je veux te manger.
Je me sentis alors saisi par un homme qui me mordait à l’épaule. Je me débattis, mais il me tenait avec une énergie telle que je ne pouvais pas me débarrasser de lui. Il enfonçait toujours ses dents dans ma chair. Mes mains n’avaient plus de force… Je crus mon dernier moment arrivé. Il y eut une mêlée, je roulais par terre avec lui… Je me sentis dégagé tout à coup ; je ne sais pas comment… je crois qu’il était mort.
De temps, en temps, il y en avait un qui disait d’une voix sourde :
Il faut nous en aller.
Où ?
Où ? Répondait-on avec le délire de la fièvre. Et alors on entendait des soupirs, des gémissements, des grincements de dents, des cris inarticulés. On sentait des corps se mouvoir et tout retombait dans l’immobilité et dans le silence.
Tout d'un coup, je me sens renversé, roulé, emporté, heurté contre les parois de la galerie, comme par un tourbillon.
J'essaye de m'accrocher... il me semblait que je tombais au fond du grand puits... Non, que je me disais pourtant, et, au moment où je me disais cela, je vois passer devant moi une langue de feu, et puis toute la galerie devient feu, et c'est dans du feu que je tourbillonne maintenant… Est-ce que je serais tombé jusqu'en enfer, que je me dis, après être tombé dans le puits ? Puis j'entends un bruit un vacarme, un écroulement comme des myriades de coups de canon, de coups de tonnerre, et quelque chose encore de plus fort... On eût dit que la terre s'ouvrait...
Je continuais à rouler au milieu du feu, de la fumée qui m'aveuglait et m'asphyxiait.
J'entrevoyais les galeries qui se crevassaient, les pierres qui tombaient, qui se brisaient... Je me remis un peu ; Je vis bien ce que c'était ! Je dis : Je suis bien heureux d'en être quitte, mais ce sera pour plus tard ; et je pensais à ma femme et à mes trois petits enfants.
J'entends toujours les explosions du grisou, les éboulements, puis le clapotement de l’eau.
« Allons, me dis-je, les digues sont brisées ; je ne suis pas brûlé mais je serai noyé. » Comme j’essayais de reconnaître où j’étais après un pareil étourdissement, nos lampes étaient brisées et éteintes, cela va sans dire, je sens une jambe qui remue.
- Qui est là ? Dis-je.
- C’est moi, François Pichot.
- et moi, Jacques Brunehaut.
- Viens donc, l’eau arrive.
- Je ne peux pas, je n’ai plus de jambes ; il me semble que je suis scié en deux.
Je veux le toucher ; mais alors je m’aperçois que mes mains me brûlent comme du feu et aussi ma figure.
Allons, me dis-je, je dois être un joli garçon. Je m’enveloppe une main avec mon mouchoir. Je veux le prendre.
- Hola ! Là ! La ! Crie-t-il, non, laisse-moi.
Mais l’eau monte… Entends-tu son clapotement ?
Je suis sûr qu’elle est tout près.
- J’aime mieux mourir. Sauve-toi, laisse-moi.
Mais non, je ne laisserai pas comme ça un camarade.
Je me penche, je veux le tâter !… Je sens une poutre qui pesait sur lui en travers… C’était elle qui le coupait comme ça… je la soulève ! Mes mains me faisaient si grand mal que mes dents se serraient à se briser. Patatras, voilà un éboulée,nt ! Et la poutre retombe plus lourdement sur lui.
Et François Pichot qui crie :
- Laisse-moi ! Laisse-moi ! Oh ! Mon dieu !… Mon Dieu !… tue-moi ! … Tue-moi !… Mes reins, mes jambes, je suis scié ! Aoh !
Et il râlait.
L’eau montait. J’en avais jusqu’à mi-jambe ! Je ne pouvais plus rien pour lui, je tâchais de m’orienter et de m’éloigner… Au milieu des éboulements, des détonations du grisou et de l’air comprimé par l’eau, j’entendais encore sa voix qui criait.
Le frisson me passait à travers le corps ; et je me disais : « Tu vas peut-être bientôt en dire autant, et je voyais comme dans un rêve ma femme et mes trois petits enfants qui m’attendaient. Je heurte un autre homme ; celui-là ne remuait plus. Je le secoue, il ne dit rien. Je le prends par un bras et je le traine en le heurtant aux poutres, aux pierres, à l’angle des galeries… De temps en temps je roulais sur lui ; et il me semblait qu’il m’éteignait comme pour m’emporter avec lui dans la mort… Allons ! Je tombe une dernière fois.
- Hola ! Là ! Crie une voix.
- Qui est là ? C’est moi ! Pierre Pichot.
- Qu’as-tu, toi ?
- Moi, oh ! Je n’en sais rien ! J’ai une jambe qui plie sous moi et mon frère François ?
- As-tu vu mon frère ? Me dit-il.
- Viens toujours, allons, viens !
- Qui est-ce qui râle donc si fort ?
Je ne lui dis pas que c’était son frère.
Je lâche mon mort ou celui qui en faisait mine, et je prends Pierre Pichot dans mes bras. Il était lourd sans que ça parût… Et l’eau montait !… C’est qu’il fallait se presser… Puis je m’y reconnaissais plus. Aux angles des galeries, les cheveux m’en dressaient sur la tête ! Si j’allais me tromper !… heureusement que je connais bien la mine et que du premier coup je m’étais dit :
"Il faut tâcher d’aller au fond de la galerie Sainte-marie."
Je portais toujours le paquet… Glouglou ! Faisait l’eau. Et puis, il y avait des éboulements, des explosions… l’eau arrivait vite.. j’en avais déjà jusqu’à mi-jambe, de temps en temps je glissais sur quelque chose de mou.
Allons ! Que je me disais ! Voilà un camarade qui a son affaire finie…
Je tombais, je me relevais, je tombais encore, je me revenais, et chaque fois que je tombais, je pensais à ma femme et mes trois petits enfants. Me vois arrivé…. Bon ! Il y a un éboulement ! Ah ! Dame ! Là, je crus que c’était fini. Je n’avais plus la force de porter le camarade. Je tâte… Je tâte… L’eau montait… Je la sentais au ventre… Elle montait vite… Pas une minute à perdre, ou c’était fini… A force de tâter, je trouve un trou.
Allons ! Dis-je ! Faut espérer.
Je m’écorche la tête. Je sens des clous qui me raclent comme une herse, je m’enfonce, je pousse toujours ; j’étouffais, j’étais serré comme dans un étau et l’étau semblait se serrer toujours plus fort… Je pousse toujours, j’y laisse de ma peau, mes vêtements accrochés, ça ne fait rien… Quand je me sens dégagé, je dis :
Il faut sauver le camarade.
Il criait de l’autre côté :
- L’eau monte ! L’eau monte !… Je vais me noyer…
- Ne m’abandonne pas ! Oh ! Je t’en prie ! Emporte-moi.
- Oui ! Oui ! Sois tranquille.
Puis je me rengage, par la tête cette fois, dans le trou ; je sens les clous, les éclisses de bois… Est-ce que je sais, moi ! Et mes mains qui me causaient ! Celles là, par exemple, je ne les sentais plus. Je croyais avoir à la place deux charbons en feu. Je le tire par le bras, je tâche de le guider… C’est qu’il y avait sa mauvaise jambe… il n’était point commode… Je tire dessus, mais c’est bien une autre chanson maintenant !
"- Non ! Non ! Laisse-moi mourir !.. J’aime mieux mourir ! Holà ! Là ! Mais tu veux donc m’assassiner !"
Et j’étais obligé de tirer de toutes mes forces. A un moment il me semble que ma main droite s’est arrachée de mon poignet. Je sens comme un fer chaud me traverser… J’en grince des dents à les casser et je pousse un cri si lugubre qu’il me fait peur… C’était lui qui m’avait mordu pour se débarrasser de moi.
"- Ah ! Tu ne veux pas te sauver !" Que je lui dis. (…)
Il me sembla que le gouffre m’attirait, que tous les fantômes que je voyais se jetaient sur moi et pesaient sur mes épaules, et courbaient ma tête et saisissaient mes membres. Je fis un effort désespéré. Il s’accrocha à mon genou, puis à ma ceinture.
Mais ce qu’il y avait de plus terrible, c’est que nous n’étions pas seuls. Nous voyions partout des esprits. Vous savez, il y en a dans la mine, et qui sont jaloux. Dans le noir qui nous entourait, il nous semblait que les formes noires de spectres, des têtes de morts, des démons bien plus terribles que ceux qu’on voit dans les églises nous entouraient, s’asseyaient entre nous, nous pressaient entre leurs bras monstrueux et nous entraînaient. (…)
A un moment, une voix cria :
J’ai faim ! Je veux te manger.
Je me sentis alors saisi par un homme qui me mordait à l’épaule. Je me débattis, mais il me tenait avec une énergie telle que je ne pouvais pas me débarrasser de lui. Il enfonçait toujours ses dents dans ma chair. Mes mains n’avaient plus de force… Je crus mon dernier moment arrivé. Il y eut une mêlée, je roulais par terre avec lui… Je me sentis dégagé tout à coup ; je ne sais pas comment… je crois qu’il était mort.
De temps, en temps, il y en avait un qui disait d’une voix sourde :
Il faut nous en aller.
Où ?
Où ? Répondait-on avec le délire de la fièvre. Et alors on entendait des soupirs, des gémissements, des grincements de dents, des cris inarticulés. On sentait des corps se mouvoir et tout retombait dans l’immobilité et dans le silence.
C'était Fanny qui pleurait. Ses sanglots redoublèrent.
— Mon père !… Mes frères !…
— Ton père, tes frères ! Rien ne prouve qu'il leur soit arrivé malheur ? Allons, va dans tu chambre et reviens vite. Fanny sortit accompagnée de (…)
— Voilà les préjugés de convention, dit M. Macreux, en allumant un cigare et en haussant les épaules. Je croyais pourtant les avoir fait détruire en elle jusqu’au dernier. Pas du tout. On parle d'un accident de mine, et parce que son père est mineur, elle pleure ! Et ce père, elle ne l'a pas vu depuis dix ans, elle n'en a jamais entendu parler. Il ne compte pour rien dans sa vie. C’est moi qui suis tout pour elle ; et elle pleure ! C'est idiot ! insista M. Onésime Macreux, pour bien s'affirmer à lui-même la réalité de ce fait, vraiment incroyable.
- Ah ! C'est la fille d'un mineur on ne le dirait pas… Dit M. Alcide Foureton avec l'indiscrétion d'un reporter.
- On ne le dirait pas ?
- Non, reprit M. Alcide Foureton, riant de sa propre naïveté... mais elle est très distinguée.
- Oh ! dit M. Onésime Macreux, avec celte large indiscrétion que lui donnait son tempérament et sous laquelle il cachait ses combinaisons les plus profondes. Le secret est bien simple. La mère était une très jolie femme, bien desséchée maintenant par la misère, mariée à un nommé Jérôme Pichot, brave homme, mais brute. Fanny a cinq ou six ans ressemblait à sa mère, était frêle, toute mignonne sous ses haillons, avait de beaux yeux bleus, un petit air futé. Je dis : Tiens ! tiens ! Ça pourrait peut-être réussir. Je préviens la maman que je trouve sa petite gentille et que je me charge de son éducation, que je veux l'élever comme une demoiselle On me remercie comme si j'étais le bon Dieu. Est-ce que je ne viens pas de faire un miracle ! Le papa approuve. Et puis voilà papa et maman qui se rengorgent, qui font les fiers, les crânes… Ah ! Ah ! La petite est élevée comme une demoiselle. Ça va bien. La petite pousse sous mon oeil paresseuse et mignonne comme une chatte, montrant les meilleures dispositions à apprendre l’art de plaire, du reste jolie ; elle embellit et se perfectionne… Papa, maman, demeurent dans leurs huttes comme des rats dans leurs trous. Personne ne s’en occupe plus. Ils font bien quelques simagrées, pleurent, réclament, mais je m’en moque. J’ai soin qu’ils ne sachent pas où est la petite fille, et la petite fille ne se souvient plus de son ancienne vie que comme d’un mauvais rêve. De temps en temps, je vais voir ma petite plante pousser dans la serre chaude où je l’ai fait soigneusement élever. Elle grandit, elle s’épanouit, elle est en bouton, et au moment où le bouton va devenir fleur, je le cueille. Oh ! Du reste, j’y mets des formes. Longtemps à l’avance, je l’y fais préparer par une honorables institutrice, et j’attends ce moment favorable pour la transporter ici, où, depuis six mois, elle fleurit sans avoir d’autre souci que de m’être agréable. Et encore, je suis trop occupé pour qu’elle ait besoin de le prendre tous les jours, ajouta-t-il avec un large rire cynique ; et ça parle de son père avant même qu’il soit question de sa mort !
et le père ? Reprit M. De la Portebatte.
Le père, je ne l’ai même pas renvoyé ; il a fait une demi-douzaine d’enfants ; c’est une bonne brute, travaillant dur, mais buvant…
Ah ! L’ivrognerie ! L’ivrognerie ! Voilà ce qui perd les ouvriers, constata M. Myopron, économiste officiel, en avalant un verre de porto.
Vous avez bien raison… tout ça grouille dans la misère… Une ou deux fois j’ai voulu, par pitié, leur voir en aide. Ça a fait les fiers, je vous demande un peu. Ce Jérôme Pichot ne s’est-il pas avisé deux ou trois fois de vouloir savoir où elle était ?… Ah ! Ah ! Je lui ai montré la porte, et je lui ai dit : Comment, triple niais, tu te plains d’avoir une bouche de moins à nourrir et qu’une de tes filles soit élevée dans du coton.
— Mon père !… Mes frères !…
— Ton père, tes frères ! Rien ne prouve qu'il leur soit arrivé malheur ? Allons, va dans tu chambre et reviens vite. Fanny sortit accompagnée de (…)
— Voilà les préjugés de convention, dit M. Macreux, en allumant un cigare et en haussant les épaules. Je croyais pourtant les avoir fait détruire en elle jusqu’au dernier. Pas du tout. On parle d'un accident de mine, et parce que son père est mineur, elle pleure ! Et ce père, elle ne l'a pas vu depuis dix ans, elle n'en a jamais entendu parler. Il ne compte pour rien dans sa vie. C’est moi qui suis tout pour elle ; et elle pleure ! C'est idiot ! insista M. Onésime Macreux, pour bien s'affirmer à lui-même la réalité de ce fait, vraiment incroyable.
- Ah ! C'est la fille d'un mineur on ne le dirait pas… Dit M. Alcide Foureton avec l'indiscrétion d'un reporter.
- On ne le dirait pas ?
- Non, reprit M. Alcide Foureton, riant de sa propre naïveté... mais elle est très distinguée.
- Oh ! dit M. Onésime Macreux, avec celte large indiscrétion que lui donnait son tempérament et sous laquelle il cachait ses combinaisons les plus profondes. Le secret est bien simple. La mère était une très jolie femme, bien desséchée maintenant par la misère, mariée à un nommé Jérôme Pichot, brave homme, mais brute. Fanny a cinq ou six ans ressemblait à sa mère, était frêle, toute mignonne sous ses haillons, avait de beaux yeux bleus, un petit air futé. Je dis : Tiens ! tiens ! Ça pourrait peut-être réussir. Je préviens la maman que je trouve sa petite gentille et que je me charge de son éducation, que je veux l'élever comme une demoiselle On me remercie comme si j'étais le bon Dieu. Est-ce que je ne viens pas de faire un miracle ! Le papa approuve. Et puis voilà papa et maman qui se rengorgent, qui font les fiers, les crânes… Ah ! Ah ! La petite est élevée comme une demoiselle. Ça va bien. La petite pousse sous mon oeil paresseuse et mignonne comme une chatte, montrant les meilleures dispositions à apprendre l’art de plaire, du reste jolie ; elle embellit et se perfectionne… Papa, maman, demeurent dans leurs huttes comme des rats dans leurs trous. Personne ne s’en occupe plus. Ils font bien quelques simagrées, pleurent, réclament, mais je m’en moque. J’ai soin qu’ils ne sachent pas où est la petite fille, et la petite fille ne se souvient plus de son ancienne vie que comme d’un mauvais rêve. De temps en temps, je vais voir ma petite plante pousser dans la serre chaude où je l’ai fait soigneusement élever. Elle grandit, elle s’épanouit, elle est en bouton, et au moment où le bouton va devenir fleur, je le cueille. Oh ! Du reste, j’y mets des formes. Longtemps à l’avance, je l’y fais préparer par une honorables institutrice, et j’attends ce moment favorable pour la transporter ici, où, depuis six mois, elle fleurit sans avoir d’autre souci que de m’être agréable. Et encore, je suis trop occupé pour qu’elle ait besoin de le prendre tous les jours, ajouta-t-il avec un large rire cynique ; et ça parle de son père avant même qu’il soit question de sa mort !
et le père ? Reprit M. De la Portebatte.
Le père, je ne l’ai même pas renvoyé ; il a fait une demi-douzaine d’enfants ; c’est une bonne brute, travaillant dur, mais buvant…
Ah ! L’ivrognerie ! L’ivrognerie ! Voilà ce qui perd les ouvriers, constata M. Myopron, économiste officiel, en avalant un verre de porto.
Vous avez bien raison… tout ça grouille dans la misère… Une ou deux fois j’ai voulu, par pitié, leur voir en aide. Ça a fait les fiers, je vous demande un peu. Ce Jérôme Pichot ne s’est-il pas avisé deux ou trois fois de vouloir savoir où elle était ?… Ah ! Ah ! Je lui ai montré la porte, et je lui ai dit : Comment, triple niais, tu te plains d’avoir une bouche de moins à nourrir et qu’une de tes filles soit élevée dans du coton.
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Livres les plus populaires de la semaine
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Yves Guyot (9)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les Chefs-d'oeuvre de la littérature
Quel écrivain est l'auteur de Madame Bovary ?
Honoré de Balzac
Stendhal
Gustave Flaubert
Guy de Maupassant
8 questions
11111 lecteurs ont répondu
Thèmes :
chef d'oeuvre intemporels
, classiqueCréer un quiz sur ce livre11111 lecteurs ont répondu