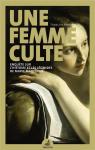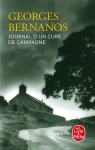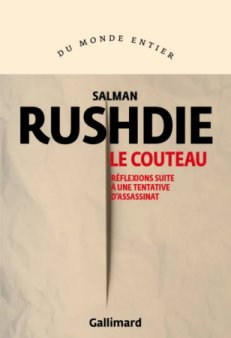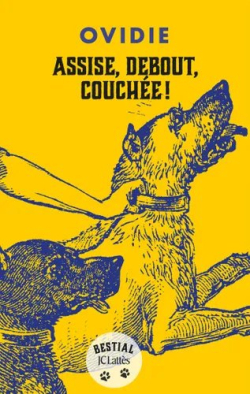Michel Lemoine/5
1 notes
Résumé :
Au XIIe siècle, le rapport entre christianisme et philosophie connaît un regain d'intérêt. Celui-ci se manifeste en un dialogue qui prend les formes variées de la rivalité, voire de l'affrontement. Parmi les divers lieux où se manifeste cette vitalité philosophique, ce que l'on a appelé « l'École de Chartres » occupe une place privilégiée. La controverse sur le platonisme, à laquelle participent de prestigieux penseurs, bat son plein. Bernard de Chartres, maître cha... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Théologie et platonisme au XIIe siècleVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (2)
Ajouter une critique
Il y eut au XIIème siècle une rivalité entre le monde monastique et les écoles, lesquelles exprimaient dans un cadre urbain en pleine mutation une plus grande soif de culture, un attrait pour la science et la philosophie. L'enseignement reposait alors sur les sept arts libéraux du Trivium et du Quadrivium, à savoir la grammaire, la rhétorique et la dialectique d'une part et l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique de l'autre. Les cours étaient organisés autour de la lecture et commentaires des oeuvres connues. On évoque un courant platonicien qu'on associe à l'école cathédrale de Chartres où se succédèrent de grands maîtres. Seul le "Timée" cependant était alors accessible grâce à la traduction d'un néo-platonicien latin, les autres dialogues de Platon n'apparaissant que dans des citations. Michel Lemoine tente , non sans prudence, d'explorer ce courant en nous présentant les oeuvres et les auteurs de "L'Ecole de Chartres" , lesquels renvoient sans doute davantage à une sensibilité qu'à une doctrine.
Marie-Thérèse d'Alverny (1953), Marie-Dominique Chenu (La théologie au douzième siècle, 1953), et Marie-Madeleine Davy (Initiation à la symbolique romane, 1955) ont épuisé le sujet il y a longtemps: Jean Scot Erigène, auteur du de divisione naturae où il reprend le Timée et l'idée d'une interaction entre le microcosme et le macrocosme, va connaître un puissant regain d'intérêt au XIIe siècle. Mais cette mode sera balayée par l'aristotélisme du XIIIe siècle (âge "gothique", deuxième scolastique).
Peut-être eût-il été bon de rappeler comment la mutation sociale du XIIe siècle opposait l'essor des villes (émergence d'une centralisation "courtoise" et des écoles) au recul des campagnes, donc la culture des "magistri" des scholae à celles des "oratores" des moûtiers...
Car il y a un parallèle sociologique entre les philosophies et les milieux des mondes roman (monastique, rural, mystique) et gothique (séculier, urbain, rationaliste) de part et d'autre d'une "révolution papale" triomphante.
Peut-être eût-il été bon de rappeler comment la mutation sociale du XIIe siècle opposait l'essor des villes (émergence d'une centralisation "courtoise" et des écoles) au recul des campagnes, donc la culture des "magistri" des scholae à celles des "oratores" des moûtiers...
Car il y a un parallèle sociologique entre les philosophies et les milieux des mondes roman (monastique, rural, mystique) et gothique (séculier, urbain, rationaliste) de part et d'autre d'une "révolution papale" triomphante.
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Michel Lemoine (6)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Jésus qui est-il ?
Jésus était-il vraiment Juif ?
Oui
Non
Plutôt Zen
Catholique
10 questions
1845 lecteurs ont répondu
Thèmes :
christianisme
, religion
, bibleCréer un quiz sur ce livre1845 lecteurs ont répondu