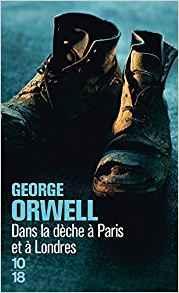A sa parution, malgré un bon accueil des critiques,"Dans la Dèche à Paris et à Londres" est presque un échec. le livre ne se vend presque pas.
En 1933, George Orwell n'est encore que Eric Arthur Blair, et il n'a publié, à Paris, que quelques articles dans "Monde"le célèbre journal d'Henri Barbusse.
Pourtant ce livre formidable,peut-être son meilleur, que l'on peut comparer au "Peuple de l'abîme" de Jack London, est déterminant dans l'oeuvre d'Orwell.
Il y raconte sa galère à Paris où il s'est installé pour écrire en 1928. A la frontière de la clochardisation, au fil de ses rencontres il brosse des portraits saisissants et un tableau social ahurissant.
"Voilà le monde qui vous attend si vous vous trouvez un jour sans le sou" dit-il, pour gagner quelque argent il devient, alors, plongeur pendant quelques semaines dans un hôtel de luxe de la rue de Rivoli. Et tout l'envers du décor nous apparaît, dans des descriptions implacables de la misère, de la détresse et de la saleté de ce prolétariat placé en semi-esclavage.
Puis Orwell reprend sa vie de vagabond et part pour Londres où il décrit la même misère retrouvée .
Ce livre est d'une puissance rare, Orwell trouve les mots justes pour rendre efficace la peinture qu'il réalise de la pauvreté, de la saleté, des ravages de l'alcool et de la maladie.
Il est, sûrement, à la base de toute l'oeuvre et de toute la pensée politique d'Orwell.
En 1933, George Orwell n'est encore que Eric Arthur Blair, et il n'a publié, à Paris, que quelques articles dans "Monde"le célèbre journal d'Henri Barbusse.
Pourtant ce livre formidable,peut-être son meilleur, que l'on peut comparer au "Peuple de l'abîme" de Jack London, est déterminant dans l'oeuvre d'Orwell.
Il y raconte sa galère à Paris où il s'est installé pour écrire en 1928. A la frontière de la clochardisation, au fil de ses rencontres il brosse des portraits saisissants et un tableau social ahurissant.
"Voilà le monde qui vous attend si vous vous trouvez un jour sans le sou" dit-il, pour gagner quelque argent il devient, alors, plongeur pendant quelques semaines dans un hôtel de luxe de la rue de Rivoli. Et tout l'envers du décor nous apparaît, dans des descriptions implacables de la misère, de la détresse et de la saleté de ce prolétariat placé en semi-esclavage.
Puis Orwell reprend sa vie de vagabond et part pour Londres où il décrit la même misère retrouvée .
Ce livre est d'une puissance rare, Orwell trouve les mots justes pour rendre efficace la peinture qu'il réalise de la pauvreté, de la saleté, des ravages de l'alcool et de la maladie.
Il est, sûrement, à la base de toute l'oeuvre et de toute la pensée politique d'Orwell.
Voici un ouvrage que j'aurais pu frôler sans le voir ...Mais , miracle ou hasard , les "godillots " bien " fatigués " de la couverture ont attiré mon regard avant de solliciter , quelques pages plus avant dans le livre , mon odorat plus prompt à s'émouvoir de leur " parfum "que de celui des cêpes qui , aux dires de certains , commencent à pointer leur nez dans les bois .
Bon , je reprends , des godasses , de vulgaires godasses et me voilà en marche ( ! ) dans une ville de Paris , " la ville lumière " qui ne veut et ne voudra jamais de moi au point que je regagnerai la merveilleuse ville de Londres ...qui ne m'accueillera pas mieux ....
Vous aimez Dickens , Hugo et les Misérables ? Oui . ben cherchez plus , vous êtes tout à fait où il faut .La cour des miracles vous tend les bras.Logements insalubres , privation de nourriture , visites jusqu'à " plus rien " au Mont de Piété , mépris , bagarres , moral " en berne " , pas " dans les chaussettes ", hein , à cause de l'odeur .La dèche , vous êtes dans la dèche jusqu'au cou et votre seule consolation est d'y croiser plein de compagnons d'infortune qui ont juste eu le malheur de râter le bon wagon , ceux dont les vies cabossées cachent leur désarroi sous de fausses espérances . Espérer ou mourir.
Cela fait bien longtemps que je n'avais pas été aussi englué dans des pages et des pages au coeur du pire de la condition humaine .La puissance descriptive est incroyablement forte , puissante , émouvante .On avance , on tourne les pages sans que le moindre rayon de soleil ne perce cet univers de misère . La description du travail dans les hôtels parisiens est sublime , criante de vérité , tout comme les hébergements dans les établissements d'accueil des sans- abri en Angleterre .
Le mépris côtoie des scènes d'amitié ou de désespoirs extraordinairement bouleversantes .Il ne se passe pas forcément grand chose sinon ce lancinant et vain " Comment vais je m'en sortir?". Aujourd'hui .....un combat sans fin.
Pour l'auteur , ça s'est arrangé , on le sait .Oui , je vous ne l'ai pas dit , ça se passe au début du siècle dernier...Ouf.La dèche , ça n'existe plus , de nos jours , aujourd'hui , tout le monde baigne dans l'opulence.....
Excusez moi , j'ai dit une bêtise . Mais pourquoi s'émeut on autant de l'atmosphère de ce roman alors qu'aujourd'hui encore , dans les rues de Paris ou ...de Londres....
Pour moi , ce livre est un vrai chef d'oeuvre , l'écriture au service d'une telle ambiance est simplement somptueuse .C'est un extraordinaire voyage dans le monde de la misère et des miséreux , un témoignage sans concession qui se lit avec avidité et dans lequel , malgré une légère
fausse impression de redondance , on attend ...on attend ...comme certains ont attendu Godot .
A bientôt.
Bon , je reprends , des godasses , de vulgaires godasses et me voilà en marche ( ! ) dans une ville de Paris , " la ville lumière " qui ne veut et ne voudra jamais de moi au point que je regagnerai la merveilleuse ville de Londres ...qui ne m'accueillera pas mieux ....
Vous aimez Dickens , Hugo et les Misérables ? Oui . ben cherchez plus , vous êtes tout à fait où il faut .La cour des miracles vous tend les bras.Logements insalubres , privation de nourriture , visites jusqu'à " plus rien " au Mont de Piété , mépris , bagarres , moral " en berne " , pas " dans les chaussettes ", hein , à cause de l'odeur .La dèche , vous êtes dans la dèche jusqu'au cou et votre seule consolation est d'y croiser plein de compagnons d'infortune qui ont juste eu le malheur de râter le bon wagon , ceux dont les vies cabossées cachent leur désarroi sous de fausses espérances . Espérer ou mourir.
Cela fait bien longtemps que je n'avais pas été aussi englué dans des pages et des pages au coeur du pire de la condition humaine .La puissance descriptive est incroyablement forte , puissante , émouvante .On avance , on tourne les pages sans que le moindre rayon de soleil ne perce cet univers de misère . La description du travail dans les hôtels parisiens est sublime , criante de vérité , tout comme les hébergements dans les établissements d'accueil des sans- abri en Angleterre .
Le mépris côtoie des scènes d'amitié ou de désespoirs extraordinairement bouleversantes .Il ne se passe pas forcément grand chose sinon ce lancinant et vain " Comment vais je m'en sortir?". Aujourd'hui .....un combat sans fin.
Pour l'auteur , ça s'est arrangé , on le sait .Oui , je vous ne l'ai pas dit , ça se passe au début du siècle dernier...Ouf.La dèche , ça n'existe plus , de nos jours , aujourd'hui , tout le monde baigne dans l'opulence.....
Excusez moi , j'ai dit une bêtise . Mais pourquoi s'émeut on autant de l'atmosphère de ce roman alors qu'aujourd'hui encore , dans les rues de Paris ou ...de Londres....
Pour moi , ce livre est un vrai chef d'oeuvre , l'écriture au service d'une telle ambiance est simplement somptueuse .C'est un extraordinaire voyage dans le monde de la misère et des miséreux , un témoignage sans concession qui se lit avec avidité et dans lequel , malgré une légère
fausse impression de redondance , on attend ...on attend ...comme certains ont attendu Godot .
A bientôt.
La dèche-pas d'argent- à Paris et à Londres. Il est certain qu'Orwell a connu des moments très difficiles et a mangé de la vache enragée avant de vivre de ses écrits.
Ce récit autobiographique commence dans un hôtel miteux à Paris. Orwell n'est pas encore dans le besoin - il a payé sa semaine - mais il sent qu'il est temps de trouver un travail.
Or, ce n'est pas si facile car la crise est là. Dans ses démarches, il va faire la connaissance de Boris, un Russe Blanc, sans le sou- comme lui- car déchu de ses privilèges en ayant fui la Révolution. Ensemble, ils vont faire la tournée des hôtels pour espérer faire la plonge.
Dans cette dèche, des moments dantesques : que ce soit au fond des cuisines d'un grand hôtel avec un Italien, Mario, à bosser 17h/jour ou dans une chambre, quelques jours sans manger ou encore avec les vagabonds sifflant les pieuses personnes venant prier pour eux...
Malgré sa sinistre position, vivant au jour le jour, on « visite » Paris et Londres avec l'humble Mister Orwell: le Mont-de-Piété, l'East End (oui et ,25 ans après « Le peuple d'en-bas » de Jack London, rien n'a changé !) et quelques hospices ou lodging houses (-10 étoiles ceux-là because les cafards, la vermine et la puanteur).
Ce témoignage d'un grand écrivain qui a vécu dans la misère à Paris et à Londres dans les années 1930, comme celui de Jack London, souligne le peu de cas que l'on fait des gens tombés dans la misère. Orwell précise que l'argent qu'on leur donne par charité (à l'embankment) est très vite perdu pour un logement indigne ou en nourriture insuffisante : le fameux « thé-deux tartines ».
J'ai aimé la colère de London mais j'ai trouvé que l'humilité d'Orwell portait tout aussi bien l'engagement du message.
Ce récit autobiographique commence dans un hôtel miteux à Paris. Orwell n'est pas encore dans le besoin - il a payé sa semaine - mais il sent qu'il est temps de trouver un travail.
Or, ce n'est pas si facile car la crise est là. Dans ses démarches, il va faire la connaissance de Boris, un Russe Blanc, sans le sou- comme lui- car déchu de ses privilèges en ayant fui la Révolution. Ensemble, ils vont faire la tournée des hôtels pour espérer faire la plonge.
Dans cette dèche, des moments dantesques : que ce soit au fond des cuisines d'un grand hôtel avec un Italien, Mario, à bosser 17h/jour ou dans une chambre, quelques jours sans manger ou encore avec les vagabonds sifflant les pieuses personnes venant prier pour eux...
Malgré sa sinistre position, vivant au jour le jour, on « visite » Paris et Londres avec l'humble Mister Orwell: le Mont-de-Piété, l'East End (oui et ,25 ans après « Le peuple d'en-bas » de Jack London, rien n'a changé !) et quelques hospices ou lodging houses (-10 étoiles ceux-là because les cafards, la vermine et la puanteur).
Ce témoignage d'un grand écrivain qui a vécu dans la misère à Paris et à Londres dans les années 1930, comme celui de Jack London, souligne le peu de cas que l'on fait des gens tombés dans la misère. Orwell précise que l'argent qu'on leur donne par charité (à l'embankment) est très vite perdu pour un logement indigne ou en nourriture insuffisante : le fameux « thé-deux tartines ».
J'ai aimé la colère de London mais j'ai trouvé que l'humilité d'Orwell portait tout aussi bien l'engagement du message.
En 1929, George Orwell, à court d'argent après avoir renoncé à l'uniforme de la police impériale qu'il portait en Birmanie, se retrouve à faire la plonge dans un hôtel parisien, avant de gagner Londres dans l'attente d'un travail plus rémunérateur.
Les deux parties du livre sont très différentes. À Paris, la misère contre laquelle il se débat nous vaut un récit rageur qui conjugue la faim et la débrouille. Orwell doit subsister avec 6 francs par jour et découvre qu'il est effectivement possible de vivre ainsi, mais à condition de ne penser qu'à ça, avec une volonté à la fois tendue et rabougrie de ne pouvoir se porter sur une quelconque ambition qui ne soit survivre: "un homme qui a passé ne serait-ce qu'une semaine au régime du pain et de la margarine n'est plus un homme mais uniquement un ventre, avec autour quelques organes annexes."
La grande corporation des pauvres ne songe donc qu'à trouver un lit et de la nourriture et déploie pour ce faire une inventivité sidérante: les uns vendent des vues de la tour Eiffel dans une enveloppe close pour les écouler au prix d'images pornographiques; d'autres se font passer pour une organisation communiste clandestine prête à rétribuer des articles subversifs si tant est que le futur journaliste verse d'abord sa cotisation.
Avoir un travail permet de se sortir de la mouise, mais au prix d'une vie de forçat, de 60 à 100 heures de labeur par semaine. "La femme que je remplaçais avait bien la soixantaine et elle restait rivée à son bac à vaisselle, treize heures par jour, six jours par semaine, toute l'année durant. [...] Cela faisait une curieuse impression de voir que, malgré son âge et sa condition présente, elle continuait à porter une perruque d'un blond éclatant, à se mettre du noir aux yeux et à se maquiller comme une fille de vingt ans. Il faut croire que soixante-dix-huit heures de travail par semaine ne suffisent pas à étouffer toute envie de vivre chez l'être humain."
La description du travail effectué pour faire tourner un restaurant est absolument épique. Dans cette Iliade des cuisines, des héros s'échinent à finir une besogne toujours à recommencer: "Entre minuit et minuit et demi, je faisais de mon mieux pour tâcher de finir la vaisselle. le temps manquant pour faire un travail convenable, je me contentais d'essuyer la graisse qui restait au fond des assiettes avec des serviettes de table. Quant au sol, je le laissais dans l'état où il était ou prenais un balai pour expédier le plus gros de la saleté sous les fourneaux. [...] En général, j'étais au lit à une heure et demie du matin. Il arrivait que je manque la dernière rame, et je devais alors dormir par terre dans le restaurant. Mais je n'en étais pas à ça près : à pareille heure, j'aurais dormi sur les pavés."
À Londres, en revanche, Orwell, qui sait que la vache enragée va bientôt se terminer pour lui, se contente d'aller d'un asile de pauvres à un autre en attendant le retour de son futur employeur. le texte devient un reportage, embedded, certes, mais un reportage tout de même, qui étudie l'argot spécifique à la classe ouvrière ou propose un plan propre à améliorer le système des asiles de nuit. C'est loin d'être inintéressant mais le ton plus distancié n'a pas la même force.
Cette expérimentation de la dèche a bien sûr une importance Kapitale dans la gestation des idées socialistes d'Orwell; sa réflexion sur le sens du travail, notamment, vaut le détour.
Il est d'autant plus effrayant de lire sous la plume de cette figure de la gauche anti-stalinienne autant de références antisémites. Avec le plus grand naturel, Orwell signale que les Juifs (qui n'ont jamais d'autre identité) volent plus malheureux qu'eux et vendent leurs propres filles: "Fie-toi à un serpent plutôt qu'à un Juif".
La répétition tranquille de ces horreurs (35 occurrences, quand même !) donne à cette révolte contre la misère prolétaire un goût plus qu'amère que les désordres de notre temps ne risquent pas d'adoucir.
Les deux parties du livre sont très différentes. À Paris, la misère contre laquelle il se débat nous vaut un récit rageur qui conjugue la faim et la débrouille. Orwell doit subsister avec 6 francs par jour et découvre qu'il est effectivement possible de vivre ainsi, mais à condition de ne penser qu'à ça, avec une volonté à la fois tendue et rabougrie de ne pouvoir se porter sur une quelconque ambition qui ne soit survivre: "un homme qui a passé ne serait-ce qu'une semaine au régime du pain et de la margarine n'est plus un homme mais uniquement un ventre, avec autour quelques organes annexes."
La grande corporation des pauvres ne songe donc qu'à trouver un lit et de la nourriture et déploie pour ce faire une inventivité sidérante: les uns vendent des vues de la tour Eiffel dans une enveloppe close pour les écouler au prix d'images pornographiques; d'autres se font passer pour une organisation communiste clandestine prête à rétribuer des articles subversifs si tant est que le futur journaliste verse d'abord sa cotisation.
Avoir un travail permet de se sortir de la mouise, mais au prix d'une vie de forçat, de 60 à 100 heures de labeur par semaine. "La femme que je remplaçais avait bien la soixantaine et elle restait rivée à son bac à vaisselle, treize heures par jour, six jours par semaine, toute l'année durant. [...] Cela faisait une curieuse impression de voir que, malgré son âge et sa condition présente, elle continuait à porter une perruque d'un blond éclatant, à se mettre du noir aux yeux et à se maquiller comme une fille de vingt ans. Il faut croire que soixante-dix-huit heures de travail par semaine ne suffisent pas à étouffer toute envie de vivre chez l'être humain."
La description du travail effectué pour faire tourner un restaurant est absolument épique. Dans cette Iliade des cuisines, des héros s'échinent à finir une besogne toujours à recommencer: "Entre minuit et minuit et demi, je faisais de mon mieux pour tâcher de finir la vaisselle. le temps manquant pour faire un travail convenable, je me contentais d'essuyer la graisse qui restait au fond des assiettes avec des serviettes de table. Quant au sol, je le laissais dans l'état où il était ou prenais un balai pour expédier le plus gros de la saleté sous les fourneaux. [...] En général, j'étais au lit à une heure et demie du matin. Il arrivait que je manque la dernière rame, et je devais alors dormir par terre dans le restaurant. Mais je n'en étais pas à ça près : à pareille heure, j'aurais dormi sur les pavés."
À Londres, en revanche, Orwell, qui sait que la vache enragée va bientôt se terminer pour lui, se contente d'aller d'un asile de pauvres à un autre en attendant le retour de son futur employeur. le texte devient un reportage, embedded, certes, mais un reportage tout de même, qui étudie l'argot spécifique à la classe ouvrière ou propose un plan propre à améliorer le système des asiles de nuit. C'est loin d'être inintéressant mais le ton plus distancié n'a pas la même force.
Cette expérimentation de la dèche a bien sûr une importance Kapitale dans la gestation des idées socialistes d'Orwell; sa réflexion sur le sens du travail, notamment, vaut le détour.
Il est d'autant plus effrayant de lire sous la plume de cette figure de la gauche anti-stalinienne autant de références antisémites. Avec le plus grand naturel, Orwell signale que les Juifs (qui n'ont jamais d'autre identité) volent plus malheureux qu'eux et vendent leurs propres filles: "Fie-toi à un serpent plutôt qu'à un Juif".
La répétition tranquille de ces horreurs (35 occurrences, quand même !) donne à cette révolte contre la misère prolétaire un goût plus qu'amère que les désordres de notre temps ne risquent pas d'adoucir.
Ce n'est peut-être pas la faute de Rousseau s'il s'est retrouvé dans le ruisseau, mais avant de devenir journaliste et écrivain, c'est bien là qu'a été Orwell. Pas longtemps, mais suffisamment pour en connaître toutes des douleurs. Pour les dénoncer ensuite.
Si ses situations furent différentes dans les deux villes, les conséquences furent les mêmes : faim et manque d'argent chroniques, existence de paria, saleté, extrême fatigue. Il a vécu avec ceux qui sont considérés comme la lie de la société britannique et le peuple des semis-esclaves parisiens : ils méritent plus de pitié et de mansuétude que de mépris. Ils sont presque tacitement maintenus dans leurs conditions (nous sommes à la fin des années 1920, de lois sociales point.) Les descriptions des conditions de vie sont dignes de Zola et Dickens.Ce qu'Orwell appelle un "journal de voyage" reste toujours lucide sur sa situation : même si le découragement guette, il observe et analyse. le temps, indispensable pour étayer ses réflexions (sur la politique, les lois, l'argot londonien...) n'a rien atténué à l'expérience de la misère.
Cette expérience fut sans doute à l'origine de son engagement politique socialiste. La trame des ses futurs écrits, romans et articles (il explique dans Why I Write qu'il écrit pour dénoncer les injustices). La raison de sa participation à la guerre d'Espagne aux côtés des Républicains. Il prend fait et cause pour ce peuple de traîne-misère, qu'il a côtoyé de près, que nous côtoyons encore. Et si d'aventure nous y tombons, nous aimerions trouver une main secourable qui nous aide à sortir de la fange.
Si ses situations furent différentes dans les deux villes, les conséquences furent les mêmes : faim et manque d'argent chroniques, existence de paria, saleté, extrême fatigue. Il a vécu avec ceux qui sont considérés comme la lie de la société britannique et le peuple des semis-esclaves parisiens : ils méritent plus de pitié et de mansuétude que de mépris. Ils sont presque tacitement maintenus dans leurs conditions (nous sommes à la fin des années 1920, de lois sociales point.) Les descriptions des conditions de vie sont dignes de Zola et Dickens.Ce qu'Orwell appelle un "journal de voyage" reste toujours lucide sur sa situation : même si le découragement guette, il observe et analyse. le temps, indispensable pour étayer ses réflexions (sur la politique, les lois, l'argot londonien...) n'a rien atténué à l'expérience de la misère.
Cette expérience fut sans doute à l'origine de son engagement politique socialiste. La trame des ses futurs écrits, romans et articles (il explique dans Why I Write qu'il écrit pour dénoncer les injustices). La raison de sa participation à la guerre d'Espagne aux côtés des Républicains. Il prend fait et cause pour ce peuple de traîne-misère, qu'il a côtoyé de près, que nous côtoyons encore. Et si d'aventure nous y tombons, nous aimerions trouver une main secourable qui nous aide à sortir de la fange.
A l'âge de Dix neuf ans, le jeune Georges Orwell s'est engagé dans La Police impériale des Indes. Six ans plus tard, il donne sa démission pour devenir écrivain. Et c'est à Paname qu'il part faire ses premiers pas d'auteur et trainer ses godillots . Sans un sou en poche, il s'installe dans les bas quartiers et loge dans des hôtels minables . Au début, il se débrouille comme il peut, vend ses fringues au Mont de Piété, donne quelques cours d'anglais qui ne suffisent pas pour payer son loyer. Il lui faut alors trouver du travail et il fait appel à une connaissance, un garçon d'hôtel russe du nom de Boris qui pourrait peut-être le faire embaucher mais ce dernier est aussi dans la mouise jusqu'au cou . du coup, ils vont devenir pôtes de galère et tenter de travailler dans la restauration. Après de longues journées d'errance sans fin, c'est à la plonge d'un grand hôtel restaurant que Georges va finalement suer, récurer, lessiver, trimer pour un salaire de misère qui lui permet tout juste de manger à sa faim. Ce job lui ouvrira les yeux sur les conditions du sous-prolétariat et sur la saleté et la crasse des hôtels de luxe parisiens... Nostalgique, La sauce à la menthe manque à l'English et le voilà parti pour Londres où il retrouve la même misère avec d'autres potes d'infortune comme Bozo l'artiste ou Paddy le mendiant...
Ce livre décrit l'expérience vécue par George Orwell à Paris et à Londres. Il a connu la dèche, la galère, la faim, les hôtels et asiles borgnes et surtout fait des rencontres inoubliables et lié d'amitié avec des personnages pittoresques, des vagabonds, des trimardeurs et autres traine-savates rencontrés dans les rues de Paris ou dans les asiles de Londres. Son journal de voyage qu'il qualifie de banal dans ses dernières pages rend hommage à tous ceux qui vivent en marge. Il conclut par ceci : "Jamais plus je ne considérai tous les chemineaux comme des vauriens ou des poivrots, jamais plus je ne m'attendrai à ce qu'un mendiant me témoigne de sa gratitude lorsque je lui aurai glissé une pièce, jamais plus je ne m'étonnerai que les chômeurs manquent d'énergie. Jamais plus je ne verserai la moindre obole à l'Armée du Salut, ni ne mettrai mes habits en gage, ni ne refuserai un prospectus qu'on me tend, ni ne m'attablerai en salivant par avance dans un grand restaurant."
Ce livre décrit l'expérience vécue par George Orwell à Paris et à Londres. Il a connu la dèche, la galère, la faim, les hôtels et asiles borgnes et surtout fait des rencontres inoubliables et lié d'amitié avec des personnages pittoresques, des vagabonds, des trimardeurs et autres traine-savates rencontrés dans les rues de Paris ou dans les asiles de Londres. Son journal de voyage qu'il qualifie de banal dans ses dernières pages rend hommage à tous ceux qui vivent en marge. Il conclut par ceci : "Jamais plus je ne considérai tous les chemineaux comme des vauriens ou des poivrots, jamais plus je ne m'attendrai à ce qu'un mendiant me témoigne de sa gratitude lorsque je lui aurai glissé une pièce, jamais plus je ne m'étonnerai que les chômeurs manquent d'énergie. Jamais plus je ne verserai la moindre obole à l'Armée du Salut, ni ne mettrai mes habits en gage, ni ne refuserai un prospectus qu'on me tend, ni ne m'attablerai en salivant par avance dans un grand restaurant."
Paru en 1933, « Dans la dèche à Paris et à Londres » peut de prime abord se lire comme un récit autobiographique dans la mesure où George Orwell nous y narre par le menu ses pérégrinations au coeur de la pauvreté parisienne puis londonienne. Pourtant, l'auteur n'a de cesse de digresser ici et là, de prendre de la hauteur, et même de formaliser des propositions qui permettraient d'améliorer le sort des plus pauvres. S'il n'en a pas la rigueur formelle, l'ouvrage peut ainsi également se lire comme un essai comparatif consacré à la manière dont est vécu le dénuement dans les deux grandes capitales européennes.
Dans la première partie, Orwell revient sur les quelques semaines passées à Paris au début des années trente, où il parvient tout juste à joindre les deux bouts en travaillant comme un forçat dans l'hôtellerie. Dans la seconde partie, l'auteur rejoint Londres où il partage l'existence des trimardeurs, ces hommes à la limite de la clochardise, qui vivent d'expédients et battent le bitume pour rejoindre chaque nuit un « asile » qui les accueillera dans des conditions proches du cauchemar.
L'auteur n'est pas absolument explicite à ce sujet mais on devine qu'il s'est imposé de partager les conditions de vie des plus précaires afin de pouvoir les relater en toute objectivité. Avant d'écrire la dystopie anti-totalitaire la plus célèbre de la littérature, on peut ainsi se demander si Orwell n'a pas inventé le journalisme gonzo, formalisé plusieurs décennies plus tard par Hunter S.Thomson, l'auteur du génial « Las Vegas Parano ». Écrit à la première personne, « Dans la dèche à Paris et à Londres » est une plongée forcément subjective dans la pauvreté effarante des années trente à Paris puis à Londres.
Malgré la rudesse de son travail de plongeur dans un grand hôtel parisien, la première partie est plus joviale et moins monotone que la seconde où l'auteur mène une vie de « cheminot » londonien. Orwell loue une chambre de bonne vétuste, est constamment à court d'argent, travaille jusqu'à 17 heures par jour, et pourtant un tumulte joyeux et souvent alcoolisé l'emporte sur la misère. L'auteur y rencontre une multitude de personnages hauts en couleur, souvent immigrés, pour la plupart des russes blancs fuyant la révolution bolchevique. L'inénarrable Boris devient le compagnon d'infortune d'Orwell, n'est jamais à court de projets et fait preuve d'un inaltérable optimisme qui confine à la folie douce. Il entraine notamment le narrateur dans l'ouverture aventureuse d'un restaurant « chic », qui verra ce dernier, employé comme homme à tout à faire, finir par jeter l'éponge et se décider à rejoindre Londres.
Le volet parisien de l'ouvrage nous décrit une capitale tumultueuse, pittoresque, et pleine de vie malgré l'incroyable pauvreté dans laquelle se démène une foule aussi indocile qu'industrieuse. le volet londonien est plus sombre et plus miséreux encore : Orwell y arrive sans le sou et ne survit que grâce à l'argent offert par un ami. Il n'y trouve pas de véritable emploi et partage la quotidien des trimardeurs, qui sont sans cesse sur la route, car le règlement des « asiles » leur interdit de rester plusieurs nuits d'affilée. Si l'auteur y côtoie la misère, la vraie, ce second volet n'est jamais misérable, sauvé par l'humour décapant de ses compagnons d'infortune, pour la plupart illettrés et à la santé trop souvent précaire. Il est interdit de mendier et de dormir sous les ponts. Les pauvres hères sont ainsi condamnés à exercer des activités improbables de peintres de rue, de chanteurs ou de photographes itinérants tout en cherchant sans cesse le gîte qui pourra les héberger pour la nuit à venir. Entre deux nuitées mouvementées, ils tentent de se sustenter auprès d'organismes religieux qui leur offrent un repas en échange d'un sermon assommant ou de la participation surréaliste à une prière de groupe.
« Dans la dèche à Paris et à Londres » est un livre d'une étonnante sincérité, d'un homme éduqué qui a délibérément choisi de partager la condition des plus démunis, et nous narre dans le détail une plongée terrifiante au coeur des ténèbres de la misère. le contraste entre le tumulte industrieux de l'épisode parisien et la triste monotonie de l'épisode londonien est saisissant. Et pourtant, l'aspect plus touchant d'un ouvrage qui côtoie la misère sans jamais sombrer dans le misérabilisme, est la dignité, la pointe d'auto-dérision, la profonde humanité des hommes et des femmes que fréquente George Orwell durant son séjour au sein des bas-fonds, quel que soit le côté de la Manche où ils se trouvent.
Dans la première partie, Orwell revient sur les quelques semaines passées à Paris au début des années trente, où il parvient tout juste à joindre les deux bouts en travaillant comme un forçat dans l'hôtellerie. Dans la seconde partie, l'auteur rejoint Londres où il partage l'existence des trimardeurs, ces hommes à la limite de la clochardise, qui vivent d'expédients et battent le bitume pour rejoindre chaque nuit un « asile » qui les accueillera dans des conditions proches du cauchemar.
L'auteur n'est pas absolument explicite à ce sujet mais on devine qu'il s'est imposé de partager les conditions de vie des plus précaires afin de pouvoir les relater en toute objectivité. Avant d'écrire la dystopie anti-totalitaire la plus célèbre de la littérature, on peut ainsi se demander si Orwell n'a pas inventé le journalisme gonzo, formalisé plusieurs décennies plus tard par Hunter S.Thomson, l'auteur du génial « Las Vegas Parano ». Écrit à la première personne, « Dans la dèche à Paris et à Londres » est une plongée forcément subjective dans la pauvreté effarante des années trente à Paris puis à Londres.
Malgré la rudesse de son travail de plongeur dans un grand hôtel parisien, la première partie est plus joviale et moins monotone que la seconde où l'auteur mène une vie de « cheminot » londonien. Orwell loue une chambre de bonne vétuste, est constamment à court d'argent, travaille jusqu'à 17 heures par jour, et pourtant un tumulte joyeux et souvent alcoolisé l'emporte sur la misère. L'auteur y rencontre une multitude de personnages hauts en couleur, souvent immigrés, pour la plupart des russes blancs fuyant la révolution bolchevique. L'inénarrable Boris devient le compagnon d'infortune d'Orwell, n'est jamais à court de projets et fait preuve d'un inaltérable optimisme qui confine à la folie douce. Il entraine notamment le narrateur dans l'ouverture aventureuse d'un restaurant « chic », qui verra ce dernier, employé comme homme à tout à faire, finir par jeter l'éponge et se décider à rejoindre Londres.
Le volet parisien de l'ouvrage nous décrit une capitale tumultueuse, pittoresque, et pleine de vie malgré l'incroyable pauvreté dans laquelle se démène une foule aussi indocile qu'industrieuse. le volet londonien est plus sombre et plus miséreux encore : Orwell y arrive sans le sou et ne survit que grâce à l'argent offert par un ami. Il n'y trouve pas de véritable emploi et partage la quotidien des trimardeurs, qui sont sans cesse sur la route, car le règlement des « asiles » leur interdit de rester plusieurs nuits d'affilée. Si l'auteur y côtoie la misère, la vraie, ce second volet n'est jamais misérable, sauvé par l'humour décapant de ses compagnons d'infortune, pour la plupart illettrés et à la santé trop souvent précaire. Il est interdit de mendier et de dormir sous les ponts. Les pauvres hères sont ainsi condamnés à exercer des activités improbables de peintres de rue, de chanteurs ou de photographes itinérants tout en cherchant sans cesse le gîte qui pourra les héberger pour la nuit à venir. Entre deux nuitées mouvementées, ils tentent de se sustenter auprès d'organismes religieux qui leur offrent un repas en échange d'un sermon assommant ou de la participation surréaliste à une prière de groupe.
« Dans la dèche à Paris et à Londres » est un livre d'une étonnante sincérité, d'un homme éduqué qui a délibérément choisi de partager la condition des plus démunis, et nous narre dans le détail une plongée terrifiante au coeur des ténèbres de la misère. le contraste entre le tumulte industrieux de l'épisode parisien et la triste monotonie de l'épisode londonien est saisissant. Et pourtant, l'aspect plus touchant d'un ouvrage qui côtoie la misère sans jamais sombrer dans le misérabilisme, est la dignité, la pointe d'auto-dérision, la profonde humanité des hommes et des femmes que fréquente George Orwell durant son séjour au sein des bas-fonds, quel que soit le côté de la Manche où ils se trouvent.
En 1928, George Orwell s'installe à Paris en faisant le voeu d'y vivre de sa plume. Commence alors une période de précarité durant laquelle il va connaître la pauvreté et les tourments de la faim. Logeant dans des meublés insalubres, il est contraint de travailler comme plongeur dans des conditions proches de l'esclavage. Il regagne ensuite l'Angleterre où il va partager la vie des vagabonds. Il publie ce texte semi-autobiographique en 1933. L'ouvrage paraît en France deux ans plus tard sous ce titre magnifique : "La vache enragée". Son objectif est de soulever un coin du voile qui couvre la misère pour éveiller les consciences. Orwell dresse le portrait de personnages pittoresques et rapporte des anecdotes insolites. Il est vrai que le peuple des bas-fonds est haut en couleurs et riche de "légendes urbaines" décapantes. Entre ces récits, l'auteur analyse les conditions d'existence et de travail du lumpenproletariat et la gestion par l'Etat anglais des mendiants et des vagabonds. Il condamne un système pervers qui entretient la misère plutôt que de la résoudre et lutte contre les préjugés touchant les plus pauvres. George Orwell livre un tableau émouvant des bas-fonds de Paris et de Londres dont il parvient à retranscrire l'ambiance au travers d'histoires cocasses, sordides ou poignantes. Il reste d'une profonde humanité sans jamais tomber dans le pathétique ou la propagande. Son témoignage n'en a que plus de valeur.
Privilège de l'âge, j'ai retrouvé dans les arrières rayons de ma bibliothèque une édition de LA VACHE ENRAGEE de Georges Orwell, dépôt légal 1935, imprimé en novembre 1957.
Il me souvient avoir acheté ce volume dans les années 1980.
Dans la somptueuse préface de Istrati Panaït, écrite à Bucarest en mars 1935 figure un avertissement dès la première ligne dont le lecteur se souviendra en fermant le livre, "Je ne sais pas quel est le genre des romans qu'écrit habituellement Georges Orwell, mais la Vache Enragée est une oeuvre rarissime à notre époque, principalement par la pureté de sa facture, je veux dire par l'absence totale de phraséologie littéraire."
Tout est dit dans ces quelques mots.
La situation dans laquelle se trouve alors le lecteur contemporain qui vient à la Vache Enragée après 1984 est l'exact contrepoint dee celle dans laquelle se trouvait Istrati Panaït, lui qui ignorait encore que l'auteur peu connu dont il préfaçait un ouvrage écrirait un jour 1984.
Et de conclure ""L'art littéraire retrouvera ce naturel-là, ou bien il mourra pour longtemps"
Il fallait que cela fut dit.
Le roman commence Rue du Coq d'Or à Paris à sept heures du matin, et se termine à l'asile de Lower Binfield à Cromley près de Londres.
Entre les deux, un parcours vertigineux chez les les chemineaux, les mendiants et les chômeurs.
"Le sujet de mon livre c'est la mouise, et c'est là que j'ai pris contact avec elle, pour la première fois."
Jules, le Roumain, Roucolle, l'avare, Furex le maçon limousin, le père Laurent, le chiffonnier, furent ses compagnons. Ses maîtres. Ses initiateurs à la débrouille.
Orwell décrit sans emphase mais avec une grande précision la vie au Coq d'Or, au bistrot du rez-de-chaussée de l'Hôtel des Trois Moineaux.
Madame Monce invective ses clients. La boulangère se soucie peu de vous couper un morceau de pain dont le prix dépassera les vingt sous que vous pouviez consacrer à cet achat. Et pour y parvenir Orwell travaille quatorze heures par jour à laver la vaisselle de la salle à manger.
Avec un sérieux que l'on a du mal à imaginer venant de quelquun qui est sous la contrainte permanente du temps, Orwell aligne les détails sur la façon dont se passe la plonge, les facéties des serveurs, la bonhommie apparente des bistrotiers qui sont de véritables négriers et la passivité des clients auxquels on fait avaler n'importe quoi dans la bonne humeur.
Cela sans compter les vingt-deux kilomètres parcourus chaque jour, et la fatigue "plus cérébrale que musculaire" nous dit Orwell.
"Il reste trente francs par semaine à dépenser pour boire."
Rien ne nous empêche de penser que la situation des serveurs aujourd'hui n'est guère plus enviable...
A Londres, la mouise est plus british...
"J'étais dans la rue avant qu'il me fut venu à l'esprit d'emprunter quelque argent."
Impossible pour Orwell d'attendre le retour de ses employeurs potentiels dans un mois, avec seulement une livre en poche.
Une seule solution, les asiles de l'Armée du Salut, qu'on ne peut fréquenter deux nuits de suite, le ramassage des mégots dans les rues avec l'Irlandais, les chants religieux obligatoires, l'observation des météores avec Bozo, toutes sortes d'occupation pour passer le temps et économiser sur le quotidien.
Vingt quatre kilomètres à pied plus loin arrivés à Cromley Orwell et son ami Paddy parviennent à un asile de nuit. Nouveaux compagnons, nouvelles histoires, mêmes regards portés sur eux par les villageois peu compatissants.
Leçon d'humanité.
"Jamais plus je ne considérerai tous les chemineaux comme des ivrognes et des coquins."
Un livre d'actualité malgré ses 85 ans...Hélas !
Lien : https://camalonga.wordpress...
Il me souvient avoir acheté ce volume dans les années 1980.
Dans la somptueuse préface de Istrati Panaït, écrite à Bucarest en mars 1935 figure un avertissement dès la première ligne dont le lecteur se souviendra en fermant le livre, "Je ne sais pas quel est le genre des romans qu'écrit habituellement Georges Orwell, mais la Vache Enragée est une oeuvre rarissime à notre époque, principalement par la pureté de sa facture, je veux dire par l'absence totale de phraséologie littéraire."
Tout est dit dans ces quelques mots.
La situation dans laquelle se trouve alors le lecteur contemporain qui vient à la Vache Enragée après 1984 est l'exact contrepoint dee celle dans laquelle se trouvait Istrati Panaït, lui qui ignorait encore que l'auteur peu connu dont il préfaçait un ouvrage écrirait un jour 1984.
Et de conclure ""L'art littéraire retrouvera ce naturel-là, ou bien il mourra pour longtemps"
Il fallait que cela fut dit.
Le roman commence Rue du Coq d'Or à Paris à sept heures du matin, et se termine à l'asile de Lower Binfield à Cromley près de Londres.
Entre les deux, un parcours vertigineux chez les les chemineaux, les mendiants et les chômeurs.
"Le sujet de mon livre c'est la mouise, et c'est là que j'ai pris contact avec elle, pour la première fois."
Jules, le Roumain, Roucolle, l'avare, Furex le maçon limousin, le père Laurent, le chiffonnier, furent ses compagnons. Ses maîtres. Ses initiateurs à la débrouille.
Orwell décrit sans emphase mais avec une grande précision la vie au Coq d'Or, au bistrot du rez-de-chaussée de l'Hôtel des Trois Moineaux.
Madame Monce invective ses clients. La boulangère se soucie peu de vous couper un morceau de pain dont le prix dépassera les vingt sous que vous pouviez consacrer à cet achat. Et pour y parvenir Orwell travaille quatorze heures par jour à laver la vaisselle de la salle à manger.
Avec un sérieux que l'on a du mal à imaginer venant de quelquun qui est sous la contrainte permanente du temps, Orwell aligne les détails sur la façon dont se passe la plonge, les facéties des serveurs, la bonhommie apparente des bistrotiers qui sont de véritables négriers et la passivité des clients auxquels on fait avaler n'importe quoi dans la bonne humeur.
Cela sans compter les vingt-deux kilomètres parcourus chaque jour, et la fatigue "plus cérébrale que musculaire" nous dit Orwell.
"Il reste trente francs par semaine à dépenser pour boire."
Rien ne nous empêche de penser que la situation des serveurs aujourd'hui n'est guère plus enviable...
A Londres, la mouise est plus british...
"J'étais dans la rue avant qu'il me fut venu à l'esprit d'emprunter quelque argent."
Impossible pour Orwell d'attendre le retour de ses employeurs potentiels dans un mois, avec seulement une livre en poche.
Une seule solution, les asiles de l'Armée du Salut, qu'on ne peut fréquenter deux nuits de suite, le ramassage des mégots dans les rues avec l'Irlandais, les chants religieux obligatoires, l'observation des météores avec Bozo, toutes sortes d'occupation pour passer le temps et économiser sur le quotidien.
Vingt quatre kilomètres à pied plus loin arrivés à Cromley Orwell et son ami Paddy parviennent à un asile de nuit. Nouveaux compagnons, nouvelles histoires, mêmes regards portés sur eux par les villageois peu compatissants.
Leçon d'humanité.
"Jamais plus je ne considérerai tous les chemineaux comme des ivrognes et des coquins."
Un livre d'actualité malgré ses 85 ans...Hélas !
Lien : https://camalonga.wordpress...
Il était modeste George Orwell. Selon lui, il lui aurait fallu « la plume d'un Zola » pour procéder à la description d'un moment passé dans l'hôtel X où il a travaillé à Paris. La plume d'un Zola ? Ce n'est que mon point de vue de lectrice, mais je pense que cela n'aurait pas été nécessaire. Car ce récit de George Orwell, qu'il jugeait lui-même « banal » (c'est trop de modestie !) est incroyablement riche, que ce soit en descriptions, en détails et en ressentis. Si bien qu'il est très simple de plonger dedans, de patauger avec les plongeurs, les trimardeurs et les chemineaux, de comprendre la faim, l'ennui et le désoeuvrement que subissent ces marginaux et de ressentir beaucoup d'injustice.
On ne sait pas très bien comment George Orwell s'est retrouvé à Paris. En tout cas, il ne l'explique pas dans son livre. On sait en revanche comment il s'y est retrouvé dans la dèche : il s'est fait volé une partie de ses économies et il a perdu son travail de professeur particulier. A partir de là, il raconte toutes les étapes de sa descente aux enfers – un enfer qui prend la forme à Paris des caves de l'hôtel X où il était plongeur, et à Londres de la puanteur et de la vétusté des asiles de nuit à quelques pence. Et ce récit est édifiant. Vivre plusieurs jours sans manger ? C'est possible. Infernal, certes, mais possible car il l'a fait. Ne pas pouvoir fermer l'oeil de la nuit dans une chambre infestée de punaises ? Ça aussi. Se nourrir de thé, de pain rassis et de margarine pendant des semaines ? Ce fut son régime. Alors forcément, quand on vit de cette façon, quand on côtoie de près des mendiants, quand on comprend ce que signifie la malnutrition et quand on doit mettre ses vêtements « au clou » pour s'acheter une miche de pain, il y a de quoi gamberger. Et ça donne Dans la dèche à Paris et à Londres.
Et au coeur de ce récit, Orwell livre quelques réflexions personnelles. La première concerne les « besognes aussi fastidieuses qu'inutiles ». Pour lui, et parce qu'il a dû travailler dix-sept heures par jour pour un salaire qui lui permettait à peine de payer sa chambre et de se nourrir, le plongeur est un « esclave » qui n'a aucune vie personnelle et ne peut espérer fonder une famille. Il explique notamment qu'on « continue à lui imposer ce travail parce que règne confusément chez les riches le sentiment que, s'il avait quelques moments à lui, cet esclave pourrait se révéler dangereux ». On sent déjà 1984, non ? La deuxième réflexion d'Orwell concerne la misère qui n'est, écrivait-il, « pas seulement insupportable par les souffrances qu'elle cause, mais aussi et surtout en ceci qu'elle pourrit un homme au physique comme au mental ». Et on les ressent bien les privations de toutes sortes, l'oisiveté forcée (celle-ci n'est pas considérée comme un « danger » par les plus riches car les mendiants, tenaillés par la faim, n'ont pas la force de se révolter) et la vie de vagabondage à laquelle ils sont réduits. Orwell, qui a vécu cette vie de chemineau en attendant de prendre son poste à Londres, les explique parfaitement. Et tous ces détails lui permettent, enfin, d'interroger les lecteurs que nous sommes : qu'est-ce qui donne donc le droit à la société de les mépriser ?
C'est peut-être un peu long pour dire que j'ai trouvé ce récit vraiment très intéressant et bouleversant par endroits. Evidemment, certains éléments sont obsolètes (les dépôts de mendicité, le travail de plongeur tel qu'il est décrit dans ce livre, le trimard, les chemineaux, etc.) mais il reste très actuel sur beaucoup de choses (le travail, la pauvreté, etc.) et il permet de réfléchir. Un récit fascinant !
On ne sait pas très bien comment George Orwell s'est retrouvé à Paris. En tout cas, il ne l'explique pas dans son livre. On sait en revanche comment il s'y est retrouvé dans la dèche : il s'est fait volé une partie de ses économies et il a perdu son travail de professeur particulier. A partir de là, il raconte toutes les étapes de sa descente aux enfers – un enfer qui prend la forme à Paris des caves de l'hôtel X où il était plongeur, et à Londres de la puanteur et de la vétusté des asiles de nuit à quelques pence. Et ce récit est édifiant. Vivre plusieurs jours sans manger ? C'est possible. Infernal, certes, mais possible car il l'a fait. Ne pas pouvoir fermer l'oeil de la nuit dans une chambre infestée de punaises ? Ça aussi. Se nourrir de thé, de pain rassis et de margarine pendant des semaines ? Ce fut son régime. Alors forcément, quand on vit de cette façon, quand on côtoie de près des mendiants, quand on comprend ce que signifie la malnutrition et quand on doit mettre ses vêtements « au clou » pour s'acheter une miche de pain, il y a de quoi gamberger. Et ça donne Dans la dèche à Paris et à Londres.
Et au coeur de ce récit, Orwell livre quelques réflexions personnelles. La première concerne les « besognes aussi fastidieuses qu'inutiles ». Pour lui, et parce qu'il a dû travailler dix-sept heures par jour pour un salaire qui lui permettait à peine de payer sa chambre et de se nourrir, le plongeur est un « esclave » qui n'a aucune vie personnelle et ne peut espérer fonder une famille. Il explique notamment qu'on « continue à lui imposer ce travail parce que règne confusément chez les riches le sentiment que, s'il avait quelques moments à lui, cet esclave pourrait se révéler dangereux ». On sent déjà 1984, non ? La deuxième réflexion d'Orwell concerne la misère qui n'est, écrivait-il, « pas seulement insupportable par les souffrances qu'elle cause, mais aussi et surtout en ceci qu'elle pourrit un homme au physique comme au mental ». Et on les ressent bien les privations de toutes sortes, l'oisiveté forcée (celle-ci n'est pas considérée comme un « danger » par les plus riches car les mendiants, tenaillés par la faim, n'ont pas la force de se révolter) et la vie de vagabondage à laquelle ils sont réduits. Orwell, qui a vécu cette vie de chemineau en attendant de prendre son poste à Londres, les explique parfaitement. Et tous ces détails lui permettent, enfin, d'interroger les lecteurs que nous sommes : qu'est-ce qui donne donc le droit à la société de les mépriser ?
C'est peut-être un peu long pour dire que j'ai trouvé ce récit vraiment très intéressant et bouleversant par endroits. Evidemment, certains éléments sont obsolètes (les dépôts de mendicité, le travail de plongeur tel qu'il est décrit dans ce livre, le trimard, les chemineaux, etc.) mais il reste très actuel sur beaucoup de choses (le travail, la pauvreté, etc.) et il permet de réfléchir. Un récit fascinant !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de George Orwell (63)
Voir plus
Quiz
Voir plus
La ferme des animaux
Qui est Mr Jones en Russie?
le tsar Nicolas I
le tsar Nicolas II
Trotski
Lénine
8 questions
1853 lecteurs ont répondu
Thème : La ferme des animaux de
George OrwellCréer un quiz sur ce livre1853 lecteurs ont répondu