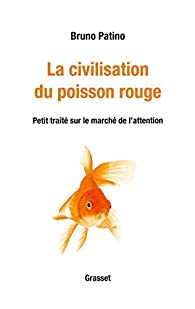Je ne trouve pas ce traité aussi alarmiste et terrifiant que ce que j'aurais pu imaginer.
Au contraire, je lui trouve une grande force dans sa lucidité et son côté très tourné vers les solutions pour se dépêtrer de cette aliénation du numérique qui semble tous nous concerner.
Au contraire, je lui trouve une grande force dans sa lucidité et son côté très tourné vers les solutions pour se dépêtrer de cette aliénation du numérique qui semble tous nous concerner.
Livre intéressant mais si vous avez déjà lu ou écouté quelques articles/émissions sur le sujet vous apprendrez pas grand chose.
Mais le livre a le mérite, dans ce cas, de synthétiser et d'être relativement bien exhaustif sur le sujet.
Si le sujet est à défricher pour vous, c'est un bon livre pour vous.
Mais le livre a le mérite, dans ce cas, de synthétiser et d'être relativement bien exhaustif sur le sujet.
Si le sujet est à défricher pour vous, c'est un bon livre pour vous.
Un court essai de 147 pages sur l'impact de l'utilisation de nos téléphones sur notre capacité d'attention qui m'a beaucoup plu.
« […] La formule initiale du Web était fondée sur le pouvoir égalisateur de la connexion. Chaque utilisateur pouvait avoir accès à toute l'information et toute la connaissance, et, dans ce système décentralisé, chacun semblait jouir de la même dose de pouvoir. Aujourd'hui, il y a ceux qui espionnent et ceux qui sont espionnés, que ce soit par des États ou des entreprises avides de données. L'égalité parfaite a engendré une asymétrie inédite. Comme l'explique Berners-Lee, « personne n'a rien volé, mais il y a eu captation et accumulation. Facebook, Google, Amazon, avec quelques agences, sont capables de contrôler, manipuler et espionner comme nul autre auparavant ». »
Des sociétés numériques qui ont pris le contrôle d'Internet, des experts de la psychologie et des comportements humains qui bâtissent les réseaux et sites que nous utilisons au quotidien et nous « la tête baissée vers notre smartphone, comme pétrifiés dans une position de soumission universelle ».
Cette dernière image m'a beaucoup fait réfléchir sur mon propre rapport aux réseaux sociaux, et à mon téléphone plus généralement. Je savais déjà que j'y passais beaucoup plus de temps que souhaité mais j'avais besoin de comprendre comment je me faisais avoir par tous ces algorithmes qui rendaient addict.
Finalement, j'ai un peu déculpabilisé en comprenant qui se cachait derrière la conception de nos applications tant convoitées et la vérité fait peur. Leurs fondateurs ont une grande part de responsabilité et doivent maintenant travailler à rendre ces espaces plus sains. Mais soyons réalistes, c'est à nous de reprendre le contrôle sur notre consommation, en gardant à l'esprit que tout est fait pour que nous devenions des utilisateurs accros.
J'ai beaucoup apprécié cet ouvrage car il offre des solutions qui ne rejettent pas complètement les réseaux mais apprennent à en tirer le meilleur.
« Lutter contre la domination de l'économie de l'attention qui nous plonge dans l'addiction n'est pas un refus de la société numérique. C'est au contraire la réinstaller dans un projet porteur d'utopie, et réinstaurer une perspective de long terme sur le cauchemar de court terme. Rappeler les incroyables potentialités émancipatrices d'un numérique qui permet un accès universel à l'information, au savoir et à l'expression du partage, le dépassement des frontières spatiales et temporelles, les avancées en termes de santé, la possibilité d'une construction d'une nouvelle forme de démocratie fondée sur la mobilisation et la collaboration délibératrice. »
J'espère avoir pu vous transmettre mon intérêt pour ce livre et vous donner, à votre tour, envie de repenser votre rapport au monde connecté.
« […] La formule initiale du Web était fondée sur le pouvoir égalisateur de la connexion. Chaque utilisateur pouvait avoir accès à toute l'information et toute la connaissance, et, dans ce système décentralisé, chacun semblait jouir de la même dose de pouvoir. Aujourd'hui, il y a ceux qui espionnent et ceux qui sont espionnés, que ce soit par des États ou des entreprises avides de données. L'égalité parfaite a engendré une asymétrie inédite. Comme l'explique Berners-Lee, « personne n'a rien volé, mais il y a eu captation et accumulation. Facebook, Google, Amazon, avec quelques agences, sont capables de contrôler, manipuler et espionner comme nul autre auparavant ». »
Des sociétés numériques qui ont pris le contrôle d'Internet, des experts de la psychologie et des comportements humains qui bâtissent les réseaux et sites que nous utilisons au quotidien et nous « la tête baissée vers notre smartphone, comme pétrifiés dans une position de soumission universelle ».
Cette dernière image m'a beaucoup fait réfléchir sur mon propre rapport aux réseaux sociaux, et à mon téléphone plus généralement. Je savais déjà que j'y passais beaucoup plus de temps que souhaité mais j'avais besoin de comprendre comment je me faisais avoir par tous ces algorithmes qui rendaient addict.
Finalement, j'ai un peu déculpabilisé en comprenant qui se cachait derrière la conception de nos applications tant convoitées et la vérité fait peur. Leurs fondateurs ont une grande part de responsabilité et doivent maintenant travailler à rendre ces espaces plus sains. Mais soyons réalistes, c'est à nous de reprendre le contrôle sur notre consommation, en gardant à l'esprit que tout est fait pour que nous devenions des utilisateurs accros.
J'ai beaucoup apprécié cet ouvrage car il offre des solutions qui ne rejettent pas complètement les réseaux mais apprennent à en tirer le meilleur.
« Lutter contre la domination de l'économie de l'attention qui nous plonge dans l'addiction n'est pas un refus de la société numérique. C'est au contraire la réinstaller dans un projet porteur d'utopie, et réinstaurer une perspective de long terme sur le cauchemar de court terme. Rappeler les incroyables potentialités émancipatrices d'un numérique qui permet un accès universel à l'information, au savoir et à l'expression du partage, le dépassement des frontières spatiales et temporelles, les avancées en termes de santé, la possibilité d'une construction d'une nouvelle forme de démocratie fondée sur la mobilisation et la collaboration délibératrice. »
J'espère avoir pu vous transmettre mon intérêt pour ce livre et vous donner, à votre tour, envie de repenser votre rapport au monde connecté.
J'ai été déçu par ce court essai sur l'économie de l'attention et le poids occupé par les réseaux sociaux. J'ai eu le sentiment que l'auteur ne prenait pas le recul suffisant et tournait autour du "c'était mieux avant". Il attribue notamment à ces nouveaux médias toute une série de nouvelles dérives : bulles d'opinion, complotisme, captation de l'attention en permanence, matraquage publicitaire, isolement... Or il me semble que rien de tout cela ne soit nouveau, ces comportements sont des invariants au fil des époques et des cultures. Simplement, leur forme est nouvelle, puisqu'elle épouse celle des réseaux sociaux. Mais en présentant ces caractères comme le mal de notre époque, comme des risques issus du rôle prépondérant qu'occupent les GAFA dans nos vies, j'ai eu le sentiment que l'auteur manquait sa cible. Lorsqu'on lit en parallèle Balzac, Maupassant ou Zola, on a plutôt l'impression que rien n'a vraiment changé depuis l'essor du capitalisme.
Je reste sur ma faim. J'aurais souhaité une analyse plus poussée et avec plus de sources. On survole le sujet, trop de poncifs. le style est bon mais pas dingue non plus. Parfois je me suis même ennuyée. C'est dommage car on sent que tous les éléments étaient là pour en faire quelque chose de bien mais ça été mal exploité.
Court livre très documenté pour mieux comprendre nos travers psychologiques (l'attrait pour le sensationnel et notre difficulté à questionner les plaisirs faciles et immédiats même s'ils peuvent devenir nocifs) et comment ils sont exploités par les algorithmes des plateformes des différents réseaux sociaux pour nous rendre adictes et générer des profits énormes.
Fréquentons bibliothèques et librairies indépendantes (et boycottons Amazon) et essayons de limiter à 1/2h par jour et 5 jours sur 7 l'utilisation de ces applications qui ne nous veulent pas du bien !
Le risque ? Finir déprimé, angoissé de ne rien avoir à raconter pour faire le buzz, stresser à l'idée de rater un événement ou de ne pas être liké, finir schizophrène de ne plus savoir qui nous sommes tant la vie idyllique mis en avant via les réseaux sociaux est fausse,... Risque aussi en terme d'information : ce n'est plus la véracité de l'information qui prime sur les reseaux sociaux, mais son financement.
Article sérieux, divertissement, propagande éhontée ou simple canular entrent en concurrence. Or "faire payer le consommateur d'information pour l'intégralité de son coût de production, c'est risquer de réserver l'accès à l'information à une minorité, et provoquer des externalités négatives : dégradation du débat public, impossibilité d'avoir un système démocratique stable non pas à cause de la différence d'opinion, mais à cause de la différence du niveau d'information."
Quelques solutions sont proposées. Une retiens particulièrement mon attention : "Notre modèle de société est structurellement tourné vers l'accélération, et toute mesure de ralentissement, dans quelque domaine que ce soit, l'information, les médias, les conversations, en réseau ou non, la consommation même, est une mesure de résistance. C'est aussi une mesure de libération."
Fréquentons bibliothèques et librairies indépendantes (et boycottons Amazon) et essayons de limiter à 1/2h par jour et 5 jours sur 7 l'utilisation de ces applications qui ne nous veulent pas du bien !
Le risque ? Finir déprimé, angoissé de ne rien avoir à raconter pour faire le buzz, stresser à l'idée de rater un événement ou de ne pas être liké, finir schizophrène de ne plus savoir qui nous sommes tant la vie idyllique mis en avant via les réseaux sociaux est fausse,... Risque aussi en terme d'information : ce n'est plus la véracité de l'information qui prime sur les reseaux sociaux, mais son financement.
Article sérieux, divertissement, propagande éhontée ou simple canular entrent en concurrence. Or "faire payer le consommateur d'information pour l'intégralité de son coût de production, c'est risquer de réserver l'accès à l'information à une minorité, et provoquer des externalités négatives : dégradation du débat public, impossibilité d'avoir un système démocratique stable non pas à cause de la différence d'opinion, mais à cause de la différence du niveau d'information."
Quelques solutions sont proposées. Une retiens particulièrement mon attention : "Notre modèle de société est structurellement tourné vers l'accélération, et toute mesure de ralentissement, dans quelque domaine que ce soit, l'information, les médias, les conversations, en réseau ou non, la consommation même, est une mesure de résistance. C'est aussi une mesure de libération."
Patino Bruno – "La civilisation du poisson rouge : petit traité sur le marché de l'attention" – Grasset / Livre de poche, 2019 (ISBN 978-2-253-10125-3)
Cet opuscule publié au format poche, ne réunissant que 162 pages dans une typographie de grande taille et fortement aérée, s'avère particulièrement décevant si on le rapporte à l'importance du sujet traité.
Après lecture, je suis tout aussi déçu qu'après celle de l'ouvrage de Desmurget intitulé "La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos enfants" (cf recension du 18 mai 2020).
Dans les deux cas, ces auteurs affaiblissent considérablement leur propos en ne mobilisant pratiquement que des références et citations issues du monde qu'ils adorent et devant lequel ils se prosternent tout deux, à savoir les États-Unis d'Amérique du Nord, qui constituent l'épicentre de leur vision bornée du monde. Dommage.
En ce qui concerne ce Patino, j'ajoute un autre grief : l'utilisation d'un "nous" englobant toute une génération (la mienne), qui aurait unanimement succombé à une croyance aveugle dans les vertus et mirages distillés par les gourous de la Silicon Valley, de cette Californie qui constituait l'horizon aussi limité qu'indépassable de cette caste d'intellectuel(le)s hyppisant, subjugués par les fariboles du "flower power" et du "peace and love".
Pour ma part, je n'ai jamais cru dans ces discours mirifiques du "tous copains pour se partager les copines", du "village mondial" et autres billevesées. Dès les premières interconnexions, dès la mise en place des réseaux, j'insistais tout au long de mes cours (j'en ai gardé copie dans mes sauvegardes) sur le fait qu'il ne fallait pas assimiler le recours à un ordinateur (une machine qui représente une puissance de travail phénoménale pour un individu) avec leur mise en réseau, laquelle – soulignai-je abondamment – présentait des dangers indéniables d'espionnite généralisée, de fichage systématique des utilisateurs, de développement de ce qui est devenu la "captologie" (je faisais alors référence au "temps de cerveau disponible" déjà problématisé avec la sur-consommation télévisuelle des publicités).
Bruno Patino joue à l'innocent, à la vierge effarouchée : sa posture ne me convainc guère, elle me fait irrémédiablement penser à l'hypocrite étonnement de cette même nomenklatura devant les pratiques pédophiles de ses sbires, qu'elle fait semblant de découvrir en ce début 2021 (comble de l'ironie involontaire, l'auteur rend hommage à son copain F. Mion dans les "remerciements").
A moins d'être des crétins hors pairs, les gens comme lui savaient pertinemment que le Web mondial menait directement à ce qu'il est devenu : un gigantesque égout aux mains de publicitaires assoiffés d'argent, se dissimulant derrière un double-langage hypocrite, véhiculant une infime couche de culture servant de paravent (wikipedia et autres) pour justifier leur entreprise d'abrutissement, de lobotomisation systématique.
Exerçant ses talents auprès de la chaîne cultureuse bien-pensante Arte et dispensant ses enseignements à l'école de journalisme satellisée par Science-Po, l'auteur baigne dans ce système qu'il s'emploie ici à dénigrer. Son opuscule est destiné à cette élite mondialisée, afin de l'inciter à prendre soin de ses chères têtes blondes appelées à s'enrichir en manipulant ce système et non à s'y vautrer sottement.
Ce problème de la décérébration systématique de générations entières mérite d'être traité de façon approfondie par des gens sérieux, s'appuyant sur des données et études propres à chacun des milieux concernés, loin des discours généraux d'une confondante hypocrisie.
Pour ce faire, il convient d'examiner – entre autres choses – son aberration économique : comment en est-on arrivé à ce que la seule publicité pour des produits et activités le plus souvent d'une imbécillité abyssale (et d'une pollution maximale) suffise à financer une infrastructure technique aussi dispendieuse tant par le matériel nécessaire que par les coûts salariaux engendrés par le recours à une masse de techniciens, complices, hautement spécialisés donc rémunérés ?
Autre angle d'étude : quel est le lien entre ce mode – virtuel, abstrait –de neutralisation des gens et leur relégation géographique, physique et concrète, dans ce que l'on appelle maintenant la "France périphérique" marginalisée (cf les travaux de Guilly) ?
Quel fut le rôle précurseur de la télévision, de l'urbanisation massive, de la "métropolisation", de l'avènement du "temps libre", du nombrilisme féroce caractérisant les populations aujourd'hui éparpillées entre mille "identités" plus fumeuses les unes que les autres ?
Il conviendrait également de faire le lien avec la posture de la nomenklatura colonisant les cercles du pouvoir et des médias : cette lobotomisation des cerveaux est complétée par la corruption au cannabis dit récréatif (aucun pouvoir politique n'a réellement lutté contre la drogue, bien au contraire) et bientôt le revenu minimal garanti (trois précautions valent mieux qu'une, pour les marginaliser et exclure un maximum de jeunes de la course aux emplois).
Bref, cet opuscule de Bruno Parino n'est guère plus qu'un pamphlet journalistique éphémère, là où il serait grand temps de produire des études fouillées... comme il en existe sur un sujet connexe, avec par exemple
"La silicolonisation du monde : l'irrésistible expansion du libéralisme numérique" publié par Eric Sadin en 2016 (cf recension).
Cet opuscule publié au format poche, ne réunissant que 162 pages dans une typographie de grande taille et fortement aérée, s'avère particulièrement décevant si on le rapporte à l'importance du sujet traité.
Après lecture, je suis tout aussi déçu qu'après celle de l'ouvrage de Desmurget intitulé "La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos enfants" (cf recension du 18 mai 2020).
Dans les deux cas, ces auteurs affaiblissent considérablement leur propos en ne mobilisant pratiquement que des références et citations issues du monde qu'ils adorent et devant lequel ils se prosternent tout deux, à savoir les États-Unis d'Amérique du Nord, qui constituent l'épicentre de leur vision bornée du monde. Dommage.
En ce qui concerne ce Patino, j'ajoute un autre grief : l'utilisation d'un "nous" englobant toute une génération (la mienne), qui aurait unanimement succombé à une croyance aveugle dans les vertus et mirages distillés par les gourous de la Silicon Valley, de cette Californie qui constituait l'horizon aussi limité qu'indépassable de cette caste d'intellectuel(le)s hyppisant, subjugués par les fariboles du "flower power" et du "peace and love".
Pour ma part, je n'ai jamais cru dans ces discours mirifiques du "tous copains pour se partager les copines", du "village mondial" et autres billevesées. Dès les premières interconnexions, dès la mise en place des réseaux, j'insistais tout au long de mes cours (j'en ai gardé copie dans mes sauvegardes) sur le fait qu'il ne fallait pas assimiler le recours à un ordinateur (une machine qui représente une puissance de travail phénoménale pour un individu) avec leur mise en réseau, laquelle – soulignai-je abondamment – présentait des dangers indéniables d'espionnite généralisée, de fichage systématique des utilisateurs, de développement de ce qui est devenu la "captologie" (je faisais alors référence au "temps de cerveau disponible" déjà problématisé avec la sur-consommation télévisuelle des publicités).
Bruno Patino joue à l'innocent, à la vierge effarouchée : sa posture ne me convainc guère, elle me fait irrémédiablement penser à l'hypocrite étonnement de cette même nomenklatura devant les pratiques pédophiles de ses sbires, qu'elle fait semblant de découvrir en ce début 2021 (comble de l'ironie involontaire, l'auteur rend hommage à son copain F. Mion dans les "remerciements").
A moins d'être des crétins hors pairs, les gens comme lui savaient pertinemment que le Web mondial menait directement à ce qu'il est devenu : un gigantesque égout aux mains de publicitaires assoiffés d'argent, se dissimulant derrière un double-langage hypocrite, véhiculant une infime couche de culture servant de paravent (wikipedia et autres) pour justifier leur entreprise d'abrutissement, de lobotomisation systématique.
Exerçant ses talents auprès de la chaîne cultureuse bien-pensante Arte et dispensant ses enseignements à l'école de journalisme satellisée par Science-Po, l'auteur baigne dans ce système qu'il s'emploie ici à dénigrer. Son opuscule est destiné à cette élite mondialisée, afin de l'inciter à prendre soin de ses chères têtes blondes appelées à s'enrichir en manipulant ce système et non à s'y vautrer sottement.
Ce problème de la décérébration systématique de générations entières mérite d'être traité de façon approfondie par des gens sérieux, s'appuyant sur des données et études propres à chacun des milieux concernés, loin des discours généraux d'une confondante hypocrisie.
Pour ce faire, il convient d'examiner – entre autres choses – son aberration économique : comment en est-on arrivé à ce que la seule publicité pour des produits et activités le plus souvent d'une imbécillité abyssale (et d'une pollution maximale) suffise à financer une infrastructure technique aussi dispendieuse tant par le matériel nécessaire que par les coûts salariaux engendrés par le recours à une masse de techniciens, complices, hautement spécialisés donc rémunérés ?
Autre angle d'étude : quel est le lien entre ce mode – virtuel, abstrait –de neutralisation des gens et leur relégation géographique, physique et concrète, dans ce que l'on appelle maintenant la "France périphérique" marginalisée (cf les travaux de Guilly) ?
Quel fut le rôle précurseur de la télévision, de l'urbanisation massive, de la "métropolisation", de l'avènement du "temps libre", du nombrilisme féroce caractérisant les populations aujourd'hui éparpillées entre mille "identités" plus fumeuses les unes que les autres ?
Il conviendrait également de faire le lien avec la posture de la nomenklatura colonisant les cercles du pouvoir et des médias : cette lobotomisation des cerveaux est complétée par la corruption au cannabis dit récréatif (aucun pouvoir politique n'a réellement lutté contre la drogue, bien au contraire) et bientôt le revenu minimal garanti (trois précautions valent mieux qu'une, pour les marginaliser et exclure un maximum de jeunes de la course aux emplois).
Bref, cet opuscule de Bruno Parino n'est guère plus qu'un pamphlet journalistique éphémère, là où il serait grand temps de produire des études fouillées... comme il en existe sur un sujet connexe, avec par exemple
"La silicolonisation du monde : l'irrésistible expansion du libéralisme numérique" publié par Eric Sadin en 2016 (cf recension).
Bruno Patino nous compare à des poissons rouges est né. La peur panique de se trouver éloigné de son portable est un trouble appelé no-
mophobie.
La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino édité chez Grasset & Fasquelle en
2019 a obtenu le Prix des Lecteurs 2020, il est donc sorti en Livre de Poche. C'est un
ouvrage accessible dans sa compréhension et par son petit format. Initialement, un but idéaliste de partage de savoir et de libre accès
Les réseaux sociaux occupent de plus en plus du temps disponible pour bon nombre
d'entre-nous. Cette attraction grandissante pour les écrans va-t-elle de paire avec un
possible éloignement face au réel ? Une attitude semblable à celui du monde du joueur
compulsif et de l'addiction, une dépendance s'installent avec la recherche de satisfac-
tion instantanée (via la molécule du plaisir qu'est la dopamine).
Le sujet du numérique intéresse de près l'auteur
Déjà avec ses précédentes publications, Bruno Patino observait depuis l'intérieur du
milieu des médias, les transformations qui s'opèrent ces dernières décennies. Créer des
stimuli et un sentiment de satisfaction prévisible, voire d'appartenance : la nouvelle gé-
nération née avec la connexion permanente et les smartphones est sollicitée en perma-
nence par les alertes, notifications et autres recommandations. L'Intelligence Artifi-
cielle digère nos données et comportements, le placement de produits et de services est
visé. En entrant dans l'ère de l'économie numérique, nous sommes passés de la loi de
la main invisible du marché à celle des réseaux capteurs d'attention par la distraction.
Un poisson rouge ?
Ce poisson que l'on a voulu comme « animal domestique » – parce qu'il implique peu
de contraintes – vit normalement en bandes entre 20 et 30 ans et peut faire jusqu'à 20
cm. Sa mise en bocal l'a atrophié, a accéléré sa mortalité et détruit sa sociabilité. Il n'a
pas d'« intimité » et est exposé à la vue de tous. Nous nous retrouvons a son image à
tourner en rond, immobilisés devant un écran. La psychologie et les neurosciences s'in-
terrogent sur la probable passivité qui en découle ainsi que la création de besoins plus
ou moins utiles. Les plateformes de rencontre modifient la notion de relations hu-
maines, le visionnage de séries également. Avec son livre Dans la nuée : Réflexions sur
le numérique (2015), Byung-Chul Han (1) observe une dépendance à l'outil : une fuite
en avant sans réelle perspective, des activités sociales virtuelles. Les professionnels du
marketing créent un écosystème en ligne superficiel et changeant. Pour Eli Pariser –
dans le livre The Filter Bubble (2011) – c'est un rapport à la réalité construit : les algo-
rithmes emprisonnent au sein d'une bulle d'informations qui maintient dans une vision
propre du monde. Yves Citton parle du syndrome Fomo : une anxiété sociale liée à la
peur de manquer un événement donnant une occasion d'interagir. Un rituel protecteur
Faire évoluer la pensée par la mise en relation collaborative des connaissances est tangible
dans les écrits de Teilhard de Chardin datant de 1955 ainsi qu'il l'écrit : « la Noosphère
tend à se constituer en un seul système clos, où chaque élément pour soi voit, sent, désire,
souffre les mêmes choses... Une collectivité harmonisée des consciences, équivalente à une
sorte de super-conscience ».
D'une agora au service de l'humanité, nous avons dérivé vers une arène avec une super-
structure accumulatrice de liens qui nous dépasse. L'égalité pour chaque utilisateur a dévié
vers la captation de données. Un espace devenu privatisé et contrôlé, loin de l'idée moder -
niste d'émancipation. L'acronyme GAFAM regroupe les grandes firmes américaines du
web - Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft – qui dominent ce marché. Google
était à ses débuts un moteur de recherches puis est devenu une entreprise de services orga -
nisant des informations. L'observation globale du passage à l'ère industrielle dont a décou-
lé la société de consommation n'est pas sans en rappeler certaines similitudes avec ce que
nous vivons aujourd'hui. Seulement, ce ne sont plus les ressources naturelles qui sont ex-
ploitées mais ce qu'André Breton appelait « l'or du temps ».
Une quête qui a provoqué une accélération sociale visible avec du bon et du mauvais
C'est cela, la disruption et elle génère une perte de repères potentielle. le sociologue Hart-
mut Rosa, souligne qu'avec le progrès numérique, la technologie permet de faire plusieurs
tâches en même temps et plus rapidement. Maximiser sa consommation de biens et services
en gagnant du temps et occuper son temps perdu paraît important, pourtant le philosophe
Eric Sadin explique que cette recherche d'optimisation satisfait en premier lieu des intérêts
privés et Bernard Stiegler, d'ajouter que celle-ci est irréelle voire une perte de temps.
Résultat : nous zappons sur des contenus, notre temps d'attention se raccourcit. L'intelli-
gence collective s'exprime en réseaux par une bataille d'opinions, la presse tente de garder
son indépendance et son autonomie de rédaction à la conquête d'une audience internatio-
nale via le net. La société du divertissement et du spectacle qui domine nos vies et dont
parlait, dès les années soixante-dix, Guy Debord n'est pas très reluisante. Les premières re-
cherches d'audience par le sensationnel, dans le but d'une rentabilité économique et d'ac -
cès pour tous, ont vu le jour via la TV et la radio. le risque de déviance s'opère lorsque une
information est traitée selon son efficacité économique ; l'achat des chaînes et de la presse
par de gros groupes n'y est sûrement pas pour rien.Modérer et utiliser le web intelligemment
La toile n'est-elle pas le reflet de la société dans laquelle nous vivons ? Réglementer, est-ce
la meilleure solution ? Changer de moteur de recherches, installer des bloqueurs de publici-
tés ainsi que des anti-virus, retirer l'option « alerte » afin de ne pas être sollicité en perma-
nence, ne pas avoir le réseau sur son téléphone portable en dehors de chez soi sont des pos-
sibilités. Quid du livre numérique et du numérique à l'école : une avancée intellectuelle ou
un danger de lissage d'un contenu ainsi que des effets indésirables sur le cerveau et nos
yeux mais captivant par son design. Quant au streaming et messageries surchargées, on
nous dit qu'ils sont consommateurs d'énergie. Cela demande une logistique sophistiquée
avec des lieux de stockage des data-centers qui ont besoin d'être refroidis en permanence et
« produisent autant de CO2 que l'industrie aéronautique » ; l'image est parlante dans le
film nouvellement sorti « Effacer l'historique » (2). Il a été question de traçage lorsqu'en
mars dernier les pays se posaient la question de comment procéder avec la pandémie de co-
vid19. La surveillance du télétravail s'instaure. La 5G s'installe dans toutes les communes
pour des raisons utiles : télétravail – on a pu le voir cette année – il faut que tous, même
dans les endroits les plus retirés du territoire puissent au moins y avoir accès. L'économie
va continuer de surfer sur cette vague puisque d'ores et déjà des séminaires de désintoxica-
tion se mettent en place (3). La démarche relève de notre propre volonté et pas d'une nou-
velle appli marketing qui nous dirigerait dans la « bienveillance » à nous déconnecter.
168 pages - 7,20€
plateformes numériques apparaissent comme le lieu d'une redéfinition des règles du jeu en
matière d'emploi et de travail. Entre marchandisation des activités de loisir et gratuité du
travail, le « capitalisme de plateformes » participe de l'émergence de formes renouvelées,
voire exacerbées, de sujétion des travailleurs. Loin des idéaux d'une prétendue « économie
du partage », n'assiste-t-on pas au déploiement de nouvelles dynamiques du capitalisme
avancé ? À partir d'enquêtes, cet ouvrage met au jour la tâcheronnisation des travailleurs et
l'extension du domaine du travail, tout en analysant les résistances et les régulations de ces
nouvelles activités.
Sarah Abdelnour est Maîtresse de conférences en sociologie, elle a réalisé une thèse de so-
ciologie à l'EHESS sur le régime de l'auto-entrepreneur. Elle a publié Les nouveaux prolé-
taires (éditions Textuel, 2012). Dominique Méda, agrégée de philosophie, ancienne élève
de l‘École Normale Supérieure et de l'École Nationale d'administration est professeure de
sociologie, chercheuse associée au Centre d'études de l'emploi. Elle est titulaire de la
chaire « Reconversion écologique, travail, emploi, politiques sociales » au Collège d'études
mondiales. Elle a publié Réinventer le travail (2013).
- Qui va prendre le pouvoir ? Les grands singes, les hommes politiques ou les robots de
Pascal Picq (Odile Jacob)
- le journalisme avant internet (2018) : ancien grand reporter au Monde et collaborateur à la re-
vue Schnock, José-Alain Fralon dresse le portrait d'une époque, où la presse écrite avait les
moyens d'envoyer des équipes de par le monde. le temps, avant l'Internet et les portables, où il
fallait se battre pour pouvoir dicter ses papiers à son journal.
AUTRES CONSEILS LECTURE SUR LE SUJET : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- La bande dessinée Sérum sortie aux éditions DELCOURT en 2017. - Technoféodalisme, critique de l'économie numérique de Cédric Durand (paru le 17 septembre
dernier). Analyse sur la Silicon Valley, l'accélération via la crise du coronavirus, la notion de
start-up nation et l'économie libérale. Les recherches de l'auteur portent sur la mondialisation,
la financiarisation et les mutations du capitalisme. Il est l'auteur de le Capital fictif (Les Prai-
ries ordinaires, 2014). La digitalisation du monde produit une grande régression. 1 - « Nous sommes dépassés par le numérique qui, en deçà de toute décision consciente,
modifie de façon déterminante notre comportement, notre perception, notre sensation,
notre pensée et notre vie sociale... Cette cécité ainsi que la torpeur qui l'accompagne sont
les symptômes fondamentaux de la crise actuelle. » de cette crise sociétale, Byung-Chul
Han analyse les aspects de l'existence de la démocratie qui sont bouleversés à l'heure où la
société est réduite à l'état de nuée volatile d'individus "connectés", auto-asservis.
- Gouverner la ville numérique d'Antoine Courmont et Patrick le Galès (PUF, 2019)
Les villes font face à des transformations. Des plates-formes telles qu'Airbnb, Uber ont boule-
versé pratiques et espaces. Les données et les algorithmes sont utilisés par les acteurs publics
comme privés pour optimiser le fonctionnement urbain. L'ouvrage illustre l'enjeu du big data,
ceux des politiques et les défis auxquels sont confrontées les autorités publiques. 2 - Source : article de la SACEM
Film de Benoît Delépine & Gustave Kervern (avec Banche Gardin, Benoit Podalydès, Co-
rinne Masiero) qui porte à l'écran cette thématique. Synopsis : trois voisins sont en prise
avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Ensemble, ils décident de partir en
guerre contre les géants d'internet.
- Les nouveaux travailleurs des applis de Sarah Abdelnour et Dominique Méda (PUF, 2019)
Deliveroo, Uber, Etsy... des applications qui prétendent bouleverser nos façons de consom-
mer. Mais qu'en est-il de nos manières de travailler ? Plus qu'une innovation technique, les
3- Signalé il y a peu dans l'émission Envoyé spécial intitulée « Écrans : sommes-nous tous
accros ?
mophobie.
La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino édité chez Grasset & Fasquelle en
2019 a obtenu le Prix des Lecteurs 2020, il est donc sorti en Livre de Poche. C'est un
ouvrage accessible dans sa compréhension et par son petit format. Initialement, un but idéaliste de partage de savoir et de libre accès
Les réseaux sociaux occupent de plus en plus du temps disponible pour bon nombre
d'entre-nous. Cette attraction grandissante pour les écrans va-t-elle de paire avec un
possible éloignement face au réel ? Une attitude semblable à celui du monde du joueur
compulsif et de l'addiction, une dépendance s'installent avec la recherche de satisfac-
tion instantanée (via la molécule du plaisir qu'est la dopamine).
Le sujet du numérique intéresse de près l'auteur
Déjà avec ses précédentes publications, Bruno Patino observait depuis l'intérieur du
milieu des médias, les transformations qui s'opèrent ces dernières décennies. Créer des
stimuli et un sentiment de satisfaction prévisible, voire d'appartenance : la nouvelle gé-
nération née avec la connexion permanente et les smartphones est sollicitée en perma-
nence par les alertes, notifications et autres recommandations. L'Intelligence Artifi-
cielle digère nos données et comportements, le placement de produits et de services est
visé. En entrant dans l'ère de l'économie numérique, nous sommes passés de la loi de
la main invisible du marché à celle des réseaux capteurs d'attention par la distraction.
Un poisson rouge ?
Ce poisson que l'on a voulu comme « animal domestique » – parce qu'il implique peu
de contraintes – vit normalement en bandes entre 20 et 30 ans et peut faire jusqu'à 20
cm. Sa mise en bocal l'a atrophié, a accéléré sa mortalité et détruit sa sociabilité. Il n'a
pas d'« intimité » et est exposé à la vue de tous. Nous nous retrouvons a son image à
tourner en rond, immobilisés devant un écran. La psychologie et les neurosciences s'in-
terrogent sur la probable passivité qui en découle ainsi que la création de besoins plus
ou moins utiles. Les plateformes de rencontre modifient la notion de relations hu-
maines, le visionnage de séries également. Avec son livre Dans la nuée : Réflexions sur
le numérique (2015), Byung-Chul Han (1) observe une dépendance à l'outil : une fuite
en avant sans réelle perspective, des activités sociales virtuelles. Les professionnels du
marketing créent un écosystème en ligne superficiel et changeant. Pour Eli Pariser –
dans le livre The Filter Bubble (2011) – c'est un rapport à la réalité construit : les algo-
rithmes emprisonnent au sein d'une bulle d'informations qui maintient dans une vision
propre du monde. Yves Citton parle du syndrome Fomo : une anxiété sociale liée à la
peur de manquer un événement donnant une occasion d'interagir. Un rituel protecteur
Faire évoluer la pensée par la mise en relation collaborative des connaissances est tangible
dans les écrits de Teilhard de Chardin datant de 1955 ainsi qu'il l'écrit : « la Noosphère
tend à se constituer en un seul système clos, où chaque élément pour soi voit, sent, désire,
souffre les mêmes choses... Une collectivité harmonisée des consciences, équivalente à une
sorte de super-conscience ».
D'une agora au service de l'humanité, nous avons dérivé vers une arène avec une super-
structure accumulatrice de liens qui nous dépasse. L'égalité pour chaque utilisateur a dévié
vers la captation de données. Un espace devenu privatisé et contrôlé, loin de l'idée moder -
niste d'émancipation. L'acronyme GAFAM regroupe les grandes firmes américaines du
web - Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft – qui dominent ce marché. Google
était à ses débuts un moteur de recherches puis est devenu une entreprise de services orga -
nisant des informations. L'observation globale du passage à l'ère industrielle dont a décou-
lé la société de consommation n'est pas sans en rappeler certaines similitudes avec ce que
nous vivons aujourd'hui. Seulement, ce ne sont plus les ressources naturelles qui sont ex-
ploitées mais ce qu'André Breton appelait « l'or du temps ».
Une quête qui a provoqué une accélération sociale visible avec du bon et du mauvais
C'est cela, la disruption et elle génère une perte de repères potentielle. le sociologue Hart-
mut Rosa, souligne qu'avec le progrès numérique, la technologie permet de faire plusieurs
tâches en même temps et plus rapidement. Maximiser sa consommation de biens et services
en gagnant du temps et occuper son temps perdu paraît important, pourtant le philosophe
Eric Sadin explique que cette recherche d'optimisation satisfait en premier lieu des intérêts
privés et Bernard Stiegler, d'ajouter que celle-ci est irréelle voire une perte de temps.
Résultat : nous zappons sur des contenus, notre temps d'attention se raccourcit. L'intelli-
gence collective s'exprime en réseaux par une bataille d'opinions, la presse tente de garder
son indépendance et son autonomie de rédaction à la conquête d'une audience internatio-
nale via le net. La société du divertissement et du spectacle qui domine nos vies et dont
parlait, dès les années soixante-dix, Guy Debord n'est pas très reluisante. Les premières re-
cherches d'audience par le sensationnel, dans le but d'une rentabilité économique et d'ac -
cès pour tous, ont vu le jour via la TV et la radio. le risque de déviance s'opère lorsque une
information est traitée selon son efficacité économique ; l'achat des chaînes et de la presse
par de gros groupes n'y est sûrement pas pour rien.Modérer et utiliser le web intelligemment
La toile n'est-elle pas le reflet de la société dans laquelle nous vivons ? Réglementer, est-ce
la meilleure solution ? Changer de moteur de recherches, installer des bloqueurs de publici-
tés ainsi que des anti-virus, retirer l'option « alerte » afin de ne pas être sollicité en perma-
nence, ne pas avoir le réseau sur son téléphone portable en dehors de chez soi sont des pos-
sibilités. Quid du livre numérique et du numérique à l'école : une avancée intellectuelle ou
un danger de lissage d'un contenu ainsi que des effets indésirables sur le cerveau et nos
yeux mais captivant par son design. Quant au streaming et messageries surchargées, on
nous dit qu'ils sont consommateurs d'énergie. Cela demande une logistique sophistiquée
avec des lieux de stockage des data-centers qui ont besoin d'être refroidis en permanence et
« produisent autant de CO2 que l'industrie aéronautique » ; l'image est parlante dans le
film nouvellement sorti « Effacer l'historique » (2). Il a été question de traçage lorsqu'en
mars dernier les pays se posaient la question de comment procéder avec la pandémie de co-
vid19. La surveillance du télétravail s'instaure. La 5G s'installe dans toutes les communes
pour des raisons utiles : télétravail – on a pu le voir cette année – il faut que tous, même
dans les endroits les plus retirés du territoire puissent au moins y avoir accès. L'économie
va continuer de surfer sur cette vague puisque d'ores et déjà des séminaires de désintoxica-
tion se mettent en place (3). La démarche relève de notre propre volonté et pas d'une nou-
velle appli marketing qui nous dirigerait dans la « bienveillance » à nous déconnecter.
168 pages - 7,20€
plateformes numériques apparaissent comme le lieu d'une redéfinition des règles du jeu en
matière d'emploi et de travail. Entre marchandisation des activités de loisir et gratuité du
travail, le « capitalisme de plateformes » participe de l'émergence de formes renouvelées,
voire exacerbées, de sujétion des travailleurs. Loin des idéaux d'une prétendue « économie
du partage », n'assiste-t-on pas au déploiement de nouvelles dynamiques du capitalisme
avancé ? À partir d'enquêtes, cet ouvrage met au jour la tâcheronnisation des travailleurs et
l'extension du domaine du travail, tout en analysant les résistances et les régulations de ces
nouvelles activités.
Sarah Abdelnour est Maîtresse de conférences en sociologie, elle a réalisé une thèse de so-
ciologie à l'EHESS sur le régime de l'auto-entrepreneur. Elle a publié Les nouveaux prolé-
taires (éditions Textuel, 2012). Dominique Méda, agrégée de philosophie, ancienne élève
de l‘École Normale Supérieure et de l'École Nationale d'administration est professeure de
sociologie, chercheuse associée au Centre d'études de l'emploi. Elle est titulaire de la
chaire « Reconversion écologique, travail, emploi, politiques sociales » au Collège d'études
mondiales. Elle a publié Réinventer le travail (2013).
- Qui va prendre le pouvoir ? Les grands singes, les hommes politiques ou les robots de
Pascal Picq (Odile Jacob)
- le journalisme avant internet (2018) : ancien grand reporter au Monde et collaborateur à la re-
vue Schnock, José-Alain Fralon dresse le portrait d'une époque, où la presse écrite avait les
moyens d'envoyer des équipes de par le monde. le temps, avant l'Internet et les portables, où il
fallait se battre pour pouvoir dicter ses papiers à son journal.
AUTRES CONSEILS LECTURE SUR LE SUJET : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- La bande dessinée Sérum sortie aux éditions DELCOURT en 2017. - Technoféodalisme, critique de l'économie numérique de Cédric Durand (paru le 17 septembre
dernier). Analyse sur la Silicon Valley, l'accélération via la crise du coronavirus, la notion de
start-up nation et l'économie libérale. Les recherches de l'auteur portent sur la mondialisation,
la financiarisation et les mutations du capitalisme. Il est l'auteur de le Capital fictif (Les Prai-
ries ordinaires, 2014). La digitalisation du monde produit une grande régression. 1 - « Nous sommes dépassés par le numérique qui, en deçà de toute décision consciente,
modifie de façon déterminante notre comportement, notre perception, notre sensation,
notre pensée et notre vie sociale... Cette cécité ainsi que la torpeur qui l'accompagne sont
les symptômes fondamentaux de la crise actuelle. » de cette crise sociétale, Byung-Chul
Han analyse les aspects de l'existence de la démocratie qui sont bouleversés à l'heure où la
société est réduite à l'état de nuée volatile d'individus "connectés", auto-asservis.
- Gouverner la ville numérique d'Antoine Courmont et Patrick le Galès (PUF, 2019)
Les villes font face à des transformations. Des plates-formes telles qu'Airbnb, Uber ont boule-
versé pratiques et espaces. Les données et les algorithmes sont utilisés par les acteurs publics
comme privés pour optimiser le fonctionnement urbain. L'ouvrage illustre l'enjeu du big data,
ceux des politiques et les défis auxquels sont confrontées les autorités publiques. 2 - Source : article de la SACEM
Film de Benoît Delépine & Gustave Kervern (avec Banche Gardin, Benoit Podalydès, Co-
rinne Masiero) qui porte à l'écran cette thématique. Synopsis : trois voisins sont en prise
avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Ensemble, ils décident de partir en
guerre contre les géants d'internet.
- Les nouveaux travailleurs des applis de Sarah Abdelnour et Dominique Méda (PUF, 2019)
Deliveroo, Uber, Etsy... des applications qui prétendent bouleverser nos façons de consom-
mer. Mais qu'en est-il de nos manières de travailler ? Plus qu'une innovation technique, les
3- Signalé il y a peu dans l'émission Envoyé spécial intitulée « Écrans : sommes-nous tous
accros ?
La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino édité chez Grasset & Fasquelle en 2019 a obtenu le Prix des Lecteurs 2020, il est donc sorti en Livre de Poche. C'est un ouvrage accessible dans sa compréhension et par son petit format.
Les réseaux sociaux occupent de plus en plus du temps disponible pour bon nombre d'entre-nous. Cette attraction grandissante pour les écrans va-t-elle de paire avec un possible éloignement face au réel ? Une attitude semblable à celui du monde du joueur compulsif et de l'addiction, une dépendance s'installent avec la recherche de satisfaction instantanée (via la molécule du plaisir qu'est la dopamine).
Le sujet du numérique intéresse de près l'auteur
Déjà avec ses précédentes publications, Bruno Patino observait depuis l'intérieur du milieu des médias, les transformations qui s'opèrent ces dernières décennies. La nouvelle génération née avec la connexion permanente et les smartphones est sollicitée en permanence par les alertes, notifications et autres recommandations. L'Intelligence Artificielle digère nos données et comportements : le placement de produits et de services est visé. le but est de créer des stimuli, un sentiment de satisfaction prévisible, voire d'appartenance. En entrant dans l'ère de l'économie numérique, nous sommes passés de la loi de la main invisible du marché à celle des réseaux capteurs d'attention par la distraction.
Un poisson rouge ?
Ce poisson que l'on a voulu comme « animal domestique » – parce qu'il implique peu de contraintes – vit normalement en bandes entre 20 et 30 ans et peut faire jusqu'à 20 cm. Sa mise en bocal l'a atrophié, a accéléré sa mortalité et détruit sa sociabilité. Il n'a pas d'« intimité » et est exposé à la vue de tous. Nous nous retrouvons a son image à tourner en rond, immobilisés devant un écran. La psychologie et les neurosciences s'interrogent sur la probable passivité qui en découle ainsi que la création de besoins plus ou moins utiles. Les plateformes de rencontre modifient la notion de relations humaines, le visionnage de séries également. Avec son livre Dans la nuée : Réflexions sur le numérique (2015), Byung-Chul Han (1) observe une dépendance à l'outil : une fuite en avant sans réelle perspective, des activités sociales virtuelles. Les professionnels du marketing créent un écosystème en ligne superficiel et changeant. Pour Eli Pariser – dans le livre The Filter Bubble (2011) – c'est un rapport à la réalité construit : les algorithmes emprisonnent au sein d'une bulle d'informations qui maintient dans une vision propre du monde. Yves Citton parle du syndrome Fomo : une anxiété sociale liée à la peur de manquer un événement donnant une occasion d'interagir. Un rituel protecteur est né. La peur panique de se trouver éloigné de son portable est un trouble appelé nomophobie.
Initialement, un but idéaliste de partage de savoir et de libre accès
Faire évoluer la pensée par la mise en relation collaborative des connaissances est tangible dans les écrits de Teilhard de Chardin datant de 1955 ainsi qu'il l'écrit : « la Noosphère tend à se constituer en un seul système clos, où chaque élément pour soi voit, sent, désire, souffre les mêmes choses... Une collectivité harmonisée des consciences, équivalente à une sorte de super-conscience ».
D'une agora au service de l'humanité, nous avons dérivé vers une arène avec une superstructure accumulatrice de liens qui nous dépasse. L'égalité pour chaque utilisateur a dévié vers la captation de données. Un espace devenu privatisé et contrôlé, loin de l'idée moderniste d'émancipation. L'acronyme GAFAM regroupe les grandes firmes américaines du web - Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft – qui dominent ce marché. Google était à ses débuts un moteur de recherches puis est devenu une entreprise de services organisant des informations. L'observation globale du passage à l'ère industrielle dont a découlé la société de consommation n'est pas sans en rappeler certaines similitudes avec ce que nous vivons aujourd'hui. Seulement, ce ne sont plus les ressources naturelles qui sont exploitées mais ce qu'André Breton appelait « l'or du temps ».
Une quête qui a provoqué une accélération sociale visible avec du bon et du mauvais
C'est cela, la disruption et elle génère une perte de repères potentielle. le sociologue Hartmut Rosa, souligne qu'avec le progrès numérique, la technologie permet de faire plusieurs tâches en même temps et plus rapidement. Maximiser sa consommation de biens et services en gagnant du temps et occuper son temps perdu paraît important, pourtant le philosophe Eric Sadin explique que cette recherche d'optimisation satisfait en premier lieu des intérêts privés et Bernard Stiegler, d'ajouter que celle-ci est irréelle voire une perte de temps.
Résultat : nous zappons sur des contenus, notre temps d'attention se raccourcit. L'intelligence collective s'exprime en réseaux par une bataille d'opinions, la presse tente de garder son indépendance et son autonomie de rédaction à la conquête d'une audience internationale via le net. La société du divertissement et du spectacle qui domine nos vies et dont parlait, dès les années soixante-dix, Guy Debord n'est pas très reluisante. Les premières recherches d'audience par le sensationnel, dans le but d'une rentabilité économique et d'accès pour tous, ont vu le jour via la TV et la radio. le risque de déviance s'opère lorsque uneinformation est traitée selon son efficacité économique ; l'achat des chaînes et de la presse par de gros groupes n'y est sûrement pas pour rien.
Modérer et utiliser le web intelligemment
La toile n'est-elle pas le reflet de la société dans laquelle nous vivons ? Réglementer, est-ce la meilleure solution ? Changer de moteur de recherches, installer des bloqueurs de publicités ainsi que des anti-virus, retirer l'option « alerte » afin de ne pas être sollicité en permanence, ne pas avoir le réseau sur son téléphone portable en dehors de chez soi sont des possibilités. Quid du livre numérique et du numérique à l'école : une avancée intellectuelle ou un danger de lissage d'un contenu ainsi que des effets indésirables sur le cerveau et nos yeux mais captivant par son design. Quant au streaming et messageries surchargées, on nous dit qu'ils sont consommateurs d'énergie. Cela demande une logistique sophistiquée avec des lieux de stockage des data-centers qui ont besoin d'être refroidis en permanence et « produisent autant de CO2 que l'industrie aéronautique » ; l'image est parlante dans le film nouvellement sorti « Effacer l'historique » (2). Il a été question de traçage lorsqu'en mars dernier les pays se posaient la question de comment procéder avec la pandémie de covid19. La surveillance du télétravail s'instaure. La 5G s'installe dans toutes les communes pour des raisons utiles : télétravail – on a pu le voir cette année – il faut que tous, même dans les endroits les plus retirés du territoire puissent au moins y avoir accès. L'économie va continuer de surfer sur cette vague puisque d'ores et déjà des séminaires de désintoxication se mettent en place (3). La démarche relève de notre propre volonté et pas d'une nouvelle appli marketing qui nous dirigerait dans la « bienveillance » à nous déconnecter.
168 pages - 7,20€
AUTRES CONSEILS LECTURE SUR LE SUJET :
- La bande dessinée Sérum sortie aux éditions DELCOURT en 2017.
- Technoféodalisme, critique de l'économie numérique de Cédric Durand (paru le 17 septembre dernier).
Analyse sur la Silicon Valley, l'accélération via la crise du coronavirus, la notion de start-up nation et l'économie libérale. Les recherches de l'auteur portent sur la mondialisation, la financiarisation et les mutations du capitalisme. Il est l'auteur de le Capital fictif (Les Prairies ordinaires, 2014). La digitalisation du monde produit une grande régression.
- Gouverner la ville numérique d'Antoine Courmont et Patrick le Galès (PUF, 2019)
Les villes font face à des transformations. Des plates-formes telles qu'Airbnb, Uber ont bouleversé pratiques et espaces. Les données et les algorithmes sont utilisés par les acteurs publics comme privés pour optimiser le fonctionnement urbain. L'ouvrage illustre l'enjeu du big data, ceux des politiques et les défis auxquels sont confrontées les autorités publiques.
- Les nouveaux travailleurs des applis de Sarah Abdelnour et Dominique Méda (PUF, 2019)
Deliveroo, Uber, Etsy... des applications qui prétendent bouleverser nos façons de consommer. Mais qu'en est-il de nos manières de travailler ? Plus qu'une innovation technique, les plateformes numériques apparaissent comme le lieu d'une redéfinition des règles du jeu en matière d'emploi et de travail. Entre marchandisation des activités de loisir et gratuité du travail, le « capitalisme de plateformes » participe de l'émergence de formes renouvelées, voire exacerbées, de sujétion des travailleurs. Loin des idéaux d'une prétendue « économie du partage », n'assiste-t-on pas au déploiement de nouvelles dynamiques du capitalisme avancé ? À partir d'enquêtes, cet ouvrage met au jour la tâcheronnisation des travailleurs et l'extension du domaine du travail, tout en analysant les résistances et les régulations de ces nouvelles activités.
Sarah Abdelnour est Maîtresse de conférences en sociologie, elle a réalisé une thèse de sociologie à l'EHESS sur le régime de l'auto-entrepreneur. Elle a publié Les nouveaux prolétaires (éditions Textuel, 2012). Dominique Méda, agrégée de philosophie, ancienne élève de l‘École Normale Supérieure et de l'École Nationale d'administration est professeure de sociologie, chercheuse associée au Centre d'études de l'emploi. Elle est titulaire de la chaire « Reconversion écologique, travail, emploi, politiques sociales » au Collège d'études mondiales. Elle a publié Réinventer le travail (2013).
- Qui va prendre le pouvoir ? Les grands singes, les hommes politiques ou les robots de Pascal Picq (Odile Jacob)
- le journalisme avant internet (2018) : ancien grand reporter au Monde et collaborateur à la revue Schnock, José-Alain Fralon dresse le portrait d'une époque, où la presse écrite avait les moyens d'envoyer des équipes de par le monde. le temps, avant l'Internet et les portables, où il fallait se battre pour pouvoir dicter ses papiers à son journal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - « Nous sommes dépassés par le numérique qui, en deçà de toute décision consciente,
modifie de façon déterminante notre comportement, notre perception, notre sensation,
notre pensée et notre vie sociale... Cette cécité ainsi que la torpeur qui l'accompagne sont
les symptômes fondamentaux de la crise actuelle. » de cette crise sociétale, Byung-Chul
Han analyse les aspects de l'existence de la démocratie qui sont bouleversés à l'heure où la
société est réduite à l'état de nuée volatile d'individus "connectés", auto-asservis.
2 - Source : article de la SACEM
Film de Benoît Delépine & Gustave Kervern (avec Banche Gardin, Benoit Podalydès, Co-
rinne Masiero) qui porte à l'écran cette thématique. Synopsis : trois voisins sont en prise
avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Ensemble, ils décident de partir en
guerre contre les géants d'internet.
3- Signalé il y a peu dans l'émission Envoyé spécial intitulée « Écrans : sommes-nous tous
accros ?
Les réseaux sociaux occupent de plus en plus du temps disponible pour bon nombre d'entre-nous. Cette attraction grandissante pour les écrans va-t-elle de paire avec un possible éloignement face au réel ? Une attitude semblable à celui du monde du joueur compulsif et de l'addiction, une dépendance s'installent avec la recherche de satisfaction instantanée (via la molécule du plaisir qu'est la dopamine).
Le sujet du numérique intéresse de près l'auteur
Déjà avec ses précédentes publications, Bruno Patino observait depuis l'intérieur du milieu des médias, les transformations qui s'opèrent ces dernières décennies. La nouvelle génération née avec la connexion permanente et les smartphones est sollicitée en permanence par les alertes, notifications et autres recommandations. L'Intelligence Artificielle digère nos données et comportements : le placement de produits et de services est visé. le but est de créer des stimuli, un sentiment de satisfaction prévisible, voire d'appartenance. En entrant dans l'ère de l'économie numérique, nous sommes passés de la loi de la main invisible du marché à celle des réseaux capteurs d'attention par la distraction.
Un poisson rouge ?
Ce poisson que l'on a voulu comme « animal domestique » – parce qu'il implique peu de contraintes – vit normalement en bandes entre 20 et 30 ans et peut faire jusqu'à 20 cm. Sa mise en bocal l'a atrophié, a accéléré sa mortalité et détruit sa sociabilité. Il n'a pas d'« intimité » et est exposé à la vue de tous. Nous nous retrouvons a son image à tourner en rond, immobilisés devant un écran. La psychologie et les neurosciences s'interrogent sur la probable passivité qui en découle ainsi que la création de besoins plus ou moins utiles. Les plateformes de rencontre modifient la notion de relations humaines, le visionnage de séries également. Avec son livre Dans la nuée : Réflexions sur le numérique (2015), Byung-Chul Han (1) observe une dépendance à l'outil : une fuite en avant sans réelle perspective, des activités sociales virtuelles. Les professionnels du marketing créent un écosystème en ligne superficiel et changeant. Pour Eli Pariser – dans le livre The Filter Bubble (2011) – c'est un rapport à la réalité construit : les algorithmes emprisonnent au sein d'une bulle d'informations qui maintient dans une vision propre du monde. Yves Citton parle du syndrome Fomo : une anxiété sociale liée à la peur de manquer un événement donnant une occasion d'interagir. Un rituel protecteur est né. La peur panique de se trouver éloigné de son portable est un trouble appelé nomophobie.
Initialement, un but idéaliste de partage de savoir et de libre accès
Faire évoluer la pensée par la mise en relation collaborative des connaissances est tangible dans les écrits de Teilhard de Chardin datant de 1955 ainsi qu'il l'écrit : « la Noosphère tend à se constituer en un seul système clos, où chaque élément pour soi voit, sent, désire, souffre les mêmes choses... Une collectivité harmonisée des consciences, équivalente à une sorte de super-conscience ».
D'une agora au service de l'humanité, nous avons dérivé vers une arène avec une superstructure accumulatrice de liens qui nous dépasse. L'égalité pour chaque utilisateur a dévié vers la captation de données. Un espace devenu privatisé et contrôlé, loin de l'idée moderniste d'émancipation. L'acronyme GAFAM regroupe les grandes firmes américaines du web - Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft – qui dominent ce marché. Google était à ses débuts un moteur de recherches puis est devenu une entreprise de services organisant des informations. L'observation globale du passage à l'ère industrielle dont a découlé la société de consommation n'est pas sans en rappeler certaines similitudes avec ce que nous vivons aujourd'hui. Seulement, ce ne sont plus les ressources naturelles qui sont exploitées mais ce qu'André Breton appelait « l'or du temps ».
Une quête qui a provoqué une accélération sociale visible avec du bon et du mauvais
C'est cela, la disruption et elle génère une perte de repères potentielle. le sociologue Hartmut Rosa, souligne qu'avec le progrès numérique, la technologie permet de faire plusieurs tâches en même temps et plus rapidement. Maximiser sa consommation de biens et services en gagnant du temps et occuper son temps perdu paraît important, pourtant le philosophe Eric Sadin explique que cette recherche d'optimisation satisfait en premier lieu des intérêts privés et Bernard Stiegler, d'ajouter que celle-ci est irréelle voire une perte de temps.
Résultat : nous zappons sur des contenus, notre temps d'attention se raccourcit. L'intelligence collective s'exprime en réseaux par une bataille d'opinions, la presse tente de garder son indépendance et son autonomie de rédaction à la conquête d'une audience internationale via le net. La société du divertissement et du spectacle qui domine nos vies et dont parlait, dès les années soixante-dix, Guy Debord n'est pas très reluisante. Les premières recherches d'audience par le sensationnel, dans le but d'une rentabilité économique et d'accès pour tous, ont vu le jour via la TV et la radio. le risque de déviance s'opère lorsque uneinformation est traitée selon son efficacité économique ; l'achat des chaînes et de la presse par de gros groupes n'y est sûrement pas pour rien.
Modérer et utiliser le web intelligemment
La toile n'est-elle pas le reflet de la société dans laquelle nous vivons ? Réglementer, est-ce la meilleure solution ? Changer de moteur de recherches, installer des bloqueurs de publicités ainsi que des anti-virus, retirer l'option « alerte » afin de ne pas être sollicité en permanence, ne pas avoir le réseau sur son téléphone portable en dehors de chez soi sont des possibilités. Quid du livre numérique et du numérique à l'école : une avancée intellectuelle ou un danger de lissage d'un contenu ainsi que des effets indésirables sur le cerveau et nos yeux mais captivant par son design. Quant au streaming et messageries surchargées, on nous dit qu'ils sont consommateurs d'énergie. Cela demande une logistique sophistiquée avec des lieux de stockage des data-centers qui ont besoin d'être refroidis en permanence et « produisent autant de CO2 que l'industrie aéronautique » ; l'image est parlante dans le film nouvellement sorti « Effacer l'historique » (2). Il a été question de traçage lorsqu'en mars dernier les pays se posaient la question de comment procéder avec la pandémie de covid19. La surveillance du télétravail s'instaure. La 5G s'installe dans toutes les communes pour des raisons utiles : télétravail – on a pu le voir cette année – il faut que tous, même dans les endroits les plus retirés du territoire puissent au moins y avoir accès. L'économie va continuer de surfer sur cette vague puisque d'ores et déjà des séminaires de désintoxication se mettent en place (3). La démarche relève de notre propre volonté et pas d'une nouvelle appli marketing qui nous dirigerait dans la « bienveillance » à nous déconnecter.
168 pages - 7,20€
AUTRES CONSEILS LECTURE SUR LE SUJET :
- La bande dessinée Sérum sortie aux éditions DELCOURT en 2017.
- Technoféodalisme, critique de l'économie numérique de Cédric Durand (paru le 17 septembre dernier).
Analyse sur la Silicon Valley, l'accélération via la crise du coronavirus, la notion de start-up nation et l'économie libérale. Les recherches de l'auteur portent sur la mondialisation, la financiarisation et les mutations du capitalisme. Il est l'auteur de le Capital fictif (Les Prairies ordinaires, 2014). La digitalisation du monde produit une grande régression.
- Gouverner la ville numérique d'Antoine Courmont et Patrick le Galès (PUF, 2019)
Les villes font face à des transformations. Des plates-formes telles qu'Airbnb, Uber ont bouleversé pratiques et espaces. Les données et les algorithmes sont utilisés par les acteurs publics comme privés pour optimiser le fonctionnement urbain. L'ouvrage illustre l'enjeu du big data, ceux des politiques et les défis auxquels sont confrontées les autorités publiques.
- Les nouveaux travailleurs des applis de Sarah Abdelnour et Dominique Méda (PUF, 2019)
Deliveroo, Uber, Etsy... des applications qui prétendent bouleverser nos façons de consommer. Mais qu'en est-il de nos manières de travailler ? Plus qu'une innovation technique, les plateformes numériques apparaissent comme le lieu d'une redéfinition des règles du jeu en matière d'emploi et de travail. Entre marchandisation des activités de loisir et gratuité du travail, le « capitalisme de plateformes » participe de l'émergence de formes renouvelées, voire exacerbées, de sujétion des travailleurs. Loin des idéaux d'une prétendue « économie du partage », n'assiste-t-on pas au déploiement de nouvelles dynamiques du capitalisme avancé ? À partir d'enquêtes, cet ouvrage met au jour la tâcheronnisation des travailleurs et l'extension du domaine du travail, tout en analysant les résistances et les régulations de ces nouvelles activités.
Sarah Abdelnour est Maîtresse de conférences en sociologie, elle a réalisé une thèse de sociologie à l'EHESS sur le régime de l'auto-entrepreneur. Elle a publié Les nouveaux prolétaires (éditions Textuel, 2012). Dominique Méda, agrégée de philosophie, ancienne élève de l‘École Normale Supérieure et de l'École Nationale d'administration est professeure de sociologie, chercheuse associée au Centre d'études de l'emploi. Elle est titulaire de la chaire « Reconversion écologique, travail, emploi, politiques sociales » au Collège d'études mondiales. Elle a publié Réinventer le travail (2013).
- Qui va prendre le pouvoir ? Les grands singes, les hommes politiques ou les robots de Pascal Picq (Odile Jacob)
- le journalisme avant internet (2018) : ancien grand reporter au Monde et collaborateur à la revue Schnock, José-Alain Fralon dresse le portrait d'une époque, où la presse écrite avait les moyens d'envoyer des équipes de par le monde. le temps, avant l'Internet et les portables, où il fallait se battre pour pouvoir dicter ses papiers à son journal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - « Nous sommes dépassés par le numérique qui, en deçà de toute décision consciente,
modifie de façon déterminante notre comportement, notre perception, notre sensation,
notre pensée et notre vie sociale... Cette cécité ainsi que la torpeur qui l'accompagne sont
les symptômes fondamentaux de la crise actuelle. » de cette crise sociétale, Byung-Chul
Han analyse les aspects de l'existence de la démocratie qui sont bouleversés à l'heure où la
société est réduite à l'état de nuée volatile d'individus "connectés", auto-asservis.
2 - Source : article de la SACEM
Film de Benoît Delépine & Gustave Kervern (avec Banche Gardin, Benoit Podalydès, Co-
rinne Masiero) qui porte à l'écran cette thématique. Synopsis : trois voisins sont en prise
avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Ensemble, ils décident de partir en
guerre contre les géants d'internet.
3- Signalé il y a peu dans l'émission Envoyé spécial intitulée « Écrans : sommes-nous tous
accros ?
Je suis né fatigué, je pense qu'une grande partie de cette fatigue est dûe à la fatigue décisionelle. C'est l'une des très nombreuses notions citées dans cet ouvrage. Trop nombreuses notions d'ailleurs, ce qui donne un côté catalogue et nuit à la compréhension. Contrairement à ce qu'indique le sous-titre, il ne s'agit pas vraiment d'un traité, d'un ouvrage didactique, mais bien d'un essai.
Et cela me convient parfaitement ! Surtout que j'étais déjà sensibilisé à ces problèmes et que je vais explorer la riche bibliographie plus en profondeur. Excellent point de départ donc, je ne regrette pas ma décision. Ce petit livre a quand même l'ambition de décrire notre époque. Si l'invention de l'imprimerie a permis de passer de l'âge de la religion à l'âge de la raison (la modernité), quelle est donc cette nouvelle ère ouverte par la révolution numérique ? Certains l'appelle postmodernité. Et Bruno Patino semble déplorer cette régression, ce retour en arrière, cette flèche du temps qui se mord la queue. Sur ce constat je suis entièrement d'accord avec lui. Sur Internet, nous sommes rapidement passés des Lumières au dark design et au bruit du buzz et des notifications, de l'agora à l'arena, de l'utopie au cauchemar à la Black Mirror, du lieu de tous les possibles au lieu où on est la cible de tous : plateformes, annonceurs, arnaqueurs, trolls, haters, hackers...
Ce livra raconte cette désillusion. Oui les gens sont émotifs, irrationnels, anxieux, influençables, plus facilement convaincus par la preuve sociale que par la preuve scientifique.
Et cette faiblesse certains vont tenter de l'exploiter. Mais l'État ne sera jamais, espérons-le, assez fort pour protéger directement tout le monde. Déjà nous ne sommes pas tous aussi sensibles, et surtout il faut que nous apprenions à nous défendre nous-même. Imagine-t-on le gouvernement s'occuper entièrement de notre hygiène (physique ou numérique) ou de la lutte contre les virus (naturels ou informatiques) ? Je ne suis pas contre des messages de prévention mais c'est à nous d'adopter les gestes barrières (ou pas).
Nous sommes peut-être des poissons rouges mais nous ne vivons pas dans un bocal. Nous vivons dans des écosystèmes complexes et connectés. Nous devons apprendre à maîtriser ces outils technologiques. Sciences de l'information, éducation aux médias, hygiène numérique ou même digital detox, voilà la solution ! J'y crois encore, en tout cas pour le moment. Car dans le futur, il n'y aura plus d'écrans, plus de bocal, les géants de la tech pourront lire dans nos pensées, analyser nos émotions et même nous rendre amoureux de nos robots de compagnie ! J'exagère peut-être mais c'est pour prendre le contrepied de l'effet Amara dans lequel l'auteur me semble être tombé : surestimer les effets à court terme d'une technologie et sous-estimer ses effets à long terme.
Et cela me convient parfaitement ! Surtout que j'étais déjà sensibilisé à ces problèmes et que je vais explorer la riche bibliographie plus en profondeur. Excellent point de départ donc, je ne regrette pas ma décision. Ce petit livre a quand même l'ambition de décrire notre époque. Si l'invention de l'imprimerie a permis de passer de l'âge de la religion à l'âge de la raison (la modernité), quelle est donc cette nouvelle ère ouverte par la révolution numérique ? Certains l'appelle postmodernité. Et Bruno Patino semble déplorer cette régression, ce retour en arrière, cette flèche du temps qui se mord la queue. Sur ce constat je suis entièrement d'accord avec lui. Sur Internet, nous sommes rapidement passés des Lumières au dark design et au bruit du buzz et des notifications, de l'agora à l'arena, de l'utopie au cauchemar à la Black Mirror, du lieu de tous les possibles au lieu où on est la cible de tous : plateformes, annonceurs, arnaqueurs, trolls, haters, hackers...
Ce livra raconte cette désillusion. Oui les gens sont émotifs, irrationnels, anxieux, influençables, plus facilement convaincus par la preuve sociale que par la preuve scientifique.
Et cette faiblesse certains vont tenter de l'exploiter. Mais l'État ne sera jamais, espérons-le, assez fort pour protéger directement tout le monde. Déjà nous ne sommes pas tous aussi sensibles, et surtout il faut que nous apprenions à nous défendre nous-même. Imagine-t-on le gouvernement s'occuper entièrement de notre hygiène (physique ou numérique) ou de la lutte contre les virus (naturels ou informatiques) ? Je ne suis pas contre des messages de prévention mais c'est à nous d'adopter les gestes barrières (ou pas).
Nous sommes peut-être des poissons rouges mais nous ne vivons pas dans un bocal. Nous vivons dans des écosystèmes complexes et connectés. Nous devons apprendre à maîtriser ces outils technologiques. Sciences de l'information, éducation aux médias, hygiène numérique ou même digital detox, voilà la solution ! J'y crois encore, en tout cas pour le moment. Car dans le futur, il n'y aura plus d'écrans, plus de bocal, les géants de la tech pourront lire dans nos pensées, analyser nos émotions et même nous rendre amoureux de nos robots de compagnie ! J'exagère peut-être mais c'est pour prendre le contrepied de l'effet Amara dans lequel l'auteur me semble être tombé : surestimer les effets à court terme d'une technologie et sous-estimer ses effets à long terme.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Bruno Patino (6)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )
Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "
amoureux
positiviste
philosophique
20 questions
859 lecteurs ont répondu
Thèmes :
essai
, essai de société
, essai philosophique
, essai documentCréer un quiz sur ce livre859 lecteurs ont répondu