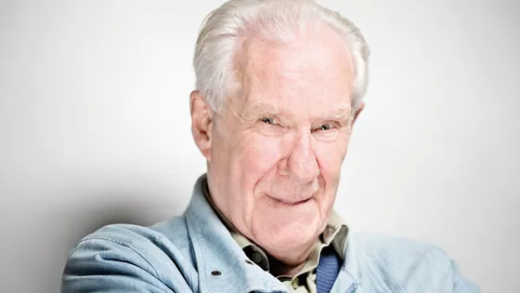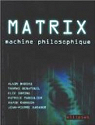Critiques de Alain Badiou (103)
Dès qu’il fît paraître son Petit Panthéon portatif en 2008 aux éditions de la Fabrique, comme pour se mettre en conformité avec l'étymologie (philo = amour) de sa discipline, Alain Badiou nous apparut travaillé par l'impérieuse nécessité de manifester de l'amour. Il s’ensuivit une série de livres d’éloges (qui ne sont pas sans rappeler la mode éditoriale des Dictionnaires amoureux…).
L’éloge des mathématiques est un livre d'entretiens, le troisième de cette série d'éloges. Il marque la volonté du philosophe d’orner de clous d'or la châsse dans laquelle il entend enfermer les gemmes d'un système (le sien) dont il professe la vocation universelle ; après un éloge de l'amour, suivi d'un éloge du théâtre voici un éloge des mathématiques.
Lorsqu’on n’est pas mathématicien, faire l'éloge des mathématiques n'est pas sans risque ; on aura l’air de manquer de modestie, pire on vous qualifiera d’élitiste. L'attitude générale face aux mathématiques voudrait qu'on en médise – même si le nombre considérable de ceux qui soutiennent n’y rien comprendre auront toujours l’air d’attaquer les maths avec la rancœur du renard de la fable des raisins verts ; peu de matheux doués affectent de les mépriser sauf pour dénoncer certains abus de leur utilisation (en économie politique particulièrement). Il faut noter que la critique des mathématiques ne porte généralement pas sur l’activité intrinsèque du mathématicien (qui dépasse le commun des mortels) mais sur le statut que la société confère aux maths: discipline survalorisée à l'école, elle est un outil de sélection scolaire considéré comme arbitraire ; par ailleurs, une certaine logique des chiffres est accusée de meurtrir la vie économique et sociale. Par devers elles, ce qui est dénoncé c'est un latin de technocrate; le Diafoirus du 21ème siècle s’exprime en équations.
Alain Badiou ouvre son éloge avec un appel angoissé : il faut sauver les mathématiques! de quoi ? de l'attitude aristocratique du milieu des mathématiciens qui sentirait trop le renfermé ; seule la philosophie pourrait sauver les maths de l'asphyxie à laquelle ses adeptes l'exposent. Après tout, en leur temps, Descartes et Leibniz n'étaient-ils pas à la fois des philosophes et des matheux de première force ? Badiou, fils de professeur de mathématiques, revendique – non pas le statut de mathématicien mais une compétence particulière car il étudia les mathématiques pendant deux ans à la Sorbonne. Mais ne fait-il pas fi de la complexité d'un champ disciplinaire foisonnant dont la tentation monolithique (totalitaire?) qui prévalait aux temps glorieux du groupe Bourbaki semble désormais dépassée: ce temps n'est plus où l'on voulait fonder LA Mathématique car aujourd'hui on continue de parler DES mathématiques. L'activité mathématique est aujourd'hui un foisonnement disparate, hétéroclite, mélangé à d'autres réalités (les maths appliquées) qui fait dire au mathématicien Didier Nordon que "les mathématiques pures n'existent pas" ? N'est-il pas tenté de réduire les mathématiques à l'activité d'un sous-système de son propre écosystème social ; le monde universitaire et académique – duquel Alain Badiou semble inquiet d'obtenir quelque reconnaissance ?
Toutefois son attachement aux mathématiques s'enracine dans un souci plus profond de vérité. A double titre : tout d’abord, pour Badiou le principe de la reconnaissance par les pairs rend impossible l'imposture en mathématiques; parce que les mathématiques sont d’abord une affaire de mathématiciens, elles sont à l’abri des impostures – contrairement à la philosophie régulièrement compromises par les modes éditoriales (Badiou évoque avec amertume la gabegie des « nouveaux philosophes »). D'autre part, parce que ce principe de vérité est au cœur de l'activité mathématique elle-même. Et c'est bien ce principe de vérité qui uni toutes ces pratiques disparates dispersées dans l'histoire et la géographie de la discipline ; ce mot mathématiques - dont l’origine grecque est contingente - réunit rétrospectivement des hommes de l'antiquité méditerranéenne, de l'ancienne Chine et de l'Inde et aujourd’hui une communauté mondiale de chercheurs. Pour Badiou, l'internationale des mathématiciens est la plus solide internationale qui soit. C'est la raison pour laquelle, il faut la prendre au sérieux et qu'il serait bon de ravaler toute rancœur afin que les mathématiques entrent dans notre vie autrement que sous la forme de ce cheval de Troye au fond duquel est tapi une sorte de dictateur abstrait qui pense à notre place – dont l'algorithme est devenu l'emblème.
Marxiste revendiqué, Alain Badiou est dialecticien dans le sens le plus modeste de ce terme ; puisque ce petit livre est un dialogue. Mais il a surtout l'esprit de système. La vision des mathématiques de Badiou est celle d'un homme ayant besoin de trouver un fondement aux choses. Autant le mathématicien a la manie de tout démontrer ; le philosophe entend tout justifier ; même les mathématiques. Or, il ressort que philosophiquement (dans ce cadre Alain Badiou revendique le terme aujourd'hui en discrédit de métaphysique) les mathématiques nous apparaissent sous deux aspects antagonistes qui retrouvent la vieille opposition médiévale du réalisme et du nominalisme. Dans l’optique réaliste les objets mathématiques existent avec un degré de réalité égal aux autres objets de l'univers ; ils constituent des essences, des sortes de faits premiers à toute appréhension par l'esprit. Pour le nominalisme l'activité mathématique est une manifestation sophistiquée du langage, une élaboration du monde, un constructivisme. Sous ce rapport, il convient de citer Alain Badiou plutôt que le trahir : « Mon but est de sauver la catégorie (philosophique) de vérité qui [ ... ] distingue et nomme [les vérités scientifiques, esthétiques, politiques ou existentielles] , en légitimant qu'une vérité puisse être : - absolue, tout en étant une construction localisée ; - éternelle, tout en résultant d'un processus qui commence dans un monde déterminé (…) et appartient donc au temps de ce monde. »
L'enjeu principal d'un tel débat est politique. Une politique minée dans ses fondements par un mauvais relativisme qui serait, dans le meilleur des cas l'alibi d'une certaine paresse intellectuelle ou, dans le pire des cas un outil de domination. Il songe à faire un éloge de la politique.
L’éloge des mathématiques est un livre d'entretiens, le troisième de cette série d'éloges. Il marque la volonté du philosophe d’orner de clous d'or la châsse dans laquelle il entend enfermer les gemmes d'un système (le sien) dont il professe la vocation universelle ; après un éloge de l'amour, suivi d'un éloge du théâtre voici un éloge des mathématiques.
Lorsqu’on n’est pas mathématicien, faire l'éloge des mathématiques n'est pas sans risque ; on aura l’air de manquer de modestie, pire on vous qualifiera d’élitiste. L'attitude générale face aux mathématiques voudrait qu'on en médise – même si le nombre considérable de ceux qui soutiennent n’y rien comprendre auront toujours l’air d’attaquer les maths avec la rancœur du renard de la fable des raisins verts ; peu de matheux doués affectent de les mépriser sauf pour dénoncer certains abus de leur utilisation (en économie politique particulièrement). Il faut noter que la critique des mathématiques ne porte généralement pas sur l’activité intrinsèque du mathématicien (qui dépasse le commun des mortels) mais sur le statut que la société confère aux maths: discipline survalorisée à l'école, elle est un outil de sélection scolaire considéré comme arbitraire ; par ailleurs, une certaine logique des chiffres est accusée de meurtrir la vie économique et sociale. Par devers elles, ce qui est dénoncé c'est un latin de technocrate; le Diafoirus du 21ème siècle s’exprime en équations.
Alain Badiou ouvre son éloge avec un appel angoissé : il faut sauver les mathématiques! de quoi ? de l'attitude aristocratique du milieu des mathématiciens qui sentirait trop le renfermé ; seule la philosophie pourrait sauver les maths de l'asphyxie à laquelle ses adeptes l'exposent. Après tout, en leur temps, Descartes et Leibniz n'étaient-ils pas à la fois des philosophes et des matheux de première force ? Badiou, fils de professeur de mathématiques, revendique – non pas le statut de mathématicien mais une compétence particulière car il étudia les mathématiques pendant deux ans à la Sorbonne. Mais ne fait-il pas fi de la complexité d'un champ disciplinaire foisonnant dont la tentation monolithique (totalitaire?) qui prévalait aux temps glorieux du groupe Bourbaki semble désormais dépassée: ce temps n'est plus où l'on voulait fonder LA Mathématique car aujourd'hui on continue de parler DES mathématiques. L'activité mathématique est aujourd'hui un foisonnement disparate, hétéroclite, mélangé à d'autres réalités (les maths appliquées) qui fait dire au mathématicien Didier Nordon que "les mathématiques pures n'existent pas" ? N'est-il pas tenté de réduire les mathématiques à l'activité d'un sous-système de son propre écosystème social ; le monde universitaire et académique – duquel Alain Badiou semble inquiet d'obtenir quelque reconnaissance ?
Toutefois son attachement aux mathématiques s'enracine dans un souci plus profond de vérité. A double titre : tout d’abord, pour Badiou le principe de la reconnaissance par les pairs rend impossible l'imposture en mathématiques; parce que les mathématiques sont d’abord une affaire de mathématiciens, elles sont à l’abri des impostures – contrairement à la philosophie régulièrement compromises par les modes éditoriales (Badiou évoque avec amertume la gabegie des « nouveaux philosophes »). D'autre part, parce que ce principe de vérité est au cœur de l'activité mathématique elle-même. Et c'est bien ce principe de vérité qui uni toutes ces pratiques disparates dispersées dans l'histoire et la géographie de la discipline ; ce mot mathématiques - dont l’origine grecque est contingente - réunit rétrospectivement des hommes de l'antiquité méditerranéenne, de l'ancienne Chine et de l'Inde et aujourd’hui une communauté mondiale de chercheurs. Pour Badiou, l'internationale des mathématiciens est la plus solide internationale qui soit. C'est la raison pour laquelle, il faut la prendre au sérieux et qu'il serait bon de ravaler toute rancœur afin que les mathématiques entrent dans notre vie autrement que sous la forme de ce cheval de Troye au fond duquel est tapi une sorte de dictateur abstrait qui pense à notre place – dont l'algorithme est devenu l'emblème.
Marxiste revendiqué, Alain Badiou est dialecticien dans le sens le plus modeste de ce terme ; puisque ce petit livre est un dialogue. Mais il a surtout l'esprit de système. La vision des mathématiques de Badiou est celle d'un homme ayant besoin de trouver un fondement aux choses. Autant le mathématicien a la manie de tout démontrer ; le philosophe entend tout justifier ; même les mathématiques. Or, il ressort que philosophiquement (dans ce cadre Alain Badiou revendique le terme aujourd'hui en discrédit de métaphysique) les mathématiques nous apparaissent sous deux aspects antagonistes qui retrouvent la vieille opposition médiévale du réalisme et du nominalisme. Dans l’optique réaliste les objets mathématiques existent avec un degré de réalité égal aux autres objets de l'univers ; ils constituent des essences, des sortes de faits premiers à toute appréhension par l'esprit. Pour le nominalisme l'activité mathématique est une manifestation sophistiquée du langage, une élaboration du monde, un constructivisme. Sous ce rapport, il convient de citer Alain Badiou plutôt que le trahir : « Mon but est de sauver la catégorie (philosophique) de vérité qui [ ... ] distingue et nomme [les vérités scientifiques, esthétiques, politiques ou existentielles] , en légitimant qu'une vérité puisse être : - absolue, tout en étant une construction localisée ; - éternelle, tout en résultant d'un processus qui commence dans un monde déterminé (…) et appartient donc au temps de ce monde. »
L'enjeu principal d'un tel débat est politique. Une politique minée dans ses fondements par un mauvais relativisme qui serait, dans le meilleur des cas l'alibi d'une certaine paresse intellectuelle ou, dans le pire des cas un outil de domination. Il songe à faire un éloge de la politique.
Malgré l’ineptie de telle ou telle contribution qui entoure les interventions de E. During et tend à transformer ce Matrix, machine philosophique en “Daubix éditorial”, le présent essai a le mérite de proposer un glossaire des principaux symboles, concepts et personnages (Agent Smith, Architecte, Baudrillard, Bullet-Time, Croyances, Cypher, Guerre hommes-machines, Maître des clés, Mérovingien, Rêve, Téléphones, Terroristes, etc.) dont il serait malhonnête de ne pas souligner l’efficacité et la pertinence. Bref, un ouvrage à lire avec précautions puisqu’il peut aussi bien déciller le regard qu’aveugler le profane à coup de concepts imposés...
Lien : http://www.lelitteraire.com/..
Lien : http://www.lelitteraire.com/..
Je ne cours pas après les essais de philosophie. Je ne suis d’ailleurs pas amateur d’essai. Mais le titre de celui-ci m’a interpellé : que pouvait bien avoir à dire un philosophe pour faire l’éloge des mathématiques ? Je n’ai pas été déçu.
Tout d’abord la formule retenue pour cette collection a son avantage : les questions de Gilles Haéri rompent la monotonie du discours. Au moment opportun, une question est posée qui amène le philosophe Alain Badiou à formuler sa pensée dans un langage plus à la portée lecteur non-philosophe. Dans ces 124 pages, nous avons à maintes reprises l’occasion de découvrir le lien qui existe ou qui devrait être fait en mathématiques et philosophie.
J’ai relevé deux passages qui, à mon sens, donnent le ton de cet opuscule :
Certes, on sait bien qu’un « nouveau philosophe » ne s’intéresse absolument pas aux mathématiques. Il s’intéresse à l’opinion publique, il s’intéresse à la religion musulmane, il s’intéresse au « totalitarisme », aux élections cantonales, à des tas de choses, mais pas aux mathématiques. Et à mes yeux, c’est une erreur. Perso, j’ai le sentiment qu’il vise quelqu’un de précis. Mais ça l’avantage d’être clair sur l’importance qu’il accorde aux mathématiques.
Malheureusement, la rhétorique est la langue politique d’aujourd’hui. C’est une rhétorique de la promesse qui ne sera pas tenue, une rhétorique du programme impraticable, une rhétorique de la nécessité factice. En dessous de cette rhétorique, un certain nombre de décisions sont prises, dans des réunions généralement secrètes ou formatées pour aboutir à la conclusion désirée, au service d’un certain nombre d’intérêts dont la puissance ne peut être contrecarrée. Il arrive même que la rhétorique débouche sur une décision calamiteuse, y compris pour ceux qui la proposent.
J’ai beaucoup apprécié cette approche : voir les mathématiques, non seulement comme une science que beaucoup d’entre nous trouvent rébarbative, mais comme une façon efficace de raisonner sur le monde qui nous entoure. Je ne pense pas déformer sa pensée en avançant que, selon Alain Badiou, cette approche éviterait bien des déboires dans de nombreux domaines tels la politique, mais pas que.
En bref : Je vous invite à découvrir ce petit livre très enrichissant et facile à lire (bien qu’il soit signé par un philosophe :-) ). N’hésitez surtout pas à le lire s’il arrive entre vos mains que ce soit en l’achetant en librairie ou en l’empruntant.
Lien : http://sciences.gloubik.info..
Tout d’abord la formule retenue pour cette collection a son avantage : les questions de Gilles Haéri rompent la monotonie du discours. Au moment opportun, une question est posée qui amène le philosophe Alain Badiou à formuler sa pensée dans un langage plus à la portée lecteur non-philosophe. Dans ces 124 pages, nous avons à maintes reprises l’occasion de découvrir le lien qui existe ou qui devrait être fait en mathématiques et philosophie.
J’ai relevé deux passages qui, à mon sens, donnent le ton de cet opuscule :
Certes, on sait bien qu’un « nouveau philosophe » ne s’intéresse absolument pas aux mathématiques. Il s’intéresse à l’opinion publique, il s’intéresse à la religion musulmane, il s’intéresse au « totalitarisme », aux élections cantonales, à des tas de choses, mais pas aux mathématiques. Et à mes yeux, c’est une erreur. Perso, j’ai le sentiment qu’il vise quelqu’un de précis. Mais ça l’avantage d’être clair sur l’importance qu’il accorde aux mathématiques.
Malheureusement, la rhétorique est la langue politique d’aujourd’hui. C’est une rhétorique de la promesse qui ne sera pas tenue, une rhétorique du programme impraticable, une rhétorique de la nécessité factice. En dessous de cette rhétorique, un certain nombre de décisions sont prises, dans des réunions généralement secrètes ou formatées pour aboutir à la conclusion désirée, au service d’un certain nombre d’intérêts dont la puissance ne peut être contrecarrée. Il arrive même que la rhétorique débouche sur une décision calamiteuse, y compris pour ceux qui la proposent.
J’ai beaucoup apprécié cette approche : voir les mathématiques, non seulement comme une science que beaucoup d’entre nous trouvent rébarbative, mais comme une façon efficace de raisonner sur le monde qui nous entoure. Je ne pense pas déformer sa pensée en avançant que, selon Alain Badiou, cette approche éviterait bien des déboires dans de nombreux domaines tels la politique, mais pas que.
En bref : Je vous invite à découvrir ce petit livre très enrichissant et facile à lire (bien qu’il soit signé par un philosophe :-) ). N’hésitez surtout pas à le lire s’il arrive entre vos mains que ce soit en l’achetant en librairie ou en l’empruntant.
Lien : http://sciences.gloubik.info..
Un beau thème que celui de l’amour. Eloge de l’amour est un beau livre qui est présenté sous forme de compte rendu d’entretiens publics, agréable à lire et à la portée de tous.
Pour ma part, je regrette simplement que la partie sur l’amour er la politique soit tout juste survolée, Alain Badiou nous entraîne, ici, sur des pistes de réflexion intéressantes qui mériteraient d’être approfondies.
Pour ma part, je regrette simplement que la partie sur l’amour er la politique soit tout juste survolée, Alain Badiou nous entraîne, ici, sur des pistes de réflexion intéressantes qui mériteraient d’être approfondies.
Ainsi que l'indique Alain Badiou en note terminale de l'ouvrage, l'idée de ce livre qui repose sur différentes conférences qu'il a donné, est "d'ouvrir entre la jeunesse contemporaine et la philosophie, une discussion sur ce qu'est la vraie vie, d'abord en général, puis selon qu'on est un garçon ou une fille" (p. 117). Mais qu'appelle t-on la "vraie vie" au sens du philosophe ? Une vie qui laisse derrière l'argent, les plaisirs et le pouvoir. Une vie fondée sur des valeurs déconnectées de la puissance de marché. Et ce qu'entend plus précisément Socrate par la corruption de la jeunesse, revient à montrer aux jeunes que la course à l'argent et au pouvoir comme précepte de vie à des fins de satisfaire des pulsions immédiates, ne vaut pas le désintéressement qui ouvre la voie à cette vraie vie. Conscient que l'obstacle principal à ce désintéressement réside dans la passion (souvent inhérente aux jeunes), Alain Badiou convient que l'absence d'initiation de nos sociétés modernes conduit à la fois au culte d'une jeunesse infinie et à une puérilisation de l'adulte, tous deux étant synonymes de désorientation. Aussi, son appel à la corruption de la jeunesse se veut-il le symbole d'un acte militant ayant pour objectif la réconciliation des jeunes et des vieux autour d'une vision philosophique désintéressée...
Telle une image d'Épinal à laquelle on aimerait s'abandonner, cet appel opportun à la corruption de la jeunesse d'Alain Badiou, laisse songeur : si je soutiens la démarche de l'auteur et que je rejoins son avis notamment sur les principales idées de sa conférence sur ce qu'est "Être jeune aujourd'hui", je reste en revanche sceptique concernant ses exposés sur le devenir contemporain des garçons et particulièrement sur celui des filles... Ne faisant toutefois pas partie des jeunes, ni d'ailleurs des vieux qu'Alain Badiou souhaite rallier à sa cause militante, je serais curieuse d'avoir l'avis des principaux intéressés. C'est donc avec un sincère plaisir que je relaie cet appel à la corruption... A vous lire...
Pour finir, je voudrais encore remercier les Éditions Fayard et NetGalley pour la découverte de ce titre dont je recommande évidemment la lecture aux jeunes mais aussi aux autres...
Telle une image d'Épinal à laquelle on aimerait s'abandonner, cet appel opportun à la corruption de la jeunesse d'Alain Badiou, laisse songeur : si je soutiens la démarche de l'auteur et que je rejoins son avis notamment sur les principales idées de sa conférence sur ce qu'est "Être jeune aujourd'hui", je reste en revanche sceptique concernant ses exposés sur le devenir contemporain des garçons et particulièrement sur celui des filles... Ne faisant toutefois pas partie des jeunes, ni d'ailleurs des vieux qu'Alain Badiou souhaite rallier à sa cause militante, je serais curieuse d'avoir l'avis des principaux intéressés. C'est donc avec un sincère plaisir que je relaie cet appel à la corruption... A vous lire...
Pour finir, je voudrais encore remercier les Éditions Fayard et NetGalley pour la découverte de ce titre dont je recommande évidemment la lecture aux jeunes mais aussi aux autres...
Cet ouvrage fait le compte-rendu d'un entretien public entre Alain Badiou et Nicolas Truong lors du festival d'Avignon de 2008. Badiou lui expose sa vision très personnelle de l'amour.
Pour Alain Badiou, la rencontre amoureuse est un hasard, et l'histoire d'un couple est l'histoire de la transformation de ce hasard en nécessité. L'amour est une rencontre de la différence. Il le confronte à de grands concepts : la philosophie, la vérité, la politique, l'art... le propos de l'auteur est simple, concis et honnête : on sent que les idées qu'il développe sont le résultat de ses propres expériences de vie, qui l'ont amenée à une profonde réflexion. Il est facile pour le lecteur d'observer sa propre expérience à la lumière de cette réflexion, et de se rendre compte ainsi à quel point elle est pertinente et encourageante. Ce livre est accessible et recommandable au plus grand nombre, car il ouvre les portes, les fenêtres et les cœurs !
Lien : http://le-cornepage.ek.la/el..
Pour Alain Badiou, la rencontre amoureuse est un hasard, et l'histoire d'un couple est l'histoire de la transformation de ce hasard en nécessité. L'amour est une rencontre de la différence. Il le confronte à de grands concepts : la philosophie, la vérité, la politique, l'art... le propos de l'auteur est simple, concis et honnête : on sent que les idées qu'il développe sont le résultat de ses propres expériences de vie, qui l'ont amenée à une profonde réflexion. Il est facile pour le lecteur d'observer sa propre expérience à la lumière de cette réflexion, et de se rendre compte ainsi à quel point elle est pertinente et encourageante. Ce livre est accessible et recommandable au plus grand nombre, car il ouvre les portes, les fenêtres et les cœurs !
Lien : http://le-cornepage.ek.la/el..
Alain Badiou est l'une des dernières grandes figures d'intellectuel engagé, infatigable défenseur de l'idée communiste. Parce qu'il pense que les idées philosophiques s'étayent et se renouvellent autour de 4 grandes vérités : les sciences, l'art, l'amour et la politique, il avait déjà écrit sur l'amour et le théatre, voici un essai sur les sciences et plus particulièrement les mathématiques. J'attends avec impatience son essai sur la 4ème vérité, la politique.
Concernant son éloge des mathématiques, vous y trouverez de nombreux développements tendant à montrer la communauté d'idées et de raisonnement entre les mathématiques et la philosophie, ce vieux couple. Au delà de ces analyses, des idées fort intéressantes sur le rôle des mathématiques dans la formation des élèves et leur place dans l'éducation. Souhaitons que certaines de ces idées soient reprises par nos enseignants afin que les mathématiques ne deviennent plus seulement une discipline de sélection sociale mais aussi une vraie matière du développement personnel.
Digne d'intérêt aussi les développements sur le formalisme mathématique qui pense en avance les formes possibles de ce qui est. Les mathématiciens découvrent des structures qui s'avéreront être présentes dans la nature. Ce que les ingénieurs contemporains nommeraient de l'avance de phase.
Concernant son éloge des mathématiques, vous y trouverez de nombreux développements tendant à montrer la communauté d'idées et de raisonnement entre les mathématiques et la philosophie, ce vieux couple. Au delà de ces analyses, des idées fort intéressantes sur le rôle des mathématiques dans la formation des élèves et leur place dans l'éducation. Souhaitons que certaines de ces idées soient reprises par nos enseignants afin que les mathématiques ne deviennent plus seulement une discipline de sélection sociale mais aussi une vraie matière du développement personnel.
Digne d'intérêt aussi les développements sur le formalisme mathématique qui pense en avance les formes possibles de ce qui est. Les mathématiciens découvrent des structures qui s'avéreront être présentes dans la nature. Ce que les ingénieurs contemporains nommeraient de l'avance de phase.
Alain Badiou souhaite partager avec nous son bonheur d'intellectuel. Il montre dans cette plaquette l'Homme qu'il est. Le philosophe nous invite à un examen rétrospectif de son parcours novateur et heureux. Il dévoile aussi ici ses projets. Le souffle court, pensant avec ou contre Alain Badiou, à la faveur de cette lecture « métaphysique», nous partageons indéniablement un intense moment de « bonheur réel ». Certes, la pente philosophique est rude mais l'auteur nous a prévenus, suivant les traces de Platon et Spinoza, le bonheur et l'accès aux vérités nécessitent d'emprunter les passages escarpés des mathématiques et de la logique. le sentier est aussi passablement encombré, il faut dégager, par le raisonnement plutôt que par le rêve, le réel du bonheur de son médiocre semblant la satisfaction résultant de la délétère conformité des intérêts de l'individu avec le monde qui lui est imposé. Pour passer par là, comme notre guide, il faut nécessairement mouiller sa chemise, ralentir sa pensée, se révolter et prendre des risques.
Alain Badiou donne envie de sa philosophie et envie de philosopher. Il replace sa pensée dans le grand et passionnant tourbillon de la modernité. La phénoménologie, l'herméneutique, les courants analytiques et post modernes, pour mieux s'y opposer, sont synthétiquement évoqués dans son dernier livre. le platonicien critique du sens commun et du régime de l'opinion, le bâtisseur de systèmes, contre une philosophie contemporaine du sens et du langage qui interprète le monde sans le changer, réaffirme naturellement la nécessité d'une métaphysique de la vérité. Il fait plus étonnamment une place dans son ouvrage à l'antiphilosophie pour laquelle la vérité existe mais doit être rencontrée plus que pensée ou construite. Et c'est avec elle que l'auteur introduit la théorie badiousienne de l'évènement. Pour l'antiphilosophe comme pour Badiou, le bonheur réel est subordonné aux rencontres hasardeuses qui nous somment de choisir. Un sujet nait dans ces rencontres incalculables d'un possible ignoré à quoi se noue un devenir-sujet. Devenir sujet d'une vérité, martèle le philosophe contre le conservatisme ambiant, est une chance que l'existence nous propose dans la modalité d'une rencontre ; et c'est l'affect qui l'accompagne, au-delà de toute satisfaction des besoins, qui mérite le nom de bonheur.
La théorie de l'évènement est assurément d'une très grande complexité. Alain Badiou évidemment n'expose pas, en quelques pages, la matière extrêmement dense, mathématique de ses travaux (« L'être et l'évènement » et « Logique des mondes »). Dans cette « Métaphysique du bonheur réel », il préfère le plus souvent – notamment lorsqu'il est question de changer le monde pour être heureux – « illustrer» avec beaucoup de simplicité et de générosité et rythmer agréablement de quelques sentences sur le bonheur, les catégories badiousiennes de l'être, de l'évènement, du sujet et de la fidélité. L'évènement, nous dit-il, c'est le nom de quelque chose qui se produit localement dans le monde et qui ne peut être déduit de ce même monde. La force d'un évènement, c'est qu'il expose quelque chose qui était cachée, invisible parce que masquée par les lois de ce monde. L'être – énigmatiques multiples inorganisés – affirme-t-il enfin, peut être interrompu par un évènement. Exposé à un évènement, l'individu se transforme en sujet, c'est-à-dire qu'il encourt un processus de subjectivation sous condition de l'évènement qui implique de sa part une décision d'y demeurer fidèle. Jusque-là, il est possible de suivre la pensée de l'auteur sans trop de difficultés. Il est cependant question dans un dernier chapitre de la philosophie « hors sol » de l'auteur et des problèmes en suspens. Alors, la grande complexité de la machine badiousienne fait surface et il arrive de perdre pied sans pouvoir vraiment dire ici si le formalisme du philosophe est utile et s'il est nécessaire. C'est certes un inconvénient de cette fin de parcours ; ce peut être un avantage car cela nous donne envie de travailler, d'aller voir. Certains livres comme celui-ci nous confrontent à une altérité forte, nous convient à une expérience de pensée. L'intérêt alors ne vient plus de ce que nous savons, mais de ce que nous sommes susceptibles d'apprendre.
Alain Badiou, en conclusion de son livre, à contrecourant du scepticisme contemporain, du relativisme culturel et de la rhétorique généralisée, affirme que la philosophie est un exercice possible de transmission du concept de vérité et de celui d'incorporation d'un individu au devenir d'une vérité. Il y a certes, nous dit-il, des procédures de vérité distinctes dans le domaine de la politique, de la science, des Arts et de l'Amour. Mais une vérité des vérités, c'est-à-dire une vérité de la vie complète, une philosophie unificatrice générale des choses est possible pour une autre raison qu'elle serait une rhétorique générale. Pour Alain Badiou, la philosophie doit repérer les vérités de son temps à travers un concept renouvelé de ce qu'est une vérité (discernements) et, à travers la construction d'une catégorie de vérité, elle doit rendre compossible des régimes hétérogènes de vérité (unification). le discernement doit aboutir à une conception critique de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas ; l'unification permettre les différents usages de la catégorie de totalité et de système.
Alain Badiou donne envie de sa philosophie et envie de philosopher. Il replace sa pensée dans le grand et passionnant tourbillon de la modernité. La phénoménologie, l'herméneutique, les courants analytiques et post modernes, pour mieux s'y opposer, sont synthétiquement évoqués dans son dernier livre. le platonicien critique du sens commun et du régime de l'opinion, le bâtisseur de systèmes, contre une philosophie contemporaine du sens et du langage qui interprète le monde sans le changer, réaffirme naturellement la nécessité d'une métaphysique de la vérité. Il fait plus étonnamment une place dans son ouvrage à l'antiphilosophie pour laquelle la vérité existe mais doit être rencontrée plus que pensée ou construite. Et c'est avec elle que l'auteur introduit la théorie badiousienne de l'évènement. Pour l'antiphilosophe comme pour Badiou, le bonheur réel est subordonné aux rencontres hasardeuses qui nous somment de choisir. Un sujet nait dans ces rencontres incalculables d'un possible ignoré à quoi se noue un devenir-sujet. Devenir sujet d'une vérité, martèle le philosophe contre le conservatisme ambiant, est une chance que l'existence nous propose dans la modalité d'une rencontre ; et c'est l'affect qui l'accompagne, au-delà de toute satisfaction des besoins, qui mérite le nom de bonheur.
La théorie de l'évènement est assurément d'une très grande complexité. Alain Badiou évidemment n'expose pas, en quelques pages, la matière extrêmement dense, mathématique de ses travaux (« L'être et l'évènement » et « Logique des mondes »). Dans cette « Métaphysique du bonheur réel », il préfère le plus souvent – notamment lorsqu'il est question de changer le monde pour être heureux – « illustrer» avec beaucoup de simplicité et de générosité et rythmer agréablement de quelques sentences sur le bonheur, les catégories badiousiennes de l'être, de l'évènement, du sujet et de la fidélité. L'évènement, nous dit-il, c'est le nom de quelque chose qui se produit localement dans le monde et qui ne peut être déduit de ce même monde. La force d'un évènement, c'est qu'il expose quelque chose qui était cachée, invisible parce que masquée par les lois de ce monde. L'être – énigmatiques multiples inorganisés – affirme-t-il enfin, peut être interrompu par un évènement. Exposé à un évènement, l'individu se transforme en sujet, c'est-à-dire qu'il encourt un processus de subjectivation sous condition de l'évènement qui implique de sa part une décision d'y demeurer fidèle. Jusque-là, il est possible de suivre la pensée de l'auteur sans trop de difficultés. Il est cependant question dans un dernier chapitre de la philosophie « hors sol » de l'auteur et des problèmes en suspens. Alors, la grande complexité de la machine badiousienne fait surface et il arrive de perdre pied sans pouvoir vraiment dire ici si le formalisme du philosophe est utile et s'il est nécessaire. C'est certes un inconvénient de cette fin de parcours ; ce peut être un avantage car cela nous donne envie de travailler, d'aller voir. Certains livres comme celui-ci nous confrontent à une altérité forte, nous convient à une expérience de pensée. L'intérêt alors ne vient plus de ce que nous savons, mais de ce que nous sommes susceptibles d'apprendre.
Alain Badiou, en conclusion de son livre, à contrecourant du scepticisme contemporain, du relativisme culturel et de la rhétorique généralisée, affirme que la philosophie est un exercice possible de transmission du concept de vérité et de celui d'incorporation d'un individu au devenir d'une vérité. Il y a certes, nous dit-il, des procédures de vérité distinctes dans le domaine de la politique, de la science, des Arts et de l'Amour. Mais une vérité des vérités, c'est-à-dire une vérité de la vie complète, une philosophie unificatrice générale des choses est possible pour une autre raison qu'elle serait une rhétorique générale. Pour Alain Badiou, la philosophie doit repérer les vérités de son temps à travers un concept renouvelé de ce qu'est une vérité (discernements) et, à travers la construction d'une catégorie de vérité, elle doit rendre compossible des régimes hétérogènes de vérité (unification). le discernement doit aboutir à une conception critique de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas ; l'unification permettre les différents usages de la catégorie de totalité et de système.
Un petit essai très bien fait et attrayant.
Lien : http://sciences.gloubik.info..
Lien : http://sciences.gloubik.info..
Dans ce court essai, Alain Badiou propose une conception originale du bonheur, compris comme la découverte par l’individu d’une capacité qu’il ignorait posséder.
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
dans cette petite conférence l'auteur nous parle de l'infini!!! ce dernier qui "torture" l'esprit des mathématiciens et des philosophes depuis si longtemps!!! l'auteur nous expose sa propre definition de l'infini!
Reçu dans le cadre du jeu Masse critique de Babelio, Métaphysique du Bonheur réel est un livre philosophique qui doit, aujourd'hui, recevoir sa critique. Comment l'amener, comment la livrer quand on a, comme moi, le sentiment de ne pas avoir tout compris? Soyons honnête, l'incompréhension me prive d'un droit de critique sur le fond. Que pourrais-je, en effet, répondre à Alain Badiou? Oui, je suis d'accord, notre époque souffre cruellement d'une absence philosophique. Bien sûre, je le confirme, la philosophie - si raillée - doit s'inviter et même s'imposer dans notre société. Evidemment, elle suppose du temps et une continuité. Mais pour le reste, que dire? Je crains tellement de dire des âneries, de peur d'avoir mal compris le philosophe, que je me garderais bien de discuter, ici, avec lui. C'est la forme que je préfère critiquée. Et sur ce point, j'ai quelque chose à écrire.
De sa plume pleine d'assurance, Alain Badiou, célèbre personnage public, n'encourage pas la compréhension. L'écriture est agréable mais difficile à entendre. C'est de la philosophie me diriez-vous, c'est complexe, toujours, et pour l'entendre il faut faire un effort. Oui mais justement ... du fait de sa complexité, l'auteur doit tenter la simplicité pour assurer l'intelligibilité. Des explications en des termes abordables n'auraient sans doute pas fait de mal. Des exemples n'auraient sans doute pas été de trop. Mais malheureusement, ils manquent cruellement à l'ouvrage difficile à apprécier pour les non-initiés. Dès lors, que faire de ce livre? Je l'ai lu sans passion ni grande conviction. Ce que je pense avoir compris ne m'a pas convaincu et ce que je n'ai pas compris reste dans l'oubli. A moins qu'une âme charitable, baignée dans la philosophie, vienne gentillement me raconter tout ce que je n'ai pas saisi. En l'état difficile pour moi de juger quoique ce soit. Philosophiquement, en tout cas.
De sa plume pleine d'assurance, Alain Badiou, célèbre personnage public, n'encourage pas la compréhension. L'écriture est agréable mais difficile à entendre. C'est de la philosophie me diriez-vous, c'est complexe, toujours, et pour l'entendre il faut faire un effort. Oui mais justement ... du fait de sa complexité, l'auteur doit tenter la simplicité pour assurer l'intelligibilité. Des explications en des termes abordables n'auraient sans doute pas fait de mal. Des exemples n'auraient sans doute pas été de trop. Mais malheureusement, ils manquent cruellement à l'ouvrage difficile à apprécier pour les non-initiés. Dès lors, que faire de ce livre? Je l'ai lu sans passion ni grande conviction. Ce que je pense avoir compris ne m'a pas convaincu et ce que je n'ai pas compris reste dans l'oubli. A moins qu'une âme charitable, baignée dans la philosophie, vienne gentillement me raconter tout ce que je n'ai pas saisi. En l'état difficile pour moi de juger quoique ce soit. Philosophiquement, en tout cas.
Publié en même temps que Métaphysique du bonheur réel, l’opuscule est un réel bonheur : s’y déploie la plus intelligente des «mécaniques» de pensée, si leste, originale et efficace qu’elle laisse baba, quand bien même ne serait-on d’accord avec rien de ce qu’elle expose.
Lien : http://rss.feedsportal.com/c..
Lien : http://rss.feedsportal.com/c..
Je tiens tout d'abord à signaler que je n'ai pas lu ce livre en entier. Donc mon avis, aussi subjectif soit-il, ne sera pas réellement complet concernant cet ouvrage. Ensuite, j'ai été poussé à lire cet essai dans le cadre de mes études de lettres, principalement en littérature française du XXème siècle, où l'on étudiait plusieurs pièces de Samuel Beckett (dont Oh les beaux jours). Pour approfondir mes connaissances, j'ai donc acheté cet essai d'Alain Badiou, que mes enseignantes citaient à longueur de temps.
Quelle ne fût pas ma surprise en découvrant l'écriture de cet homme ! Alain Badiou, professeur de philosophie à l'Ecole Normale Supérieure, a la plume alambiquée, tortueuse et presque incompréhensible à déchiffrer. Sa profession est clairement visible à travers ses lignes, car même en lisant, relisant, re-relisant encor et toujours une seule et même phrase, il est très complexe de voir ce que veut signifier l'auteur. Alain Badiou amène à réfléchir. Il faut décrypter, analyser, puiser dans les connaissances déjà acquises pour ensuite pleinement interpréter les dires de l'auteur.
Vous l'aurez compris, je n'ai pas eu le courage (ni assez de temps) pour approfondir cette lecture complémentaire. Je lisais en lire, sans comprendre ce que je lisais. J'applaudis l'intelligence, la dextérité de l'esprit d'Alain Badiou, sa jolie prose et son génie littéraire... mais je ne le remercie pas de laisser les étudiants dans la mouise la plus totale. Au bout de quelques dizaines de pages sans comprendre une seule phrase de ce que je lisais, j'ai finalement décidé d'abandonner.
Un essai censé aider les étudiants à approfondir l'analyse des oeuvres de Samuel Beckett, mais qui les complique bien davantage. Une écriture philosophique bien trop poussée pour les lecteurs moyens dont je fais partie. Une note à la hauteur de ma déception concernant cette étude.
Lien : http://addictbooks.skyrock.c..
Quelle ne fût pas ma surprise en découvrant l'écriture de cet homme ! Alain Badiou, professeur de philosophie à l'Ecole Normale Supérieure, a la plume alambiquée, tortueuse et presque incompréhensible à déchiffrer. Sa profession est clairement visible à travers ses lignes, car même en lisant, relisant, re-relisant encor et toujours une seule et même phrase, il est très complexe de voir ce que veut signifier l'auteur. Alain Badiou amène à réfléchir. Il faut décrypter, analyser, puiser dans les connaissances déjà acquises pour ensuite pleinement interpréter les dires de l'auteur.
Vous l'aurez compris, je n'ai pas eu le courage (ni assez de temps) pour approfondir cette lecture complémentaire. Je lisais en lire, sans comprendre ce que je lisais. J'applaudis l'intelligence, la dextérité de l'esprit d'Alain Badiou, sa jolie prose et son génie littéraire... mais je ne le remercie pas de laisser les étudiants dans la mouise la plus totale. Au bout de quelques dizaines de pages sans comprendre une seule phrase de ce que je lisais, j'ai finalement décidé d'abandonner.
Un essai censé aider les étudiants à approfondir l'analyse des oeuvres de Samuel Beckett, mais qui les complique bien davantage. Une écriture philosophique bien trop poussée pour les lecteurs moyens dont je fais partie. Une note à la hauteur de ma déception concernant cette étude.
Lien : http://addictbooks.skyrock.c..
Faire tomber les murs transforme la réalité
« Les textes qui suivent correspondent à une partie des interventions prononcées à l’occasion du colloque organisé avec l’université de Paris-8 sous le titre « Le Symptôma grec » en janvier 2013. Il s’agissait de penser dans et sous condition de la circonstance politique, au plus près de l’actualité, sans disposer de la distance nécessaire et de la prudence qui président habituellement aux manifestations académiques ».
Comme l’indique Maria Kakogianni dans un premier texte « L’usage du mot « symptôme » comporte une note ironique qui fait écho à la discursivité dominante d’une politique médicalisée ». Car au delà des prétendues « thérapies » organisées et imposées par la Troïka, il s’agit de politiques concertées, d’attaques frontales contre les droits des salarié-e-s ou des peuples, au nom du remboursement des dettes, dont les caractères odieux et illégitimes ne doivent pas être oubliés, de « leur crise » plutôt que de « la crise ».
Les auteur-e-s revendiquent à juste titre « une liberté inconditionnelle de questionnement et de proposition » et le refus d’abandonner l’avenir, leur/notre avenir à l’Etat ou au marché.
« Notre point de départ était de ne pas construire un colloque « réussi » où finalement nos oreilles entendraient ce qu’elles sont habituées à entendre. Où les gens se rassembleraient de la manière habituelle. Où les gestes ne trembleraient pas mais sont imprégnés de maîtrise. Et parfois même d’un savoir aussi mélancolique qu’accumulé, d’un monde impossible à changer ».
Le projet est louable, reste que certain-e-s, sans la prudence revendiquée par Jacques Rancière (« comment on peut tenter un petit peu aujourd’hui de changer la manière même dont on pense ce que c’est que penser, ce que c’est qu’agir après une pensée »), n’hésitent pas asséner leurs jargons, truffés de « post » de « biopolitique », de « multitude », de « biocapital », de production cognitive ou de travail cognitif (lire aussi le rappel de Jacques Rancière : « Les 250 millions de travailleurs migrants intérieurs en Chine n’ont rien à voir avec le « nomade » des philosophes ni avec le travail « immatériel ». »), de donner des leçons… à l’instar de Antonio Negri, oublieux de son appel à voter pour la constitution ultra-libérale proposée pour l’Europe, ou d’Alain Badiou, qui écrit, sans rire, à propos des « Etats socialistes » et des « Partis communistes » que « cette critique devait être la nôtre », oubliant son passé stalinien, son soutien, entre autres, aux exactions des gardes rouges chinois ou au régime génocidaire des khmers rouges…
Il me fallait exprimer cet énervement devant la morgue de certains, les relents fétides incompatibles avec les auto-émancipations possibles…
Cela étant dit, et dans la limite de mes compétences, j’indique quelques points présentés comme interrogations ou analyses.
Etienne Balibar propose des réflexions autour du « peuple européen », de la démocratie. Il souligne qu’il « convient d’offrir au « peuple européen » les « possibilités d’expression démocratique et de contrôle du pouvoir par la « masse » des citoyens supérieures (et non inférieures) à celles que présentent (ou présentaient naguère) les Etats nationaux même les plus démocratiques ». Contre les visions réductrices de la démocratie, il indique « Il y a une complexité, une hétérogénéité même de la démocratisation, qui est la condition de son effectivité » et fait le lien entre imposition et représentation « no taxation without representation ! » et « no representation without taxation ! » et poursuit sur l’harmonisation fiscale européenne à mettre en place. Pour lui, la politique démocratique peut se définir « en avançant, en créant à mesure ses propres conditions de possibilité « subjectives » et « objectives ». »
Bancocratie, endettement de l’Etat, monnaie et dépossession du pouvoir, gestion de la « crise grecque », Marie Cuillerai et Maria Kakogianni soulignent que « cet échec est ici le nom d’une certaine réussite ». La notion de « monnaie politique » me semble peu pourvu de sens, je rappelle que la monnaie relève d’un rapport social. Les auteures indiquent, et on ne le dira jamais assez, que « les Etats ont activement produit la financiarisation… », parlent des « dettes des vaincus »… Je suis étonné de l’absence de référence sur la bancocratie et sur la dette aux travaux du CADTM (voir par exemple : Damien Millet et Éric Toussaint : AAA Audit Annulation Autre politique. Crise de la dette : la seule façon d’en sortir, ou Eric Toussaint : Bancocratie).Parler de la dette sans la remettre en cause, sans évoquer les multiples mobilisations sur son annulation, sur les politiques sud-américaines, me semble contre-productif. (C’est aussi le cas dans l’article de Yannis Stavrakakis). En rester aux conséquences subjectives sur les individu-e-s reste très restrictif, même d’un point de vue strictement philosophique. Comme l’indique Costas Douzinas, la dette est un rapport social.
J’ai apprécié des pistes ouvertes par Elsa Papageorgiou. Retours à Henri Lefebvre, à Walter Benjamin. L’auteure souligne que « la capacité destructice produit des lieux de prospérité », parle de l’impuissance politique, des effets compensatoires de la consommation, de menace fasciste, d’image de dépossession et d’impuissance. Il reste étonnant, et cela est valable pour tou-te-s les auteur-e-s, que les élaborations du mouvement féministe ne soient pas intégrées. (Voir par exemple sur la dépossession et l’impuissance, Andrea Dworkin : Les femmes de droite).J’ai été notamment intéressé par l’article d’Amador Fernández-Savater, son traitement des fictions littéraires, du 15-M, sa lecture de « L’homme citoyen », de « Nous sommes tous des juifs allemands » ou de « Nous sommes le peuple », ses questionnement sur les processus de subjectivation, les fables comme choses sérieuses, l’émancipation, « nous sommes et nous ne sommes pas ce que nous sommes », le « nous ouvert et incluant »…
Les éléments les plus intéressants du livre, me semblent se trouver dans les réponses de Jacques Rancière aux questions/discours de Maria Kakogianni : sur des présents contribuant à créer des futurs, les opérations d’universalisation produites par les collectifs politiques, les représentations, les formes de violence, les anonymes, la constitution du nouveau, les rythmes temporels, les processus de subjectivation, la libération « d’autres enchaînements nécessaires »… Ou le rappel que « l’économie du profit ne sera pas vaincue par des arts du vivre » et sa critique du « baratin » post-moderne…
Jacques Rancière développe des pensées intégrant les contradictions, ne lissant les situations, comme par exemple : « Ce n’est pas parce qu’on reconnaît la violence des actes de lutte de classes de l’internationale capitaliste qu’on fait pour autant un discours victimaire sur la souffrance des pauvres grecs ou autres peuples soumis aux mêmes contraintes ».
Une invitation, non à fournir des lunettes pour voir, mais « une méthode artisanale pour construire ces lunettes. Le reste nous appartient ».
Sommaire :
Maria Kakogianni : Essayer encore. Rater encore. Rater mieux
Étienne Balibar : Comment résoudre l’aporie du « peuple européen » ?
Marie Cuillerai, Maria Kakogianni : Bancocratie
Bruno Théret : Pour un fédéralisme monétaire européen
Elsa Papageorgiou : La crise sociale totale et le retour du fascisme
Yannis Stavrakakis : La société de la dette : la Grèce et l’avenir de la post-démocratie
Howard Caygill : Résister à l’escalade : l’image de la villa Amalias
Costas Douzinas : La résistance, la philosophie et la gauche
Antonio Negri : De la fin des gauches nationales aux mouvements subversifs pour l’Europe
Amador Fernández-Savater : Politique littérale et politique littéraire
Maria Kakogianni, Jacques Rancière : Dialogue précaire
Alain Badiou : L’impuissance contemporaine
Camille Louis : Symptôma, suites
Lien : https://entreleslignesentrel..
« Les textes qui suivent correspondent à une partie des interventions prononcées à l’occasion du colloque organisé avec l’université de Paris-8 sous le titre « Le Symptôma grec » en janvier 2013. Il s’agissait de penser dans et sous condition de la circonstance politique, au plus près de l’actualité, sans disposer de la distance nécessaire et de la prudence qui président habituellement aux manifestations académiques ».
Comme l’indique Maria Kakogianni dans un premier texte « L’usage du mot « symptôme » comporte une note ironique qui fait écho à la discursivité dominante d’une politique médicalisée ». Car au delà des prétendues « thérapies » organisées et imposées par la Troïka, il s’agit de politiques concertées, d’attaques frontales contre les droits des salarié-e-s ou des peuples, au nom du remboursement des dettes, dont les caractères odieux et illégitimes ne doivent pas être oubliés, de « leur crise » plutôt que de « la crise ».
Les auteur-e-s revendiquent à juste titre « une liberté inconditionnelle de questionnement et de proposition » et le refus d’abandonner l’avenir, leur/notre avenir à l’Etat ou au marché.
« Notre point de départ était de ne pas construire un colloque « réussi » où finalement nos oreilles entendraient ce qu’elles sont habituées à entendre. Où les gens se rassembleraient de la manière habituelle. Où les gestes ne trembleraient pas mais sont imprégnés de maîtrise. Et parfois même d’un savoir aussi mélancolique qu’accumulé, d’un monde impossible à changer ».
Le projet est louable, reste que certain-e-s, sans la prudence revendiquée par Jacques Rancière (« comment on peut tenter un petit peu aujourd’hui de changer la manière même dont on pense ce que c’est que penser, ce que c’est qu’agir après une pensée »), n’hésitent pas asséner leurs jargons, truffés de « post » de « biopolitique », de « multitude », de « biocapital », de production cognitive ou de travail cognitif (lire aussi le rappel de Jacques Rancière : « Les 250 millions de travailleurs migrants intérieurs en Chine n’ont rien à voir avec le « nomade » des philosophes ni avec le travail « immatériel ». »), de donner des leçons… à l’instar de Antonio Negri, oublieux de son appel à voter pour la constitution ultra-libérale proposée pour l’Europe, ou d’Alain Badiou, qui écrit, sans rire, à propos des « Etats socialistes » et des « Partis communistes » que « cette critique devait être la nôtre », oubliant son passé stalinien, son soutien, entre autres, aux exactions des gardes rouges chinois ou au régime génocidaire des khmers rouges…
Il me fallait exprimer cet énervement devant la morgue de certains, les relents fétides incompatibles avec les auto-émancipations possibles…
Cela étant dit, et dans la limite de mes compétences, j’indique quelques points présentés comme interrogations ou analyses.
Etienne Balibar propose des réflexions autour du « peuple européen », de la démocratie. Il souligne qu’il « convient d’offrir au « peuple européen » les « possibilités d’expression démocratique et de contrôle du pouvoir par la « masse » des citoyens supérieures (et non inférieures) à celles que présentent (ou présentaient naguère) les Etats nationaux même les plus démocratiques ». Contre les visions réductrices de la démocratie, il indique « Il y a une complexité, une hétérogénéité même de la démocratisation, qui est la condition de son effectivité » et fait le lien entre imposition et représentation « no taxation without representation ! » et « no representation without taxation ! » et poursuit sur l’harmonisation fiscale européenne à mettre en place. Pour lui, la politique démocratique peut se définir « en avançant, en créant à mesure ses propres conditions de possibilité « subjectives » et « objectives ». »
Bancocratie, endettement de l’Etat, monnaie et dépossession du pouvoir, gestion de la « crise grecque », Marie Cuillerai et Maria Kakogianni soulignent que « cet échec est ici le nom d’une certaine réussite ». La notion de « monnaie politique » me semble peu pourvu de sens, je rappelle que la monnaie relève d’un rapport social. Les auteures indiquent, et on ne le dira jamais assez, que « les Etats ont activement produit la financiarisation… », parlent des « dettes des vaincus »… Je suis étonné de l’absence de référence sur la bancocratie et sur la dette aux travaux du CADTM (voir par exemple : Damien Millet et Éric Toussaint : AAA Audit Annulation Autre politique. Crise de la dette : la seule façon d’en sortir, ou Eric Toussaint : Bancocratie).Parler de la dette sans la remettre en cause, sans évoquer les multiples mobilisations sur son annulation, sur les politiques sud-américaines, me semble contre-productif. (C’est aussi le cas dans l’article de Yannis Stavrakakis). En rester aux conséquences subjectives sur les individu-e-s reste très restrictif, même d’un point de vue strictement philosophique. Comme l’indique Costas Douzinas, la dette est un rapport social.
J’ai apprécié des pistes ouvertes par Elsa Papageorgiou. Retours à Henri Lefebvre, à Walter Benjamin. L’auteure souligne que « la capacité destructice produit des lieux de prospérité », parle de l’impuissance politique, des effets compensatoires de la consommation, de menace fasciste, d’image de dépossession et d’impuissance. Il reste étonnant, et cela est valable pour tou-te-s les auteur-e-s, que les élaborations du mouvement féministe ne soient pas intégrées. (Voir par exemple sur la dépossession et l’impuissance, Andrea Dworkin : Les femmes de droite).J’ai été notamment intéressé par l’article d’Amador Fernández-Savater, son traitement des fictions littéraires, du 15-M, sa lecture de « L’homme citoyen », de « Nous sommes tous des juifs allemands » ou de « Nous sommes le peuple », ses questionnement sur les processus de subjectivation, les fables comme choses sérieuses, l’émancipation, « nous sommes et nous ne sommes pas ce que nous sommes », le « nous ouvert et incluant »…
Les éléments les plus intéressants du livre, me semblent se trouver dans les réponses de Jacques Rancière aux questions/discours de Maria Kakogianni : sur des présents contribuant à créer des futurs, les opérations d’universalisation produites par les collectifs politiques, les représentations, les formes de violence, les anonymes, la constitution du nouveau, les rythmes temporels, les processus de subjectivation, la libération « d’autres enchaînements nécessaires »… Ou le rappel que « l’économie du profit ne sera pas vaincue par des arts du vivre » et sa critique du « baratin » post-moderne…
Jacques Rancière développe des pensées intégrant les contradictions, ne lissant les situations, comme par exemple : « Ce n’est pas parce qu’on reconnaît la violence des actes de lutte de classes de l’internationale capitaliste qu’on fait pour autant un discours victimaire sur la souffrance des pauvres grecs ou autres peuples soumis aux mêmes contraintes ».
Une invitation, non à fournir des lunettes pour voir, mais « une méthode artisanale pour construire ces lunettes. Le reste nous appartient ».
Sommaire :
Maria Kakogianni : Essayer encore. Rater encore. Rater mieux
Étienne Balibar : Comment résoudre l’aporie du « peuple européen » ?
Marie Cuillerai, Maria Kakogianni : Bancocratie
Bruno Théret : Pour un fédéralisme monétaire européen
Elsa Papageorgiou : La crise sociale totale et le retour du fascisme
Yannis Stavrakakis : La société de la dette : la Grèce et l’avenir de la post-démocratie
Howard Caygill : Résister à l’escalade : l’image de la villa Amalias
Costas Douzinas : La résistance, la philosophie et la gauche
Antonio Negri : De la fin des gauches nationales aux mouvements subversifs pour l’Europe
Amador Fernández-Savater : Politique littérale et politique littéraire
Maria Kakogianni, Jacques Rancière : Dialogue précaire
Alain Badiou : L’impuissance contemporaine
Camille Louis : Symptôma, suites
Lien : https://entreleslignesentrel..
Le titre renvoie bien sûr à Lénine, mais, pour moi, dans la mesure où il touche à une grande quantité de sujets allant de l'éducation au politique, il est plus proche de l'essai Que Faire? de Tchernishevsky...qui a téerminé le titre de l'essai de Lénine.
Livre reçu dans le cadre de masse critique, merci à babelio et à philosophie éditions
Le titre de ce livre est naturellement une référence au livre de Lénine rédigé lors de son exil en Finlande, livre de réflexion de stratégie de prise de pouvoir écrit avant 1917.
Un livre dialogue entre les deux philosophes Alain Badiou et Marcel Gauchet sur « l’hypothèse communiste ». Pour l’anecdote les deux penseurs ont échangé dans les locaux du siège du parti communiste français à Paris, de l’hôtel Lutetia et des éditions Gallimard…. Le choix du second lieu a de quoi laisser perplexe eu égard au contenu des échanges, outre qu’il s’agit d’un établissement de luxe, ce fut aussi le quartier général de la gestapo.
Cette hypothèse communiste est le retour en force de Marx que les logiques mortifères du capitalisme financier ont réussi le tour de force de remettre en selle le vieux barbu. On se souvient que le système de Marx est fondé sur le matérialisme historique, c'est-à-dire sur une « loi » qui constituerait le moteur de l’histoire, le développement des forces productives permettrait aux classes sociales dominantes, à un moment historique, d’imposer un mode de production.
Dans ce déterminisme, le capitalisme après avoir imposé son hégémonie sur l’ancien régime est voué à connaitre des crises à répétition, jusqu’à la crise finale, en raison de la loi de la baisse tendancielle et inéluctable du taux de profit. Le prolétariat serait ainsi conduit le à prendre le pouvoir pour instaurer le communisme.
Or, la chute du mur de Berlin en 1989 semblait couronner le triomphe définitif du modèle capitaliste sur le socialisme à tel point que le philosophe Fukuyama énonçait avec autorité « la fin de l’histoire ».
C’est sur ces fondements idéologiques tous les acquis de l’Etat providence, institués pour éviter que les citoyens ne soient tentés par le « modèle » socialiste étatique alors en vigueur en URSS et en Chine ont été progressivement remis en question.
En 2008, il y a eu la chute de la maison Lehman Brothers et du modèle économique sur lequel la banque était adossée. Le système était réputé s’auto réguler, il était mathématiquement prouvé qu’une crise n’était plus possible, « l’optimisation des facteurs de production », garantie pour que l’Etat n’intervienne pas et abroge les réglementations mises en place à la suite de la crise de 1929 et du nouvel ordre mondial de 1945. Les algorithmes miraculeux veillaient à la place des réglementations désuètes.
Mais cette nouvelle crise n’est en réalité que la plus violente d’une série à périodicité de plus en plus rapprochée, sans oublier toute les affaires (LTCM, Enron, Vivendi…) qui illustrent l’irrationalité des acteurs financiers et la prise de risques incontrôlée par appât du gain, susceptible de provoquer des crises systémiques. Nous sommes à des années lumière de la main invisible qui garantit les grands équilibres à la fois micro et macro économiques.
Les deux philosophes se rejoignent sur le caractère toxique du capitalisme financier,
Ainsi pour Gauchet « Nous avons aujourd’hui, avec la gangrène de la finance, un capitalisme de prédation, voué à la crise permanente du fait de sa perpétuelle fuite en avant, portée par des instruments de plus en plus déconnectés du réel et incontrôlables », difficile de faire un réquisitoire plus incisif.
De même, il semble y avoir consensus pour considérer qu’il y a une césure entre Lénine, et Marx. Le second n’aurait pas été favorable à une dictature de l’Etat, fut-elle imposée au nom du socialisme.
Cette appréciation est pour le moins discutable, Marx n’acceptait pas la contradiction et la biodiversité dans les différentes sensibilités de l’idée du socialisme, il avait une haute idée du caractère scientifique de ses conclusions. Le léninisme porte bien les gênes de Marx.
En revanche, la ligne de partage entre les deux philosophes passe par les moyens de réformer les défauts du capitalisme. Gauchet est persuadé qu’il peut être réformé dans un cadre démocratique conventionnel, ce qui n’est évidemment pas le point de vue de Badiou qui considère que les détenteurs du pouvoir ne renonceront pas à leurs intérêts.
Sans adhérer aux conceptions de Badiou notamment à l’égard du maoisme, on ne peut que relever que les espérances de Gauchet pêchent par optimisme.
Les plus grands progrès sociaux du XXéme siécle dans les pays industrialisés les plus modernes ont été rendus possibles, non par philanthropie ou sagesse des détenteurs du pouvoir financier mais parce qu’il y a eu une conjonction exceptionnelle de facteurs favorables en 1945 et dans les années suivantes pour mettre en place les fondations de l’Etat providence. Certes on peut espérer que les grands défis à affronter aujourd’hui puissent provoquer un électro choc dans les consciences collectives et individuelles, mais le chemin semble encore très escarpé, c’est un euphémisme.
Un dialogue de grande qualité entre deux grands esprits, qui met le doigt là où cela fait mal mais qui ne répond pas à la question « que faire ?»
Le titre de ce livre est naturellement une référence au livre de Lénine rédigé lors de son exil en Finlande, livre de réflexion de stratégie de prise de pouvoir écrit avant 1917.
Un livre dialogue entre les deux philosophes Alain Badiou et Marcel Gauchet sur « l’hypothèse communiste ». Pour l’anecdote les deux penseurs ont échangé dans les locaux du siège du parti communiste français à Paris, de l’hôtel Lutetia et des éditions Gallimard…. Le choix du second lieu a de quoi laisser perplexe eu égard au contenu des échanges, outre qu’il s’agit d’un établissement de luxe, ce fut aussi le quartier général de la gestapo.
Cette hypothèse communiste est le retour en force de Marx que les logiques mortifères du capitalisme financier ont réussi le tour de force de remettre en selle le vieux barbu. On se souvient que le système de Marx est fondé sur le matérialisme historique, c'est-à-dire sur une « loi » qui constituerait le moteur de l’histoire, le développement des forces productives permettrait aux classes sociales dominantes, à un moment historique, d’imposer un mode de production.
Dans ce déterminisme, le capitalisme après avoir imposé son hégémonie sur l’ancien régime est voué à connaitre des crises à répétition, jusqu’à la crise finale, en raison de la loi de la baisse tendancielle et inéluctable du taux de profit. Le prolétariat serait ainsi conduit le à prendre le pouvoir pour instaurer le communisme.
Or, la chute du mur de Berlin en 1989 semblait couronner le triomphe définitif du modèle capitaliste sur le socialisme à tel point que le philosophe Fukuyama énonçait avec autorité « la fin de l’histoire ».
C’est sur ces fondements idéologiques tous les acquis de l’Etat providence, institués pour éviter que les citoyens ne soient tentés par le « modèle » socialiste étatique alors en vigueur en URSS et en Chine ont été progressivement remis en question.
En 2008, il y a eu la chute de la maison Lehman Brothers et du modèle économique sur lequel la banque était adossée. Le système était réputé s’auto réguler, il était mathématiquement prouvé qu’une crise n’était plus possible, « l’optimisation des facteurs de production », garantie pour que l’Etat n’intervienne pas et abroge les réglementations mises en place à la suite de la crise de 1929 et du nouvel ordre mondial de 1945. Les algorithmes miraculeux veillaient à la place des réglementations désuètes.
Mais cette nouvelle crise n’est en réalité que la plus violente d’une série à périodicité de plus en plus rapprochée, sans oublier toute les affaires (LTCM, Enron, Vivendi…) qui illustrent l’irrationalité des acteurs financiers et la prise de risques incontrôlée par appât du gain, susceptible de provoquer des crises systémiques. Nous sommes à des années lumière de la main invisible qui garantit les grands équilibres à la fois micro et macro économiques.
Les deux philosophes se rejoignent sur le caractère toxique du capitalisme financier,
Ainsi pour Gauchet « Nous avons aujourd’hui, avec la gangrène de la finance, un capitalisme de prédation, voué à la crise permanente du fait de sa perpétuelle fuite en avant, portée par des instruments de plus en plus déconnectés du réel et incontrôlables », difficile de faire un réquisitoire plus incisif.
De même, il semble y avoir consensus pour considérer qu’il y a une césure entre Lénine, et Marx. Le second n’aurait pas été favorable à une dictature de l’Etat, fut-elle imposée au nom du socialisme.
Cette appréciation est pour le moins discutable, Marx n’acceptait pas la contradiction et la biodiversité dans les différentes sensibilités de l’idée du socialisme, il avait une haute idée du caractère scientifique de ses conclusions. Le léninisme porte bien les gênes de Marx.
En revanche, la ligne de partage entre les deux philosophes passe par les moyens de réformer les défauts du capitalisme. Gauchet est persuadé qu’il peut être réformé dans un cadre démocratique conventionnel, ce qui n’est évidemment pas le point de vue de Badiou qui considère que les détenteurs du pouvoir ne renonceront pas à leurs intérêts.
Sans adhérer aux conceptions de Badiou notamment à l’égard du maoisme, on ne peut que relever que les espérances de Gauchet pêchent par optimisme.
Les plus grands progrès sociaux du XXéme siécle dans les pays industrialisés les plus modernes ont été rendus possibles, non par philanthropie ou sagesse des détenteurs du pouvoir financier mais parce qu’il y a eu une conjonction exceptionnelle de facteurs favorables en 1945 et dans les années suivantes pour mettre en place les fondations de l’Etat providence. Certes on peut espérer que les grands défis à affronter aujourd’hui puissent provoquer un électro choc dans les consciences collectives et individuelles, mais le chemin semble encore très escarpé, c’est un euphémisme.
Un dialogue de grande qualité entre deux grands esprits, qui met le doigt là où cela fait mal mais qui ne répond pas à la question « que faire ?»
Je remercie Babelio, dans le cadre de Masse Critique, et les éditions Philosophie magazine de m’avoir permis de lire et de faire la critique de Que faire, Dialogue sur le communisme, le capitalisme et l’avenir de la démocratie, d’Alain Badiou et de Marcel Gauchet.
« Que Faire », cette question renvoie à un opuscule écrit par Lénine en 1902 dans lequel, il évoque déjà l’idée d’un parti révolutionnaire d’avant-garde, mais où il demande aussi aux intellectuels de fournir une aide, une analyse face à la domination de la politique économique.
Martin Duru et Martin Legros, journalistes à Philosophie Magazine, dans un hors série intitulé « les philosophes et le communisme », ont jugé pertinent de faire se rencontrer deux philosophes que tout semble opposer, Alain Badiou philosophe partisan du retour de l’idée communiste, et Marcel Gauchet, penseur de la démocratie libérale. Leur premier entretien, positif, a été prolongé deux fois, et au final, a donné naissance à cet ouvrage. Les deux journalistes ont fait appel à Alain Badiou et à Marcel Gauchet pour tenter de répondre à certaines des interrogations de Lénine, transposées à notre époque : « La démocratie libérale n’est-elle pas ébranlée dans ses fondements même par l’emprise du capitalisme et celui-ci n’est –il pas miné de l’intérieur par le poids de la finance ? La politique n’a-t-elle pas perdu tout pouvoir d’orienter l’Histoire ? L’hypothèse communiste, débarassée de ses oripeaux totalitaires, permet-elle d’offrir une solution crédible ? Ou la démocratie est-elle capable de se réinventer pour répondre aux défis de la mondialisation ?
Il s’agit d’un débat de grande qualité, brillamment arbitré. Les deux philosophes s’affrontent à la manière de deux joueurs d’échecs, chacun appréciant l’érudition de son partenaire, tout en réfutant son analyse. J’ai apprécié ce débat, et mesuré la qualité des opposants, tout en le trouvant extrêment abstrait.
Je pensais trouver dans cet ouvrage un éclairage d’intellectuels sur notre époque, ses enjeux, ses difficultés. Le débat a porté sur tout autre chose. Les deux philosophes ont semblé heureux de s’affronter, pour l'affrontement en lui-même. Et pourtant, de manière étonnante, la conclusion du débat porte sur la complémentarité de leurs analyses, et sur le pouvoir qu’il faut redonner à la politique « Même les adversaires les plus acharnés peuvent se retrouver s’ils savent identifier ceci : qu’au final, chacun de leur côté et avec leurs armes propres, ils combattent le même ennemi ».
« Que faire » est un ouvrage de grande qualité ; il s’adresse à un lecteur érudit, historien, maîtrisant parfaitement les concepts, et à même d’apprécier un débat entre spécialistes. J’avoue que ce n’était pas mon cas. Pourtant je ne regrette pas d’avoir lu ce livre qui m’a laissée souvent perplexe, déconcertée.
C'est surtout le prologue rédigé par Martin Duru et Martin Legros « L’avenir d’une alternative » qui m’a intéressée et m’a paru plus accessible.
Que faire ? la question reste ouverte, et l’aide des intellectuels plus que jamais nécessaire.
« Que Faire », cette question renvoie à un opuscule écrit par Lénine en 1902 dans lequel, il évoque déjà l’idée d’un parti révolutionnaire d’avant-garde, mais où il demande aussi aux intellectuels de fournir une aide, une analyse face à la domination de la politique économique.
Martin Duru et Martin Legros, journalistes à Philosophie Magazine, dans un hors série intitulé « les philosophes et le communisme », ont jugé pertinent de faire se rencontrer deux philosophes que tout semble opposer, Alain Badiou philosophe partisan du retour de l’idée communiste, et Marcel Gauchet, penseur de la démocratie libérale. Leur premier entretien, positif, a été prolongé deux fois, et au final, a donné naissance à cet ouvrage. Les deux journalistes ont fait appel à Alain Badiou et à Marcel Gauchet pour tenter de répondre à certaines des interrogations de Lénine, transposées à notre époque : « La démocratie libérale n’est-elle pas ébranlée dans ses fondements même par l’emprise du capitalisme et celui-ci n’est –il pas miné de l’intérieur par le poids de la finance ? La politique n’a-t-elle pas perdu tout pouvoir d’orienter l’Histoire ? L’hypothèse communiste, débarassée de ses oripeaux totalitaires, permet-elle d’offrir une solution crédible ? Ou la démocratie est-elle capable de se réinventer pour répondre aux défis de la mondialisation ?
Il s’agit d’un débat de grande qualité, brillamment arbitré. Les deux philosophes s’affrontent à la manière de deux joueurs d’échecs, chacun appréciant l’érudition de son partenaire, tout en réfutant son analyse. J’ai apprécié ce débat, et mesuré la qualité des opposants, tout en le trouvant extrêment abstrait.
Je pensais trouver dans cet ouvrage un éclairage d’intellectuels sur notre époque, ses enjeux, ses difficultés. Le débat a porté sur tout autre chose. Les deux philosophes ont semblé heureux de s’affronter, pour l'affrontement en lui-même. Et pourtant, de manière étonnante, la conclusion du débat porte sur la complémentarité de leurs analyses, et sur le pouvoir qu’il faut redonner à la politique « Même les adversaires les plus acharnés peuvent se retrouver s’ils savent identifier ceci : qu’au final, chacun de leur côté et avec leurs armes propres, ils combattent le même ennemi ».
« Que faire » est un ouvrage de grande qualité ; il s’adresse à un lecteur érudit, historien, maîtrisant parfaitement les concepts, et à même d’apprécier un débat entre spécialistes. J’avoue que ce n’était pas mon cas. Pourtant je ne regrette pas d’avoir lu ce livre qui m’a laissée souvent perplexe, déconcertée.
C'est surtout le prologue rédigé par Martin Duru et Martin Legros « L’avenir d’une alternative » qui m’a intéressée et m’a paru plus accessible.
Que faire ? la question reste ouverte, et l’aide des intellectuels plus que jamais nécessaire.
Un débat vif entre deux penseurs sur l'actualité.
Alain Badiou, qui, inspiré par Marx, Mao et Sartre, partage avec Slavoj Žižek et Antonio Negri des critiques sans concession sur le capitalisme. Marcel Gauchet, réformiste humaniste, espère que la démocratie permettra de limiter les excès du capitalisme.
‘Que faire?', un titre qui s'inspire de Lénine en 1902 et son appel à la Révolution à venir en 1917.
Mais l'échec de l'Union soviétique, entité plus étatiste que communiste, puis les revirements de la Révolution Chinoise, disqualifient-ils ‘l'hypothèse communiste' à jamais ? Des positions opposées ici, mais un débat de haut niveau à découvrir.
Vient ensuite une conclusion surprenante et positive autour d'une alliance tactique qui proposerait ‘la démocratie sociale sinon…. l'hypothèse communiste….'
Le Grand capital doit en trembler.
On évoque les totalitarismes sans un mot sur Hannah Arendt, peu ou rien sur l'Union européenne et son vaste espace de droit, sur les grands enjeux modernes tels l'environnement, le développement durable, le poudrier du Moyen- Orient ou l'avenir de l'Afrique.
Le spectre qui ‘hantait l'Europe' en 1848, peut-il et doit-il renaître à notre époque et sous quel avatar? Au lecteur de juger, seule l'histoire nous le dira.
Alain Badiou, qui, inspiré par Marx, Mao et Sartre, partage avec Slavoj Žižek et Antonio Negri des critiques sans concession sur le capitalisme. Marcel Gauchet, réformiste humaniste, espère que la démocratie permettra de limiter les excès du capitalisme.
‘Que faire?', un titre qui s'inspire de Lénine en 1902 et son appel à la Révolution à venir en 1917.
Mais l'échec de l'Union soviétique, entité plus étatiste que communiste, puis les revirements de la Révolution Chinoise, disqualifient-ils ‘l'hypothèse communiste' à jamais ? Des positions opposées ici, mais un débat de haut niveau à découvrir.
Vient ensuite une conclusion surprenante et positive autour d'une alliance tactique qui proposerait ‘la démocratie sociale sinon…. l'hypothèse communiste….'
Le Grand capital doit en trembler.
On évoque les totalitarismes sans un mot sur Hannah Arendt, peu ou rien sur l'Union européenne et son vaste espace de droit, sur les grands enjeux modernes tels l'environnement, le développement durable, le poudrier du Moyen- Orient ou l'avenir de l'Afrique.
Le spectre qui ‘hantait l'Europe' en 1848, peut-il et doit-il renaître à notre époque et sous quel avatar? Au lecteur de juger, seule l'histoire nous le dira.
Alain Badiou répondant à une interview de Nicloas Truong entreprend la tâche philosophique d’expliquer et de défendre l’amour. L’amour est sans “assurance” ; il est la séparation de l’individu, la rencontre de deux êtres différents qui après s’être déclarés leur flamme vont construire avec obstination et dans la durée une vérité qui sera leur.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Les plus belles tétralogies
Eric75
146 livres

Tracts Gallimard
jaiuneheurealire
64 livres

Prix du livre Tangente
py314159
12 livres
Auteurs proches de Alain Badiou
Quiz
Voir plus
Quel est le bon titre des livres d’Emile Zola (2) ?
... ?
La catastrophe
La débâcle
Le naufrage
Le désastre
10 questions
273 lecteurs ont répondu
Thème :
Émile ZolaCréer un quiz sur cet auteur273 lecteurs ont répondu