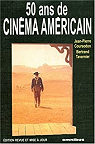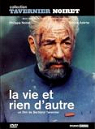Nationalité : France
Né(e) à : Lyon , le 25/04/1941
Mort(e) à : Sainte-Maxime , le 25/03/2021
Ajouter des informations
Né(e) à : Lyon , le 25/04/1941
Mort(e) à : Sainte-Maxime , le 25/03/2021
Biographie :
Bertrand Tavernier est un réalisateur, scénariste, producteur français et président de l'Institut Lumière
Fils de l'écrivain et résistant René Tavernier, il découvre le cinéma lors d'un séjour en sanatorium. Monté à Paris après-guerre, il y a pour camarade de lycée Volker Schlöndorff, qui lui fait connaître la Cinémathèque de la rue d'ULM.
Il a fait ses débuts dans le cinéma comme assistant de Jean-Pierre Melville (Léon Morin, prêtre), expérience qu'il évoque dans le documentaire Sous le nom de Melville réalisé par Olivier Bohler.
C'est seulement en 1973 qu'il tourne, dans le Lyon de son enfance, son premier long-métrage, L' Horloger de Saint-Paul adapté de l'œuvre de Simenon. Ce polar aux accents sociaux, récompensé par le Prix Louis-Delluc et l'Ours d'argent à Berlin, marque aussi sa rencontre avec Philippe Noiret, qui deviendra son acteur-fétiche.
Comme critique cinématographique, il collabore dans les années 1960 à plusieurs revues : Les Cahiers du cinéma, Cinéma, Positif, Présence du cinéma, etc.
En 1970, il publie avec Jean-Pierre Coursodon 30 ans de cinéma américain (éd. Omnibus). Cet ouvrage, actualisé et réédité en 1995 sous le titre 50 ans de cinéma américain, est considéré par beaucoup de cinéphiles comme la bible française sur ce sujet.
Bertrand Tavernier est le père de Nils Tavernier, également réalisateur, mais aussi comédien, et de la romancière Tiffany Tavernier.
Il signe avec son fils un documentaire, Histoires de vies brisées : les double peine à Lyon (2001), puis en 2004, avec sa fille cette fois, il coécrit Holy Lola (2004), une exploration des conditions d'adoption au Cambodge avec Jacques Gamblin et Isabelle Carré.
C'est dans une Louisiane dévastée par l'ouragan Katrina qu'il part ensuite tourner Dans la brume électrique (2009), adaptation d'un polar de James Lee Burke avec Tommy Lee Jones. De retour de son escale américaine, il présente à la Compétition officielle de Cannes, sa Princesse de Montpensier, une plongée au cœur d'intrigues faites d'amour et de pouvoir dans la France du XVIe siècle, portée entre autres par Mélanie Thierry, Lambert Wilson et Gaspard Ulliel.
+ Voir plusBertrand Tavernier est un réalisateur, scénariste, producteur français et président de l'Institut Lumière
Fils de l'écrivain et résistant René Tavernier, il découvre le cinéma lors d'un séjour en sanatorium. Monté à Paris après-guerre, il y a pour camarade de lycée Volker Schlöndorff, qui lui fait connaître la Cinémathèque de la rue d'ULM.
Il a fait ses débuts dans le cinéma comme assistant de Jean-Pierre Melville (Léon Morin, prêtre), expérience qu'il évoque dans le documentaire Sous le nom de Melville réalisé par Olivier Bohler.
C'est seulement en 1973 qu'il tourne, dans le Lyon de son enfance, son premier long-métrage, L' Horloger de Saint-Paul adapté de l'œuvre de Simenon. Ce polar aux accents sociaux, récompensé par le Prix Louis-Delluc et l'Ours d'argent à Berlin, marque aussi sa rencontre avec Philippe Noiret, qui deviendra son acteur-fétiche.
Comme critique cinématographique, il collabore dans les années 1960 à plusieurs revues : Les Cahiers du cinéma, Cinéma, Positif, Présence du cinéma, etc.
En 1970, il publie avec Jean-Pierre Coursodon 30 ans de cinéma américain (éd. Omnibus). Cet ouvrage, actualisé et réédité en 1995 sous le titre 50 ans de cinéma américain, est considéré par beaucoup de cinéphiles comme la bible française sur ce sujet.
Bertrand Tavernier est le père de Nils Tavernier, également réalisateur, mais aussi comédien, et de la romancière Tiffany Tavernier.
Il signe avec son fils un documentaire, Histoires de vies brisées : les double peine à Lyon (2001), puis en 2004, avec sa fille cette fois, il coécrit Holy Lola (2004), une exploration des conditions d'adoption au Cambodge avec Jacques Gamblin et Isabelle Carré.
C'est dans une Louisiane dévastée par l'ouragan Katrina qu'il part ensuite tourner Dans la brume électrique (2009), adaptation d'un polar de James Lee Burke avec Tommy Lee Jones. De retour de son escale américaine, il présente à la Compétition officielle de Cannes, sa Princesse de Montpensier, une plongée au cœur d'intrigues faites d'amour et de pouvoir dans la France du XVIe siècle, portée entre autres par Mélanie Thierry, Lambert Wilson et Gaspard Ulliel.
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (41)
Voir plusAjouter une vidéo
Citations et extraits (20)
Voir plus
Ajouter une citation
Entre 1893 et 1898, le sergent Joseph Bouvier tua 12 enfants. Durant la même période, plus de 2 500 enfants de moins de 15 ans périrent dans les mines et les usines à soie, assassinés !
[Carton final du film Le juge et l'assassin.]
[Carton final du film Le juge et l'assassin.]
La chose la plus plaisante qui puisse arriver à un metteur en scène, c'est quand un homme comme Brando tire de la scène plus que ce que l'on croyait y avoir mis. On se dit : "Bon Dieu, je ne savais pas qu'il y avait cela dans cette scène, et cet homme l'a pourtant trouvé".
Voilà ce qu'un acteur formidable peut faire pour un metteur en scène.
Elia Kazan
Voilà ce qu'un acteur formidable peut faire pour un metteur en scène.
Elia Kazan
Vous connaissez l'histoire du metteur en scène qui demande à l'intervieweur :
"Avez vous vu mon dernier film?"
Et l'autre répond : "Je l'espère bien..."!
"Avez vous vu mon dernier film?"
Et l'autre répond : "Je l'espère bien..."!
L'on fit se rencontrer Robert Mitchum et Philippe Noiret.
Ce furent des moments inoubliables, comme celui où Noiret montra son alliance à l'intérieur de laquelle Monique Chaumette avait fait graver qu'elle l'épousait faute d'avoir pu rencontrer Robert Mitchum..
Ce dernier en a ri pendant des années.
Ce furent des moments inoubliables, comme celui où Noiret montra son alliance à l'intérieur de laquelle Monique Chaumette avait fait graver qu'elle l'épousait faute d'avoir pu rencontrer Robert Mitchum..
Ce dernier en a ri pendant des années.
Quand je tourne, je ne me sens pas du tout cinéphile. Je vais très peu au cinéma ou alors, je ne vois que des films épouvantables pour reprendre un peu confiance !
Bertrand Tavernier
Bertrand Tavernier
Je vous offre sans trop d’illusion cette royauté dérisoire.
Lettre à Irène
Lettre à Irène
otre film Le Juge et l’Assassin est dédié à Abraham Polonsky...
J’ai eu envie de le saluer car j’avais adoré travailler avec lui quand j’étais attaché de presse. J’avais été impressionné par Tell Them Willie Boy Is Here (Willie Boy, 1969) et la manière dont il captait de manière synthétique l’essence d’une situation historique, politique et sociale au travers d’une œuvre qui était d’abord un film de poursuite et d’aventures. Voilà une qualité propre au cinéma américain mais qu’il aiguisait, allant sans pathos au cœur des émotions.
Même si ce goût pour l’Histoire, on le sent chez des gens comme Becker, Ophuls, Grémillon ou le Renoir du Crime de Monsieur Lange (1936) qui brasse des tas de personnages, j’ai été marqué par ce cinéma qui respire, qui évoque les pionniers, les classes populaires. J’admire chez Ford qu’on se souvienne de la moindre silhouette dans un plan large ou du forgeron de She Wore a Yellow Ribbon (La Charge héroïque, 1949) : un personnage qu’on découvre fugitivement et qu’on retrouve ensuite au bar en sachant parfaitement qui il est. Quand j’ai commencé à réaliser, j’avais envie de conjuguer ce que j’aimais de ce grand cinéma, cette emprise sur le monde, sur le décor, l’Ouest de Ford et de Daves mais aussi les rues de Losey ou Polonsky avec ce qui venait du cinéma français des années soixante, caméra légère, pellicule ultrasensible, décors naturels, des plans filmés à l’épaule, son direct.
J’ai eu envie de le saluer car j’avais adoré travailler avec lui quand j’étais attaché de presse. J’avais été impressionné par Tell Them Willie Boy Is Here (Willie Boy, 1969) et la manière dont il captait de manière synthétique l’essence d’une situation historique, politique et sociale au travers d’une œuvre qui était d’abord un film de poursuite et d’aventures. Voilà une qualité propre au cinéma américain mais qu’il aiguisait, allant sans pathos au cœur des émotions.
Même si ce goût pour l’Histoire, on le sent chez des gens comme Becker, Ophuls, Grémillon ou le Renoir du Crime de Monsieur Lange (1936) qui brasse des tas de personnages, j’ai été marqué par ce cinéma qui respire, qui évoque les pionniers, les classes populaires. J’admire chez Ford qu’on se souvienne de la moindre silhouette dans un plan large ou du forgeron de She Wore a Yellow Ribbon (La Charge héroïque, 1949) : un personnage qu’on découvre fugitivement et qu’on retrouve ensuite au bar en sachant parfaitement qui il est. Quand j’ai commencé à réaliser, j’avais envie de conjuguer ce que j’aimais de ce grand cinéma, cette emprise sur le monde, sur le décor, l’Ouest de Ford et de Daves mais aussi les rues de Losey ou Polonsky avec ce qui venait du cinéma français des années soixante, caméra légère, pellicule ultrasensible, décors naturels, des plans filmés à l’épaule, son direct.
Je préfère parler de ce que j'aime, pas de ce que je n'aime pas. Je parle surtout des films que je vois et que d'autres n'ont pas vus. D'avoir travaillé sur le cinéma américain et récemment sur le cinéma français me met dans un état de grande admiration vis-à-vis de ceux qui font des films. Ça me donne envie de continuer, de me tourner vers d'autres pays, d'aller chercher cette grande respiration qu'est la connaissance de l'Histoire.
La cinéphilie à la française n’a jamais été avare de généralités sur tel ou tel cinéaste…
On veut trop trouver de la cohérence tout le temps, on aime parfois la déceler dans des films qui se suivent alors que, parfois, un cinéaste peut revenir un jour à quelque chose présent au début de son oeuvre. Godard avait mis le doigt là-dessus quand il disait que découvrir Man of the West (L’Homme de l’Ouest, 1958) l’amenait à revoir The Tin Star (Du sang dans le désert, 1957) et des films antérieurs sous-estimés d’Anthony Mann. C’est un exercice auquel on devrait se livrer régulièrement. Cela demande une certaine humilité car il n’est pas facile d’avouer ses erreurs. Moi, je suis passé à côté de pas mal de films, de pas mal de réalisateurs…
… comme qui ?
William Wyler, par exemple. Il est l’un des grands absents de ce livre parce que je n’avais pas vu certains de ses films. Je l’ai rencontré deux fois mais je ne connaissais pas assez son travail. Il n’était pas à la mode, il n’était pas montré à la Cinémathèque. Alors ses films des années trente furent une grande découverte, hélas trop tardive.
On veut trop trouver de la cohérence tout le temps, on aime parfois la déceler dans des films qui se suivent alors que, parfois, un cinéaste peut revenir un jour à quelque chose présent au début de son oeuvre. Godard avait mis le doigt là-dessus quand il disait que découvrir Man of the West (L’Homme de l’Ouest, 1958) l’amenait à revoir The Tin Star (Du sang dans le désert, 1957) et des films antérieurs sous-estimés d’Anthony Mann. C’est un exercice auquel on devrait se livrer régulièrement. Cela demande une certaine humilité car il n’est pas facile d’avouer ses erreurs. Moi, je suis passé à côté de pas mal de films, de pas mal de réalisateurs…
… comme qui ?
William Wyler, par exemple. Il est l’un des grands absents de ce livre parce que je n’avais pas vu certains de ses films. Je l’ai rencontré deux fois mais je ne connaissais pas assez son travail. Il n’était pas à la mode, il n’était pas montré à la Cinémathèque. Alors ses films des années trente furent une grande découverte, hélas trop tardive.
Je préfère parler de ce que j'aime, pas de ce que je n'aime pas. Je parle surtout des films que je vois et que d'autres n'ont pas vus.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
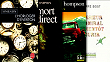
Lire avec Bertrand Tavernier
Pecosa
23 livres
Auteurs proches de Bertrand Tavernier
Lecteurs de Bertrand Tavernier (183)Voir plus
Quiz
Voir plus
La ferme des animaux ( G. Orwell )
Comment s’appele Le plus vieux cochon qui apparaît au début du livre ?
Brille babil
Ancien cochon
Sage l’ancien
8 questions
470 lecteurs ont répondu
Thème : La ferme des animaux de
George OrwellCréer un quiz sur cet auteur470 lecteurs ont répondu